
Jazz Stage (clubs, concerts, festivals)
Jazz Hot Library (les livres)
Jazz Records (les disques)
Jazz Movies (les films)
Jazz Shows (les expositions) |
|
JAZZ STAGES
• Clubs, Concerts, Festivals •
La Petite Halle, Paris • Uno Jazz & Blues, Sanremo • Jazznary • Sunside, Paris • Sunside, Paris • Les Deux Magots, Paris • Sunside, Paris • Caveau de La Huchette, Paris • Caveau de La Huchette, Paris • Sunside, Paris • Marciac • Festival de Big Band de Pertuis • Caveau de La Huchette, Paris • Jazz in Langourla • Ystad Sweden Jazz Festival • Cotton Club, Hambourg • Jazz à Toulon • Marseille Jazz des 5 Continents • Jazz à L'Amirauté, Pléneuf-Val-André • Jazz à Juan • Festival de Jazz Roger Mennillo, Saint-Cannat • JazzAscona • Festival International de Jazz d'Antibes/Juan-les-Pins, 1960-1962 • Sunset, Paris • Le Marcounet, Paris • Marciac, L'Astrada • Bruxelles
|
|
© Jazz Hot 2019
|

Kahil El'Zabar & Ethnic Heritage Ensemble,
La Petite Halle, 8 novembre 2019 © Mathieu Perez
La Petite Halle, Paris
Kahil El'Zabar & Ethnic Heritage Ensemble,
8 novembre 2019
Les
passages du percussionniste et batteur de Chicago Kahil El’Zabar sont rares à
Paris. On se souvient de l’inoubliable concert avec son Ritual Trio et le
vocaliste Dwight Trible, en première partie de Randy Weston en 2014. Il était aussi venu au début de
cette année 2019, toujours dans le cadre de Banlieues Bleues.
Le 8
novembre, c’est à la Petite Halle qu’il se produisait, à La Villette, à
l’occasion de la sortie de l’album Be
Known: Ancient/Future/Music for Your Mind, Body and Soul (Spiritmuse
Records, 2019). Le nouvel opus de son Ethnic Heritage Ensemble, un trio composé
de Corey Wilkes (tp, perc) et Alex Harding (bar). Cette
formation se situe dans le prolongement du travail de l’Association for the
Advancement of Creative Musicians (AACM). Avec cette liberté, cette
connaissance approfondie de l’histoire du jazz et de la culture afro-américaine,
cette conscience politique, cette recherche des racines, ce dialogue avec la
musique traditionnelle africaine.On peut lire les interviews du percussionniste
publiées dans Jazz Hot (n°354 etn°659) dont la dernière est en ligne (Jazz Hot 2019). Il y retrace notamment l’histoire de cette
formation fondée en 1973 à son retour du Ghana. Il explique aussi
l’importance
de placer un percussionniste au milieu de deux soufflants pour explorer
tous
les aspects du rythme. En voyant Kahil El’Zabar entre Corey Wilkes et
Alex Harding, on comprend. Percussions obsédantes, chants, atmosphère
méditative,
cosmique, solistes magnifiques. Et
une interprétation, ce soir-là, du répertoire coltranien («Naima» au kalimba) d’une beauté à couper le souffle. Jouer du
jazz, nous disait Kahil El’Zabar, est l’expérience la plus profonde de sa vie.
En écouter aussi.
Mathieu Perez
Texte et photo
© Jazz Hot 2019
|
Sanremo, Italie
Uno Jazz & Blues, 31 octobre 2019
Le 31 octobre dernier, le festival Uno Jazz & Blues, situé à Sanremo (Liguerie), célébrait sa 10e édition en accueillant une légende vivante du jazz, Herbie Hancock.
Compte-rendu à lire dans la langue de Dante (pour une approche, un traducteur automatique est installé sur votre site).
Non
è facile approcciarsi ad una leggenda vivente come Herbie Hancock.
Sessant'anni di carriera in cui ha travalicato i generi, passando dal
jazz moderno alla musica elettronica, lo hanno trasformato in un
personaggio
che, spesso, oscura e supera il suo lato artistico. Era molta, dunque,
l'attesa da parte del pubblico che, giovedì 31
ottobre, ha gremito la sala del teatro Ariston di Sanremo per la
chiusura della
rassegna "UnoJazz", quest'anno spalmata in diversi periodi e locations.

Herbie Hancock, Sanremo, 31 octobre 2019 © Umberto Germinale
In
questo tour europeo Hancock si è avvalso della collaborazione dei fidi
Lionel Loueke alla chitarra e James Genus al basso elettrico aggiungendo
ad
essi le new entry Elena Pinderhughes al flauto e Justin Tyson alla
batteria. Nomi già noti nell'ambiente musicale votato all'electro-jazz
ed a
suggestioni etniche da incorporare nell'alveo della musica nera
tradizionale. Loueke rappresenta il chitarrista ideale per Hancock
grazie alle radici
africane (nato nel Benin e recentemente naturalizzato statunitense), al
fraseggio fortemente ritmico, all'uso dell'effettistica ed agli spazi
vocali
che si ritaglia all'interno delle esibizioni live. Tyson, batterista del
trio di Robert Glasper e del progetto "Now is now",
ed un James Genus, cui i tecnici del suono hanno applicato un volume
fastidiosamente alto, hanno supportato le evoluzioni solistiche del
gruppo
mostrando più i muscoli che il fioretto. La sorpresa più piacevole è
stata la personalità dimostrata da Elena
Pinderhughes. La giovane flautista. già apprezzata nei dischi di
Christian Scott, ha
sfruttato sapientemente gli spazi solistici riservatele dal leader
cesellando
alcuni dei soli più riusciti della serata.

Herbie Hancock et ses musiciens, Sanremo, 31 octobre 2019 © Umberto GerminaleChe
dire di Herbie? Si è diviso tra pianoforte, varie tastiere, vocoder e
keytar con la
solita classe senza prevaricare i colleghi e, anzi, lasciando loro
parecchio
spazio prendendo esempio, anche in questo, dal suo grande mentore Miles
Davis. E, in fondo, i percorsi dei due musicisti sono assimilabili nel
loro
passaggio da una musica impegnata a progetti maggiormente fruibili dal
grande
pubblico. Dopo avere eseguito alcuni brani nuovi Hancock ha regalato ai
fans le
composizioni che attendevano con ansia. Quindi "Chameleon", "Actual
proof" e l'immancabile "Cantaloupe island"
hanno riportato in auge gli anni 70 del progetto "Headhunters" col suo
concentrato di suoni elettrici e funk a piene mani. Il genio di Hancock,
dal rivoluzionario secondo quintetto di Miles in
avanti, è fuori discussione ma la strada intrapresa negli ultimi decenni
parla
un linguaggio diverso da quello che molti appassionati, me compreso,
auspicherebbero.
Però, sulla soglia degli 80 anni, il pianista di Chicago ha energia da
vendere ed un notevole senso dello spettacolo. Oltre alla gratificazione per avere aperto le strade battute oggi dai
succitati Glasper e compagnia il buon Herbie si gode le standing ovations
tributategli dal suo fedele pubblico in giro per il mondo. Per chi cerca le nuove vie del pianismo jazz contemporaneo è giusto
rivolgersi altrove.
Adriano Ghirardo
Photos: Umberto Germinale
© Jazz Hot 2019
|
Sanary-sur-Mer, Var
Jazznary, 9-10 novembre 2019
Sanary-sur-Mer
est l’un des plus jolis et sympathiques ports de la côte varoise, encore
peu
encombré de touristes hors les mois d’été. Un magnifique Casino y est
apparu il
y a un an et demi. Immense bâtisse à l’architecture d’un modernisme de
bon aloi en pleine campagne, il est de plus doté d’une grande salle de
spectacle pourvue
d’une large scène. Après la disparition de pas mal de festivals de jazz
dans la
région, dont le célèbre et regretté Jazz au Fort Napoléon à La
Seyne-sur-Mer,
il est réconfortant de voir que le Casino de Sanary a fait émerger un
nouveau
rendez-vous pour les amateurs de la région: «Jazznary». Le
bébé a été confié à Victor Palombo et son association «Infotournée»
avec une programmation originale.
Première soirée avec le quartet «We are 4» qui réunit depuis
plus d’un an Laurent de Wilde (kb), Fifi Chayeb (eb), André Ceccarelli (dm) et
Sly Johnson (voc). Ce dernier est un cas inhabituel. Né Silvère Johnson, à
Montrouge (92), c'est un sacré personnage, extraverti au possible. Il a débuté
sa carrière comme rappeur (sous le nom de «Sly the Mic Buddah») et,
après plusieurs collaborations avec différents groupes, chanteurs et
chanteuses, s’est orienté vers un style soul-jazz, chantant sur une tessiture
qui va de la basse au ténor léger. C’est un acrobate verbal (cela vient
certainement de sa période rap), qui sait swinguer et est capable de reproduire
des sons de percussions (cymbale, peaux…) en ne se servant que de sa bouche et
du micro, cf. le contest en duo
avec le batteur André Ceccarelli, dont il est sorti vainqueur. A l’image de
Didier Lockwood et ses mouettes, il joue son propre concerto, assurant toutes
les parties, tant rythmiques que mélodiques, seulement avec la bouche, le micro
et sa machine. Il fut réellement soul dans un «Georgia»
d’anthologie pris à fond le blues avec une réelle émotion et un grand Laurent
de Wilde au Fender. Un bémol tout de même, la propension de Sly Johnson à faire
le clown, avec des gamineries et des gesticulations qui alourdissent le concert
et n’apportent rien, même si une part du public paraît y être sensible. S’il
décidait de se concentrer davantage sur la musique, il pourrait devenir l’un
des meilleurs chanteurs jazz d’aujourd’hui (d’autant qu’ils sont peu nombreux,
contrairement aux chanteuses), capable de damer le pion à Gregory Porter dont
il est parfois proche.

We Are 4, Sanary, 9 novembre 2019 © Serge Baudot
Quant à André Ceccarelli, il rayonne derrière sa batterie,
quelques fois se rapprochant de Billy Cobham, très à l’écoute du chanteur, manifestement
heureux dans ce contexte. Fifi Chayeb est un digne descendant de Stanley Clarke,
assurant parfaitement le soubassement terrien du groupe, et auteur d’un solo
slap du pouce de grande volée. Laurent de Wilde est le garant jazz: le
Fender lui va comme un gant; il sait en tirer la substantifique moelle,
avec ses deux mains qui se courent après ou qui swinguent en contrepoints.
Un très bon concert donc donné devant une salle pleine et un
public très réceptif et enthousiaste.
Deuxième soirée avec le chanteur argentin Jairo, de son vrai nom Mario Rubén Marito González
Pierotti. On l’a connu dans les années 1970 et 1980 comme chanteur de variétés,
période à laquelle il rencontra un succès certain (notamment avec le tube
mondial «Les Jardins du ciel»), se produisant à maintes reprises à
L’Olympia. Ce n’est donc pas a priori un chanteur de jazz, mais il s’est trouvé
fort bien entouré par ses deux compatriotes, Minino Garay (dm, à la tête de plus
de 250 albums) et Carlos El Tero Buschini (b) ainsi que par Baptiste Trotignon (b),
lequel aime bien sortir des rails du jazz, en écrivant par exemple un concerto,Different Spaces, créé en 2012, ou en
se frottant à la chanson comme avec ce groupe. Certes, l’on savait d’avance qu’on
aurait affaire à un concert de chansons plutôt que de jazz mais dans la tradition
de la grande chanson française: Brassens, Brel, Ferré, Bécaud, Aznavour,
Piaf... Bref des gens qui chantaient vraiment. Il en est ainsi de Jairo: une voix puissante
et chaude, bien timbrée, avec parfois un petit côté Aznavour, mais en plus
puissant et avec une plus grande tessiture. Il tient la note jusqu’au bout, avec
un feeling à la Ferré. Une diction parfaite, chose qui s’oublie de plus en plus
chez la plupart des chanteurs du monde entier. Comme on dit au cinéma, il
prend la lumière. Tenue et présentation sobres. Il ne bouge pas; peu de gestes,
juste un peu les mains. Ça repose de tous les agités d’aujourd’hui. De la
musique avant toute chose. Il ainsi interprété de grandes chansons sud-américaines
en espagnol. Dont une d’Atahualpa Yupanqui en hommage à son amie Marie Laforêt,
qui avait appris l’espagnol avec l’accent argentin pour approfondir l’œuvre d’Atahualpa, nous dit-il.
En français, nombre de chansons immortelles: «Le
Métèque», «Et maintenant», «La foule», «Elisa»...
et avec des moments d’émotion partagée comme sur «Avec le temps»
suivie de «Ne me quitte pas», réellement bouleversante, arrangées
avec finesse. Au milieu du concert, Jairo prend sa guitare et nous raconte,
comme un secret, sa venue en France, son amour de notre pays et de sa langue.
Puis, il fait venir son fils, le chanteur Joao Gonzales, et partage une chanson
en français pour le fils, en espagnol pour le père.

«Jazziro», Sanary, 10 novembre 2019 © Serge Baudot
Et le jazz dans tout ça? Il y en eu tout de même, dans
les arrangements, les longs solos. On peut dire que la majorité des chansons
furent jazzifiées de la meilleure manière. Minino Garay est un sacré
polyrythmicien, swingue à fond, même avec son cajon, et chauffe la machine
sur les rythmes latinos. Le contrebassiste assure parfaitement la pompe et les
lignes de basse, discret et efficace. Baptiste Trotignon se régale visiblement
(et il me l’a avoué!); ses solos sont des plats de rois. Il
interpréta en duo avec le cajon ce qu’on peut appeler un concerto sur un mode
espagnol: fulgurant et brillant à la Chick Corea.
Encore un excellent concert, fortement apprécié par une salle
comble.
Il faut aussi signaler la qualité technique de deux
prestations parfaitement sonorisées. Le jazz y était bien présent, malgré
tout, notamment par la conviction des deux pianistes qui nous ont chacun confié
leur bonheur à jouer cette musique. Bravo donc à Jazznary pour cette première
édition très réussie et à l’année prochaine!
Serge Baudot
Texte et photos
© Jazz Hot 2019
|

Ben Sidran et Rick Marguitza,
Sunside, 1er novembre 2019 © David Bouzaclou
Sunside, Paris
Ben Sidran Quartet, 1er novembre 2019
C’est une longue histoire d’amitié de plus de deux
décennies entre le Sunside et le pianiste-chanteur Ben Sidran qui revient, fidèlement, chaque mois de novembre. Il y a quelques
années, il avait, à travers son ouvrage de référence Talking Jazz, mis en lumière les conversations avec des musiciens
d’exception qu’il avait eues lors de ses émissions sur NPR, la radio publique
américaine. Un titre qui représente à merveille son approche du jazz entre le
chant et la parole à l’image d’un Mose Allison ou de ses contemporains Georgie Fame
et Van Morrison. Cette balade permanente au cœur d’un New York aux fortes
contradictions, où la politique se mêle à la poésie, reste la base des textes
débordant d’humour du leader. Pour son séjour de trois soirées sur la scène du
Sunside, le nombreux public attendait déjà à l’extérieur du club sous les yeux
d’un Ben Sidran qui est un peu chez lui du côté de la rue des Lombards. Aux
alentours de 22 h, le quartet débute sur un blues instrumental au swing
permanent laissant place à un jeu de piano sans fioriture, issu du bop le plus
orthodoxe. Cet univers singulier le met en position d’observateur privilégié à
la fois du petit monde du jazz mais aussi de la société qu’il décrit avec un
esprit critique débordant de détails savoureux au niveau du texte, comme sur
«Don’t Cry for no Hipster» ou «King of Harlem» en forme
d’hommage à Federico Garcia Lorca lorsque ce dernier écrivait son fameux
recueil de poèmes, Poeta en Nueva York,
alors qu’il résidait en tant qu’étudiant à l’université de Columbia en 1929. Le
leader installe d’ailleurs une sorte de connivence avec le public en évoquant
diverses anecdotes, le tout avec une spontanéité déconcertante. Le quartet
affiche une mise en place impeccable, soutenu par le fidèle Billy Peterson à la
contrebasse et son fils Léo Sidran à la batterie et aux contre-chants, aussi à
l’aise en ternaire que sur un groove funky tout en légèreté évoquant la
maîtrise d’Al Foster dans ces univers hybrides.
L’excellent Rick Margitza au ténor apporte une autre dimension à
la formation. Le saxophoniste originaire de Detroit et parisien depuis le début
des années 2000, s’illustre dans un registre post bop, avec une sonorité lisse
et chaleureuse doublée de quelques fulgurances coltraniennes lors de ses
interventions dans la lignée d’un Bob Berg. Ces trois superbes sets nous auront
démontrés que Ben Sidran reste un véritable trésor new-yorkais et représente ce
qui se fait de mieux dans cette Amérique en crise et repliée sur elle-même.
David Bouzaclou
Texte et photo
© Jazz Hot 2019
|
Sunside, Paris
Black Art Jazz Collective, 19 octobre 2019
Le 19 octobre, le Sunside accueillait un magnifique
all-stars in the tradition: le
Black Art Jazz Collective, cofondé par Jeremy Pelt (tp, flh) et Wayne Escoffery
(ts). Une rutilante machine produisant un hard bop sauvage, comptant également
les excellents James Burton III (tb), Xavier Davis (p) ainsi que, appartenant
aux nouveaux talents de la génération suivante, Corcoran Holt (b) et Mark
Whitfield Jr. (dm), lesquels remplacent respectivement deux membres originels
du collectif: Vicente Archer et Jonathan Blake. Ayant pour postulat de
réaffirmer l’ancrage culturel afro-américain du jazz, le Black Art Jazz
Collective, qui revendique une filiation directe avec les Jazz Messengers d’Art
Blakey, présentait le répertoire issu de son second album, Armor of Pride (HighNote).

de gauche à droite: Xavier Davis, Wayne Escoffery, Jeremy Pelt, James Burton III, Mark Whitfield Jr.,
Sunside, 19 octobre 2019 © Jérôme Partage
Un répertoire original, constitué des
compositions de chaque soliste, et dont le premier titre offert au public fut
«Miller of Time» (Jonathan Blake) en hommage au grand Mulgrew
Miller. Parmi ces bonnes compositions on retiendra également «Awuraa Amma»
(Jeremy Pelt) un hommage à sa fille de 3 ans, une évocation également de l’ascendance
africaine. Dans un Sunside bondé et surchauffé, la formation, emmenée par le
jeu incandescent de Jeremy Pelt et la puissance coltranienne de Wayne
Escoffery, a produit un jazz pur et dur, créatif et enraciné. Une
démonstration de vitalité artistique portée par des musiciens au discours
solide, en pleine possession de leurs moyens.
Jérôme Partage
Texte et photo
© Jazz Hot 2019
|
Raphaëlle Brochet Quartet, Les Deux Magots,
26 septembre 2019 © Jérôme Partage
Les Deux Magots, Paris
Raphaëlle Brochet Quartet, 26 septembre 2019
Institution
emblématique de Saint-Germain-des-Prés, les Deux
Magots programment du jazz chaque jeudi soir, en saison, depuis
l’automne 2017.
Une réjouissante initiative de Catherine Mathivat, la propriétaire de ce
café
historique qu’avait acquis son arrière-grand-père en 1914. Une adresse
prestigieuse qui reste donc une affaire familiale où le jazz se sent
chez
lui, en voisin quelque peu turbulent de la vie littéraire bien installée
en ces lieux. Le 26 septembre pour débuter la saison 2019-2020, la
swinguante
programmation du batteur Lionel Boccara, qui tenait aussi ce soir-là les
baguettes, proposait le quartet de Raphaëlle Brochet (voc) complété de
Sandro Zerafa (g) et de Sylvain Dubrez (b). Notons que la chanteuse,
installée à Bruxelles depuis 2015, travaille habituellement en duo avec
Philippe
Aerts (b). Dans une ambiance bon enfant, la formation a enchaîné les
standards
(«Caravan», Moonlight in Vermont», «Yesterdays»…),
interprétés avec finesse, avec de belles interventions de Sandro Zerafa.
Les bonnes
vibrations ont redoublé quand un sax ténor de l’assistance, que nous
n'avons pas identifié, s’est invité à faire le bœuf
sur «Smile» et a enchaîné quelques titres pour le plus grand plaisir
des présents.
Qui a dit qu’il n’y avait plus d’après à Saint-Germain-des-Prés?
Jérôme Partage
Texte et photo
© Jazz Hot 2019
|
Philippe Milanta, Sunside,
21 septembre 2019 © Mathieu Perez
Sunside, Paris
Philippe Milanta, 21 septembre 2019
Voir Philippe Milanta en concert, c’est toujours un
événement; le voir en solo, un vrai plaisir! Il se produisait le 21 septembre
au Sunside en début de soirée. Si les amateurs subjugués n’ont eu droit qu’à
un set de 1h20, ils ont voyagé loin, très loin dans les plus profondes contrées
du jazz que le pianiste explore depuis longtemps. Puisant en partie dans son
album Wash (Camille Productions, voir
notre chronique), il interpréta des compositions personnelles
(«Source»,
«Kryzoqr», «Twelve for a Change»), d’autres non enregistrées, et des
standards
signés Ellington-Strayhorn («Melancholia», «A Single Petal of a Rose»).
Vingt
thèmes très courts, pleins de finesse, très construits, à la beauté sans
cesse
renouvelée.
Musicien aux moyens hors norme, à la mesure de ses confrères américains
sur son instrument, Philippe Milanta est un véritable artiste de culture
qui a assimilé avec la même profondeur Ellington et Debussy.
Les concerts en solo des grands du piano jazz manquent à
Paris. La scène parisienne propose pourtant une belle tradition de pianistes.
Il serait temps que les clubs et les festivals honorent leurs talents.
Mathieu Perez
Texte et photo
© Jazz Hot 2019
|
De gauche à droite: Dany Doriz, Pascal Thouvenin,
Sax Gordon et Boris Blanchet,
Caveau de La Huchette, 17 septembre 2019
© Alexandra Green
Caveau de La Huchette, Paris
17 septembre 2019
Soirée de fin d’été vivifiante à La Huchette, avec le
maître de céans, Dany Doriz (vib), ses acolytes, Philippe Petit (org), Pascal
Thouvenin (s, arr), Boris Blanchet (s), Didier Dorise (dm) et ses invités
bœufeurs, Sax Gordon (s) et Jean-Philippe O’Neill (dm): de «Amen» à
«Somewhere Over the Rainbow», «Topsy», «Shiny Stockings», «On the Sunny Side of
the Street», «Sing, Sing, Sing», «Slipped Disc», «Hamp’s Boogie Woogie», un
vrai show de swing intense, d’introductions imaginatives, de citations, de
riffs des soufflants, de solos inspirés, de mimiques, d’échanges de sourires et
de regards, le tout très apprécié par un public d’amateurs
marquant l’after beat, des pieds, des mains, des épaules, de la tête, de
danseurs par couples, solos, affranchis ou débutants. La scène et la salle se
synchronisent d’un seul et même élan, celui de toujours re-venir dans cette
cave remuante, dans une même quête de chaleur, d’énergie, de sens, de
générosité musicale et de folie, à notre époque singulièrement carencée de
toute pêche… Sans doute, les «esprits» ont-ils trouvé ici la vie et l’harmonie,
dans ce lieu chargé de mémoire et scintillant de notes bleues.
Hélène Sportis et Alexandra Green
Texte et photos
© Jazz Hot 2019
|
Jazzobal Band: Jean-Yves Dubanton,
Jean-Yves Lacombe, Claude Tissendier,
Bruno Desmouillières, Caveau de La Huchette, 18 août 2019 © Jérôme Partage
Caveau de La Huchette, Paris
18 et 22 août 2019
Le
18 août, une toute jeune formation se rodait sur la scène
du Caveau: Jazzobal Band. Non pas que ce quartet soit composé de
débutants: si on ne présente plus Claude Tissendier (as, ancien de chez
Claude Bolling et titulaire d’une vingtaine de disques environ sous son
nom) ni
Jean-Yves Dubanton (g, voc, dont on retient les collaborations avec
Patrick
Saussois et les associations avec l’accordéoniste Jean-Claude Laudat),
rappelons que Jean-Yves Lacombe (b, voc) s’est fait connaître avec Le
Quatuor
(1980-2015) dont la spécialité était d’interpréter le répertoire
classique,
jazz et variétés sur un mode humoristique; quant à Bruno Desmouillières
(dm, voc) il appartient au groupe Les Bons Becs (créée en 1992) qui se
situe
également dans un registre parodique. On saisit dès lors
l’esprit qui anime Jazzobal Band: jouer un jazz festif et agrémenté de
paroles originales en français (sur des standards ou des compositions).
Les
tenues bigarrées de l’orchestre annoncent également la couleur! Pour
autant, les intentions farceuses n’amenuisent en rien ses qualités et
son swing, notamment un «Topsy» percutant introduit par Bruno
Desmouillières.
Les parties chantées se sont surtout réparties entre Jean-Yves Lacombe
–avec
des textes d’une poétique loufoquerie–et Jean-Yves Dubanton en crooner
cabotin
(«C’est si bon», «Route 66»).

Esaie Cid, Pablo Campos, Nicola Sabato,
Germain Cornet, Caveau de La Huchette,
22 août 2019 © Jérôme Partage
Le 22 août, Esaie Cid (as, Jazz Hot n°674) a réjoui le public et particulièrement les danseurs
de La Huchette, entouré d’une rythmique au swing incandescent: Pablo
Campos (p), Nicola Sabato (b) et Germain Cornet (dm). Un régal de la première à
la dernière note que l’on a pu apprécier tant collectivement que dans l’écoute
individuelle de chacun des solistes. Tout en sobriété et en intensité, l’altiste
donne chair aux mélodies et les habille d’un son velouté et de quelques
acrobaties parfois dans les aigus («Johnny Come Lately»).
Pianiste
très rythmique, dont le tempérament musical révèle les racines latines,
Pablo
Campos se distingue tant par la densité de ses solos («Four Brothers»)
que par son soutien dynamique en étroit partenariat avec l’excellent
Germain
Cornet; les deux musiciens (respectivement de 30 et 28 ans), toujours
complices, incarnant une enthousiasmante jeune garde parisienne.
On a pu profiter du drumming coloré du second tout particulièrement sur
un
«Strike up the Band» pris sur tempo rapide. Quant à Nicola Sabato, son
jeu d’une grande profondeur et d’une belle musicalité, renforcés par l’expérience,
en font la clé de voûte de la section rythmique. Un chaleureux plateau, sous le signe du meilleur jazz et de l’amitié,
auquel s’est joint, au deuxième set, «notre» Gérard Naulet (p) pour
un «Out of Nowhere» aux accents, nécessairement, afro-cubains puis au troisième set, Thomas Ibanez (ts) et Corinne Sahraoui (voc), venu(e)s faire le bœuf.
Jérôme Partage
Texte et photos
© Jazz Hot 2019
|

René Urtreger, Sunside,
16 août 2019 © Jérôme Partage
Sunside, Paris
René Urtreger Trio. 16 août 2019
«J’ai toujours le désir de jouer. Ce qui est triste
quand on est vieux, c’est de ne plus avoir de désir, pour rien. Moi, j’ai
toujours ce désir-là, et d’autres également.» Voilà ce que nous confiait,
l’œil pétillant, René Urtreger (85 ans) avant de monter sur la scène du Sunside
avec ses deux habituels complices, Yves Torchinsky (b) et Eric Dervieu (dm).
Un désir de jazz effectivement intact qui se traduit dans un jeu limpide,
sobre, fait de respirations et de franches attaques, et des notes qui swinguent
de la première à la dernière. Désir aussi d’honorer les géants qu’il a
côtoyés: Bud Powell, Charlie Parker, Dizzy Gillespie (magnifique version
de «Con Alma» avec le soutien tout en finesse d’Yves Torchinsky à
l’archet). Tandis que les morceaux à tempos rapides permettent d’apprécier les
ressources rythmiques d’Eric Dervieu («Easy Does It»). Le désir était aussi dans le public –de tous âges– venu en nombre
en ce pont du 15 août, jouissant de son privilège:
entendre un maître, une mémoire du jazz!
Jérôme Partage
Texte et photo
© Jazz Hot 2019
|
Marciac, Gers
Jazz in Marciac, 25 juillet - 15 août 2019
Couvrir un tel festival relève du tour de force.
Il y a la durée (22 jours) et le polymorphisme de l'offre (lieux et genres).
L'amateur de jazz est un pêcheur de perles dans l'océan. Mais des perles jazz il
y en a au Bis (place et lac, gratuit) et sous chapiteau; il faut fréquenter les
deux. Nous ne mettrons pas de frontière entre eux, ce qui rendra ici justice
aux artisans du Bis, lesquels, cette année, ont œuvré dans un quasi anonymat:
les lines up ne figurent pas dans le n°1 du magazine In Marciac... (futur nom du festival?). Plus
anonymes encore: les musiciens se produisant au Festival Off (Dixie Village,
chemin de ronde) pour ne rien dire de la scène MoJam (cour de l'Astrada) et duOff du Off (restaurants, rues). L'Astrada (27 juillet au 13 août) dirigée par
Fanny Pagès, a une programmation indépendante en dehors de quelques
coproductions avec Jazz in Marciac (exemples: Molly Johnson, le 29/7 et David
Enhco le 9/8).
C'est un groupe très
swing qui a lancé cette mouture 2019, le Pat Giraud Reunion Quartet, à 13h45
sur la place, le 25 juillet. De la musique hot en pleine fournaise (41°
à l'ombre): «Blues de la chauffe» (!) de Pat Giraud, «Exactly Like
You», «Gee Baby», «The Cat» de Jimmy Smith,
«When I'm Beginning to See the Light», «Sunny Side of the
Street» (!), «Caravan» par Pat Giraud (org) disciple avoué de
Jimmy Smith, Nicolas Peslier (g) parfois dans l'esprit de Wes Montgomery
(«Canadian Sunset»), Eric Jaccard (dm) et le grand retour à Marciac
après douze ans d'absence de Michel Pastre (ts) toujours dans la lignée
d'Illinois Jacquet (quel son!). Puis Olivier Temime (ts, ss) a joué les
compositions ou les arrangements de John Coltrane («Summertime»,
«My Favorite Things») dans le style du quartet John Coltrane, en
compagnie de Laurent Fickelson (p), Sylvain Romano (b), Philippe Soirat (dm).
Enfin Jérôme Etcheberry (tp), devenu excellent chanteur –il ne copie
personne–, a pris le relais en compagnie de David Blenkhorn (g), Raphaël Dever (b),
Mourad Benhammou (dm). Du jazz de qualité («Sometimes I'm Happy»,
«Pennies From Heaven», «If I Could Be With You»,
«Linger Awhile», «September in the Rain»,...).
 Wynton Marsalis, Veronica Swift, Walter Blanding, Marciac, 26 juillet 2019 © Michel Laplace
Wynton Marsalis, Veronica Swift, Walter Blanding, Marciac, 26 juillet 2019 © Michel Laplace
Le premier concert non
pop, sous le chapiteau, s'est tenu le 26 juillet. Après une prestation du
chanteur soul, Gregory Porter flanqué d'un sax tonique, Tivon Penniquott, un
moment d'exception nous a été proposé par Wynton Marsalis en quartet augmenté
de Veronica Swift (voc), une révélation. Le projet était la musique de Dizzy
Gillespie et Charlie Parker. Promesse tenue. Parker est très assimilable, ce
qui n'est pas le cas de Gillespie dont le propos n'était jamais prévisible et
que peu sont parvenus à approcher dans sa complexité et originalité (c'est par
le biais du courant Fats Navarro-Clifford Brown que la trompette bop a fait des
petits). Wynton Marsalis a «marsalisé» Gillespie, sans trahison et
loin de toute tentative de copie. Beau programme lancé par «Be Bop»,
thème typiquement gillespien et pas simple. Wynton Marsalis y a pris un solo
très véloce et technique, et Veronica Swift a immédiatement séduit par un scat
vivant, pas scolaire. Elle intervint dans le thème comme un instrument. C'est
«Anthropology» qui suivit, introduit par Carlos Henriquez (b) et
Veronica qui expose ensuite le thème en évoquant Sarah Vaughan. Beau solo de
trompette avec sourdine bol, Veronica chante «How High the Moon»
avec les contre-chants de Walter Blanding (ts), belle alternative entre Wynton Marsalis
et Dan Nimmer (p) et retour au thème en scat. Veronica Swift (née en 1994)
laisse ces messieurs interpréter «My Little Suede Shoes» exposé par
Nimmer (le pont par Blanding). Admirable solo de Nimmer avec des lignes de
basse d'Henriquez parfaites. Wynton Marsalis prend un solo avec la sourdine
straight, pas bop, plus mélodique qu'harmonique avec quelques effets en growl.
Après le bon solo de Blanding, il reprendra un court solo, suivi de celui du
batteur Francesco Ciniglio. L'ensemble reprend le thème en coda (le pont par
Henriquez). Blanding s'efface devant Veronica pour «Au Private» qui
donnera lieu à un grand dialogue entre elle et Wynton Marsalis (avec la
sourdine plunger). Retour à Gillespie avec «Dizzy Atmosphere» sans
voix et exposé à l'unisson par trompette et sax ténor. Dialogue entre Marsalis
et Blanding, bon solo grogné d'Henriquez. Veronica Swift donne une belle
version d'«Embraceable You» (très proche de Sarah Vaughan
dans le maniérisme vocal). Wynton Marsalis intervient en solo, superbe de
musicalité. C'est un thème du pianiste Hod O'Brien (père de Veronica), «The
Diffusion of Beauty» qui est exposé en scat. On y remarque les block
chords de Dan Nimmer dans son solo. Sans chanteuse, le quartet se lance dans
«Hot House» de Tadd Dameron exposé à l'unisson par les souffleurs.
Son généreux de Walter Blanding au ténor dans son solo. Belle alternative
contrebasse-batterie. Dans «Cherokee» lancé avec vivacité par la
trompette, Veronica chante les paroles dans le style de Sarah Vaughan puis
improvise en scat avec swing et inspiration. Wynton Marsalis prend un solo
curieux comme il sait aussi faire et termine de façon abrupte. Un seul bis:
«All the Things You Are»: Veronica Swift chante les paroles (beau
soutien aux balais), Wynton Marsalis prend un solo très «vocal»
avec le plunger, Blanding utilise pour la seule fois de la soirée le soprano, et
Nimmer sollicite quelques block chords. C'est fini, et on reste sidéré par
autant de talent! Gillespie et Parker ne pouvaient mieux espérer. L'un des
meilleurs concerts du festival, si ce n'est le meilleur.

Isaiah Thompson, Sam Chess, Wynton Marsalis, Julian Lee, Alexa Tarantino,
Camille Thurman, Marciac, 30 juillet 2019 © Michel Laplace
Le deuxième concert de
Wynton Marsalis s'est tenu le 30 juillet et fut d'une autre nature
(compositions originales). L'instrumentation de ses Young Stars of Jazz s'y
prêtant, on a retrouvé le son de ses septets des années 1990 («No Surrender»):
outre Wynton Marsalis (tp), il y avait Sam Chess (tb), Alexa Tarantino (as,
fl), Camille Thurman (ts, ss), Isaiah Thompson (p), Carlos Henriquez (b), T.J.
Redick (dm). Julian Lee (ts) s'est ajouté à partir du quatrième morceau. Carlos
Henriquez n'est pas un nouveau, sauf comme compositeur et il a là beaucoup
contribué, notamment avec «Time to Wake Up» (introduction de
contrebasse, bon solo d'alto, appel-réponse entre Chess et Marsalis avec le
plunger), «Lost Rhythms of Our Soul» (belle alternative entre Wynton
Marsalis et Alexa Tarantino à l'alto reprenant souvent les phrases du chef) et
surtout «Moses on the Cross» qui sollicite la flûte et des passages
chantés par les membres de l'orchestre (Wynton Marsalis y a pris un solo
spectaculaire de drive). Wynton Marsalis a écrit «The Struggle to Become
Aware» où T.J. Redick a pris un solo, mais surtout aussi Sam Chess (belle
sonorité, discours bien construit, intensité allant crescendo) sur des lignes
de basse parfaite. Le meilleur fut «Something About Belief» sur
tempo lent, introduit par la rythmique (Redick aux balais). Le thème collectif
(Lee, présent, ne joue pas) sonne ellingtonien. Isaiah Thompson a pris un solo
sobre et swing, le passage d'alto et ténor (Tarantino et Thurman) est chantant,
auquel s'ajoute un Sam Chess dans le style de Lawrence Brown. Suivent une
alternative entre Tarantino (entre Johnny Hodges et Wes Anderson) et Wynton
Marsalis (avec le plunger), un solo de Carlos Henriquez (son massif genre
Mingus) et une vocalise de Camille Thurman. Superbe. Un seul bis, «Talk
About You», où Chick Corea s'est joint au groupe (Isaiah Thompson, puis
Chick Corea, puis quatre mains).
Nous avons maintenant une
relève qui commence à se distancier de l'influence initiale de Wynton Marsalis
(58 ans!). Le jeune Noé Codjia, 25 ans, a su séduire sur la place, le 2 août,
par la qualité de sa sonorité et son sens des nuances au service de solos bien
construits, équilibrés. Son phrasé est souvent véloce à la Leroy Jones: «Second
Line/Bourbon Street Parade», «When I Grow Too Old to Dream».
C'est à la Nouvelle Orléans, il y a trois ans, qu'il s'est fait des amis
(buddies) qui constituent autour de lui ce Buddy Jazz Club 5tet: Nicolas Laroza
(tb, voc), Camille Holzer (g), Nicolas Oustiakine (b, voc), Ophélie Luminati
(dm). Le soir même, 2 août, c'est sous le chapiteau que Nicolas Gardel allait
rejoindre les étoiles de la trompette. Il a œuvré à Marciac de nombreuses
années (au Bis, à L'Astrada, et comme sideman sous le chapiteau). Pour cette
prestation, il a choisi l'exigeant challenge du duo trompette et piano. Comme en
1928 entre Louis Armstrong et Earl Hines, on a trouvé la même virtuosité,
souplesse et complicité artistique entre Nicolas Gardel et Rémi Panossian. Il a
donné des morceaux originaux où il est puissant et lyrique («Dive With
Me», «The Mirror»). L'atmosphère peut être sombre comme dans
«EMY (Endless Memory of You)» (discrète influence classique). La
recherche sur le son, sans excès, c'est par exemple le début ad libd'«Amaterasu» où il place le pavillon au-dessus de la table d'harmonie du
piano. Mais Nicolas Gardel, c'est surtout un son de trompette (charnu, chantant),
un drive foudroyant, des facilités dans l'aigu et, par ailleurs, beaucoup
d'inspiration dans l'improvisation, le tout convenant au jazz qu'il a délivré
dans «I Fall in Love too Easily» (quelques growls, mais surtout
virtuosité et swing), «I Got Rhythm» (Panossian a le même niveau et
swingue), «Lean on Me» –intégrant «Things Ain't What They Used
to Be»– (inflexions, drive et en coda, shakes vers l'aigu),
«Caravan» et en bis «Autumn Leaves» (avec sourdine
harmon). Le public copieux et réceptif leur a fait un triomphe.

Mozes, Nonnie et Stochelo Rosenberg, Marciac, 27 juillet 2019 © Michel Laplace
Sous le chapiteau, la
guitare fut à l'honneur. Les trois premiers morceaux du spectacle de George
Benson sont toujours les plus intéressants car ils rappellent le bon guitariste
qu'il a été, sa sonorité personnelle est intacte (27/7). Avec la famille
Rosenberg, on n'est jamais déçu. Au trio réduit à deux (Stochelo, g, Nonnie, b)
fut ajouté en diverses combinaisons, du duo au quintet: Mozes Rosenberg (g,
plus jeune frère de Stochelo), Johnny Rosenberg (g, voc) et Sani van Mullem
(b). Le répertoire choisi est vaste allant de Django Reinhardt (2e bis:
«Minor Swing») à Stochelo Rosenberg («For Sephora» en
bossa) et Mozes Rosenberg («Mozology») en passant par Stevie
Wonder. Les standards comme «Stomping at the Savoy» et «I Got
Rhythm» sont «reinhardtisés». Stochelo (toujours en premier)
et Mozes se relayent en solo. Johnny est strictement rythmique, mais il est
aussi un bon crooner («The Old Fashion Way» de Charles Aznavour,
«My One and Only Love», «I Got Rhythm» où il vocalise à
l'unisson avec la guitare de Stochelo). Une soirée virtuose et swing (31
juillet). Le relais fut passé au RP Quartet qui avec un savoir-faire
sympathique font (sur)vivre «la musique de Django» dans un
répertoire qui va de Django («Nuages», «Blues en
mineur», «Minor Swing») à John Coltrane (son arrangement de
«Body and Soul», 1960; «Giant Steps»): Bastien Ribot
(vln, disciple de Didier Lockwood), Edouard Pennes (g solo), Rémi Oswald (g),
Damien Varaillon-Laborie (b) (1er août). 
Cécile McLorin Salvant, Marciac,
10 août 2019 © Michel Laplace
Pour le piano, Pierre Chrisophe (2 août) en
compagnie de Sébastien Girardot (b) et Laurent Bataille (dm, cga) a été un
parfait guide de l'œuvre méconnue d'Erroll Garner qu'il interprète
parfaitement. Son travail est pédagogique car il fait revivre
«Dreamy», «Way Back Blues» (main gauche low down), et pas seulement «Misty»
et «Play Piano Play». Il illustre musicalement la filiation entre
Garner et, vedette locale, Ahmad Jamal (du temps de sa splendeur
artistique-années 1950) dans «Afinidad» et «Mood
Island».
Le 8 août c'est en vedette que Pablo Campos s'est présenté en
quartet (David Blenkhorn, g, Viktor Nyberg, b, Philip Maniez, dm) dans la
tradition du pianiste-chanteur à la Nat King Cole. En fait sa voix évoque celle
d'Harry Connck, Jr. («At Long Last Love» de Cole Porter, très bon
solo de basse). Un seul instrumental bien venu.
Le soir même, un géant a œuvré:
Kenny Barron en trio (Kiyoshi Kitagawa, b, Jonathan Blake, dm). Finesse
d'interprétation et swing, on retiendra «How Deep Is the Ocean?»
(bon jeu de balais de Jonathan Blake), «Bud Like» de Kenny Barron dans le style de
Bud Powell (et bon solo de batterie) et «Cook's Bay» en bis. En
piano solo Kenny Barron a joué un Medley Ellington-Strayhorn qui lui va
parfaitement («Lotus Blossom»/«A Flower Is a Lovesome
Thing» /«Melancholia»/«Star-Crossed Lover»).
Le concert hommage à Michel Petrucciani fut mené tambour battant (15 titres et
un bis en dehors des souvenirs émouvants d'Aldo Romano). Onze musiciens avec
une combinaison différente pour chaque morceau. Pour le swing, nous retiendrons
Laurent Coulondre en piano solo («Take the A Train»), le même à
l'orgue Hammond avec Flavio Boltro (tp), Philippe Petrucciani (g) et Lenny
White (dm) («Play Me» de Michel Petruciani), un Jacky Terrasson
monkien (!) en compagnie d'Airelle Besson (tp), Géraldine Laurent (as) et un
tandem qui fonctionne, Géraud Portal (b) et Lenny White (dm) («Hommage à
Enelram Atsenig» de Michel Petruccini). Enfin pour l'épaisseur de son de
Joe Lovano (ts) son duo avec Terrasson sur «Body and Soul». C'est
Franck Avitabile qui a débuté, seul, le concert dans un style proche de Michel
Petrucciani («J'aurai tellement voulu» de Frédéric Botton).
Même
s'il est co-vedette, nous signalons ici la classe considérable du
pianiste
Sullivan Fortner, passé le 10 août sous le chapiteau avec Cécile
McLorin-Salvant. Non pas que la chanteuse n'a pas été superbe de talent.
Elle a
beaucoup gagné en présence scénique, et ses qualités d'interprétation
l'installent dans les indispensables du moment. Cécile McLorin-Salvant a
un incroyable
contrôle de sa voix et des nuances (influence classique). Son registre
grave,
le phrasé et quelques maniérismes rappellent Sarah Vaughan. Sa diction
est impeccable.
Mais son récital n'aurait pas atteint ce niveau expressif sans
l'incroyable
virtuosité et l'inspiration de Sullivan Fortner. Comme elle, il a une
palette
globale qui va, pour lui, de l'impressionnisme classique («à clef»
de McLorin) au stride (ballade écossaise «The Raggle Taggle Gypsies-O»)
et feeling blues («Nothing Like You» de Bob Dorough), avec
puissance («Ghost Song» de McLorin) et un son massif («Wild Is
Love» de Nat Cole). Ils passent de la chanson réaliste au jazz avec
naturel, comme s'il s'agit d'un même genre. D'où un répertoire
œcuménique qui
est en phase avec le temps présent et qui va de Kurt Weill à Sting en
passant
par Big Bill Broonzy (1er bis: «Black, Brown & White»)
et Jacques Brel.
Restons dans la voix, pour indiquer que la réussite de cette
soirée vient aussi d'une première partie confiée à Eric Bibb. En dehors de deux
chants à tendance folk («On My Way to Bamako» et en bis, «Needed
Time») et d'une séquence sénégalaise avec Lamine Cissokho (kora, voix)
l'espace de quatre morceaux (dont un de Leadbelly, «Bring a Little Water,
Sylvie»), Eric Bibb nous a donné du blues low down comme, hélas!, on en entend peu aujourd'hui: seul au début
dans «Goin' Down Slow», puis «Turner Station» (swing!),
«Come Back, Baby», «In My Father's Home», avec Carl Orr
(g), Neville Malcolm (b), Paul Robinson (dm).
Au nombre des bonnes surprises,
il y eut le Meeting quintet, passé en effectif complet le 30 juillet matin:
Malo Mazurié (tp), Giacomo Smith (as, cl), Bastien Brison (p), Edouard Pennes
(b), David Grebil (dm). Programme orienté swing avec deux souffleurs virtuoses:
«You Do Something to Me», «When I Grow Too Old to Dream»,
«Can We Be Friends?», «Muskrat Ramble», «Kiss Me
to Build a Dream On» (sans Mazurié), «I May Be Wrong But I Think
You're Wonderful», «Liza», «New Orleans», etc. Le
6 août, nous retrouvons Mazurié, Pennes et Grebil (directeur artistique) dans le
Gumbo quintet avec Pablo Campos (p) pour accompagner l'agréable Cecil L.
Recchia dans des arrangements parfois inattendus de thèmes de la Nouvelle
Orléans d'aujourd'hui («St. James Infirmary» sur tempo vif avec
scat; «Bourbon Street Parade» à la Jamal).
En bref, Baptiste Herbin
(as) s'est inspiré du disque Cannonball Adderley Quintet in Chicago(6/8, intéressante suite «Dis Here»/«Stars Fell on Alabama»/«Limehouse Blues», avec introduction à la Bobby Timmons de Simon
Chivallon), Géraud Portal a restitué le son massif de contrebasse et les
couleurs orchestrales de Charlie Mingus en quintet sans piano (6/8: Quentin
Ghomari, tp -clarté à la Clarence Shaw, César Poirier, as lyrique et plus sage
que Dolphy, Boris Blanchet, ts, Lucio Tomasi, dm: «Haitian Fight Song»,
la belle ballade «Self-Portrait in Three Colors»), Philippe Léogé a
proposé en quintet l'ambiance Blue Note et d'Horace Silver avec Adrien Dumont (flh,
lignée Art Farmer) (12/8: «Gregory Is Here» de Silver, «Driftin»
d'Hancock, etc.) et c'est dans des compositions originales comme «Blueland»
(de Gérard Poncin) et «La Route bleue» (Poncin-Cabrol) que
Jean-Michel Cabrol (ts) a dévoilé un genre charnu à la Fats Theus (12/8).
Du
côté world/pop/rock qui a un public, Orlando Poleo a présenté Laurent Maur
(hca, disciple de Toots Thielemans) et Renaud Palisseaux (p, bon «Round
Midnight», 5/8), Christian Scott (tp) dont l'ambition est de «redefine
what this music means» a mis en vedette l'excellent Lawrence Fields
(p) et l'impressionnant Max Mucha (b) dans «West of the West»
(7/8), l'Australien Alex Stuart (g) a su mettre en valeur l'excellente sonorité
d'Arno de Casanove (tp) aux côtés d'Irving Acao (ts, p) (12/8, «An
Afternoon With Kiefer»)
Comme chaque année, c'est
le Festival Bis qui clôt l'événement (14-15/8) et cette fois par du blues.
Alexis Evans (g, voc), de Bordeaux, interprète ses compositions («Keep
the Good Time in Your Mind», slow soul type sixties: «Come Home
With Me»). Il chauffait l'assistance pour la prestation de Gladys Amoros
(voc) excellemment entourée (Michel Foizon, g, Nico Wayne Toussaint, hca,
Jean-Luc Fabre, b, Romain Gratalon, dm). Le moment de grâce fut lorsque Gladys
Amoros a rendu hommage avec conviction à son idole Carrie Smith qu'elle a
entendu dans la salle des fêtes de Marciac le 20 décembre 1997 («Smoke
Like You»). La dernière prestation a donné lieu à un bœuf des deux
groupes (Robin Magord, org, du groupe Alexis Evans, a des qualités) et les
dernières notes sont «What a Wonderful World» (on peut rêver). Les conditions
climatiques n'ont pas été idéales et expliquent en partie une fréquentation
variable. Mais, les concerts ci-dessus décrits resteront des temps forts dans
l'histoire de ce festival.
Michel Laplace
Texte et photos
© Jazz Hot 2019
|
Pertuis, Vaucluse
Festival de Big Band de Pertuis, 5-10 août 2019
Le Festival de Big Bands de
Pertuis a fêté ses 20 ans avec une programmation exceptionnelle. Après avoir
invité lors de la précédente édition le big band de la BBC, c’est le Count
Basie Orchestra qui officiait en clôture du festival. L’affaire a été rendue
possible par le volontarisme de Léandre Grau, l’âme du festival, avec la
complicité de Jean-Pierre Vignola (toujours impliqué dans la programmation de
Jazz à Vienne). C’est dans cette
ambiance chaleureuse qu’on aime à retrouver, que se tient le
festival, avec un public connaisseur, une organisation impeccable, reposant sur
des bénévoles dévoués, une sonorisation parfaite, assurée principalement par
Bruno Minisimi, grand amateur de jazz et présent depuis une dizaine d’années. Adossées
au Conservatoire de Pertuis, se tiennent des master classes d’improvisation et
d’ensemble jazz, animées cette année par Julien Armani, Christophe Allemand et
Nicolas Sanchez. Ces ateliers ont donné lieu à plusieurs concerts qui se sont
tenus dans différents endroits de la ville.
Pour les 20 ans du festival, les cieux se sont montrés cléments, le public
nombreux et la restauration dans le ton. Si l’on ajoute la gratuité des
concerts du lundi et du mardi et le prix très raisonnable des places pour les
autres soirées, on peut en conclure que cette édition anniversaire a été
parfaitement réussie.
Lundi 5 août, 19h30. Tartôprunes
On
retrouve Tartôprunes, orchestre-fanfare déjantée qui ouvre
traditionnellement les festivités. Ça commence façon fanfare, ça
continue façon reggae, ça paraît partir dans tous les sens comme pour
faire oublier les arrangements de haut niveau et quelques jolis chorus
portés par une bonne rythmique. On remarque Valentin Halain (tp)
largement applaudi par le public. Les solos sont pris par le saxophone,
le trombone, le trompettiste. Joli chorus croisé batterie/percussion sur
«Boogie Stop Shuffle» de Charlie Mingus. Le répertoire emprunte à
diverses sources de toutes les époques, dans un melting pot réjouissant.
Tartôprunes:
Maeva Morello (tp), Valentin Halain (tp), Romain Morello (tb) Philippe
Ruffin, Clément Serre, Alex Chagvardieff (g), Bastien Roblot (g, perc,
voc), Caroline Suche (p), Maxime Briard (dm)
Big Band de Pertuis, Pertuis, 5 août 2019 © Christian Palen
Lundi 5 août, 21h30. Big Band de Pertuis
On
se presse pour le concert du Big Band de Pertuis, dirigé par Léandre
Grau: les amis sont là et l’ambiance est au beau fixe. Le premier set
commence par une composition de Gilles Arcens, chef d’orchestre pour
René Cot. Lionel Aymes (tp) y intervient avec profondeur, suivi par
Romain Morello (tb) et Julien Sapies (p). Sur «Kids Are Pretty People»
(Thad Jones), c’est un nouveau chorus de Romain Morello qui met en
valeur l’œuvre du trompettiste. Après «Doodle Blues» (Frank Foster),
Alice Martinez intervient sur «That’s My Style», qui fut chanté par
Peggy Lee (arrangements originaux de John Harpin). La fluidité des
échanges entre l’orchestre et de la chanteuse fait plaisir à voir et les
chorus de sax de Christophe Allemand (ts) et Michael Baez (as) achèvent
de faire rugir le public de plaisir. On continue avec «The Windmills of
Your Mind» («Les Moulins de mon cœur», Michel Legrand) où se
distinguent Lionel Aymes (cnt) et Christophe Allemand. Cette première
partie se terminant avec deux thèmes de Cole Porter, «Too Darn Hot»
(arr. Buddy Bregman), chanté par Alice Martinez, et «It’s All Right With
Me» (arr. Mike Collins).
Le deuxième set débute avec «Told You so»,
de Bill Holman, qui fut l’un des grands succès de Count Basie et où
Lonny Martin pousse son trombone dans ses derniers retranchements; il
est suivi de l’intervention d’Yvan Combeau qui a troqué son sax pour une
flûte. On revient à Thad Jones, avec «Groove Merchant», où Lionel
Aymes (tp) et Julien Sanches (p) nous offrent de jolis chorus croisés,
tendance acrobatique! Retour à Cole Porter ensuite avec «I Love You»
(arr. Miles Ciollins) sur lequel Alice Martinez qui a troqué sa robe
pour le t-shirt du festival. «Only You» (arr. Bob Florence) propose un
chorus de trompette bouchée par Yves Douste. Thad Jones encore avec
«Three and One» où se distinguent Michael Baes (as) et Lionnel Aymes
(tp). Puis, «720 in the Books» de Johnny Watson (arr. David Wolpe), avec
Alice, suivi de «Sing Sang Sung» de Gordon Goodwing, agrémentés de deux
belles interventions de Michael Baez et Valentin Halin (tp). Et sur
«You Can Have It» (Frank Foster), en rappel, que se termine la soirée.
Big
Band de Pertuis: Léandre Grau (lead, tb), Yves Douste, Lionel Aymes,
Roger Arnald, Valentin Halin, Jean Marie Pellenc (tp), Jean-Pierre
Ingoglia, Romain Morello, Lonny Martin (tb), Bernard Jaubert (btb, tu),
Yves Martin (btb), Yvan Combeau, Michael Baez (as), Christophe Allemand,
Clément Baudier (ts), Laurence Allemand (ts), Jérémie Laurès (bar),
Gérard Grelet (g), Julien Sanches (p), Bruno Roumestan (eb), Stéphane
Richard (dm), Alice Martinez (voc)
Mardi 6 août, 19h30. Serket and the Cicadas
Le
nom de ce groupe associe «Sektet», divinité égyptienne bienveillante,
et la traduction anglaise du mot «cigales». Il est dirigé par Cathy
Escoffier (p), professeur au conservatoire de Pertuis, et entend
mélanger jazz et tendances musicales «plus récentes». Ainsi, «Speak Low»
est longuement introduit par le piano seul, rejoint par la guitare. Ce
duo récurrent se développe sur de longs échanges, au confluent du jazz
et de la musique contemporaine, avec des éléments de structure
répétitifs. Après des prises de parole successives sur «Temps conté»,
une composition de Cathy Escoffier, «Indifférence» (Tony Murena) est
exposé au trombone, tandis que le piano se fait plus jazz. Suivent deux
autres originaux de Cathy Escoffier, «Soleil noir» et «L’Appel aux
larmes» avant qu’hommage ne soit rendu à Claude Nougaro avec «Le
Cinéma». Cathy Escoffier passe après au Fender sur son morceau
«Volupté», basé sur un crescendo rythmique assuré par l’ensemble du
groupe. Le concert se conclut avec «Afro Blue» (John Coltrane), joué
avec conviction. Il est à noter que Serket and the Cicadas a prévu
d’entrer en studio en septembre pour enregistrer un CD.
Serket
and the Cicadas: Cathy Escoffier (p, lead), Romain Morello (tb), Pierre
Renard (b), Andrew Sudibasi (g) Julien Artel (dm)
 Middle Jazz Orchestra, Pertuis, 6 août 2019 © Christian Palen
Mardi 6 août, 21h30. Middle Jazz Orchestra
Avec
ce concert dédié à la soul music, le Middle Jazz Orchestra, originaire
de Sanary, rendait hommage à Ray Charles, Aretha Franklin et aux Blues
Brothers en particulier par les interventions d’Edith Darasse et
Bertrand Borgognone (voc). Didactique et badin, le chef d’orchestre,
Didier Huot, introduit les morceaux en rappelant son ancrage dans
l’histoire des Afro-Américains et des luttes pour les Droits civiques.
Avec «Blues for Scottie» et «Let the Good Time Roll» (Sam Theard),
chantés par Bertrand Borgognone, on assiste à une belle démonstration
d’efficacité du Middle jazz Orchestra. C’est ensuite «Busted» (John
Deley) avec un chorus de Michael Steiman (tb) et «Oh What a Beautiful
Morning» (Richard Rodgers et Oscar Hammerstein II). Edith Darasse
enchaîne avec plusieurs titres d’Aretha Franklin («Chain of Fools»,
«Respect», «I Can’t Stop Loving You» qui font monter d’un cran la
tension avant «Oh Happy Days» repris en chœur par le public, tandis que
le premier set se termine sur «Land of 1000 Dances».
Le concert
reprend avec de nouveau Aretha Franklin («Rock Steady», «Think») ce qui
entraîne une partie du public à danser, sous les encouragements de
l’orchestre. Suivent un «Say no More» langoureux à souhait, «Fever»,
repris par Edith et Bertrand, «I Got a Woman» et «Hit the Road Jack»
agrémenté d’un faux départ relevé avec humour par Didier Huot. La
performance s’achève avec «What I’d Say» et, en rappel, «Sweet Home
Chicago» pour respecter la tradition des concerts de blues.
Middle
Jazz Orchestra: Didier Huot (lead) Laurent Hitts, Daniel Swalder,
Laurent Selda, Philippe Bayle (tp), Henri Gangopis, Vitel Stanel (tb),
Michel Robsteter, Olivier Studor, Laurent Moll (s), Gérard Davour (g), Edith Darasse, Bertrand Borgognone (voc)…
Jeudi 8 août, 19h30. La Bande à Bruzzo
Pierre
Bruzzo (ss) est à la tête d’une formation où se mêlent deux
générations. On démarre avec «Ain’t Misbehavin’» (Fats Waller) et un
solo élégant de Vincent Lagnaud (b), soutenu par le piano, avant une
composition de Pierre Bruzzo, «Ici mieux qu’en face» (en référence à un
bar, en face de la prison des Beaumettes, à Marseille, où il avait
coutume de se produire) qui lui donne l’occasion de développer son
expressivité. Un «Where I Got all the Dreams» collégial précède un
hommage à Sidney Bechet, la spécialité de Pierre Bruzzo, avec «Le
Marchand de poisson» et «Petite fleur». «Sweet Georgia Brown» (Maceo
Pinkard/Ken Casey) est l’occasion d’un chorus de batterie très nuancé
d’Alain Mano, cymbales dans un premier temps, puis peaux. L’orchestre
termine avec «Oh When the Saints» dans une ambiance New Orleans, avec un
public très complice.
La Bande à Bruzzo: Pierre Bruzzo (ss), Philippe Couron (p), Vincent Lagnaud (b), Alain Mano (dm) + Romain Morello (tb)
 Bolden Buddies Little Big Band, Pertuis, 8 août 2019 © Christian Palen
Jeudi 8 août 21h30. Bolden Buddies Little Big Band
Ils
viennent de Montpellier et se sont spécialisés dans l’interprétation
rigoureuse des arrangements originaux des big bands des années 1920-30,
avec un répertoire autour de Duke Ellington, Fletcher Henderson, King
Oliver… Arnaud Gauchio chante et présente les différents titres avec
beaucoup de feeling. Dès «Everything Is Jumping» d’Artie Shaw (solo de
contrebasse de Julien Didier très applaudi) l’ambiance est installée: on
a affaire à de véritables amoureux de la musique de ces années-là, avec
des parties d’ensemble très travaillées, sous la direction de Guillaume
Corral (as, cl). Non sans prise de risques sur les chorus. On peut
apprécier ces interventions, souvent très belles sur «Blues in My Heart»
de Benny Carter (Arnaud Gauchio), «King Porter Stomp» de Jelly Roll
Morton (Eric Serra, tb), «Echoes of Harlem» de Duke Ellington (Corentin
Lehembre, tp), «When It’s Sleepy Time» de Clarence Muse (Corentin
Lehembre, voc), «Crazy About My Baby» de Fats Waller (Auguste Ceres, p),
«East St Louis» de Duke Ellington (clarinette, banjo, batterie et sax
alto).
Le second set débute avec «Begin the Biguine» d’Artie Shaw,
puis « Blue Brag » de Joseph Miro (Auguste Ceres), «The Mooche» de Duke
Ellington, suivi de «Swinging the Blues» et «Deep Blues» (Corentin
Lehembre, tp), «Travelin», «Tickle Toe» de Lester Young (Corentin
Lehembre). Le concert s’achève avec «I Left My Baby» et «Carioca» du
même Artie Shaw et, après un rappel enthousiaste, un «Double Check
Stomp» du Duke assez jouissif!
Bolden Buddies Little Big Band:
Guillaume Corral (as, cl,lead), Arne Wernik, Gilles Berthet (tp),
Corentin Lehembre (tp, voc), Eric Serra, Samy Khalfon (tb), Maximilien
Zechine, Charlie Maur, Pierre Leydre (as, cl), Julien Didier (bs),
Joseph Vu Van (bjo, g), Auguste Ceres (p), Thomas Domeme (dm), Arnaud
Gauchio (voc)
Vendredi 9 août, 19h30. Swing Bones
L’idée
originelle de Swing Bones était de rendre hommage au «Four Bones»,
quartet de trombones créé en 1967 par François Guin (voir notre
chronique) avec en soutien une rythmique. Ainsi se succèdent les
compositions de François Guin: «Six O’ Clock Jump», «Blues for Ever»
(écrit avec Gérard Badini, parrain du festival) –où se distingue Jérôme
Laborde (tb)– «Between the Devil», «Elsa». On entend également «Ghost
pédalo mania», dont le thème est tenu au trombone bouché avec un joli
chorus de piano, «Et maintenant» de Gilbert Bécaud, tandis qu’une
ballade, «Affection of Lord» permet enfin à chacun des trombonistes de
prendre la parole, avant «Sonny Rivers» où Malo Evrard (dm) sera très
applaudi.
Swing Bones: Jérôme Capdepont (tb), Baptiste Techer
(tb), Jérôme Laborde (tb), Olivier Lachurie (btb), Thierry Gonzalez
(p), Julien Duthu (b), Malo Evrard (dm)
 James Morrison (à droite) avec le Big Band Brass, Pertuis, 9 août 2019 © Christian Palen
Vendredi 9 août, 21h30. Big Band Brass and James Morrison
Venu
spécialement d’Australie pour ce concert, James Morrison,
multi-instrumentiste, virtuose de la trompette, du piano, du trombone,
du saxophone, était l’invité soliste du big band de Dominique Rieux
(tp). Si le Big Band Brass avait déjà régalé le public de Pertuis en
2013 avec son hommage à Glenn Miller, c’est autour du CD enregistré avec
James Morrison, The Amazing Live, que s’organisait le concert de
ce soir. Dès les premiers titres, «All of Me» et «I’m Getting
Sentimental Over You», on constate l’impressionnante virtuosité de James
Morrison, d’abord à la trompette, par ailleurs très en phase avec
l’orchestre. Il s’efforce aussi de communiquer avec le public,
présentant les morceaux avec humour. Et c’est au saxophone soprano qu’il
s’exprime sur «Here That Rainy Day» (Jimmy Van Heusen), de même que
Jean-Michel Cabrol. Autre duo sur «Benno’s Blues», un original de James
Morrison, ici au trombone avec Rémi Vidal. On remarque la propension à
jouer en chorus croisé, très présente dans l’orchestre et qui donne
l’occasion de belles rencontres. Le set s’achève sur «Yesterdays»
(Jerome Kern), pris mid tempo avec James Morrison au bugle.
Au second
set, «Lazy River» (Louis Amstrong), arrangé par Morrison, est
l’occasion d’un nouveau chorus croisé entre Rémi Vidal (tb) et James
Morrison, plein de feeling à la trompette. Suivent un autre original de
sa main, «Zog Jog», une belle démonstration collective, «Things Ain’t
What They Used to Be » d’Ellington sur lequel James Morrison joue tour à
tour, et très rapidement, du trombone et de la trompette. Il récidive
sur «Basin Street Blues», cette fois en passant du piano à la trompette.
La performance, virtuose, ne s’est pour autant pas limitée à un numéro
d’acrobatie mais aussi de belle musique.
Big Band Brass:
Dominique Rieux (tp, lead), Tony Amouroux, Jacques Adamao, Eric Duroc
(tp), Rémi Vidal (tb), Ferdinand Doumerc, Christophe Mouly (as),
Jean-Michel Cabrol, David Pautric (ts), David Cayron (bar), Florent
Hortal (g), Thierry Gonzales (p), Michel Chalot (b), André Neufert (dm)
 Scotty Barnhart et le Count Basie Orchestra, Pertuis, 10 août 2019 © Christian Palen
Samedi 10 août 2019, 21h30. Count Basie Orchestra
«Une
machine mise en place par quelqu’un qui savait rassembler. En Europe
c’est un orchestre mythique. C’est un rêve d’inviter le Count Basie
Orchestra à Pertuis!» déclare, en ouverture, Léandre Grau. Sous
la direction de Scotty Barnhart, la venue du Count Basie Orchestra
constituait bien entendu l’évènement du festival et, si l’on en juge par
le nombre de musiciens présents dans le public (on jouait à guichet
fermé), ce fut un sentiment partagé par les professionnels et les
amateurs de jazz. Depuis le décès de Count Basie en 1984, Thad Jones,
Frank Foster, Grover Mitchell, Bill Hughes, Dennis Mackrel et, à
présent, Scotty Barnhart, ont dirigé le big band qui demeure l’une des
meilleures formations de jazz au monde. Son dernier album paru, à
l’automne 2018, All About That Basie (Concord Jazz) compte de
nombreux invités, de Joey DeFrancesco à… Stevie Wonder! L’orchestre
compte encore des membres originaux, qui avaient été recrutés par le
maître lui-même: Carmen Bradford (1983, chanteuse invitée), Clarence
Banks (1984), ainsi que Mike Williams (1987, anciennement Glenn Miller
Orchestra), Doug Miller (1989, anciennement Lionel Hampton Orchestra).
Beaucoup d’autres se sont joints au big band durant les quinze à vingt
dernières années, tandis que le benjamin est Robert Boone (26 ans, dm).
Le
premier set débute avec un morceau arrangé par Quincy Jones, et l’on
perçoit d’emblée l’extraordinaire capacité de l’orchestre à moduler les
parties d’ensemble tout en nuances, entre forte et pianissimo,
et à constituer un écrin sur lequel les solistes vont pouvoir
s’appuyer. Le thème suivant, «Moten Swing» (Bennie Moten, 1935), donne
un aperçu de la situation avec les chorus de Josh Lee (ts), Bob Note
(ts), David Galasser (fl), Mark Williams (tb), David Keim (tb) et
Clarence Banks (tb). L’orchestre poursuit avec «Shiny Stockings» (arr.
Frank Foster) et un chorus à la trompette bouchée d’Endre Rice, puis
«Back to the Apple» (arr. Frank Foster) qui voit un superbe travail au
piano de Glen Pearson en accord avec deux chorus croisés ts/tp puis
tp/tp. La section rythmique est véritablement exceptionnelle de cohésion
et de nuance L’accord piano/batterie/propulse le big band. Alors
arrive en scène Carmen Bradford sur «I Need to Be With» (Quincy Jones)
et elle enchaîne avec «Basie Land» qui est l’occasion encore de solos
croisés entre deux ténors, Doug Lawrence et Doug Miller.
Après la
pause, le concert reprend avec «Blues in Hoss’ Flat» (Frank Foster), un
titre qui fut également beaucoup joué par le Duke Ellington Orchestra
et qui permet d’apprécier le jeu de David Keim (tb). «Basie Power» voit
les deux altos échanger à une vitesse stupéfiante. Après «I Can Give You
Anything for Love», nous retrouvons une composition de Thad Jones «From
One to Another» où s’illustre Josh Lee (bar), Carmen Bradford et Frank
Greene (tp). Le final, «Basie», donne enfin la parole au batteur, Robert
Boone, tout en swing et en nuance!
The Count Basie
Orchestra: Scotty Barnhart (tp, lead), Frank Greene, Shawn Edmonds,
Endre Rice, Brandon Lee (tp), David Keim, Clarence Banks, Mark Williams,
Alvin Walker (tb), David Glasser, Markus Howell (as), Doug Lawrence,
Doug Miller (ts), Josh Lee (bar), Will Matthews (g), Glen Pearson (p),
Trevor Ware (b), Robert Boone (dm), Carmen Bradford (voc)
Encore
bravo et excellent anniversaire au festival de Big Band de Pertuis qui
depuis 20 ans porte le jazz en grande formation avec passion,
enthousiasme et un professionnalisme exceptionnel quand on sait ce que
signifie accueillir un big band. Ce festival a de plus formé l'oreille
des milliers de spectateurs –c'est aujourd'hui l'un des publics les plus
avertis du monde en matière de jazz et de big band– qui viennent et
reviennent chaque été dans cet environnement convivial, très abordable
économiquement et donc ouvert à tous: la vraie vocation d'un festival de
jazz! On souhaite à toute l'équipe une longue vie pour ce festival
aussi généreux que passionnant, une belle aventure humaine!
Christian Palen
Texte et photos
© Jazz Hot 2019
|

Charles Turner, Caveau de La Huchette,
8 août 2019 © Jérôme Partage
Caveau de La Huchette, Paris
Charles Turner. 8 août 2019
Le 8 août, nous avons découvert, dans un Caveau de La Huchette bondé, le
chanteur Charles Turner, dont le timbre n'est pas sans rappeler Nat King Cole.
Originaire de Los Angeles, diplômé du Berklee College et
établi à New York, Charles Turner, la trentaine, y a remporté la 1ère Duke Ellington Vocal Competition
en 2014. Il s’est depuis produit au Dizzy’s Club de Jazz at Lincoln Center et a
notamment travaillé avec Jason Moran (p). Depuis deux ans, il effectue des
séjours réguliers à Paris et donne des cours à l’American School of Modern
Music (15e arrondissement). Il était entouré ce soir-là du Suédois
Björn Ingelstam (tp), récemment installé à Paris après avoir travaillé à New
York où il a connu le chanteur, de Julien Coriatt (p), complice régulier de Denise
King, laquelle était venue jammer le soir précédent, et d’Alex Gilson (b) et Paul
Morvan (dm).
Le premier set fut une agréable mise en jambe bien que peu propice pour
les danseurs car la piste était presque totalement occupée des jeunes gens
assis à même le sol, délaissant les pratiques du Caveau. Deux ou trois
couples donnèrent tout de même l’exemple et furent applaudis. L’orchestre
donna à entendre plusieurs morceaux sur tempo medium («I Wish Your Love»,
«Blue Sky», «Blue Moon», «I Can’t Give You
Anything but Love») ainsi qu’un «Honeysuckle Rose» sur tempo
rapide qui a permis d’apprécier l’excellente technique vocale du chanteur sur
le scat et, de la part de Julien Coriatt, un solo de stride évoquant Fats
Waller. Inspiré par l’assistance sagement assise, Charles Turner enroba une
ballade qui n’est pas des plus courues: «Blame It on My Youth»,
écrite en 1934 par Oscar Levant (p) et Edward Heyman (également auteur des
paroles de «Body and Soul»).

Björn Ingelstam (tp), Charles Turner (voc), Alex Gilson (b), Paul Morvan (dm)
et au centre la mère et la sœur du chanteur, Caveau de La Huchette, 8 août 2019 © Jérôme Partage
Avec le deuxième set, le concert gagna en intensité: l’orchestre
et son leader, en phase dans le swing,
ont déchaîné l’enthousiasme du public, qui s’est enfin livré à la danse sans
plus de retenue. Entre «On the Sunny Side of the Street» et «Sweet
Lorraine», Charles Turner donna un réjouissant «Tea for Two» qu’il
conclut en invitant sur scène sa maman qui fêtait ce jour ses 70 ans. Pas
farouche, la dame a esquissé quelques pas au son d’un «Happy Birthday»
collégial.
Nous vous reparlerons prochainement de Charles Turner, un artiste qui a un
sacré métier et des idées déjà précises sur la musique.
Jérôme Partage
Texte et photos
© Jazz Hot 2019
|

La carrière couverte de Jazz in Langourla
© Yves Sportis
Langourla, Côtes-d’Armor
Jazz in Langourla, 2-4 août 2019
Langourla est un charmant petit village, de 500 habitants aujourd’hui, niché au cœur de la Bretagne et du Mené dont l’existence remonte sous ce nom à l’an 1000. Il existe depuis peu un regroupement de plusieurs villages, la commune nouvelle du Mené. Non loin de la forêt légendaire de Brocéliande (au sud-est), sa principale activité reste l’agriculture, et sa population vit d’abord de l’agriculture et de l’industrie agro-alimentaire.
Autour de la Mairie, de l’Eglise St-Pierre, de l’ancienne Tour St-Eutrope (XIIIe siècle) et du Café Le Narguilé, à l’origine du festival, se démène depuis plus de 20 ans, une équipe de bénévoles animée avec constance et conviction par Marie-Hélène Buron et Gildas Le Floch. Elle a donné vie à l’un des principaux événements jazzique de Bretagne, Jazz in Langourla qui en est à sa 24e édition cette année. Le jazz déborde aujourd’hui le cadre du seul festival de Langourla, car la solidarité des communes, des édiles des différents échelons administratifs et des habitants du Mené a permis de créer un engouement pour le jazz au pays du Mené, du 26 juillet au 9 août 2019, dont Jazz in Langourla est le temps fort. Il existe plusieurs associations, au-delà de l’équipe de Jazz in Langourla pour assumer tous les besoins de l’ensemble des activités culturelles de ce petit coin de paradis, en particulier une pour la logistique économique et matérielle (Office de développement culturel du Mené), une pour la restauration, etc. Tout ce beau monde, bénévole pour la quasi-totalité, s’agite pour donner à la vie locale un supplément d’âme, de convivialité, dans une atmosphère apaisée. Là, réside la performance car beaucoup d’entités interviennent en harmonie.
On comprend mieux alors la réussite de cet événement et la création du spectaculaire cadre champêtre du festival, à 300m de la Mairie, une ancienne carrière en amphithéâtre à côté d’un petit lac, aujourd’hui couverte qui permet le bon déroulement quels que soient les caprices d’un climat, clément au demeurant le plus souvent dans cette plaisante contrée.
Enfin, la dernière particularité de ce cœur de Bretagne, est la présence non négligeable d’une population d’adoption, anglaise principalement, et pas seulement de retraités. Il n’est pas rare d’entendre l’accent d’outre-manche se mêler aux conversations ordinaires des festivaliers au Narguilé, le bar-épicerie qui anime le village, le point chaud des after hours qui se prolongent chaque soir jusqu’à 3h du matin et plus si affinités, avec comme maître de cérémonie, Patrick, l’hôte idéal de ces fins de nuit parce qu’il garde l’esprit et son calme dans un lieu qui ressemble à la cabine des Marx Brothers dans Une Nuit à l’Opera. Cette année, les Belmondo boys comme l’orchestre de Raul De Souza et la formation de Claire Michael s’en sont donnés jusqu’à plus soif dans la jam animée avec talent par le trio de Dexter Goldberg. Nous n’avons pas assisté à la dernière soirée avec la formation Les Doigts de l’homme, et dont le point d’orgue était le concert avec Alain Jean-Marie et Sara Lazarus (Gilles Naturel, b; Philippe Soirat, dm); nul doute que la fête s’est prolongée tard dans la nuit en conclusion de cette édition.
Le Narguilé est aussi le lieu où les deux premiers jours se déroule le tremplin du jazz, une confrontation entre quatre groupes dont l’heureux élu inaugurera en 2020 la prochaine édition, comme ce fut le cas cette année pour l’excellent groupe Ultra Renard (Lucas Robin, vln; Morgan Bonnot, g; Priscilla Popiolek, g; Benjamin Clément,b) au milieu du village du Festival, en ouverture de cette 24e édition: au menu, le répertoire de Django Reinhardt intelligemment modernisé de «Nuages» à «Place de Brouckère» parmi d’autres classiques, des standards du jazz comme «Honeysuckle Rose», et, très réussi, un «Fable of Faubus» de Charles Mingus. Une découverte!
Pour le premier soir, c’est Sébastien Giniaux (g), l’animateur de la master class, et Cherif Soumano (kora) qui ont inauguré la grande scène d’une carrière bien remplie (la capacité est d’environ 500 à 1000 personnes selon les besoins) dans un duo intitulé «African Variations». Si ces deux musiciens, en particulier Cherif Soumano, sont des virtuoses de leur instrument, ce fut très long à notre goût en raison d’une volonté de démonstration technique, au détriment de la musicalité, qui n’a pas sa place dans un festival de jazz.
 Belmondo Quintet: Eric Legnini, Sylvain Romano, Stéphane et Lionel Belmondo, Tony Rabeson,
Belmondo Quintet: Eric Legnini, Sylvain Romano, Stéphane et Lionel Belmondo, Tony Rabeson,
Langourla, 2 août 2019 © Yves Sportis
La démonstration a ravi cependant le public qui en a redemandé, décalant sur le tard l’intervention du groupe phare de la soirée, le Belmondo Quintet (Stéphane, tp, flh; Lionel Belmondo, ts, ss; Eric Legnini, p; Sylvain Romano, b; Tony Rabeson, dm). Ce all stars a répondu à l’attente, malgré le refroidissement de l’atmosphère, très sensible pour les musiciens et le public. Si le concert en a quelque peu pâti, les musiciens ont délivré une belle musique, souvent intense, avec un premier thème attaqué à la conque par Stéphane, dédié à Yusef Lateef, en fait très coltranien dans l’esprit (en particulier par le son de Lionel, le jeu de Tony Rabeson). Le second thème, de Yusef Lateef himself, «Soul Backery», plus enlevé, puis avec un autre thème, en up-tempo dédié à Elvin Jones, et dont la forme restait coltranienne sur le fond. Stéphane Belmondo fit ensuite admirer sa sonorité au bugle, exceptionnelle, sur un beau standard, sans Lionel, avant de terminer sur un thème de Lionel où il a fait apprécier sa sonorité de saxophoniste, durablement marquée par l’univers coltranien. La section rythmique du quintet a été à l’unisson de ce bon concert, avec un excellent Tony Rabeson, parfait dans ce registre musical, d’intéressants Eric Legnini et Sylvain Romano. Quelques chorus leur ont permis de démontrer des qualités de sons et d’inspiration de haut-niveau. La fraîcheur de cette nuit n’incita pas au rappel, et c’est avec empressement que tout le monde, public, musiciens et organisation se retrouvèrent au Narguilé pour une nuit de musique, hot sur tous les plans.Le lendemain, c’est le trio vocal, La Vie en rose (Virginie Coutin, perc; Marie Mercier, p; Sophie Druais, b) qui ouvrit le bal en fin d’après-midi au centre du village du festival, dans un registre chanson jazzy. Le public apprécia une prestation pleine d’énergie et d’humour.
Claire Michael ouvrit la soirée sur la grande scène, avec une musique très écrite avec son compagnon de longue date, Jean-Michel Vallet, p. La matière se présente comme inspirée, encore une fois par John Coltrane, brillamment soutenue par un bassiste électrique de talent, Patrick Chartol, et un splendide batteur, Isaias Zaza Desiderio. En fait, malgré une sonorité de saxophones (Claire joue de tous les saxophones, de la flûte et chante ou vocalise) qui évoque le John Coltrane de l’album Crescent, les compositions et l’esprit font plutôt penser à un autre descendant de «saint John», Pharoah Sanders, bien plus qu’à Wayne Shorter revendiqué dans le programme. Claire Michael présentait à Langourla son nouveau projet, un ensemble de pièces courtes, modales, qui misent sur l’intensité du son, l’écriture soignée, les atmosphères. La puissance de la première inspiration fait place à une légèreté aérienne de ton à peu près générale («Vers la lumière», «Ce que c’est que l’amour», un complexe «Harpégic», «So Beautiful, So Lovely», «Mystical Way»), avec , changement de climat, un intense «Dream», où l’introduction et la conclusion laissent entendre la voix et le discours de Martin Luther King dans son fameux discours, et où Zaza Desiderio a offert un chorus exceptionnel soutenu par Patrick Chartol sur l’ostinato de «A Love Supreme» de Coltrane. Il parvient à faire chanter sa basse électrique. «La Mésange» fut la conclusion triste en référence au 13 novembre 2015… A noter un «Giant Steps», curieusement mis en place, pour rappeler au milieu de ce projet l’inspiration essentielle d’une bonne saxophoniste, originale et intègre dans son art. Sans doute en raison de la nouveauté et du caractère écrit, certaines parties ont paru parfois rigides sur le plan de l’expression; nul doute qu’avec le temps, la musique va mûrir et se libérer.
 Raul de Souza, Mauro Martins, Langourla, 3 août 2019 © Yves Sportis
Raul de Souza, Mauro Martins, Langourla, 3 août 2019 © Yves Sportis
La seconde partie fut, pour nous, le moment le plus musical de cette édition, le plus naturel aussi et d’une certaine manière le plus hot au plan de l’expression, avec la légende brésilienne, le tromboniste Raul de Souza, qui a côtoyé le gotha de la musique brésilienne, mais aussi nombre de musiciens de jazz dont Sonny Rollins (Nucleus, Milestone). Aujourd’hui à plus de 85 ans (1934), il possède si intimement son art qu’il n’a besoin ni de pupitres, ni de partitions –un plaisir pour les photographes et une liberté pour la musique– pour se lancer corps et âme dans son expression, entouré par d’excellents musiciens, tout aussi naturels: Glauco Sölter (elecb), qui danse de la première à la dernière seconde, joue le maître de cérémonie, présente en français avec un sourire éclatant. Il y a encore un batteur puissant et pourtant délicat, possédant un bon drive, Mauro Martins (il vit en Allemagne aux côtés de sa compagne, chanteuse lyrique). Il y a enfin un brillant Leo Montana (p), qui apporte son inventivité et sa virtuosité. Tous démontrent par leur cohésion autour de Raul et par de passionnants chorus, que cette musique et ces musiciens sont portés par une âme, un inconscient collectif.
 Leo Montana, Mauro Martins, Raul de Souza, Glauco Sölter, Langourla, 3 août 2019 © Yves Sportis
Leo Montana, Mauro Martins, Raul de Souza, Glauco Sölter, Langourla, 3 août 2019 © Yves Sportis Raul de Souza est un excellent tromboniste (trombone basse), doué d’une sonorité veloutée et puissante, d’une dynamique exceptionnelle sur ce gros instrument, d’une musicalité très brésilienne –il fait chanter et danser ses notes. Il a choisi de faire la synthèse entre la musique brésilienne de ses racines et une manière très jazz, voire de faire danser la musique de Thelonious Monk («Well You Needn’t»). A l’occasion au saxophone ténor, il intensifie son message sur «Equinox» de John Coltrane, avant de revenir au trombone, moment que choisirent Claire Michael et Zaza Desiderio pour le rejoindre sur scène pour une conclusion très chaude et joyeuse de cette belle soirée.
Raul de Souza nous a gratifiés de près de deux heures de musique avec une énergie que ne laissait pas soupçonner son grand âge: commencé par «Vila Mariana», le thème dansant qui inaugure Blue Voyage, le récent enregistrement de Raul (Selo Sesc 0119/18), le concert a non seulement évoqué le disque mais aussi débordé ce répertoire avec «Rio Loco», «Violão Quebrado», «Saudade do Frank», un bel hommage à Frank Rosolino, le virtuose du trombone disparu, ami de longue date de Raul, avec encore «Bossa Eterna», un thème de João Donato, tous enregistrés sur le précédent opus Brazilian Samba Jazz (2016). Il y a eu également un «Céu E Mar» de Johnny Alf et un grand chorus de trombone de Raul sur ce thème, puis « A Vontade Mesmo», avec une manière très jazz d’aborder le répertoire brésilien, même si musique et musiciens ne cessent de danser.
Autour de Raul, le talent, la prévenance, les sourires et la complicité des musiciens de son orchestre ont apporté à l’ensemble de la soirée un bon état d’esprit, le public faisant une standing ovation pour la générosité de Raul, de l’ensemble des musiciens et pour une musique qui a fait danser les étoiles.
 Jam in Langourla, Le Narguilé: 1/ Claire Michael, s; Zaza Desiderio, dm; Mauro Martins, b; Dexter Goldberg, p -
Jam in Langourla, Le Narguilé: 1/ Claire Michael, s; Zaza Desiderio, dm; Mauro Martins, b; Dexter Goldberg, p -
2/ Mauro Martins, dm; Glauco Sölter, b; Leo Montana, p, Langourla, 3 août 2019 © Yves Sportis
L’after hours, sans Raul qui récupérait de son concert, n’a pas manqué de piquant, et c’est encore à 3h du matin que musiciens et amateurs ont posé instruments et verres au Narguilé, après que Mauro (qui alterna la batterie et la basse), Glauco, Zaza, Claire, Leo, Dexter, Jean-Michel, Patrick, et beaucoup d’autres, venu(e)s faire la jam, aient gentiment enflammé une longue nuit de convivialité jazzique au pays des druides.
La suite, le dimanche, se passa sans nous, mais nul doute que Jazz in Langourla a poursuivi la fête pour le plus grand plaisir de tous. L’an prochain, c’est le quart de siècle, un important anniversaire en perspective, et on attend déjà ce que vont concocter Marie-Hélène, Gildas et leurs complices pour cette édition spéciale…
Yves Sportis
texte et photos
© Jazz Hot 2019
|

Isabella Lundgren (voc) à Solhällan,
Löderup, 3 août 2019 © Jérôme Partage
Ystad, Suède
Ystad Sweden Jazz Festival,
31 juillet - 4 août 2019
La 10eédition de l’Ystad Sweden Jazz Festival paraît être celle de la
maturité avec des fondamentaux bien
ancrés: convivialité, diversité des esthétiques jazz proposées, mais avec
toujours une prédominance pour un certain jazz européen (et scandinave) notamment
mis en avant cette année par la célébration des 50 ans du label ECM. Sur le
plan organisationnel, la quarantaine de concerts proposée se répartit, comme à
l’habitude, en une dizaine de lieux, dont trois situés en dehors d’Ystad, comme
«Solhällan», joli dancing en
rotonde des années 1900. On se réjouit d’ailleurs que le festival ait cette
année davantage investi son théâtre à l’italienne et délaissé le complexe
sportif de l’«Arena», peu propice au jazz. Une fois encore,
l’abondante offre du festival a permis de vivre d’excellents moments de jazz,
notamment par l’intervention de plusieurs big bands de qualité.
Le 31 juillet à 18h, nous avons ainsi abordé le festival dans la cour du Hos
Morten Café avec le quartet de Paul Strandberg (cl, voc), constitué de sa
compagne, la Française Kiki Desplat (cnt, voc), de Frans Sjöström (bs) et Tony
Balldwin (p). La cornettiste, qui a débuté sa carrière au début des années 1980
comme washboardiste et chanteuse, a élu résidence en Suède en 1995. Néanmoins,
elle se produit toujours ponctuellement en France avec le groupe féminin
qu’elle a fondé en 1983: Certains l’aiment chaud. Outre ses qualités
d’instrumentiste, elle a fait valoir son expressivité blues au chant,
notamment sur «Am I Blue», «Don’t Tell Me Nothing About My
Man» et «C’est si bon» (en français, of course). Au total, un sympathique orchestre de jazz dit
«traditionnel».
Paul Strandber Quartet (à gauche), Hayati Kafe & Roger Berg Big Band (à droite) © Jérôme Partage
Le 1er août, le concert de 11h se déroulait à
l’Ystads Teater pour cause de pluie. Un repli qui fut bienvenu car l’acoustique
du théâtre a permis de mieux apprécier le big band de Roger Berg (dm). Emule de
Gene Krupa et de Jo Jones, il a été formé à l’académie de musique de
Malmö et a appartenu, durant vingt ans, à l’orchestre du fameux parc
d’attraction Tivoli, à Copenhague. C’est en 2007 qu’il a monté son propre big
band de vingt musiciens tous originaires de la région du détroit d’Öresund (qui
sépare le Danemark de la Suède). Invité du Roger Berg Big Band, Hayati Kafe (né
à Istanbul en 1941) est un chanteur dont la popularité en Suède, depuis son
installation en 1962, ne s’est jamais démentie. Issu du monde de la variété, il
s’est aussi régulièrement produit avec de grands orchestres et son style
crooner convient bien au jazz. C’est donc avec un plaisir certain que l’on a
entendu «All of Me», «Somewhere Over the Rainbow»,
«Blue Skies», «Waltz for Debby» de même qu’une swingante version
instrumentale de «I Can’t Stop Loving You».

Jan Lundgren (p), Bjarke Falgran (vln), Sinne Eeg (voc), Jacob Fisher (g), Mads Mathias (voc),
Filip Jers (hca), Ystad, 1er août 2019 © Jérôme Partage
A
20h, toujours au théâtre, le festival proposait un hommage à Svend
Asmussen (1916-2017), immense figure du jazz scandinave. On se
souvient d’ailleurs qu’Ystad l’avait déjà célébré en 2016, alors que le
légendaire violoniste danois venait de fêter ses 100 ans (cf. notre compte-rendu) et avait fait la surprise d’y assister. Comme en 2016, c’est l’un de ses compatriotes et anciens compagnons de
route, l’excellent Jacob Fisher (g) qui
a mené ce tribute, à
configuration changeante, avec la finesse et l’humour qu’on lui connaît. Ellen,
la dernière épouse de Svend Asmussen, a dit quelques mots en introduction avant
de laisser place à un premier trio, bien dans l'esprit de la musique évoqué, constitué de Jacob Fisher, Filip
Jers (hca) et Bjarke Falgran (vln), soutenu par Hans Backenroth (b) et Kristian
Leth (dm). Nous avions déjà remarqué dans de précédentes éditions du festival
Filip Jers (1986), mais ce concert a pu nous donner la mesure de son talent.
S’inscrivant dans l’esprit de Toots Thielemans, il s’est trouvé à l’aise sur sa célèbre composition, «For My Lady»,
affichant une remarquable sensibilité. Jacob Fisher a ensuite été rejoint par
Mads Mathias, chanteur (et saxophoniste, mais pas ce soir-là) sans grand
relief, sur «Tea for Two», ainsi que –de façon impromptue– par Jan
Lundgren (p), que les doigts démangeaient, sur «The Nearness of
You». Le directeur artistique du festival d'Ystad démontrant toujours de remarquables
ressources sur les standards. Dernier protagoniste de cet hommage, Sinne
Eeg (voc), très convaincante dans ce registre, est dotée d’un beau grain de voix,
avec du caractère. Elle a
donné à entendre un réjouissant «Makin’ Whoopee» tout en complicité
avec Jacob Fisher et Filip Jers. Cette évocation réussie de Svend Asmussen
s’est achevée, en rappel, sur un tonique «It Don’t Mean a Thing»
collégial. On a, plus tard dans la
soirée, retrouvé avec plaisir certains des participants pendant la
jam-session.

Joey DeFrancesco (ts), Troy Roberts (b), Ystad, 1er août 2019 © Jérôme Partage
A 23h, Joey DeFrancesco (org, tp, ts) est venu présenter la
musique de son dernier album, In the Key
of the Universe (cf. notre chronique),
en trio, accompagné par Troy
Roberts (ts, b) et Khary Shaheed (dm), alors que le programme annonçait
Billy
Hart, batteur en titre sur le disque. Le fait est que Khary Shaheed ne
possède
pas la subtilité de son aîné et on regrettera tout au long du concert un
jeu
«viril» manquant de nuance. A l’inverse, Troy Roberts s’est montré
épatant
tant au ténor (superbe solo sur «In the Key of the Universe») qu’à
la contrebasse qu’il a surtout tenue lorsque le leader délaissait
l’orgue
Hammond pour la trompette et –nouveauté!– le saxophone ténor, instrument
adopté depuis sa récente collaboration avec Pharoah Sanders sur ce même
album: un concert d’une grande intensité de Joey DeFrancesco pour cette
deuxième soirée.
 Mathias Algotsson (p), Claes Brodda (ts), Karl Olandersson (tp), Anders Norell (tb), Ronnie Gardiner (dm),
Mathias Algotsson (p), Claes Brodda (ts), Karl Olandersson (tp), Anders Norell (tb), Ronnie Gardiner (dm),
Claes Askelöf (eg), Ystad, 2 août 2019 © Jérôme Partage
Le 2 août, le concert de 11h retrouvait ses quartiers
habituels dans la jolie cour fleurie de Per Helsas Gård. Le batteur américain
Ronnie Gardiner, établi en Suède de longue date, s’y produisait avec son
septet: Karl Olandersson (tp), Anders Norell (tb), Claes Brodda (ts), Claes
Askelöf (eg), Mathias Algotsson (p) et Han Larsson (b, voc). Nous avions déjà eu
l’occasion d’entendre à Ystad Ronnie Gardiner et ses musiciens, en particulier
les deux benjamins du groupe, dotés d'un sens du swing aigü: Mathias Algotsson
et Karl Olandersson (vu l’année dernière avec le bon trio de l’organiste Andreas
Hellkvist). Des qualités que le leader a souhaité mettre en avant, en milieu de
concert, en interprétant en leur seule compagnie «In a Mellow
Tone». On a sinon profité de versions dynamiques de «Blues on
Down», «St. Louis Blues» (avec une intervention au
chant, bluesy, du contrebassiste), «The More I See You» ou encore d’un
«Caravan» sur tempo rapide où se faisait sentir la pulsation de
Ronnie Gardiner, lequel a également donné un chorus foisonnant sur ce titre.
A 17h, au théâtre, le Norrbotten Big Band jouait une
adaptation jazz de Pierre et le Loup (Prokofiev), à destination
du jeune public. Ce grand ensemble suédois existe
depuis 1986 et eut pour premier directeur le vibraphoniste et
compositeur Örjan
Fahlström (jusqu’en 1996); il est aujourd’hui conduit par Joakim Milder
(s, comp, arr). L'orchestre a mené des collaborations avec divers
artistes de jazz: Carla Bley,
Randy Brecker, Kurt Elling, Toots Thielemans ou encore Nils Landgren. Il
comporte quelques solides solistes, dont Håkan Broström (as, ss) dont
on avait pu également apprécier la présence à la jam, la veille. La
version
proposée du conte musical (lu par la comédienne Beatrice Järås) est
restée
relativement proche de l’original, le jazz ne surgissant vraiment
qu’avec les
improvisations individuelles ou collectives des solistes.
 Richard Galliano (acc) et Paolo Fresu (tp), Ystad, 2 août 2019 © Jérôme Partage
Richard Galliano (acc) et Paolo Fresu (tp), Ystad, 2 août 2019 © Jérôme Partage
A 20h, Jan Lundgren (p) conviait deux habitués du festival,
Richard Galliano (acc, melodica) et Paolo Fresu (tp, flh) pour le troisième
chapitre de leur Mare Nostrum (dont
l’enregistrement est sorti chez ACT). Le Sarde est apparu en tenue
particulièrement décontractée, due à la perte de ses bagages par la compagnie
aérienne (c’est la troisième fois que cette mésaventure lui arrive, en cinq
participations au festival d’Ystad: record à battre!). Après ce
sourire, le trio, bien rôdé (en douze ans d’existence), a
déroulé d’élégantes compositions –la plupart dues au pianiste– dont le
pétillant «Chapitre» distillant des ambiances de fête foraine et de
cirque. Seul standard joué, «Les Moulins de mon cœur» a mis en
avant la grande musicalité de Richard Galliano, lequel s’est amusé à citer la
célèbre chanson «Titine» de Charlie Chaplin dans Les Temps Modernes. Un joli voyage musical, hors des terres du
jazz, mais porté par trois interprètes aux personnalités marquées.
Le 3 août, à 11h, à Per Helsas Gård, la chanteuse Hannah
Svensson présentait la musique issue de son dernier album, Places and Dreams, soit pour
l’essentiel des compositions relevant de la variété jazzy et dont le titre le
plus intéressant fut «Friday Afternoon». Elle était en cela
accompagnée de son père, Ewan Svensson (g), Matz Nilsson (b), Zoltan Czörsz Jr.
(dm) et Jan Lundgren (p) en special guest.
A
18h30, nous nous sommes rendus à Löderup, à 20 km d’Ystad,
dans le dancing historique de Solhällan pour écouter Isabella Lundgren
(voc), la révélation de l’édition 2013 et qui avait, deux ans plus
tard, participé, non sans y être remarquée, à la fête des 80 ans de Jazz Hot, à l’occasion d’un
voyage à Paris. Le répertoire abordé était plus pop que
jazz. Hormis le premier
morceau «Blowin’ in the Wind» de Bob Dylan, pris joliment a capella, on a été déçu de ne pas retrouver la talentueuse chanteuse de jazz Isabella Lundgren.

Joakim Milder (lead), Benny Golson (ts), Håkan Broström (as, à droite)
et le Norrbotten Big Band, Ystad, 3 août 2019 © Jérôme Partage
|

Benny Golson (ts), Ystad,
3 août 2019 © Jérôme Partage |
A 20h, à l’Ystads Teater, nous retrouvions le Norrbotten Big
Band, avec un invité exceptionnel: Benny Golson. A 90 ans, le ténor
affiche un esprit et un humour toujours vifs. Comme c’est désormais le
cas, il passe du temps en scène à se raconter à travers de savoureuses
anecdotes, mais il conserve un son net et suave qui a fait sa gloire. C’était au
big band qu’incombait la tâche de mettre en relief les célèbres standards créés par
Benny Golson: «I Remember Clifford», «Whisper
Not» (flamboyant), «Killer Joe» ou encore «Blues
March» qui ont électrisé le public pour un grand moment de bonheur, servi par un big band de jazz à la hauteur de l'événement.

Anke Helfrich (ep), Lisa Wulff (b), Dorota Piotrowska (dm), Caecilie Norby (voc),
Hildegunn Øiseth (tp), Nicole Johänntgen (ts), Ystad, 3 août 2019 © Jérôme Partage
A 23h, la Danoise Caecilie Norby (voc) donnait à entendre
son dernier projet, Sisters in Jazz (CD paru chez ACT), entourée d’un groupe entièrement féminin: la
Norvégienne Hildegunn Øiseth (tp, cor norvégien), les Allemandes Nicole
Johänntgen (ts), Anke Helfrich (p, ep), Lisa Wulff (b) et la Polonaise
Dorota
Piotrowska (dm). Si la carrière de la chanteuse, souvent associée à
celle de
son compagnon Lars Danielsson (b) –également présent cette année à Ystad
pour
deux concerts hors jazz– est des plus éclectiques, le jazz a bien été au
centre de ce concert –fait d’originaux et de reprises–, servi par
une rythmique qui connaît le swing, la jeune
Lisa Wulff en particulier, et par deux soufflantes toutes à leur affaire
(une mention spéciale
à Nicole Johänntgen au jeu d’une belle intensité et teinté de blues).
Quant à Caecilie
Norby, elle a livré une prestation de haut niveau; ses
interactions avec le groupe, ses qualités d’expression et sa façon
originale de
scatter (à la façon d’une percussionniste, comme sur «Girl Talk») en
font une artiste complète. Elle ne s’en est pas moins
quelque peu éloignée du jazz en fin de concert, en maniant des
percussions
orientales, en s’adonnant au chant lyrique (sa mère était
cantatrice) et en donnant, en rappel, une version alanguie du tube de
Leonard
Cohen, «Hallelujah».
La dernière journée du festival, le 4 août, a démarré tôt, à
9h, dans l'abbaye d’Ystad, construite au XIIIe siècle. Nicole Johänntgen
(ts, Jazz Hot n°675)
nous y avait en
effet donné rendez-vous pour une performance en solo à laquelle
l’ambiance introspective des lieux se prêtait fort bien. Ce fut un
concert donné d’un trait, soit une
improvisation continue (avec un thème récurrent) d’une trentaine de
minutes. Une
méditation à la frontière entre le jazz et la musique répétitive de
Philip
Glass, compositeur contemporain américain.
 Jill Johnson (voc) et le Monday Night Big Band, Södve, 4 août 2019 © Jérôme Partage
Jill Johnson (voc) et le Monday Night Big Band, Södve, 4 août 2019 © Jérôme Partage
A 14h, le Monday Night Big Band d’Anders Berlung –un
orchestre créé en 1998 et qui tourne essentiellement dans le sud de la Suède– se
produisait avec Jill Johnson (voc) dans le vaste amphithéâtre de verdure de
Södve, à 25 km au nord d’Ystad. En dépit d’ondées passagères (mais le public
suédois est résistant aux intempéries), les travées et le parterre étaient
combles. Appartenant à l’univers du rock et de la country, Jill Johnson possède
un joli timbre bluesy, au caractère affirmé, qui en fait une chanteuse de jazz
plus que correcte. Le répertoire était constitué de standards particulièrement
populaires («Everybody Loves Somebody», «I Will Wait for
You», «Moon River», «Et
maintenant»…) qui ont ravi l’assistance –très
familiale; certains engageant quelques pas de danse. Un concert bon
enfant dont même le duo vocal entre Jill Johnson et Anders Berlung (pourtant
médiocre chanteur), sur «Cheeck to Cheeck», s’est avéré
sympathique.
A 16h, dans la salle de réception de l’hôtel de Saltsjöbad,
sur la plage d’Ystad, la soul sirupeuse du Brésilien Ed Motta était à
l’honneur. Cette prestation était à réserver aux amateurs du genre, lesquels
eurent cependant à supporter une sonorisation beaucoup trop forte.

Omar Sosa (p), Geir Lysne (lead, de dos) et le NDR Bigband, Ystad,
4 août 2019 © Jérôme Partage
|

Luigi Grasso (bcl), Ystad,
4 août 2019 © Jérôme Partage |
Mais le 10e festival d’Ystad nous avait réservé un final très réussi, au théâtre. A
18h, Omar Sosa (p, ep), accompagné de sa rythmique cubaine, interprétait ses
propres compositions provenant de ses différents albums. Il recevait pour cela
le renfort du NDR Bigband, une véritable institution issue de la radio publique
NDR basée à Hambourg. Depuis 2016, l’orchestre est dirigé par le Norvégien Geir
Lysne (s, fl, comp, arr). Nous avons par ailleurs eu la (bonne) surprise de reconnaître au sein de
la section des saxophones le talentueux Luigi Grasso (bar, bcl, Jazz Hot n°675) qui a récemment quitté
Paris pour s’installer à Hambourg, après avoir intégré le big band. De fait, le
NDR Bigband est un ensemble de haut niveau et se situe un cran au-dessus des
autres big bands entendus durant la semaine, tant par la qualité de ses
solistes que par son intensité orchestrale. L’alliage avec Omar Sosa a ainsi
fort bien fonctionné, le big band fournissant puissance et ampleur à la musique
du Cubain, lequel y amenait sa pulsation singulière.

Charles Lloyd (ts), Ystad,
4 août 2019 © Jérôme Partage
Enfin, à 22h, c’est Charles Lloyd (ts, fl) qui a conclu en beauté
ces cinq jours de festival, avec un groupe à deux guitares (Julian Lage, Marvin
Sewell, eg, Reuben Rogers, eb, Eric Harland, dm) en lieu et place du piano
longtemps occupé par Jason Moran, tandis que Reuben Rogers et Eric Harland (absolument
épatant) restent indispensables quels que soient les projets enchaînés depuis
dix ans. La résultante de cette formation originale est une dominante blues, superbement
incarnée par Marvin Sewell, comme un retour aux sources pour le saxophoniste de
Memphis. La complémentarité avec Julian Lage –subtil et musical– est au
cœur de la dynamique de ce quintet dont le leader, allant de l’un à l’autre de
ses partenaires, à l’écoute de leurs interventions, est non seulement la
clé de voûte mais aussi le premier auditeur. Impérial au ténor, Charles
Lloyd, tout en légèreté à la flûte, demeure à 81 ans un maître en constant
renouvellement.
Jérôme Partage
Texte et photos
© Jazz Hot 2019
|

Cotton Club, Hambourg, 30 juillet 2019
© Jérôme Partage
Hambourg, Allemagne
Cotton Club, 30 juillet 2019
Deuxième plus grande ville d’Allemagne et deuxième port
d’Europe, Hambourg alterne grandes artères à l’architecture massive et
quartiers conviviaux où il fait bon flâner et prendre une bière en terrasse. La
ville compte plusieurs clubs de jazz: le Birdland, le Jazzclub-Bergedorf,
le Jazz Federation Hamburg et le Cotton Club que nous avons découvert à
l’occasion d’un bref séjour. Créé en 1959, il s’est d’abord appelé le Vati's
Tube Jazzclub, avant d’être renommé Cotton Club en 1963. Il a par ailleurs été
l’objet de déménagements successifs avant de s’établir à son adresse actuelle
en 1971. Installée en sous-sol, la salle
de concert se trouve au bout d’un couloir, après que l’on ait passé le bar. Ses
murs sont ornés de photos souvenirs des groupes qui en on fait l’histoire, tous
issus du jazz dit «traditionnel»(new orleans, swing,
tradition Django): quelques «légendes» américaines comme
Benny Waters (s, cl), Alton Purnell (p), Louis Nelson (tb) et beaucoup de formations
allemandes, mais également polonaises, scandinaves, britanniques (Sammy
Rimington) ou françaises (René Franc). La scène, placée au centre de la salle permet
à chacun d’apprécier le spectacle et renforce le caractère chaleureux du club.

Le Traditionnal New Orleans Ensemble, Cotton Club, Hambourg,
30 juillet 2019 © Jérôme Partage
Nous étions présents le 30 juillet pour entendre le Traditionnal
New Orleans Ensemble, constitué d’Uli Falk (tb, voc, lead), Karsten Ettling
(cl, ts), Holger Bundel (p) et Kurt Tomm (b), tous musiciens
semi-professionnels. Fondé en 1979 (c’était alors un septet), cet ensemble a
connu un second démarrage il y a dix ans, sous l’impulsion Uli Falk, seul
membre originel avec Kurt Tomm; Karsten Ettling et Holger Bundel les
ayant rejoints il y a seulement deux ans. Le Traditionnal New Orleans Ensemble se
produit essentiellement dans le nord de l’Allemagne, autour de Hambourg et de
Kiel. Si son activité, de l’aveu de son leader, est aujourd’hui modeste, une
profonde conviction anime ces musiciens. Portés par le jeu très percussif du
contrebassiste, le duo clarinette/trombone fonctionne bien. On a ainsi entendu
des interprétations dynamiques de «Pennies From Heaven» (Johnny
Burke/Arthur Johnston, 1928) ou de «Tin Roof Blues» (New Orleans
Rhythm Kings, 1932). On relèvera également les bonnes interventions vocales du
leader, lesquelles ne manquent pas de caractère.
Jérôme Partage
Texte et photo
© Jazz Hot 2019
|
Toulon, Var
Jazz à Toulon, 30e Edition, du 19 au 28 juillet 2019
Yes,
we can!!! La formule, quoique bien usée, pourrait être la devise de l’équipe du
COFS qui faisait le pari, une certaine année ’89, de mettre sur pieds un festival
de jazz entièrement gratuit, à deux pas des grandes machines de la Côte-d’Azur.
Débuts discrets, mais la presse a vite fait de s’attacher à ce «Jazz is Toulon» devenu «Jazz à Toulon»
qui se démarque par sa volonté d’ouverture au public le plus large sans céder aux
effets de mode.
Et
trente ans après, par l’addition de volonté et de bonnes volontés,
d’engagement, de programmation de qualité, juillet respire encore le jazz, un
jazz rassembleur et convivial qui remue l’amateur comme le passant curieux. La
ville se prête au jeu, avec ses places qui trouent le lacis des ruelles du port;
pas de problème pour les décors: une longue histoire a parsemé la vieille ville
de façades idéales qui jouent avec la lumière, tandis que la grande scène du
Mourillon s’offre l’horizon de la mer…
L’édition
2019 s’inscrit dans la continuité des 29 autres: donner à découvrir ce qui
émerge de la scène jazz locale, nationale ou internationale, que ce soit à la
marge ou in the tradition, faire
voyager, enrichir, surprendre… Cette année, 17 groupes se partageaient la
tâche, des animations ambulantes aux concerts de l’après-midi et du soir. Les
tendances: du côté de la tradition revisitée, le public pouvait suivre
dès le matin dans les travioles du port le quartet Swing Pocket Manouche pour
une balade sur la piste de Django, ou s’offrir un petit détour par New Orleans
en croisant l’Angel City Players de Michael Steinman sur un répertoire teinté
de funk.
En point d’orgue de cette édition très spéciale, la soirée
dédiée de l’hommage à Michel Petrucciani qui illumina de la plus belle
des manières la première édition, il y a 30 ans…
 30e Jazz à Toulon, hommage à Michel Petrucciani: Stéphane Bernard, Louis et Philippe Petrucciani, Sylvain Ghio,
30e Jazz à Toulon, hommage à Michel Petrucciani: Stéphane Bernard, Louis et Philippe Petrucciani, Sylvain Ghio,
Jazz à Toulon, 28 juillet 2019 © Ellen Bertet
Roots encore, avec le trio Po’ Boys, groupe
festif et local de trois compères fous de blues, qui nous en content l’histoire
avec énergie par les voix de Claude Philip dit «Poupa Claudio»
(voc, g), Didier Francisci dit «King Didou» (voc, hca), Philippe Thevenin dit
«Daddy Yoggy» (perc).
Nostalgies. Le quartet Ananda Revival (Romain Thivolle, g; Geoffrey Nicolas, kbd; Jean-Christophe Gautier, b; Rudy Piccinelli, dm) est une
fusion de générations réunies autour d’un projet, faire revivre le jazz
électrique des années 1970, avec deux vieux routiers des circuits jazz et deux
jeunes musiciens passionnés, tandis que Spirale trio tourne avec bonheur son
regard vers un jazz acoustique inspirés des années 1980 avec Laurent Rossi (p),
Philippe Brassoud (b), Jérôme Achat (dm).
Précédant l’hommage à Michel
Petrucciani, le trio acoustique d’Alexis Tcholakian (Alexis Tcholakian, p; Lilian Bencini, b; Cedrick Bec, dm) délivre une musique fluide
et apaisée, où se mêlent standards, thèmes de Michel Petrucciani et ses
compositions personnelles, que l’on retouvera sur le volume 2 d’Inner Voice, un enregistrement qui sort en septembre prochain.
Les
concerts du soir ont, comme à l’habitude, fait quelques détours par
l’Afrique, la terre ancestrale, mais aussi par l’Amérique latine,
l’Europe et les Etats-Unis, avec la mauvaise surprise (à Toulon, la
pluie est rare) d’avoir eu à annuler le concert de Kenny Garrett le 27
juillet… Petit rappel de ce tour du monde:
Le 19 juillet, pas de jazz sans l’Afrique! le
retour aux sources est assuré par Manu Dibango qui, à 85 ans, guide toujours
l’afro-jazz à la tête de son Soul Makossa Gang, avec en special guest Manou
Gallo, ex bassiste de Zap Mama. Energie et partage restent les leitmotiv de
Papa Groove, qui poursuit son chemin de passeur infatigable entre l’Afrique,
l’Europe et les USA.
Le 20 juillet, sur un autre versant de la mixité
musicale, l’Afro Blue Project du chanteur et compositeur britannique Randolph
Matthews est à la fois héritier de la soul, du jazz new orleans et du blues
contemporain électrique. Avec une forte personnalité scénique, Randolph
Matthews joue de sa voix et de son corps avec une gestuelle, un scat et des
vocalises qui évoquent fortement Bobby McFerrin.
Le 22 juillet, le tour du monde se poursuit et on
aborde le continent du jazz latin, avec le pianiste franco-péruvien et enfant
de Toulon Manu Guerrero. Longtemps sideman de vedettes de la variété française,
il se tourne avec bonheur vers le jazz avec son dernier album Nuevo
Mundo.
Le 23 juillet, à un peu moins de 30 ans, la chanteuse
franco-brésilienne Agathe Iracema a déjà une longue expérience de la scène,
elle écrit ses thèmes et dirige son groupe depuis 2011. Ses atouts sont
nombreux et indéniables: une voix naturelle et tonique, un vrai feeling et une
facilité d’expression aussi bien dans le jazz que sur les bossas, ses deux
cultures.
Le 24 juillet, Django toujours, qui fut un familier des places toulonnaises, sous les doigts du
surprenant trio de Théo Ceccaldi (vln),
Valentin Ceccaldi (cello) et Guillaume Aknine (g). Victoire de la musique 2017, Théo Ceccaldi
réunit des influences très diverses, classique, jazz, musique improvisée et
jusqu’au rock, pour une musique très travaillée, baroque et exubérante. Une création
aux divagations réjouissantes.
Le 25 juillet, cross over jazz-classique avec la
belle rencontre entre le quintet de Riccardo del Fra et l’Orchestre Symphonique
de l’Opéra de Toulon. Rencontre improvisée, mais pas un territoire étranger
pour Riccardo qui, issu du conservatoire, a gardé des liens avec le monde du
classique tout au long de sa carrière dans le jazz.
Le 26 juillet, Tony Allen, pionnier et prophète de
l’afro-beat, illustre un troisième volet de cette capacité à s’imprégner de
cultures pour en extraire un élixir personnel. Après un parcours dans le funk,
Tony Allen revient à un jazz cuivré avec son dernier disque, The Source,
en hommage à Lester Bowie et Charlie Mingus.

Louis et Philippe Petrucciani, Jazz à Toulon, 2019 © Ellen Bertet
Nous nous sommes concentrés sur l’événement de la 30e saison de Jazz à
Toulon qui se clôt sur le concert «coup de cœur», l’hommage à Michel
Petrucciani, porté par ses deux frères Philippe (g) et Louis (b), et le quintet
composé de Stéphane
Bernard (p), Sylvain Rifflet (s), Olivier Miconi (tp), Mathias Allamane (b) et
Sylvain Ghio (dm), dont certains anciens élèves des workshops des années 1990. Cette rencontre unique, préparée pour
le festival, était un double anniversaire: celui de la venue de Michel
Petrucciani à Toulon lors de la création en 1989, et un autre, plus triste,
celui des 20 ans de la disparition du pianiste en 1999.
Pour évoquer la carrière musicale de leur
frère, Philippe et Louis Petrucciani se présentent en scène, seuls, Louis
d’abord pour un solo de contrebasse, puis Philippe à la guitare pour un «Brazilian
Like» tout en nuances, porteur de souvenirs. Le quintet les rejoint et
les suit sur quelques thèmes, puis occupe seul la scène faire revivre le
répertoire de Michel Petrucciani. Les «jeunes» ont avancé dans la
vie et dans l’expression, mais ont en commun une solide culture jazz: Olivier Miconi (tp) a été aperçu dans le Mojo Workin’ Band, une fanfare jazz aux
accents caribbéens, et dans l’Attica Blues Big Band d’Archie Shepp. Sylvain
Rifflet, titulaire d’un Django d’Or, ne compte plus les expériences et les
incursions dans la musique expérimentale, sinon minimaliste. Mathias Allamane
est un multi-instrumentiste et sideman recherché pour son adaptabilité,
bassiste préféré d’Eric Legnini. Sylvain Ghio, batteur et percussionniste virtuose,
d’une musicalité assez étonnante, complète la rythmique. Le rôle principal a été confié à Stéphane
Bernard, dont le jeu, resté dans la ligne d’un jazz classique, précis et
volubile, se prête idéalement à l’évocation du pianiste disparu.
Ce fut un hommage, parfois grave mais
sans tristesse, sans contrainte non plus, chacun prenant sa part de liberté
autour des thèmes de ou immortalisé par Michel Petrucciani : «Training»,
«Estate» ou «100 Hearts»… Tout le monde se rassemble
autour de Philippe et Louis Petrucciani sur «A Little Piece in C for
You» pour un final généreux, joyeux et très applaudi.
Olivier Miconi, Stéphane Bernard, Sylvain Rifflet, Mathias Allamane, Philippe Petrucciani, Jazz à Toulon 2019 © Ellen Bertet
Une conclusion très émouvante pour cette édition-anniversaire
de Jazz à Toulon: en ces temps où la culture et la mémoire ne
pèsent plus très lourd dans la vision de technocrates mercantiles, et où
«gratuit» sonne comme un blasphème ou un label de médiocrité, Jazz à
Toulon renverse les préjugés, et reste une respiration essentielle, une
exception culturelle à la française qui démontre que Yes, we can!!!
Ellen Bertet
Texte et photos
© Jazz Hot 2019
|

Chucho Valdés, Marseille Jazz des Cinq Continents 2019,
© Michel Antonelli
Marseille, Bouches-du-Rhône
Marseille Jazz des Cinq Continents,
17-27 juillet 2019
Il est agréable de constater que pour fêter en fanfare sa 20e année, le festival de Marseille a mis les moyens et multiplié les performances. Désormais il intègre dans sa mission une série de partenariats avec des concerts et événements qui se déroulent dans tout le département des Bouches-du-Rhône et dans des parcs marseillais. Dès le 8 juin, Carry-le-Rouet ouvrait le ban avec un concert de Kellylee Evans, tandis que la diva Melody Gardot clôturait cette édition dans les Jardins du Palais Longchamp. Au programme, plus de 40 formations allant du soliste à l’énorme plateau des 12 formations de John Zorn (soit plus de 30 musiciens). La qualité des prestations fut servie tant par des jeunes formations issues de la région (Nicolas Koedinberg Quintet) que par l’immense star internationale, Chucho Valdés. Expositions, films et conférences ont complété les événements dont un bon nombre en accès gratuit.
Le festival fut lancé par un concert gratuit, le 17 juillet, qui rassembla un vaste public. Le lieu symbolique du Parvis des Archives et Bibliothèque Gaston-Defferre s’est transformé en un espace festif parfait pour accueillir un plateau aux multiples langages allant du groupe Delgrès, du duo de Mino Cinelu (perc)/Nils Petter Molvaer (tp) pour se terminer en beauté avec la rencontre du groupe Papanosh qui accueillait Roy Nathanson (s, voc) et Napoleon Maddox (voc).
Se voulant ancré dans un courant moderne, ouvert aux influences des musiques actuelles et du monde, l’esprit du festival était symbolisé par la carte blanche offerte à l’accordéoniste Vincent Peirani, le 18 juillet, qui combinait un riche mariage entre le jazz et des thèmes de différents pays servis par un plateau international avec le pianiste cubain, Harold Lopez Nussa, le batteur italien, Michele Rabia, le saxophoniste syrien, Basel Rajoub, le guitariste norvégien Elvin Aarset, soutenus par Vincent Segal (cello, b), Ballaké Sissoko (kora) et Stéphane Huchard (dm). Avec simplicité et talent, l’accordéoniste, a rempli son contrat en nous faisant voyager de l’Italie au Mali, en passant par le Brésil, la Serbie ou encore les terres celtiques. Sur la Corniche, dans le cadre à l'antique du Théâtre Sylvain, cette création trouva le lieu idéal pour recevoir une véritable ovation.
Thomas Dutronc (g) et ses Esprits Manouches, le 19 juillet, et Chilly Gonzales (p, voc), le 20 juillet –concerts complets– firent aussi vibrer les gradins où un public de tous âges et très enthousiaste partagea son plaisir.
Les toits du Mucem et du Fort St-Jean ont accueilli, le 21 juillet, en front de mer, les prochaines escales offertes par Samy Thiebault (ts) avec son nouveau projet Caribbean Stories, le trio d’Omri Mor (p), le duo d’Elia Duni (voc) et Rob Luft (g) et un final flamboyant du Donny McCaslin (ts) Quintet qui revisitait son nouvel album, Blow.
Le 22 juillet, pour le retour sur la grande scène des Jardins du Palais Longchamp, le festival fit le pari de remonter sa production Marius et Fanny, un opéra jazz à partir de l’œuvre de Marcel Pagnol, dont la musique a été composée par Vladimir Cosma, où brilla un tonique big band autour des voix de d’Hugh Coltman, Irina Baïant, André Minvielle, The Voice Messengers et du conteur Tom Novembre.
Le 23 juillet, en lever de rideau du splendide Marcus Miller, le jeune chanteur José James rendit hommage à Bill Withers dans un rhythm’n’blues lorgnant vers le rap; à signaler, le guitariste Marcus Machado évoquant l’âme de Jimi Hendrix.
Marcus Miller (eb), comme à son habitude, fut brillant et proposa l’intégrale de son Laid Black Tour 2019 évoquant aussi l’esprit de Miles Davis avec la reprise de «Bitches Brew». Un grand groupe de funk/rhythm’n’blues au service d’un son moderne où chacun des musiciens eut son moment de gloire.
La soirée du 24 juillet célébrait les 20 ans de la Cie Nine Spirit, dirigée par Raphaël Imbert (s) et présenta la continuité de leur travail aux racines du blues avec comme invité spécial le guitariste-chanteur Eric Bibb. Le gâteau d’anniversaire fut à la hauteur de ses espérances.
Autre tradition, plus proche du rock, The Good, the Bad and the Queen, animé entre autres par Damon Albarn (chanteur de Gorillaz) emprunta des formes inédites pour célébrer leur dernier album Merrie Land et offrir une version riche et bigarrée notamment avec l’apport du batteur Tony Allen.
Le voyage continua, le 25 juillet, avec le septet du guitariste Juan Carmona qui chauffa l’atmosphère dans l’attente du magnifique Chucho Valdés.
Le pianiste cubain, habitué du festival proposait son projet Jazz Bata véritable machine rythmique des traditions cubaines ou chacun des percussionnistes nous enivra de sa folie. En grand maître de cérémonie et avec un talent inégalé, Chucho Valdés invita Yilan Cañizares (vln) et Kenny Garrett (ss, ts) qui chacun excellèrent sur des tempos dansant et festifs. Autre invitée de marque pour deux titres, la légendaire chanteuse Omara Portuondo dont le charme opère toujours et qui, avec son «Besame Mucho», fit lever le public. Chucho Valdés évoqua aussi la musique de son ami Michel Legrand, avec lequel il avait partagé en duo cette même scène et «tous les moulins de nos cœurs» firent des grandes envolées. Chucho Valdés a sans doute donné ce soir-là l’un de ses meilleurs concerts depuis son époque d’Irakere.
Le 26 juillet, changement d’atmosphère avec un plateau entièrement composé par John Zorn (as) qui présenta 33 musiciens répartis en une douzaine de formations et/ou solistes qui gravitent autour de sa planète musicale. Le projet baptisé Bagatelles Marathon (petite forme musicale dans la musique classique) est devenu motif à démontrer que les musiques, même dites ardues, peuvent se jouer devant un large public. Les différentes formules, dont certaines purent paraître difficiles, remportèrent l’adhésion du public qui pour ce marathon musical eut l’occasion d’être assis.
Et c’est une soirée féminine qui clôtura cette 20e édition, le 27 juillet. Sous un ciel menaçant, Fiona Monbet, jeune virtuose du violon, subjugua le public dans un répertoire issu de son nouvel album Contrebande. De tradition plus classique, elle rejoint l’esprit de ses maîtres, notamment Didier Lockwood. Son jeune quartet est à suivre.
Melody Gardot, toujours classe, nous offrit une version plus acoustique de son Live in Europe. A ses côtés, outre le violoncelle Artyom Manukyan renforcé d’un trio de violonistes arméniens qui donnèrent une couleur particulière au répertoire, le guitariste Longue Mitchell apporta une grande liberté. La soirée était parfaite jusqu’au moment où hélas le concert, sous la pluie, dut s‘interrompre.
Marseille Jazz des Cinq Continents, par son amplitude, fait désormais parti des grands festivals. Son ouverture vers le public, par des manifestations gratuites, mais aussi des participations à différents concerts hors les murs et une programmation variée comme avec John Zorn, s’inscrit désormais dans les moments forts de l’été sudiste. Remarquons l’implication grandissante de son rôle de production sur certains des projets qui vont sans aucun doute tourner en dehors du Sud dans les temps à venir.
Michel Antonelli
Texte et photo
|
Pléneuf-Val-André, Côtes-d'Armor
Jazz à l’Amirauté 2019, les mardis de juillet et d’août
On ne présente plus la charmante station balnéaire des Côtes-d’Armor (cf. nos précédents comptes rendus) à l'extrémité ouest de cette belle côte d’Emeraude, où se déroule depuis plus de vingt ans (24e édition), un festival de jazz sans concession commerciale, dans un parc très début de XXe siècle, avec des essences rares et un club de tennis, encore en terre battue, au centre duquel se trouve le château de l’Amiral qui fut le donateur de l’ensemble à la collectivité et qui a donné son nom à ce festival.
Sous les grands pins (essences rares) qui l’entourent, la scène se donne des allures de pinède (suivez mon regard!) et le jazz qui est proposé à une belle assistance (au delà de 1000 spectateurs chaque soir) rappelle qu’il est toujours possible de réunir un large public non spécialiste et populaire en programmant du jazz, du vrai, qui tire ses racines de la longue histoire d’amour que la France entretient avec cette musique venue du fond de l’Amérique.
L’originalité de ce festival, outre sa gratuité, est de réunir, tous les mardis des mois de juillet et d’août dans un cadre parfait, autant par son confort que pour l’écoute, amateurs de jazz, autochtones, public en vacances et musiciens de jazz, avec autant de plaisir pour les uns que pour les autres. Les conditions techniques sont aussi réunies (accueil, éclairage et son) pour parfaire cet événement.
On doit cette réussite qui dure maintenant depuis près d’un quart de siècle à une association, Jazz à l'Amirauté, d’une trentaine de bénévoles, tout aussi sympathiques, accueillants et efficaces les uns que les autres, une équipe que le responsable Elie Guilmoto anime avec doigté et avec le sourire. Ici, la convivialité est le maître-mot: donc pas de gros bras, de file d’attente, de tensions et de VIP. Tout concourt à faire de la soirée un pur moment de jazz et de plaisir partagé; les enfants (4 à 8 ans) ayant le privilège d’assister au concert au premier rang, et apprenant ainsi, année après année, l’attention, l’écoute de la musique en toute simplicité. Cette année, les commerçants se sont davantage impliqués dans le festival, et le résultat en est une meilleure visibilité dans la cité, le personnel de plusieurs établissements partenaires arborant le tee-shirt aux couleurs du festival.
 Festival Jazz à l'Amirauté 2019, le trio Philippe Duchemin invite Carl Schlosser © Yves Sportis
Festival Jazz à l'Amirauté 2019, le trio Philippe Duchemin invite Carl Schlosser © Yves SportisCe mardi 30 juillet 2019, nous avons assisté à la soirée dévolue au parrain du festival depuis de nombreuses années, le pianiste Philippe Duchemin, qui a toujours le souci de renouveler ses formules, ses formations, et qui propose ainsi, chaque année, d’excellents concerts avec des invités de marque, une année une chanteuse, une autre année un quatuor à cordes ou des instrumentistes réputés, toujours autour de son trio, la formule de base qu'il affectionne, dont les membres varient selon les projets.
En 2019, entouré d’une rythmique exceptionnellement soudée à la ville comme à la scène, car il s’agit des frères Christophe (b) et Philippe (dm) Le Van, jumeaux comme le révèle le pianiste avec humour, mais comme on le devine au premier coup d’œil. Philippe Duchemin a invité un saxophoniste-flûtiste, Carl Schlosser, dont la carrière longue et riche a connu quelques méandres et quelques rêves au-delà du jazz, mais qui n’a jamais perdu cet enracinement dans l’univers de sa jeunesse et la sonorité qui le lie à cette musique.
Au programme, du jazz trempé dans l’encre blues comme il se doit, avec, dans l’expression, le swing, la chaleur et la poésie qui ont permis deux heures de bonheur en ce mardi où les cieux ont été cléments.
Le répertoire et les compositeurs avaient été choisis avec le souci des belles mélodies et de l’énergie, et l’alchimie a fonctionné à merveille avec une variation des atmosphères, des tempos, des émotions, des moods. Au programme et dans le désordre, «Caravan» (Duke Ellington et Juan Tizol), «In a Sentimental Mood» (Ellington) à la flûte pour Carl, «Whisper Not» (Benny Golson) où Carl, cette fois au ténor, honore le son du compositeur, un émouvant «I Remember Clifford» pris sur tempo très lent, Philippe Duchemin rapsodiant et Carl Schlosser tirant des larmes de son pavillon. Il y a eu aussi le «Moanin’» intense et puissant de Bobby Timmons pour confirmer l’ombre tutélaire d’Art Blakey, aussi présente que celles de Golson et d'Ellington, sur tout ce répertoire avec les press rolls de Philippe Le Van, les interventions blues sonores de Philippe Duchemin, variant ses effets (classique et blues) et le beau son à la Benny Golson à nouveau de Carl Schlosser. Le public garde encore la mémoire de ces thèmes, de ce son (pour les plus avertis et anciens) et soutient volontiers la tension en tapant des mains, comme à l’église baptiste et en toute laïcité, instinctivement…
Le blues et le swing sont partout présents dans ce concert, avec le «Cold Duck Time» du grand et trop oublié Eddie Harris que Carl Schlosser rappelle à notre souvenir, Christophe Le Van optant pour la basse électrique sur le rythme funky, avec également le «Bag’s Groove» de Milt Jackson, introduit à la contrebasse par l’excellent Christophe Le Van, tranquille et serein d’autant que son complice de frère soutient de belle manière aux balais ses interventions de soliste, et ne se prive pas d’interventions inspirées en chorus ou en 4/4 (ces échanges hot entre musiciens sur quelques mesures). Il y eut d’autres thèmes encore («Full House», «Old Man River», «Look Out», «Come Fly With Me»…), parfois sans l’invité, où le trio délivra son entente et son swing à la Peterson et/ou à la Duchemin, et c’est naturellement sur un blues que se termina l’excellent concert par un rappel pour ce quartet de jazz, une façon de rappeler que pour un public de 2019, le blues est encore et toujours une musique qui parle au cœur et à l’âme sans détour et qu’il reste l’indispensable marmite pour faire bouillir son jazz…
 Christophe Le Van, Carl Schlosser, Philippe Le Van © Yves Sportis
Christophe Le Van, Carl Schlosser, Philippe Le Van © Yves Sportis
On sait l’admiration pour Oscar Peterson de Philippe Duchemin, et dans sa manière, on retrouve cette dimension virtuose et un art de jouer du trio, avec des envolées et une ample sonorité d’ensemble, souple et puissante, accompagnée de quelques touches de musique classique, une signature propre à Philippe Duchemin qui lui permet par ailleurs ses nombreux concerts avec quatuors classiques. Ici, c’est plus jazz et blues, et la présence de Carl Schlosser l’explique, en même temps qu'elle enrichit le mood de la formation. Carl Schlosser est cet excellent saxophoniste, flûtiste de première formation, qui a illuminé –et il continue– de nombreux big bands et orchestres (Gérard Badini, Claude Bolling, aujourd’hui le Duke Ellington Orchestra de Laurent Mignard), mais qui a aussi accompagné Dee Dee Bridgewater, Michel Petrucciani… la liste est bien plus longue et internationale. Aujourd’hui partagé entre la scène et un studio d’enregistrement qu’il dirige avec talent, il vient de réaliser, comme ingénieur du son et musicien, l’enregistrement de Philippe Chagne, My Mingus Soul. Sa carrière d’ingénieur est riche de bon nombre d’excellents disques, comme le récent disque de Philippe Duchemin (Quiétis, cf. notre rubrique disques), le nouveau disque avec les Goldberg, père et fils (Michel et Dexter), et beaucoup d’autres, de belle qualité… Carl Schosser a encore d’autres cordes à son arc, y compris d’organisateur, on en garde pour un prochain article.
Au ténor, Carl Schlosser possède un son issu de la tradition du saxophone, travaillant maintenant (avec l'âge) sur le grain du son même s'il ne dédaigne pas jouer les gros sons, et à la flûte il développe autant de qualités de sonorité, jouant sur les sonorités doubles (un peu dans l'esprit de Roland Kirk mais plus calmement), variant les atmosphères sans jamais perdre ce qui fait son charme, un grain de poésie jazz: l’homme est comme sa musique, rien d'étonnant donc.
Les frères Le Van sont ceux dont on ne parle pas assez en général car avec eux tout est huilé, parfait, une section rythmique d’une complicité rare, et qui convient parfaitement à un trio aussi dynamique que celui de Philippe Duchemin. Le trio était donc un beau «véhicule» swing, à l’image de l’inspirateur Oscar Peterson, dans lequel s’est embarqué pour un soir Carl Schlosser. Le public et l’organisation ont adoré, on ne va pas les contredire… d'autant que les musiciens étaient fort à l’aise sur la scène.
Ce bon festival, vraiment de jazz, où on peut encore parler naturellement avec les musiciens avant ou après le concert, se poursuit jusqu’à la fin août; avis aux amateurs de belles soirées sous les étoiles! (www.jazzalamiraute.fr)
Yves Sportis
Texte et photos
© Jazz Hot 2019
|

Rachel Therrien, Juan-les-Pins, 13 juillet 2019
© Jacques Lerognon, by courtesy
Antibes-Juan-les-Pins,
Alpes-Maritimes
Jazz à Juan, 12-21 juillet 2019
Le
festival d’Antibes Juan-les-Pins se prépare déjà à célébrer comme il se
doit son 60e anniversaire l’été prochain. En attendant, son édition
2019, bien que laissant la part belle aux musiques «voisines», a tout de même permis aux amateurs, sur dix jours de concerts, de
trouver leur compte et de faire quelques découvertes sur les scènes
gratuites.
Le
12 juillet, en fin d’après-midi et en début de soirée, le traditionnel
«Jazz en fête» présentait pas moins de neuf groupes (soit une
soixantaine de musiciens) sur les places –et dans les rues d’Antibes–,
évoquant les parades de New Orleans et le souvenir de Sidney Bechet.
George Benson, Juan-les-Pins, 13 juillet 2019 © Jacques Lerognon, by courtesy
Le
13, à 19h, à la Petite pinède, se produisait la trompettiste québécoise
Rachel Therrien qui s’était faite remarquée pour son dynamisme
rappelant celui de Freddie Hubbard, au cours des journées
professionnelles de Jammin’ Juan d’octobre 2018 (cf. notre compte rendu, Jazz Hot n°685)
, une manifestation reconduite prochainement le 23 octobre 2019, qui
sont l'occasion de découvrir de jeunes talents qui peuvent ainsi se
retrouver ultérieurement programmés pendant le festival.
Plus
tard, à la Pinède Gould, se succédaient deux habitués: Steve Gadd (dm)
et George Benson (eg, voc). Le premier a participé ici à tellement
d’expériences différentes qu’on ne sait jamais quelle musique il va
produire. Cette fois, il revisitait son parcours jazz rock «chic», façon
Steely Dan/Steps Ahead/Frank Zappa, aidé en cela par le guitariste
David Spinozza et le trompettiste Walt Fowler qui l’accompagnaient à
l’époque dans ces aventures et avec l’appui des prestigieux musiciens
Jimmy Johnson (b) et Kevin Hays (kb). Impeccable!
Que pouvait-on
attendre ensuite de George Benson, présent sur cette scène pour la 9e
fois? Une grande maîtrise! Fils spirituel de Wes Montgomery pour son jeu
de guitare et de Nat King Cole pour son chant, George Benson (76 ans)
n’a perdu aucune des qualités qui ont fait de lui une icône. S’il laisse
parfois le soin à son guitariste Michael O’Neill d’assurer, à sa propre
manière, les solos de guitare, il mène un show en tout point
remarquable, gorgé d’énergie où il interprète plusieurs perles de son
vaste répertoire.
James Andrews, Juan-les-Pins, 21 juillet 2019 © Jacques Lerognon, by courtesy
Après
d’autres bons moments, selon les échos que nous en avons eus car nous
n’étions pas présents, en particulier les concerts du saxophoniste Eli
Degibri et le duo détonnant formé par Diana Krall et Joe Lovano, le
festival s’est conclu, le dimanche 21 juillet, à la Petite pinède, avec
le trompettiste et chanteur James Andrews, surnommé à La
Nouvelle-Orléans, sa cité natale: «The Satchmo of the Ghetto». Il a fait
partie des orchestres de son quartier (le Treme Brass Band, le New
Birth Brass Band, etc.), Treme, devenu mondialement célèbre par la série
télévisée Treme, où il joue
son propre rôle. Frère aîné de Troy Andrews, alias Trombone Shorty, déjà
connu sur nos scènes européennes, qu’il a formé quand il était encore à
peine aussi grand que son instrument, d’où son surnom, James Andrews
chante et joue à la façon d’Armstrong les succès de Fats Domino, Dr.
John, ses concitoyens et amis, ou de Ray Charles, ainsi que plus
largement les standards de Crescent City. Il tient, en bon
néo-orléanais, à incorporer dans sa musique des influences rappelant ses
origines africaines et amérindiennes, plus une dose de funk
contemporain, qui est devenu une couleur locale, comme on a pu s'en
rendre compte dans les passages musicaux de la série télévisée. Présent
dans plusieurs épisodes de Treme, son charisme fait merveille et
capte l’attention de manière magique! Il n'est pas impossible qu'on le
revoit à Juan-les-Pins, sur la grande scène tant sa prestation fut
convaincante.
La
programmation de cette édition de Jazz à Juan ne laissera cependant pas
un souvenir exceptionnel, car l'événement on l'attend pour le grand
anniversaire de l'an prochain, les 60 ans d'un festival international de
jazz d'Antibes/Juan-les-Pins, Jazz à Juan aujourd'hui, sans équivalant
dans le monde par sa continuité et par le contenu artistique de son
histoire, à quelques rares exceptions près (Newport, Monterey, San
Sebastián…), dont nous vous avons conté les prémices en ce début d'été
2019 (cf. notre rubrique chronique/Jazz Stage). A l'an prochain donc!
Daniel Chauvet
Photos: Jacques Lerognon, by courtesy
|

Kenny Barron, Festival de
Jazz Roger Menillo,
St-Cannat, 2019 © Eric Ribot by courtesy
Saint-Cannat, Bouches-du-Rhône
Festival de Jazz Roger Mennillo,
Mas de Fauchon, 11 juillet 2019
En cette année 2019, Art-Expression, association animée par Chris Brégoli et Roger
Mennillo à Saint-Cannat, avait installé le plateau de son festival annuel en pleine
campagne saint-cannadenne: au Mas
de Fauchon, un endroit aussi intime qu’élégant, au sortir de la Nationale 7
entre Aix-en-Provence et Salon-de-Provence. C’était la 23e édition
de la manifestation, soutenue depuis de longues années par la municipalité.
Après une brève introduction de la fille de Roger, la soirée fut officiellement
ouverte par le maire Jacky Gérard qui, à cette occasion, annonça que ledit
festival, à l’avenir, porterait le nom de son fondateur, absent cette année pour
raison de santé. Ensuite, Jean Pelle, toujours fidèle au poste, officia au
micro pour présenter le programme du soir.
Le Prima
Lutz Trio, composé de la harpiste Christine Lutz, de son époux
vibraphoniste Thierry Lutz et du contrebassiste Pierre Fénichel ouvrit les festivités.
Pendant 45 minutes, il offrit des compositions originales, aux influences
exotiques, agréables à entendre.
Après un long entracte, qui permit au public,
affamé de jazz mais aussi soucieux de se sustenter de nourritures moins spirituelles,
et le temps de placer le piano au centre de la terrasse, le maître de cérémonie présenta
celui que les spectateurs attendaient avec impatience, le pianiste Kenny
Barron.
C’est donc dans cet écrin de
campagne provençale, par une chaude soirée d’été où la fraîcheur ose à peine
poser son voile, qu’à son piano en solo Kenny Barron installa, avec la
sensualité raffinée dont il a la magie, sa musique dans l’intimité de chacun. Il commença le concert avec un standard ancien,
«Beautiful Love» de Victor Young, Egbert
Van Alstyne et Wayne King (1931) sur le tempo de la tendresse, juste enlevé.
Après les applaudissements, le silence s’installa dans l’assistance; même les cigales cessèrent leur aubade. Tous écoutaient sans perdre
un silence.
Il poursuivit avec un medleyellingtonien où se répondaient en une sorte de nocturne recomposé les pièces deDuke et Swee’ Pea [«Lotus Blossom» (Billy Srayhorn, 1947),
«Single Petal of Rose» (Duke Ellington, 1958), «Star Crossed
Lovers» (DE et BS, 1944), «Passion Flower» (BS, 1944)]:
moment de poésie qui contint le souffle des spectateurs avant qu’ils
n’applaudissent.
Ensuite, il joua avec la même densité «For
Abdullah» une composition nostalgiquement fraternelle, écrite en 1990 en
l’honneur du pianiste sud-africain, Abdullah Ibrahim (de son premier nom de baptême Adolph Johannes Brand qui joua
pour la première fois en Europe sur les planches de la Pinède Gould au Festival
de Jazz d’Antibes Juan-les-Pins en 1963 sous le nom de Dollar Brand). Ce
fut ensuite «Melancholia» (DE, 1954) et «Isfahan» (BS et DE, 1963, extrait de la Far East Suite), en
forme d’élégies du soir.
Enfin vint le moment Thelonious Monk: une pièce
de 1955, «Shuffle Boil»que Kenny déconstruisit avec intelligence et intelligibilité jusqu’à en redessiner,
à la grande joie des spectateurs, la structure élémentaire stride héritée de James P. Johnson.
On revint après à
un œuvre de Duke Ellington et Billy Strayhorn, «Day Dream» (1941)
où perçait la mélancolie inquiète de cette période. Il enchaîna ensuite avec
une autre composition personnelle enlevée et joyeusement descriptive,
«Calypso», écrite, raconta-t-il, en 1961 lorsqu’il découvrit «Little Jamaica» à New York;
au cours de ce morceau, il s’amusa à déconstruire la pièce jusqu’à sa structure
élémentaire en forme de matrice de«Tea for Two». Le public
bruissa de complicité.
Il insista ensuite sur l’univers des ballades poétiques
de Monk en donnant une superbe version de «Monk’s Mood» (1946). Enbis, il donna une interprétation épurée très modernisée d’une des plus
anciennes compositions d’Eubie Blake, «Memories of You» (1930).
Il quitta le clavier sous les applaudissements
nourris et chaleureux d’un public conquis par cette musique puissante et riche.
Les personnes qui sortaient disaient leur bonheur d’avoir entendu une heure et
demie de concert sans bruit. Et pour ne rien gâcher, en un endroit qui seyait
au programme de la musique interprétée. Poliment, les cigales reprirent alors leur
chanson.
Texte: Félix W. Sportis
Photo: Eric Ribot, by courtesy of FJRM
(Remerciements à Chris Brégoli)
|

Othella Dallas, Ascona,
22 juin 2019 © Michel Laplace
Ascona, Suisse
JazzAscona, 20-29 juin 2019
35 ans! Il y a toujours de 11h30 à minuit des
activités musicales dans les hôtels restaurants, ainsi que le soir sur quatre
podiums le long du Lac. Il y a cohabitation de deux types de programmes mais
toujours jazz/blues: international et from New Orleans.
Commençons par la facette
internationale. Othella Dallas(-Strozier), 94 ans, née à Memphis a reçu le 13eSwiss Jazz Award 2019 le 23 juin, jour où on a diffusé au cinéma Otello, le
film d'Andres Bruetsch, What Is Luck?,
qui lui est consacrée. Le 22 juin, elle a attiré du monde pour sa prestation en
quartet dans du blues mais pas seulement («Route 66», «September
Song»,...). Le 23 juin, à Piazza, suite de standards délivrée avec
finesse de style par Fabrizio Cattaneo (tp), Alfredo Ferrario (cl) et Marco
Raggi (ts) bien soutenu (g, b, dm). Pas moins swing, George Washingmachine (voc,
vln) et David Blenkhorn (g) étaient soutenus par David Torkanowsky (p, inspiration débordante),
Victor Nyberg (b) et Andreas Svendson (dm) à l'hôtel Castello-Seeschloss.
Dernière prestation du groupe australien, the Syncopators, à Piazzetta, le 24,
avec des remplaçants dont l'Allemand Herbert Christ (tp), dans un répertoire
jazz classique. Et plaisir de réentendre «Absolutely Positively» de
Jabbo Smith!
Répertoire très fouillé
dans la veine rhythm’n’blues/rock’n’roll (Chuck Willis, Lonnie Johnson, etc.)
par le groupe de Cat Lee King (p, voc), le 24 juin. Le combo est excellent avec
un sax ténor hurleur, Mathias Luszpinski et une rythmique qui pulse: Stéphane
Barral (b) et Simon Boyer (dm).
Le 25, c'est en trio que les Fats Boys ont joué
à Piazza: Adriano Bassanini (tp, voc), Thomas Winteler (cl, ss), Brenno
Boccadoro (p).
A l'hôtel Ascovilla, le 26, le seul groupe dans la pure
tradition des anciens de la Nouvelle Orléans, l'International Jazz Band de Geoff
Bull (tp, voc): Philippe de Smet (tb), John Defferary (cl), John Richardson
(p), Luc van Hoeteghem (bjo, g), Bob Culverson (b), Thomas Young (dm, disciple
de Sammy Penn): des thèmes qu'on ne joue plus ailleurs («When You and I
Were Young, Maggie», «Dream» exposé au trombone, etc). Peu
après, Ellen Birath (voc) offre un rhythm’n’blues sympathique (Solomon Burke, etc). Thomas L'Etienne (ts, cl) a introduit la
chanteuse de Philadelphie, Monique Thomas. L'accompagnement était bon et on a
remarqué la classe de Jan Luley (p) qui, en hommage à Dr. John, a chanté «Iko
Iko», version Dixie Cups.
Le
clou de ce domaine de la programmation a été le concert du 27 devant
une foule subjuguée, du Monty Alexander Trio: Hassan J.J. Shakur (b) et
Jason Brown (dm). Un début de programme typiquement Monty Alexander
(swing, volubilité de jeu et changements de tempo) avec, notamment un
long «The Story of the Hurricane». Puis, Monty Alexander a rendu hommage
à Nat King Cole.
Le 28, Al Copley (p, voc) s'est produit pour
quelques initiés non indisposés par la chaleur. Le Dutch Swing College Jazz
Band ne compte plus les membres d'origine, mais c'est toujours un répertoire
dixieland joué on ne peut plus dixieland.
 Leroy Jones, Ascona, 25 juin 2019 © Michel Laplace
Leroy Jones, Ascona, 25 juin 2019 © Michel Laplace
Abordons la particularité
fondatrice du festival que sont les artistes de New Orleans, conviés à Ascona.
Leroy Jones, Jr. y est venu à partir de 1995. Pour l'accompagner, la formation
d'Uli Wunner (cl, as) est excellente: Tom Kincaid (p), Karel Algoed (b),
Frederick Van den Bergh (dm). Ce que Leroy a développé et qu'aujourd'hui une majorité
néglige, c'est l'«individual code»: quatre notes suffisent pour l'identifier.
C'est un Leroy Jones en grande forme qui s'est produit le 25 juin sur la scèneN«ew
Orleans» («When You're Smiling», «Hindustan»,...).
Puis c'est la remise à Leroy, par Nicolas Gilliet du «Ascona Jazz Award
2019», saluée par une courte fanfare jouée par Ashlin Parker à la tête de
la Trumpet Mafia (Manolo, Michel, Annia, etc).
Le 27, la famille Masakowski,
Steve (g) et ses enfants Sasha (voc) et Martin (b) ont proposé une musique délicate
sur des thèmes connus («Basin Street Blues», «Exactly Like
You», etc.). Quatre ans après son triomphe de 2015, le New Orleans Jazz
Orchestra (NOJO) fut la colonne portante de cette édition. Le NOJO, cette fois sous la
direction d'Adonis Rose, s'est aussi décliné en combos et en brass band. Dès le
22 juin, on put apprécier Leon «Kid Chocolate» Brown (tp, voc) au
sein du NOJO, complété par Ricardo Pascal (ts), Viktor Atkins (p), Jason
Steward (b) et Adonis Rose (dm) avec, pour certains titres, Steve Glenn (sousaph)
et Nayo Jones (dm). C'est sous la direction de Leon Brown, trompettiste au son
brillant (il joue une trompette King de 1934) que nous avons entendu un groupe
funky à souhait: Michael Watson (tb, voc), David Torkanowsky (p), Amina Scott
(b) et Gerald Watkins (dm).
Hommages à Harold Battiste et à Dr. John («The
Monkey Speaks His Mind»). Nous retrouvons Michael Watson en quartet le
25, entouré d'Atkins, Amina Scott et Gerald Watkins. Chanteur agréable, Watson
est un tromboniste qui a la même consistance de son qu'un Trummy Young.
Retour
d'Adonis Rose, le 26, avec les mêmes que 4 jours plus tôt et Michael Watson en
plus. Ce dernier a chanté un «Body and Soul» qui compte dans les
meilleurs moments.
Devant une foule respectable, le big band complet s'est
produit...sans Davell Crawford (annoncé), le 28 (Viktor Atkins, p). L'orchestre
a un drive indiscutable: Barney Floyd (tp1, screamer), Leon Brown, Ashlin
Parker qui a invité Laurent Dessaints et Francesca Zuriati (tp), Michael Watson
(tb, voc), Terrence Taplin, Chris Butcher (tb), Jerome Ansari (as), Ricardo
Pascal, Ed Peterson (ts), Travari Broone (bs), Amina Scott (b), Gerald Watkins
en alternance avec le chef, Adonis Rose (dm), Alexey Marti (perc) et Steve
Glenn dans la finale (tu). Le programme nous a fait voyager de Jelly Roll
Morton à Michael Jackson. C'est l'autre clou du festival avec Monty Alexander!
L'innovation cette année
fut la résidence du 23 au 29 juin, du trompette Ashlin Parker à l’Aula
Magna du Collegio Papio. Ashlin qui a fêté ses 37 ans pendant le festival, le
21 juin, a amené avec lui sa «philosophie» Trumpet Mafia lancée en
2013: c'est le plaisir de se rencontrer, de
partager et d’apprendre. En fait c'est comme une master class: mise en
forme physique (pour une meilleur capacité respiratoire), les émissions de son
soufflées (non attaquées) et le bend, travail rythmique, les riffs en
progression d'accords (le blues), l'appel/réponse et l'appel/répétition, la «liminalité»,
la théorie musicale (la progression par quarte) et enseignement de thèmes («Li'l
Liza Jane», «And Ain't My Fault») que Trumpet Mafia a joué en
parade le 28, avec le TINOLA Brass Band local (+ Francesca Zuriati, tp).
La
plus grosse parade donnée par Trumpet Mafia fut le 26 sous un soleil de plomb («Joe
Avery's Tune»). Allant de 10 à 79 ans, les membres de cette Trumpet Mafia
comptaient (avec un noyau stable et un turn over) Leon Brown, Manolo Maestrini,
Aya Takazawa, Michel Laplace, Oscar Morandi, Tiziano Codoro, Adriano Bassanini,
Jacques Rohner, Stany Andenmatten, Carlo Longo, Manuel Faivre, Laurent Dessants
(également tp), les sousaphones Andrea Menghetti et Steve Glenn
On peut ainsi comprendre
que JazzAscona poursuit son concept, le développe même, et ceci avec succès. Ce
qui prouve qu'il n'est nul besoin de faire appel aux vedettes de la pop music pour
faire (sur)vivre un festival jazz. Ici, le jazz et le blues restent rois. Et le
succès en fréquentation (malgré la canicule) fut là! Signalons donc que
l'édition 2020 aura lieu du 25 juin au 4 juillet!
Michel Laplace
Texte et photos
© Jazz Hot 2019
|
 Parade dans les rues en prélude du 1er Festival d'Antibes/Juan-les-Pins, 1960 © Pierre Coulet
Parade dans les rues en prélude du 1er Festival d'Antibes/Juan-les-Pins, 1960 © Pierre Coulet
L’été des Festivals 2019-Préambule
Un voyage dans le temps… au Festival international de jazz d'Antibes/Juan-les-Pins (1960-1962)
Pierre Coulet est un lecteur qui, en octobre dernier, a commandé un ancien numéro de Jazz Hot grâce auquel il cherchait à retresser les fils de la mémoire de ses
jeunes années quand il découvrait le jazz, dans un âge d'or car la
plupart des grands créateurs du jazz, depuis ses débuts supposés, au
début du siècle, étaient encore en vie, côtoyant sur les scènes toutes
les générations suivantes dans une explosion créatrice dont il est
difficile de prendre conscience aujourd'hui.
Il
nous demanda alors quelques précisions pour l'aider dans sa recherche
«du temps perdu», et nous en sommes venus à l'idée, simple, que la
mémoire des lecteurs-amateurs-spectateurs –des acteurs et des témoins
de cette histoire– est souvent très instructive, nous l'avons souvent
constaté, en particulier quant à cette atmosphère qui existait alors
autour d'un jazz, une expression qui avait déjà plus d'un demi-siècle,
avec des personnages déjà considérés comme des génies artistiques dans
la plupart des générations.
Car cette mémoire des amateurs, plus
fidèle, modeste et réaliste complète en la relativisant et en
l'élargissant parfois, celle d'un certain nombre d'historiens ou
d'acteurs de «l'intérieur». On rappelle que l'alchimie du jazz doit
beaucoup à sa rencontre avec un public populaire (socialement brassé
sans distinction d'âge et de sexe marquée), exigeant, qui s'est formé
dans l'enthousiasme, sans avoir besoin d'une propagande médiatique
massive parce que la musique, le jazz, par ses valeurs et pas seulement
musicales, rencontrait avec naturel les peuples et les publics les plus
divers, de tous les âges.
Cette mémoire nous remet aussi en
perspective une ambiance de société qui a fait du jazz, musique
populaire dans son essence et par ses artistes, une musique populaire
dans ses pays d'adoption, la France en est le premier exemple, sa
relation avec ses auditeurs-spectateurs, comme cela a rarement été le
cas pour d'autres musiques (marginalement pour l'opéra italien), et
jamais à l'échelle planétaire; comme ça n'est plus tout à fait le cas
aujourd'hui, même pour le jazz.
On redécouvre un fonctionnement
simple, naturel et démocratique, comme une aspiration à la liberté,
encore déconnecté des phénomènes de mode véhiculés par les médias de
masse, où artistes et publics se croisent et se parlent, avec la
distance bien sûr de l'admiration et du respect, ou de la langue aussi,
mais où le jazz vit en liberté dans un village ou une ville sans avoir
besoin de l'encadrement normés des animateurs institutionnels ou
patentés. On redécouvre aussi un public avec la chaleur de la curiosité
artistique naturelle (on y va pour la musique, pas pour les selfies, même
si on peut faire des photos sans problème avec un musicien rencontré au
bar du coin, sans Monsieur Muscle ou l'agent «exclusif» du musicien
pour nous priver de la rencontre directe. Parfois la musique est
surprenante, il manque quelques maillons pour en comprendre l'actualité,
notamment les disques qui sont rares et arrivent en décalage, mais le
regard et l'oreille sont disponibles, et la modestie des musiciens, sans
vedettariat outrancier, sans service d'ordre fasciste par les
pratiques, sans rabaissement du public au statut de troupeau de
consommateurs.
C'est aussi pour les musiciens, la plupart
afro-américains, l'occasion de rencontrer un public pour lequel ils ne
sont «ni blancs ni noirs», mais simplement des artistes admirés ou
critiqués pour leur art, à tort ou à raison, avec au moins la liberté de
jugement que chacun se fait dans des conversations chaudes entre
amateurs, sans pression outrancière des médias –la seule source
d'information, les revues spécialisées ne sont pas lues par tous– sans
conscience de la mode comme obligation de pensée qui castre l'esprit
critique qui est à la base de l'aventure du jazz.
C'est enfin un
temps où le jazz est roi sur les lieux et les événements qui portent ce
qualificatif «de jazz», pas ou peu aidés par des subventions, mais où
chaque groupe d'artistes, de jeunes ou d'anciens indifférenciés, participe
à la légende du jazz, parce que les responsables artistiques sont
d'abord des amateurs-connaisseurs. Si querelle il y a, elle est le plus
souvent esthétique, querelle de «connaisseurs», parfois politique en
raison même de l'époque, souvent de générations d'amateurs, même quand
ces connaisseurs ne découvrent le jazz que depuis quelques années,
quelques mois; car le public est avide de découvrir, curieux d'échanger,
et il part aussi à la découverte de cette musique qui est venue à leur
rencontre sans préjugé, avec un enthousiasme communicatif.
Le
témoignage de Pierre Coulet, qui relève des souvenirs, comme ceux
apportés dans ces mêmes colonnes récemment sur la Grande Parade du Jazz
de Nice lors du décès de Simone Ginibre (le festival de Nice, version Wein-Ginibre, a commencé en 1974, une étape intermédiaire où la société
de consommation avait déjà avancé), loin d'être anodin, malgré son côté
personnel, reconstitue sous nos yeux les conditions nécessaires et
indispensables qui expliquent la vie et le développement d'un art
populaire depuis la fin de la Seconde Guerre jusqu’aux années 1960.
L’histoire se passe autour du Festival international de Jazz
d'Antibes/Juan-les-Pins, l'un des plus anciens et des plus célèbres du
monde, devenu depuis, comme beaucoup d'autres, une machine à événement à
vocation d'animation. La programmation a perdu son côté exclusivement
jazz & blues, comme l'avaient voulu les pères spirituels de ce type
d'évènement (Hugues Panassié, Charles Delaunay et George Wein). Le
caractère artistique, dans une période où la critique participaient à la
découverte et à l'aventure. Les festivals d'été, comme dans le théâtre,
étaient une fenêtre ouverte sur le monde, sur les autres, sur
l'inconnu, et les espaces en plein air signifiaient que le peuple, dans
son ensemble, y était chez lui, à condition de choisir parce qu'on
s'était passionné avant, donc cultivé, encore…
Il n'était pas
question de consommer mais de se cultiver en respirant l'air de la
liberté, l'air libre au propre et au figuré et de participer à un art
populaire, un échange entre humains, qui fonctionne dans les deux sens,
où la proximité est encore possible car le nombre le permet, ou la
critique est admise car les artistes sont à portée de leur public; la
démocratie en un mot tel que la définit Montesquieu qui rappela, entre
autres principes, que la démocratie ne peut se concevoir quand la taille
des ensembles est trop grande, que le pouvoir est trop éloigné pour
être contrôlé, que les échanges ne sont plus possibles, car il n'y a que
le sens du haut vers le bas, le modèle hiérarchique. C'est vrai en
politique comme en art.
Les festivals sont un reste d'une utopie
née dans l’après-guerre, un prolongement aussi de l'esprit des congés
payés et de 1936. Ça, personne n'en parle plus, et sans doute que peu en
ont conscience, dans le public en particulier. Peut-être pas Pierre qui
écrit ce texte… Il nous excusera d'avoir tiré son texte vers ces
rappels et ces idées, pour introduire cet été des festivals 2019, car le
jazz, c'est une expression artistique autant que philosophique, une
synthèse unique d'un projet social alternatif aujourd'hui disparu, qui a
même inspiré le théâtre populaire de Jean Vilar, le cinéma, sans que
cela ne se dise ou ne se sache, c'était une époque, et la condition
humaine de sa communauté de naissance dans les Etats-Unis y participe
bien sûr essentiellement…
La captation progressive de ce
succès aussi bien par le cadre politico-institutionnel que par la
société de consommation dans les périodes suivantes a abouti de nos
jours à la perversion de l'esprit des festivals de jazz, sans beaucoup
de jazz et sans public de jazz, si ce n'est à la marge comme un alibi,
malgré une survivance du jazz –un paradoxe– parmi
les artistes eux-mêmes, consciente ou la plupart du temps inconsciente,
par filiation, proximité amicale, rencontre fortuite, etc. Le jazz est
devenu une étiquette, valorisante pour le vernis culturel d'une image,
une question d’image donc pour une société d'animation généralisée, où
les valeurs profondes du jazz ont été balayées comme a été annihilée
cette relation naturelle et curieuse entre artistes et public qui
faisait toute la différence.
Le
jazz a eu besoin de cette dimension démocratique pour être et se
développer, pour la création et le renouvellement des artistes
eux-mêmes, par la rencontre, la transmission. Il s'est élaboré dans
cette relation libre et humaine entre public et artistes, cette
dimension qui a progressivement disparu des événements qui se disent «de
jazz», mille fois plus nombreux aujourd'hui, et pourtant si pauvres en
jazz et en expression de cet art populaire, si peu créatifs sur le plan
du jazz, si pauvres en jazz spirit, à quelques exceptions près, de plus en plus rares.
Le
témoignage de Pierre Coulet est naturel, mais si on y réfléchit un peu,
il relate quelques traces d'une société démocratique et d'une époque à
jamais révolues. La nostalgie ne vient pas que de l'âge de celui qui
témoigne. Elle vient d'un monde perdu, qui n'était pourtant pas
idyllique mais controversé: il y avait la Guerre d'Algérie, la guerre
froide, la lutte pour les Droits Civils, la poursuite de la guerre du
Vietnam par les Américains après les Français, et des tentatives
d'alternatives à l'Est vers un mieux communiste, étouffées, qui se sont
soldées finalement par la disparition de l'alternative communiste et des
utopies de gauche… Il y avait aussi les indépendances, Cuba et quelques
utopies plus tard submergées par la consommation de masse mondialisée.
Résultante
d'un siècle contrasté où les peuples ont émergé dans les tragédies (car
les pouvoirs ne sont pas restés l'arme au pied pour les asservir), il y avait, au
moins dans la pensée et dans certains fonctionnements, l'envie
d'alternative et de non conformisme, condition élémentaire du
développement artistique, du jazz en particulier, du jazz d'abord. Le
caractère populaire était devenu une valeur supplémentaire, positive
après avoir été longtemps moquée, dénigrée. La recherche de liberté
individuelle marchait de concert avec la recherche d'un équilibre
collectif.
La
France comptait 45 millions d'habitants (67 millions aujourd'hui), la
planète 3 milliards de terriens (7,5 milliards 60 ans plus tard):
l'horizon utopique étaient la découverte, l'échange et la concorde, pas
la consommation, l'ego, la course à la domination, la rivalité (qu'on
l'appelle comme on veut: concurrence, guerre…). On traversait la
campagne pour aller à Juan-les-Pins, et non pas un ruban de béton
continu, et on pouvait rencontrer, à Juan et dans d’autres festivals,
dans un bar Count Basie ou Charles Mingus, George Benson grattant une
guitare rudimentaire et, avec un peu de chance, raccompagner le grand
Benny Carter à son hôtel, dans la 404 d'un amateur s’attardant pour
approcher un monument du jazz oublié par l'organisation…
Yves Sportis
Marchons dans les rues d'Antibes
Souvenirs d’un jeune passionné: 1960-1961-1962
Le
texte qui suit, écrit près de soixante ans après les débuts du Festival
international de jazz d’Antibes-Juan-les-Pins, rassemble les souvenirs
et impressions que le jeune homme que j’étais à l’époque a mémorisés. Il
ne s’agit donc ni d’un compte rendu exhaustif de tous les concerts et
formations entendues, ni d’une analyse critique comme les spécialistes
ont pu le faire à l’époque dans des revues comme Jazz Hot.
Ce texte doit être lu comme un témoignage, certes avec sa part de
subjectivité, mais fidèle à ce que j’ai ressenti et au quotidien partagé
avec d’autres jeunes passionnés, autour du festival. Alors
qu’aujourd’hui les festivals de jazz existent partout en France, et
tout au long de l’année, il est bon de rappeler que c’était loin d’être
le cas au début des années 1960. Les premières éditions du Festival
d’Antibes-Juan-les-Pins ont représenté à l’époque, une ouverture
extraordinaire pour les jeunes amateurs de jazz, dont j’étais. Partir
pour Juan, sac au dos, était une aventure, entendre et voir les plus
grands, un moment fabuleux. Ce sont ces quelques souvenirs qui sont
rapportés ici.
Pierre Coulet
Photos © Pierre Coulet

Jazz Hot n°155, juin 1960
annonce en une du premier Festival
International de Jazz d'Antibes/Juan-les-Pins
Découvrir le jazz à la fin des années 1950
Originaire
d’un petit village d’Ardèche, j’avais, en 1952, réussi l’examen
d’entrée en sixième et décroché une bourse. A la rentrée, je me
retrouvais interne au Lycée de Valence, pour sept ans.
C’est
au cours de ces années que j’ai découvert le jazz. Tout d’abord avec
Sidney Bechet bien sûr, qui était déjà connu d’un large public. Il avait
même donné un concert dans la ville et nous en avions eu des échos,
mais c’est par le disque, au «Foyer»des internes auquel nous avions
accès à partir de la classe de seconde que j’ai été conquis par cette
musique. Le foyer disposait d’un gros poste de radio à lampes, équipé
dans sa partie supérieure d’une platine tourne-disques.

Nous
étions au début du microsillon et, grâce au petit budget qui nous était
alloué, on pouvait se procurer quelques disques chez le disquaire de la
ville, lors des sorties du jeudi après-midi. A côté de disques de
variétés, nous avions pour le jazz quelques «25 cm» sur lesquels on
retrouvait des morceaux d’anciens 78 tours repiqués et également des
productions plus récentes. Je me souviens notamment de «L’Enterrement à
la Nouvelle Orléans» avec Armstrong et son All stars et de la découverte
du Modern Jazz Quartet à travers la musique du film de Vadim, Sait-on-jamais…, parue en disque.
L’émission «Pour ceux qui aiment le Jazz»1 diffusée sur Europe n°1,
était trop tardive pour que nous puissions l’écouter, sauf lorsque,
malades et plus ou moins contagieux, nous étions, par chance, retenus à
l’infirmerie. Je garde un très bon souvenir d’une varicelle où je me
revois, installé pour quelques jours, dans une chambre individuelle
équipée d’un vieux poste de radio qui captait à peu près correctement
les «Grandes Ondes». J’attendais avec impatience l’indicatif de cette
émission culte que l’infirmière, compréhensive, me permettait d’écouter
en sourdine après 22h: souvenir d’une grande bouffée d’oxygène dans la
grisaille de l’internat…
Après
le bac’, en 1959, ce fut la Fac’ à Lyon et l’occasion de nouvelles
rencontres, dont Robert avec qui je suis devenu très vite ami. Arrivé de
Nice, il jouait de la trompette et était bien plus calé que moi en
jazz. Il m’ouvrit de nouveaux horizons avec des morceaux que je
découvrais par le disque comme «Bag’s Groove», «Jordu», «Django», «Blue
Monk» et bien d’autres.

Jazz Hot n°156, juillet-août 1960,
Charles Mingus en couverture est annoncé au festival
Une incursion au premier festival en 1960
C’est
avec mon ami Robert, chez qui je séjournais à Nice en juillet 1960, que
j’ai assisté à mon premier concert lors du premier Festival
d’Antibes-Juan-les-Pins. J’avais 18 ans et lui un an de plus. Après la
fin de nos examens à Lyon, nous avions prévu de faire une randonnée de
deux semaines, sac au dos, dans le massif du Mercantour, au départ de
Nice. Partis début juillet, au bout d’une semaine nous étions de retour à
Nice à cause d’un enneigement tardif. Ce fut donc en fait un peu par
hasard, car avec notre budget d’étudiant nous n’achetions pas les revues
de jazz, que nous avons été au courant de l’inauguration à Antibes de
la stèle à la mémoire de Sidney Bechet et du festival qui s’y déroulait.
Avec la «Lambretta»2 de mon ami, nous étions venus de Nice.

Jazz Hot n°157, septembre 1957
Premier Compte rendu
Pendant
la journée, nous avions déambulé dans la ville, vu la stèle de Sidney
Bechet ainsi qu’une parade dans le style Nouvelle-Orléans en hommage à
Sidney Bechet avec Wilbur de Paris dans une calèche ainsi que d’autres
musiciens, comme Guy Lafitte, croisé au détour d’une rue…
Le
concert auquel nous avons assisté regroupait des styles très
différents, dont, dans mon lointain souvenir, Sister Rosetta Tharpe à
l’énergie communicative et se donnant à fond, s’accompagnant parfois au
washboard, puis, dans un genre très différent, Charlie Mingus et son
groupe, dont les morceaux nous avaient alors assez déconcertés…

Le festival de 1961: The Genius
L’année
suivante, c’est avec un ami d’enfance, David, dont les parents
habitaient alors la région parisienne mais passaient leurs vacances dans
mon village en Ardèche, que je partais pour le festival, en train, sac
au dos. A Juan, nous avions installé notre tente au Camping des Aloès,
situé sur les hauteurs de la ville, devenu depuis un lotissement.
Nos
moyens financiers étant limités, nous avions mis toutes nos économies
dans une cagnotte pour payer nos entrées et vivions très frugalement sur
ce qui nous restait en poche. Le soir, nous descendions à pied du
camping jusqu’à la Pinède Gould, très à l’avance, et dès l’ouverture
allions nous placer au plus près de la scène pour profiter au maximum
des orchestres qui allaient se succéder. Enfin, la soirée commençait
avec le programme annoncé par André Francis, spécialiste du jazz à la
Radio nationale et, à Juan, maître de cérémonie toujours tiré à quatre
épingles et à l’élocution posée.
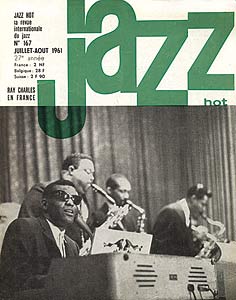
Jazz Hot n°167, juillet-août 1961
Ray Charles est annoncé à Antibes
Cette
année-là, c’était essentiellement Ray Charles que nous étions venus
écouter et surtout voir pour la première fois. Les grandes affiches avec
la tête du «Genius» aux lunettes noires sur fond rouge, que nous avions
découvertes sur les panneaux en bord de mer à notre
arrivée, aiguisaient notre attente. Le live à
la pinède nous réservait cependant quelques surprises et je me souviens
de l’impression particulièrement pénible ressentie à l’arrivée sur
scène de cet homme aveugle, marchant d’un pas hésitant, cornaqué par son
présentateur attitré, du genre «montreur d’ours», le conduisant à son
piano à grands renforts de superlatifs hurlés dans le micro.
Heureusement, dès qu’il était installé, après quelques notes, venait la
voix de Ray Charles. Nous étions conquis d’avance, il y avait les
morceaux que nous connaissions et que nous attendions ainsi que
d’autres. Tout était bon pour nous puisque le «Genius» tant attendu
était là devant nous avec les Raelets (Raelettes)! Il avait été
programmé sur plusieurs soirées et nous ne nous en lassions pas.
L’autre
grande tête d’affiche cette année-là était Count Basie. Il nous
arrivait de le croiser pendant la journée dans les rues de Juan, portant
une casquette de marin et déambulant nonchalamment, l’air malicieux,
répondant par un bon sourire à ceux qui l’avaient reconnu et le
saluaient. Le soir, c’est avec le classique complet-veston de l’époque
que nous le retrouvions sur scène avec tous ses musiciens à leur
pupitre. J’ai gardé le souvenir de prestations au swing sans faille,
dans une bonne ambiance bien huilée, d’où se détache une soirée
particulière où le Count convia Bill Coleman, qui se trouvait dans le
public, à venir le rejoindre sur scène. Je revois ce dernier passer dans
l’allée à côté de nous, l’air ravi, avec sa trompette à la main et être
chaleureusement accueilli sur scène. Avec cet invité surprise qui se
surpassait et un orchestre qui semblait heureux de sortir des figures
imposées, ce fut un très beau moment, très applaudi.
Mais
pour nous, à côté de Ray Charles et de Basie que nous connaissions déjà
par le disque et attendions de voir sur scène, il y eut deux grandes
surprises: le trio vocal Lambert-Hendricks-Ross et celui de Les McCann.
Le trio L.H.R. transposait avec la voix les versions orchestrales de
thèmes du jazz. Je revois Dave Lambert avec son collier de barbe, mobile
tel un lutin, animant son groupe à côté de Jon Hendricks au physique
plus flegmatique et Annie Ross, débordante d’énergie. Je garde en
mémoire cette impression de dialogue vocal entre les trois et la joie
évidente à chanter ensemble qui émanait du trio, le tout ponctué de
traits d’humour que malheureusement notre anglais scolaire ne permettait
pas d’apprécier pleinement. Ce fut un triomphe et nous avons été
conquis.
Bien des années plus tard, Jon
Hendricks, vétéran de la deuxième guerre mondiale débarqué en juin 1944
sur les plages de Normandie, parlait avec reconnaissance de l’accueil
qui avait été réservé à sa patrouille, dans une ferme, au petit matin
où, après le café, le fermier avait exhumé une bouteille de Calvados
cachée dans l’étable, qu’il avait débouchée pour fêter l’événement! Pour
ces Afro-Américains, victimes quotidiennes de la ségrégation aux
Etats-Unis, ce fut une révélation et pour Jon Hendricks le début d’une
francophilie qui n’a jamais cessé. A Juan, c’était une tout autre
époque, mais peut-être a-t-il ressenti, dans un registre bien différent,
ce même accueil…
Avec
le trio du jeune pianiste Les McCann, ce fut pour nous la révélation!
Dès les premières notes, dans une ambiance très bluesy, avec un bon
sourire et quelques paroles enjôleuses, il établissait avec le public
une sorte de connivence, attaquant les morceaux avec une certaine
nonchalance puis, sur une rupture de tempo, il se donnait à fond avec
son bassiste et son batteur produisant un swing ébouriffant. C’était
l’apothéose! Totalement conquis, nous sommes immédiatement devenus des
inconditionnels et en redemandions…
Après
le concert officiel, certaines formations se produisaient dans des
établissements de Juan plus ou moins huppés, où les consommations
n’étaient guère abordables. Heureusement, il y avait sur une voie très
passante du centre-ville où se concentrait la vie nocturne, un bar, le
Pam-Pam, largement ouvert à l’extérieur, avec un piano installé
pratiquement sur la rue où le trio venait jouer. Nous passions avec
ravissement une bonne partie de la nuit, assis sur le trottoir d’en
face, à bénéficier de ce supplément de concert gratuit. Je garde un
souvenir vif du plaisir éprouvé au cours de ces moments heureux, dans
l’insouciance d’un temps suspendu.

Au Camping… © Pierre Coulet
1962, troisième édition du festival:
Dizzy and the Champ!
Cette
année là, j’ai troqué la sac à dos pour la 2 CV familiale que mon père,
compréhensif, m’avait autorisé à prendre. Filant vers le Sud sur la
Nationale 7, je rejoignais à Juan mon ami David, venu en train de Paris
avec un copain, Dominique. Nous avons planté notre tente au camping des
Aloès où nous avions déjà nos habitudes, et où se retrouvaient les
passionnés de jazz. Notre autre point commun à tous était d’avoir un
budget serré… Nous étions une quinzaine et avons très vite formé une
petite communauté. Nous venions pour la plupart de différents coins de
France ou de Belgique et, à l’exception de deux filles, dont l’une
descendue de Paris dessinait sur les trottoirs, avec un bel assortiment
de craies, des portraits très réussis, le groupe était essentiellement
masculin. Pour diminuer nos frais de nourriture au quotidien, nous
avions décidé de faire cuisine et caisse communes au camping. Pour cela,
la 2 CV s’avérait très précieuse pour l’approvisionnement. En effet, il
y avait à Antibes un marché où nous allions vers midi au moment où les
producteurs commençaient à plier bagages et d’où nous revenions avec des
cageots pleins de tomates ou autres invendus, à prix largement soldés,
ou même donnés. Le gérant du camping nous avait prêté une grosse gamelle
pour collectivités dans laquelle nous préparions des quantités
impressionnantes de pâtes. Avec du pain à volonté, le tout conduisait à
un prix de repas par tête, très modique.

Il
y avait également parmi nous une petite formation de musiciens amateurs
venus avec leurs instruments (saxophone, trompette, basse, batterie),
d’origine stéphanoise, si je ne me trompe pas. Nous baignions dans la
musique car, dès le repas terminé, ils répétaient au camping dans le
coin qui nous était dédié, ce qui attirait d’ailleurs pas mal d’autres
spectateurs. Je me rappelle avoir été frappé par le très jeune âge du
batteur dont le frère plus âgé faisait, je crois, partie de la
formation. Nous consacrions en fait peu de temps à la baignade et, le
soir, c’est donc à partir de ce camp de base et dans cette atmosphère
conviviale que nous descendions ensemble au festival. A l’entrée, nous
étions connus des hôtesses qui avaient à peu près notre âge et, avec un
peu de baratin, il nous arrivait d’obtenir une entrée gratuite pour l’un
d’entre nous, en guise de tarif de groupe…
Mes
deux amis parisiens et moi étions venus essentiellement pour Dizzy
Gillespie et Jimmy Smith, dont nous connaissions les disques et étions
des inconditionnels. Pour cette troisième édition, je m’étais muni de mon appareil photo, un «Foca Sport» au format 24x36, très maniable3,
et de quelques pellicules noir et blanc Kodak Plus-X alors très en
vogue. Je ne l’avais pas apporté l’année précédente et l’avais regretté.
Bien entendu, il n’était pas question de rivaliser avec le maître du
genre, Jean-Pierre Leloir, photographe attitré des musiciens, bien mieux
équipé, et qui avait accès au stand presse et à la scène, mais
simplement de rapporter quelques souvenirs de concerts. Selon les
soirées et l’endroit où nous étions placés dans la pinède, les angles
variaient et une fois installés, il n’était pas très facile de se
déplacer. De plus, mon appareil était d’une génération d’avant les
téléobjectifs, et il fallait donc faire avec. Malgré tout, et notamment
grâce à la débrouillardise de l’un d’entre nous, Dominique, trouvant
toujours un moyen de se faufiler pour s’approcher de la scène, je suis
revenu avec une petite série de clichés représentatifs de ces soirées.

Dizzy Gillespie Orchestra, Antibes, juillet 1962 © Pierre Coulet
De
l’orchestre de Gillespie sur scène, je garde le souvenir marquant du
pianiste Lalo Schifrin que je découvrais. Dizzy, en meneur de jeu
facétieux avec ses adresses humoristiques au public et aussi son
autorité de leader, toujours très mobile sur scène et mettant en valeur
ses solistes, veillait à maintenir pour sa formation un bon niveau
d’énergie, notamment dans le style afro-cubain qu’il affectionnait.
Parmi tous les morceaux, certains nous étaient familiers comme «Manteca»
ou «Night in Tunisia». Nous étions comblés.
Personnellement,
c’est probablement Jimmy Smith que j’attendais avec le plus
d’impatience. J’avais un faible pour son style et la sonorité de l’orgue
Hammond et connaissais plusieurs de ses disques parus chez Blue Note.Un
soir de concert, passant devant la buvette installée à l’entrée de la
pinède, je le reconnus au comptoir, prenant un soda. J’avais juste eu le
temps de prendre une photo qui, avec la faible luminosité, allait
s’avérer de qualité très moyenne. De ces soirées, j’ai gardé le souvenir
d’une interprétation époustouflante de «The Champ», où il avait fait
monter la tension de façon paroxystique, nous conduisant au bord de la
transe. Peut-être,
est-ce le soir où nous avons croisé à la sortie du concert Barney
Wilen, entendu l’année précédente et venu en auditeur, aisément
reconnaissable à ses grosses lunettes et son air juvénile, toujours un
peu lunaire. Il n’avait que quelques années de plus que nous et une aura
incontestée depuis qu’il avait joué avec Miles Davis et participé
notamment à l’enregistrement de la musique du film Ascenseur pour l’échafaud. Il s’était adressé à nous spontanément, nous demandant sans préambule: «Avez-vous reçu le message?» Je
me souviens que la formulation quelque peu ésotérique de la question
nous avait surpris et laissés assez secs. Je n’ai en revanche pas gardé
le souvenir de notre réponse qui fut sans doute plus terre-à-terre, du
genre: «Oui, oui, c’était extra…»
La
présence de Fats Domino dans le programme nous avait quelque peu
surpris. Certes, comme pianiste il se rattachait au Rhythm and
Blues mais son «Blueberry Hill», grand succès à l’époque, tenait plus,
pour nous, de la variété que du jazz. La déconvenue fut immédiate avec
tout d’abord la présentation du leader par un «Monsieur Loyal»
imbuvable, et les jeux de scène de ses musiciens à la fois burlesques et
pitoyables. Tout ceci occultait largement ce qui restait de musical
dans la prestation du pianiste. Devant ce spectacle clownesque censé
séduire le public, ce furent les huées récurrentes émanant de notre
groupe. Personne ne nous fit taire, et le service d’ordre du festival
laissa faire, y compris les jours suivants. A la rentrée, dans le numéro
de Jazz Hot rendant compte du festival, cette «bronca», attribuée à des jazzfans, avait même fait l’objet d’une mention!
Concernant
les Clara Ward Singers et leur présence sur scène, j’ai le souvenir
d’un groupe féminin bien rôdé prenant du plaisir à s’exprimer dans la
grande tradition des spirituals, qui a su conquérir le public.

Jazz Hot n°178, Juillet-août 1962,
Le festival est annoncé en couverture
After hours …
Après
les soirées au festival, certains musiciens se retrouvaient dans divers
lieux où ils jouaient tard dans la nuit. Cette année-là, c’était le
Club 3 qui avait la cote. Grâce à l’un des Parisiens de notre groupe qui
avait un ami dans la place (il s’agissait de Carlos, futur chanteur à
succès, cf. Jazz Hot n°597),
nous y avons fait, un soir, une incursion vite écourtée, tant nous
étions serrés, debout près de l’entrée. Notre préférence allait, de
loin, à la plage située en contre-bas du Casino où nous pouvions
profiter gratuitement des prolongations qu’assuraient les formations
invitées par l’établissement. Celles-ci se produisaient dans une salle
ouverte sur la mer, et même si l’acoustique n’était pas optimale, nous
restions dans l’ambiance, et cela nous suffisait. Je me souviens d'un
soir, où après le dernier morceau, nous avons décidé à quelques-uns de
ne pas remonter au camping et de terminer la nuit sur un coin de plage,
un peu à l’écart, en attendant le lever du soleil. Roulés dans un
vêtement chaud, nous nous sommes vite endormis et avons été réveillés au
petit matin, non par le soleil, mais par une patrouille de CRS pour un
contrôle d’identité, plutôt bon enfant. Il était, paraît-il, interdit de
dormir sur la plage… Après cet épisode inattendu, nous sentant une
petite faim, nous avons cherché un bistrot. A Juan, tout était fermé, et
nous sommes donc partis à Antibes où on se levait tôt. Sur le coup de
6h1/2, nous avons trouvé un bar où les habitués étaient déjà au
comptoir. Notre petite bande fut bien accueillie par le patron, et nous
avons eu droit à un solide petit déjeuner, plus proche du casse-croûte
que de l'habituel café-crème avec croissant… Au retour, d'excellente
humeur, nous étions prêts pour une nouvelle journée!
Après
une semaine exaltante, nous avons pris la route du retour. Chacun s’en
est allé, la tête pleine de musique et de souvenirs, vers ses propres
horizons. Pour moi, trois mois plus tard, je partais faire mon service
militaire. Ensuite, ce fut la vie professionnelle et ses incertitudes.
Le temps de l’insouciance était passé, pas celui de la passion pour
cette musique: le jazz…
1. Émission musicale quotidienne de 1955 à 1971 dans la tranche 22h-23h, animée par Frank Tenot et Daniel Filipacchi.
2. Modèle de scooter en vogue, au centre d’un échange-chantage dans le film de Luchino Visconti, Bellissima, avec Anna Magnani (1951).
3.
Fabriqué par la société française OPL (Optique de précision de
Levallois) Foca, le Foca Sport (1954) était une sorte de Leica par
l’apparence mais «petit budget».
© Jazz Hot 2019
|
Sunset, Paris
Kiko Berenguer, 3 avril 2019
Le 3
avril, le saxophoniste espagnol Kiko Berenguer et son quartet se présentaient à
Paris au Sunset pour la première fois en France et pour une prestation se
basant sur un dialogue entre jazz et flamenco, entre saxophones, guitare
flamenca et cajón avec le soutien de la basse électrique. Le risque était
grand pour les organisateurs et le club de mettre à l’affiche une formation
inconnue dans l’Hexagone et sortant des sentiers battus. Le public présent a
été conquis par cette conversation qu’on ne peut intituler jazz flamenco à
moins d’utiliser l’expression dès qu’on aperçoit sur scène la présence
conjointe d’un saxophone, d’une guitare flamenca et d’un cajón. Dans ce mano a mano Kiko Berenguer qui s’éloigne
de toute virtuosité superflue pour aller à l’essentiel: la précision, la
fluidité, montre qu’il domine le jazz, possède une belle technique, un beau son
tant au ténor qu’au soprano et maîtrise les fondamentaux du flamenco. Mais ce
n’est ni l’esprit d’un Chano Domínguez, ni celui d’un Jorge Pardo. Sa
personnalité émerge à travers l’originalité de son travail et offre une
fraîcheur particulière, unique à sa musique. Ses compositions, réfléchies,
maintes et maintes fois retravaillées, distillées ici en trois sets, sont
marquées par la minutie. Chaque note est étudiée et à sa place et pourtant rien
n’est académique et les partenaires ont tout le loisir de s’illustrer.
Le discret mais énergique César Giner (eb) a offert un beau soutien à son
directeur et s’est montré excellent dans ses soli notamment dans «Dancing with
the Moon» et «Reencuentro». Juan del Pilar (g flamenca) est un véritable
maestro de son instrument. Ses doigts font jaillir l’essence même de la musique
flamenca avec l’indispensable soniquete,
qui comme le disait Paco de Lucía, si tu ne sais pas le faire, tu t’abstiens de
jouer. Ses introductions et ses improvisations ont toutes été convaincantes. «Dancing
with the Moon» a permis à Miquel Asensio de montrer son habileté à passer sans
faille du cajón à la batterie, réduite au minimum pour les nécessités de la
musique de Kiko Berenguer.
Parmi les plus beaux des quatorze thèmes interprétés -dont douze compositions
personnelles de Kiko- on doit relever aussi les dynamiques «Narsong»,
«Canastera», avec une belle fusion entre le swing et le soniquete et une forte présence de la basse ainsi que «Mi Camino»,
«Conversa» qui auraient pu donner leurs noms au dernier disque de Kiko
Berenguer, tout autant que celui retenu «Aire» entendu dès le premier set.
Laissant au repos ses partenaires le saxophoniste seul sur la scène a joué le
boléro «Ayer te vi llorar» avant de clore la session avec le très joli thème
«Canela y Menta», requérant la collaboration vocale d’un public réduit à cette
heure avancée de la nuit mais qui ne s’est pas fait prier, montrant combien il
avait apprécié le concert.
On ne peut qu’espérer revoir et
réécouter rapidement en France Kiko Berenguer et son cuarteto.
Patrick Dalmace
© Jazz Hot 2019
|
Péniche Le Marcounet, Paris
Kirk Lightsey-Talib Kibwe, To Randy With Love, 2 avril 2019
Au pied du Pont Marie, sur la péniche Marcounet, dans un cadre
chaleureux, l’association Spirit of Jazz organisait un moment rare de musique
intemporelle. Un rendez-vous évident avec l’histoire du jazz à Paris et de ses
nombreux musiciens américains venus de tout temps en résidence plus ou moins
prolongée. Un passé révolu aujourd’hui qui aurait d’ailleurs mérité d’être
immortalisé sur la pellicule ou sur disque. Ce duo entre le pianiste de Detroit
Kirk Lightsey et le saxophoniste new-yorkais Talib Kibwe renvoie à la fameuse
rencontre entre Randy Weston et Billy Harper sur le magnifique The Roots of the Blues. Un hommage au
pianiste disparu le 1er septembre 2018 qui fut le lien entre Ellington,
Monk et l’Afrique et qui, à l’image d’un griot,
nous avait habitué à raconter des histoires universelles et
merveilleuses dont la genèse débuta dans son Brooklyn natal où il croisa Max
Roach ou son cousin Wynton Kelly, pour se terminer sur les rives subsahariennes
au cœur de la musique des Gnaoua. Pour cette évocation sous forme d'ode à
l'univers de Randy Weston, il faut voir comment Kirk Lightsey enroule ses notes
sur le blues qui est toujours suggéré tout au long du concert, du sublime
«Berkshire Blues» à «African Village». Du beau piano entre lyrisme classique et
tradition bop dans un jeu souvent rythmique évoquant aussi bien l'école de
Detroit que les apports de McCoy Tyner. Il y a dans cette musique une
expressivité et une exigence puisant dans la grande tradition de l'art
afro-américain à l'image d'une formation telle que les «Leaders» que connaît
bien Kirk Lightsey. L’art du duo dans sa forme la plus
intense d’interactivité entre deux musiciens partageant un langage commun.
Celui de la tradition avec ce retour en permanence à l’esprit du blues et un
swing quasi viscéral sous les doigts du pianiste. Ce dernier fascine de par la
qualité de son jeu dynamique et surtout un contrôle de la sonorité lui ouvrant
de nouvelles perspectives. Le lien avec Randy Weston est une évidence de par
cet héritage commun et partagé. La présence de l’altiste Talib Kibwe, New-Yorkais
ayant lui aussi résidé à Paris dans les années 80, semble une évidence tant sa
collaboration avec Randy Weston, durant plus d’un quart de siècle, fut intense.
Il y a dans son jeu une expressivité extrême doublé d’un fort vibrato
prolongeant à merveille le discours de son ancien mentor. Un lyrisme permanent
dans le jeu de l’altiste qui est également un excellent arrangeur sur un thème
tel que «Little Niles» et qui se veut conteur et passeur auprès d’un public
friand d’anecdotes, parmi lesquels quelques illustres musiciens et amis de passages tels que les batteurs John Betsch
et Steve McCraven, le contrebassiste Jack Cregg ou l’altiste Sulaiman Hakim.
 Kirk Lightsey et Talib Kibwe, Péniche Le Marcounet, Paris, 4 avril 2019 © Jérôme Partage
Talib Kibwe,
d’une grande musicalité, utilise tous les registres de son instrument notamment
sur «Hi Fly» ou «Saucer Eyes» thème qu’il ne jouait jamais sur scène à son
grand désespoir mais qui lors du dernier concert de Randy Weston à Nice l'année
dernière a pu l'interpréter à sa plus grande surprise en rappel. Ce thème bop
immortalisé à la fin des années 50 par Cecil Payne puis plus tard par Ron
Carter et Art Farmer est un modèle du genre. Dans un esprit de jam session,
l'arrivée du jeune trompettiste américain Josiah Woodson originaire de l'Ohio
apporte une couleur particulière à l'ensemble. Il a déjà une expérience riche
en rencontres, de Branford Marsalis à Billy Hart en passant par Dave Holland,
Mulgrew Miller ou son aîné Marcus Belgrave. Le piano de Kirk Lightsey donnant
une forme d'équilibre sur le plan rythmique et harmonique. Le répertoire évoque
la relation particulière qu'avait Randy Weston avec l'œuvre de Thelonious Monk
avec un superbe «Well You Needn't» revisité en trio, avant d'explorer «African
Sunrise» où plane l'ombre de Dizzy Gillespie ainsi qu'un «Birk Works»
où le jeu linéaire et les longues phrases sinueuses du trompettiste donnent à
cet hommage une nouvelle dimension. L'audace se vérifia avec la version du
thème complexe de Jon Hendricks «Pretty Strange» avec la vocaliste Sarah Thorpe
doublé des contre-chants des cuivres avant de conclure sur un «Now the Time»
débordant de swing. Un rendez-vous avec une des plus belle page de l'histoire
du jazz par des musiciens authentiques partageant une culture commune et
éternelle.
David Bouzaclou
Photo © Jérôme Partage
© Jazz Hot 2019
|
|
Rhoda Scott Lady All Stars
L'Astrada, Marciac (32), 23 mars 2019
© Michel Laplace
Marciac, Gers
Rhoda Scott Lady All Stars, L'Astrada. 23 mars 2019
Une salle pleine pour ces
dames! A croire que les gens aiment encore quand ça swingue et avec Rhoda Scott
c'est une garantie. Ou bien que les femmes musiciennes sont sur une vague porteuse.
Ce qui paraît être le cas. Mais que l'on ne vienne pas dire que les femmes
saxophonistes sont une nouveauté! N'est-ce pas Elise Hall (1853-1924),
saxophoniste et présidente de l'Orchestral Club de Boston qui, en 1901, a
commandé à Debussy une Rhapsodie pour saxophone? Ce qui n'enlève rien au
talent des instrumentistes actuelles. Nous avions donc le quartet de Rhoda
Scott (Lisa Cat-Berro, as, Sophie Alour, ts, Julie Saury, dm) augmenté d'Anne
Paceo (dm), Géraldine Laurent (as) et Céline Bonacina (bar), un septet qualifié
à juste titre de «Lady All Stars». Sur scène, deux batteries à gauche, l'orgue
hammond au centre, et les quatre saxophones à droite. Nous n'avions pas revu
Rhoda Scott, 80 ans, depuis juin 2004 à Ascona. Elle n'a rien perdu de son
swing et de son inspiration. Elle présente chaque morceau, en français (elle
vie dans l'Eure & Loire), avec humour.
Après un thème-riff (sans
solos) très efficace et signé Lisa Cat-Berro, le septet a joué «Escapade»
d'Airelle Besson. C'est là l'exception, car le répertoire est constitué
d'originaux signés par l'équipe actuelle, sauf Céline Bonacina qui vient d'être
recrutée. Nous avons donc eu, notamment, et dans le désordre: «Château de
sable» d'Anne Paceo, «Laissez-moi» de Julie Saury, «Short Night Blues» de Rhoda
Scott et «Golden Age» de Cat-Berro (la plus contributive). Une formation à deux
batteurs peut-être risquée. Soit comme chez Duke Ellington (épisode Elvin
Jones/Skeets Marsh, 1966), il y a deux tempos (déstabilisant pour les
solistes), soit c'est une surenchère démonstrative (Gene Krupa/Buddy Rich). Là,
Anne Paceo et Julie Saury ont très intelligemment abordé cette coopération,
soit par le relais, soit par la complémentarité. En tout cas, ce fut très
efficace et un élément important dans le succès du résultat, très swing. Les
solos des saxophonistes ne manquaient pas d'enthousiasme avec une Géraldine
Laurent toujours aussi «out» en parfait contraste avec la sobriété de Sophie
Alour. Lisa Cat-Berro est une excellente premier pupitre pour les passages en section
de saxophones impeccables dans la mise en place et le son d'ensemble qui bénéficiait
de la profondeur du baryton de Céline Bonacina. Une bonne soirée.
Michel Laplace
Texte et photos
© Jazz Hot 2019
|

Jan de Haas
Jazz Station, Bruxelles, 12 janvier 2019
© Pierre Hembise
Winter in Brussels
Clubs-concerts-festivals, janvier-février 2019
Le 12 janvier, la Jazz Station accueillait quelques-uns
des meilleurs jazzmen belges pour évoquer les grands moments de Steps Ahead (Jan de Haas, vib, dir,
Fabrice Alleman, ts, Ivan Paduart p, ep), Théo De Jong, b, Bruno
Castellucci, dm). L’hommage intitulé «Steps Tribe» reprenait pour le bonheur
des quaternaires les morceaux de bravoure du jazz-rock composés par Mike
Mainieri, Don Grolnik et Michael Brecker. Le plus souvent, on écoute Jan de
Haas à la batterie, comme accompagnateur. C’est beaucoup plus rare de le
retrouver au vibraphone et comme leader. Ce soir-là, son idée était de faire
revivre les sons et les rythmes des années 80 et non de se mettre en avant
comme soliste. Pour le reflet d’une certaine nostalgie, le pari fut gagné ! Au fil de thèmes,
comme «Tea Bag», «Island», «Sarah’s Touch», «Fawty Tenors», «Oops», «Pools»,
«Self Portrait», «I’m Sorry», «Trains»
et «Bullet Train» on apprécia le tempo et les lignes de Théo De Jong sur une
cinq cordes. Bruno Castellucci, attentif à la partoche, complétait l’assise en parfaite
harmonie avec le bassiste. Sur «Bullet Train» : on retiendra le thème joué
note pour note par le vibraphone et la basse. Effacé la plupart du temps,
Fabrice Alleman (ts) parvint à imprimer sa marque de hard-bopper dans quelques
solos dont il a le secret («Fawty Tenors»).Les vagues d’Ivan Paduart aux
synthés coloriaient joliment une musique qui charme encore aujourd’hui avec ses
contrastes, ses crescendos, ses retenues et une définition en mode majeur. A
l’occasion du premier rappel (il y en eut deux), Ivan Paduart imposa le choix
de «Before You» de Lyle Mays: l’opportunité de nous offrir un magnifique solo. Le concert s’est conclu sur «Blue Montreux». Dans
la salle, on remarquait la présence de Diederik Wissels (p) et de Bart Quartier
(vib) qui se fait trop rare à Bruxelles comme en Wallonie.
Le petit Musée Charlier de la commune de
Saint-Josse-ten-Noode, perpétue la tradition initiée par Jean Demannez (ex-bourgmestre)
en proposant un concert de jazz une ou
deux fois par mois. Depuis quelques années, les Lundis d’Hortense programment des solos, des duos et des trios. Le 15 janvier, entre 12h30 et 13h30, Diederik Wissels (p) et Nicolas
Kummert (ts) conjuguaient leurs talents autour de quelques œuvres
personnelles dont «Joy» (Kummert) et «Pasarela» (Wissels). Malgré de très jolis
solos de piano, je dois avouer avoir été déçu par cette association piano/sax-ténor.
Pour l’équilibre musical, j’aurais préféré ouïr un violoncelle. Quoiqu’il en
soit, l’assistance était à la mesure de la renommée des solistes :
quatre-vingt personnes. A l’heure du jambon-beurre, ce n’est pas si mal!
Une amie nous avait
chaudement recommandé d’aller voir la pièce Nina Lisa au Théâtre Le Public (Saint-Josse). Cette
création de Thomas Prédour et Isnelle da Silveira met en scène les relations
d’amour/désamour de Nina Simone et de sa fille Lisa dans la maison qu’occupait
la chanteuse de «My Baby Just Care for Me» à la fin de sa vie à Carry-le-Rouet
(13). Les rôles titres sont tenus par l’actrice et coauteure sénégalaise
Isnelle da Silveira (Nina) et la chanteuse belgo-haïtienne Dyna. Mieux qu’une comédie musicale, comptant une vingtaine
d’extraits chantés par l’une et/ou l’autre, la pièce s’attarde sur les
sentiments de manque partagés entre la mère et sa fille, mais aussi sur le
parcours de Nina Simone en faveur des Droits civiques aux Etats-Unis. Les
chansons étaient bien interprétées par Dyna mais c’est la puissance d’Isabelle
da Silveira –voix et gestuelle– qui furent remarquables. La mise en scène
sert les dialogues et les chants avec
maestria; l’accompagnement live du pianiste Charles Loos est impeccable (le
piano est sur la scène). Cette belle réussite mériterait un prolongement en
tournée en France. Et pourquoi pas dans la Salle Fernandel de Carry-le-Rouet?
Nous étions au Public le 18 janvier; le lendemain, Lisa Simone se produisait en
concert à Flagey! A-t-elle vu la pièce et l’a-t-elle apprécié?
Le 19 janvier, Les Doigts de l’Homme étaient à la Jazz Station, une première depuis dix
ans. Avec l’incorporation du breton
Benoît Convert (g) et du percussionniste franco-algérien Nazim Aliouche, le
leader, Olivier Kikteff (g), a redimensionné le groupe autour de ses
compositions originales et celles de Benoît Convert. Les deux guitaristes se
partagent les solos, se relayant au cours de morceaux négociés à vitesse V.
La sonorité est un peu plus métallique pour Convert; elle est vibrée et plus
matte pour Kikteff. Yannick Alcover (g) et Tanguy Blum (b) assoient les accords
et le tempo de manière rigoureuse. Le swing est intense et les compositions
osent quelques accents inhabituels, transméditerranéens. Comme il sied, les
musiciens s’amusent des envois (parfois lourds) d’Olivier Kikteff entre les morceaux. Le groupe est
bien rôdé, les arrangements sont en place; la musique primesautière. «Miss
Young», «Amir Accross the Sea», «Le Cœur des Vivants», «Caprice », «Old
Man River» et «I See the Light» sont quelques-uns des thèmes réjouissants
interprétés ce soir-là.

Olivier Kikteff, Jazz Station, Bruxelles, 19 janvier 2019 © Pierre Hembise
Vincent
Peirani (acc), Fred Casagrande(g) et Ziv Ravitz (dm, perc,
electronics): un trio de choc pour illuminer la soirée du jeudi 24 janvier à la Jazz Station, dans le cadre du River Jazz Festival. 140 personnes et salle comble dans un espace prévu pour la moitié; il fallait
réserver tôt pour espérer une place assise. Ce qui frappe immédiatement à
l’écoute des premiers morceaux, c’est la force d’expression d’un trio soudé
comme les doigts de la main. Et leurs mains savent très bien chanter sur
un lit d’ostinatos joué alternativement par l’accordéoniste ou le guitariste.
La base est souvent obsessionnelle; elle permet tous les crescendos.
L’inspiration va de la Mer de Chine au Golfe du Mexique en passant par les
côtes méditerranéennes, Indonésie («Joker»), Proche et Moyen-Orient («Dream
Brother»), Italie, Islande. Vincent Peirani et Fred Casagrande vivent
intensément ce qu’ils jouent, volubiles, inspirés, très jazz dans leurs solos.
Ziv Ravitz complète l’unité comme batteur ou percussionniste, mais surtout
comme l’ordinateur des sons; il lance des séquences préenregistrées, des loops,
des percussions sur des toms électroniques, des phrases courtes de clavinette,
des psalmodies chantées. L’électronique sert parfaitement la musique, sans
déformations, en enrichissements mieux qu’en complément. La technique de Fred
Casagrande est stupéfiante; alors que les doigts de la main droite remontent
les cordes, le guitariste attaque en descente avec le pouce entouré d’un
médiator métallique. A l’aide des pédales, il modifie les tons et les octaves
d’une six cordes d’apparence normale (une Fender) jusqu’à nous offrir des solos
et des accompagnements de basse très professionnels («Fool Circle» joué jadis
avec la chanteuse Yun Sun Nah). Avec «Ritournelle» et le solo d’accordéon, on
ose la comparaison avec Galliano. «Nin-na-Lan» est une berceuse lente jouée
au melodica par Vincent Peirani et enrichie par la clavinette de Ziv Ravitz. Le
concert s’est déroulé en une seule partie de quatre-vingt-dix minutes et s’est
conclu sur deux thèmes mêlant chansons islandaises et italiennes («Anouka», «Lesindarla», «Seria»).
Il faut saluer le travail remarquable de l’ingé-son pour le dosage très fin. La
technique et l’électronique sont au service de la musique. On a malheureusement
trop souvent l’inverse en concerts et en festivals.
Le 7 février, la toute
grande foule se pressait au Studio 4 de Flagey (sold out) pour écouter Stefano
Bollani (p). Nous connaissions le pianiste italien comme accompagnateur
d’Enrico Rava (tp) ou de Richard Galliano (acc) et nous ne pouvions rater
l’occasion de le redécouvrir seul face à l’ivoire d’un beau Steinway. Dans le
cadre du festival de piano, le maître avait choisi de faire la démonstration de
sa virtuosité au travers des chansons populaires de son pays («Azuro»,
«Volare»), de quelques originaux («Song for My Wife»), de grands standards de
Broadway et du jazz («Summertime», «Someday My Prince Will Come») et de
quelques tubes latinos comme «Estate» et «Besame Mucho». Le doigté du maître est
stupéfiant au travers des œuvres qui se succèdent en medleys avec des
changements de rythmes et beaucoup d’imagination. Trop d’imagination sans doute
lorsqu’il parodie la «Marche turque» de Mozart ou la «Cinquième» de Beethoven!
Et puis, colorier tout cela par des gesticulations assis-debout –avec ou sans
tabouret– et des traits d’humour à la grosse louche: c’en était trop et cela
tournait au spectacle de cirque. Virtuose, d’accord! Clown, non merci!
Parmi les rendez-vous de
février à la Jazz Station, la Singers Night mensuelle, le 16,
proposait aux chanteurs/ses amateurs de se présenter à 18h avec trois
partitions. Sous le contrôle de Natacha
Wuyts (voc) l’ordre de passage est tiré au sort et deux morceaux par personne sont sélectionnés. Un pianiste
professionnel assure l’accompagnement adéquat à partir de 20h30. L’assistance
d’une cinquantaine de personnes est constituée de parents, d’amis, de collègues
de bureau ou de simples curieux. Outre
de jeunes chanteuses, on a découvert l’une ou l’autre personne d’âge «mûr»; des
Belges, mais aussi des résidents européens: une Danoise, une Espagnole... Le
niveau n’est pas toujours exceptionnel, mais, en général c’est juste ;
raide, peu nuancé, mais juste. Deux jeunes filles se sont nettement détachées ce
soir-là au cours de cette joute amicale.
Le lendemain, le 17, il
ne fallait pas manquer le concert du trio d’Amaury Faye (p, voir la chronique de son disque dans Jazz Hot n°686). Le pianiste toulousain
et son batteur,Théo Lanau, résident à Bruxelles alors que Louis Navarro (b) a
choisi de vivre à Berlin après ses études au Conservatoire d’Amsterdam. C’est
d’ailleurs à Berlin que le trio enregistrera son prochain album live (le
projet étant d’un disque par année dans chaque capitale européenne). Nous avons
retrouvé ce soir-là toutes les qualités qui nous avaient séduites: cohésion,
virtuosité, richesse des arrangements. Le concert débuta par «Ilex», le thème
qui clôture l’album. Vinrent ensuite : «Yosemite» puis «Ugly Beauty», une jolie
valse. «April Showers» est entamé par la seule main droite du pianiste en duo
avec le bassiste, puis la batterie lance le bridge sur un up-tempo qui
introduit un solo très inspiré d’Amaury Faye. Solo de basse, solo de drums aux
balais puis aux cymbales; reprise du thème. Le premier set se termine sur une
belle ballade «In the Small Hours in the Morning». En seconde partie, le trio
nous offrira deux standards: «Fascination Rhythm» de Gershwin et «We See» de Monk. Le premier de ces morceaux
ouvre à nouveau sur une longue intro au piano avant l’exposé du thème, le solo
de basse, la reprise fulgurante du claviériste et le solo de batterie. Pour «Wee
See», on note la manière remarquable de séquencer et breaker de Théo Lanau;
l’osmose est parfaite entre le piano et les drums ; elle l’est aussi lors d’un duo basse/batterie et lors du 4/4
qui suit. Les trois morceaux suivants sont joués en enchaînements: «They Didn’t
Believe Me» de Jérôme Kern, «Interlude» puis «Escalator». Syncopes, notes
retenues, ostinatos, tensions, détentes ; la construction est tellement rigoureuse qu’on pourrait
croire que tout est écrit et joué par cœur (il n’y a pas de partitions sur les
pupitres). Pour le bis, les musiciens nous ont offert un blues de derrière le
chemin de fer (on est à la Jazz Station!)
sur un tempo du diable tenu avec talent par Louis Navarro, le jeune et
surprenant contrebassiste. On en redemandera!
 Amaury Faye, Jazz Station, Bruxelles, 17 février 2019 © Roger Vantilt
Le 20 février, Diederik Wissels entamait son Jazz
Tour en quartet pour Les Lundis
d’Hortense. Séduit par l’album Pasarela et resté sur ma faim lors du concert en duo au Musée Charlier (lire plus haut),
j’avais convié quelques amis à découvrir le groupe à la Jazz Station. Je pense avoir
été mal inspiré! Je n’ai pas retrouvé les mélodies sensibles découvertes
l’année dernière. Le premier set a duré quelque soixante minutes de séquences
collées; longs exposés minimalistes au piano, reprises en duos (sax-piano),
quelques sursauts en quartet… Ennui garanti! C’était légèrement mieux au cours
de la seconde partie avec des œuvres apparemment mieux maîtrisées et quelques
solos intéressants: Nicolas Kummert (ts, voc), Victor Foulon (b) et le plus inspiré, Thibault Dille (acc,
melodica). Pas de synthés ni de loops pour ce concert; Diederik Wissels avait
sans doute pris le parti de tester quelques idées. Les malheureux cobayes
étaient en droit d’attendre des œuvres plus abouties!
Jean-Marie Hacquier
Photos © Pierre Hembise et Roger Vantilt
© Jazz Hot 2019
|
|

