
Jazz Movies (les films-recherche chronologique)
Jazz Live! (les vidéographies disponible en ligne-recherche alphabétique)
|
|
JAZZ MOVIES
• Les films •
|
|
© Jazz Hot 2025
|
|
Sinners
Film de Ryan Coogler (production Ryan et Zinzi Coogler, Sev Ohanian),
137 min., USA, en anglais, sorti en France au cinéma le 16 avril 2025
https://www.imdb.com/fr/title/tt31193180/fullcredits/?ref_=tt_cst_sm
https://www.youtube.com/watch?v=AsTeafVF-KE
Extraits de la bande originale:
https://www.youtube.com/watch?v=suxyBQr1TQw
https://www.youtube.com/watch?v=juNKOc67CYo
https://www.youtube.com/watch?v=1AOydLHGMnY
Sinners est le cinquième long-métrage de Ryan Coogler dont le premier, Fruitvale Station (2013), retraçait le meurtre en 2009 à Oakland, CA, d’Oscar Grant III âgé de 22 ans. Fidèle à ses thématiques –l’Afro-Amérique et le racisme–, Ryan Coogler a enchaîné les succès hollywoodiens, dont le genre fantastique auquel Sinners se rattache, entre fresque historique, pastiche à la Quentin Tarentino teinté de Chester Himes et comédie musicale blues. Car le blues «musique du diable» est au centre du film pour ses pouvoirs magiques hérités d’une Afrique ancestrale, laquelle alimente le rêve afro-américain du «retour» depuis Marcus Garvey (1887-1940) et a inspiré aussi bien les artistes de la Harlem Renaissance que des générations de jazzmen. Côté bande-son du film, saluons le travail de reconstitution du compositeur suédois Ludwig Göransson –un habitué des studios qui collabore avec Ryan Coogler depuis son premier film– tant pour la toile de fond musicale que pour les thèmes originaux interprétés par les personnages.
L’histoire se déroule sur la journée et la nuit du 16 octobre 1932. Deux jumeaux (interprétés par Michael B. Jordan, acteur fétiche de Ryan Coogler), Stack et Smoke, reviennent après sept ans d’absence dans leur ville natale de Clarksdale, MS (cf. Jazz Hot n°501), fortune faite dans la pègre de Chicago, à la tête d’un énorme stock d’alcool probablement volé. L’idée de ces entreprenants voyous est d’ouvrir un juke joint, une taverne aménagée dans une ancienne scierie rachetée incognito au responsable local du Ku Klux Klan. Ils en confient l’animation musicale à leur cousin Sammie, un jeune prodige de la guitare (campé par Miles Caton, excellent chanteur) qui travaille dans les champs de coton, et à un vieux pianiste alcoolique, Delta Slim (Delroy Lindo). La première heure du film plante ce décor du Sud profond marqué par une tension raciste à fleur de peau («les Blancs aiment le blues mais pas ceux qui le jouent» explique Delta Slim) et la rugosité, souvent la violence, des rapports entre individus, tant sur le plan communautaire que familial et sentimental, Stack et Smoke renouant avec leurs anciens amours, deux femmes de caractère: Mary (Hailee Steinfeld), une métisse qui passe pour «blanche», et Annie (Wunmi Mosaku), experte en sorcellerie. Ouvert le soir même, le club voit affluer une clientèle de «pécheurs» (sinners) avides d’échapper pour quelques heures à la dureté de leur vie en communiant autour du blues et de la danse, dans une atmosphère débridée et poisseuse faite d’alcool, de jeux d’argent, de sexe, de sueur et de bagarres. Investi dans sa musique au point d’entrer en transe, Sammie qui a le don de convoquer les esprits (musicaux) du passé et du futur, se retrouve dans un bœuf onirique entre griots africains et… rappeurs! Habile sur le plan technique (notamment sonore), la scène illustre intentionnellement la continuité culturelle entre Afrique et Afro-Amérique jusque dans l’expression hip hop; un discours par ailleurs régulièrement soutenu par des musiciens de jazz comme Jason Moran, Robert Glasper, etc.
La seconde partie relève du film d’action autant que du fantastique, décrivant l’attaque du club par des vampires dirigés par Remmick (Jack O'Connell), un immigrant irlandais (de son vivant) qui a réchappé de la traque menée par une troupe d’Amérindiens! Lui-même musicien, il est attiré par le don de Sammie qu’il convoite. Entre deux coups de flingues, le film distille encore quelques idées: le juke joint, espace précaire d’une liberté vitale, à l’abri des «Blancs», se défend au prix du sang des «pécheurs»; le dilemme de Stack et Smoke oscillant entre leurs petits intérêts personnels et la solidarité communautaire pour ouvrir des «ardoises» (crédits) aux clients travaillant dans les champs de coton; l’antagonisme culturel Afro-Américains/Euro-Américains se manifeste au plan musical par l'opposition entre le blues des vivants et la folk-country des vampires: la prédation des vampires comme métaphore de la prédation du monde blanc à l’égard du monde afro-américain.
On retiendra aussi de Sinners la présence de la légende Buddy Guy dans une séquence qu’on laisse découvrir à ceux qui seront tentés par cette fiction fantastique mais très convaincue, avec naturel, des pouvoirs surnaturels du blues dans le Delta! Qui ne le serait pas quand on connaît John Lee Hooker, Muddy Waters ou Howlin’ Wolf parmi beaucoup d’autres?
Jérôme Partage
Sur le blues et l'Afrique rêvée des jazzmen, dans JAZZ HOT:
• Rubrique «Recherches dans Jazz Hot»: pour connaître les archives sur les musiciens et autres acteurs du jazz, les références données dans le présent article n’étant que parcellaires…
https://www.jazzhot.net/PBCPPlayer.asp?ID=2429560
• Table des numéros de Jazz Hot par année:
https://www.jazzhot.net/PBSCCatalog.asp?CatID=692881
• Index alphabétique des Tears en ligne:
https://www.jazzhot.net/PBCPPlayer.asp?ADContext=1&ID=2202601
• Table des index de Jazz Hot par rubrique:
https://www.jazzhot.net/PBCPPlayer.asp?ADContext=1&ID=2429540
© Jazz Hot 2025
|
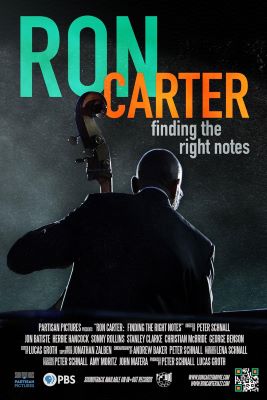
Ron Carter
A la recherche des notes justes (Finding the Right Notes)
Documentaire de Peter Schnall (réalisation et production:
Partisan Pictures/DVD PBS), 107 min., USA, 2022,
Tourné entre 2017 et 2022, ce très bon documentaire sur Ron Carter de Peter Schnall nous fait percevoir l’essence d’un artiste habité par le son, musicien dans
l’âme, compositeur, jazzman et messenger conscient de son rôle, de son
devoir de garder la musique en vie, le jazz, pour les autres. Cette biographie nous
fait comprendre l’essence d’un humain et de ce qui l’a constitué. Le réalisateur
(et directeur de la photographie), questionne et travaille en profondeur les
relations (in)humaines dans la société américaine, celles aussi entre l’artiste
et le collectif live dans lequel il s’insère, mais surtout le rôle de
l’art dans la transmission des valeurs philosophiques, notamment la notion de
«juste», à la croisée de la «justesse» (des notes), de la «justice» (des
hommes), et donc de l’intégrité indispensable pour lutter contre le dysfonctionnement
systémique social. Avec Ron Carter, «l’homme en quête du juste», et pas
seulement pour les notes bleues qui lui donnent la sérénité, Peter Schnall a un
interlocuteur, un coréalisateur, davantage qu’un «sujet». Ron Carter dit sans
détours: «Combien de temps ai-je envie de
poursuivre la lutte, ou de faire partie de la lutte?» au moment de ses 80
ans, alors qu’il a déjà traversé le champ de mines de la vie.
Le pianiste Jon Batiste joue le rôle du Candide 2.0 partant
découvrir un continent de vécu, de rigueur, de discipline, de maîtrise,
d’épaisseur et de don de soi, un monde si différent du sien, de son être à lui,
Jon Batiste; il interroge un monde structuré en voie de disparition, dans la
concurrence désordonnée des apparences qui règnent sur notre planète. Pourtant,
par son immersion familiale dans le jazz, le jeune pianiste de NOLA pourrait
être –ce qu’il n’est pas, son début d’œuvre en atteste– le bon expérimentateur
au piano ou avec les mains, être l’héritier d’une perception au-delà de l’instrumentiste
surdoué testant des éléments rythmiques et harmoniques dont Ron Carter veut
donner la compréhension à l’image.
Le fil conducteur choisi par Ron Carter est la ségrégation,
le racisme, qui l’ont forcé, étant né en 1937 à Ferndale, MI, non loin de
Detroit, à devenir bassiste de jazz, alors qu’il voulait être violoncelliste
classique, et donc à se dépasser jusqu’à côtoyer l’excellence en participant à
créer un nouveau langage, car comme il l’énonce clairement: «On est tous égaux jusqu’à la fausse note, et
là, on n’est plus si égaux». Son parcours nous en rappelle de nombreux
autres, de Charles Mingus à Nina Simone pour ne citer qu’eux.
De concerts en témoignages, d’archives en auto introspections,
le portrait de Ron Carter se dessine: de son père qui avait dû travailler plus
que dur pour éduquer ses huit enfants et leur construire une maison, aux
voyages inquiétants où tout peut arriver à cause de la couleur de peau, en
passant par le racisme guindé des orchestres classiques qui refusent l’embauche
du meilleur violoncelliste parce qu’il est Afro-Américain. Ces touches
d’informations construisent, au fil des récits, au fil des expressions, des
images, ce qui a bâti un Ron Carter: une détermination endurante, une curiosité
sans limite, une honnêteté vitale pour lui-même: trouver la juste note,
d’autres combinaisons de notes, chercher les défauts, rester patient et arriver
à ses fins.
Plusieurs musiciens interviennent dans le documentaire dont
George Benson, Russell Malone qui vient de disparaître en laissant Ron Carter et Donald Vega terminer seuls leur
tournée au Japon, réactivant la douleur de la perte, après celles de sa
première épouse, Janet Hasbrouch, en 2000, celle de son fils Myles en 2018
alors qu’il joue dans les festivals d’été, sans compter ses amis musiciens partis,
nombreux à la période du covid, une période de gestion sanitaire par
interruption des relations humaines dont on saisit l’impact mortifère dans la
communauté du jazz qui vit du contact, du live.
Parmi les autres témoignages apportés (cf. casting IMDB et roncartermovie.com cités
en entête), dont Sonny Rollins, Herbie Hancock, Buster Williams, Christian
McBride, Stanley Clarke a cette très fine et tendre observation sur son ami: «Même quand il est sérieux, il y a quand même
du comique». Une autre qualité de Ron Carter est son élégance organisée
poussée jusqu’à un art de vivre avec les autres, la considération qu’il leur
accorde, mais aussi l’exigence demandée en retour à chacun, comme l’importance
de chaque détail de son environnement: son appartement rangé, avec des objets
d’arts qui le ressourcent quand la vie secoue, le décompte précis en tête du
nombre de ses disques (à l’époque 2221, sans compter plus de 50 sessions non parues), le
classement alphabétique de ses albums en leader pour trouver ses idées
rapidement… Tout un monde d’équilibre et d’harmonie pour garder le cap de ses
objectifs au milieu du tumulte: «C’est
comme ça que la musique vit, quand les gens en veulent… qu’ils veulent de la
musique dans leur vie. Quand vais-je me lasser d’être celui qui les aide?»
A la fin, à Jon Batiste qui le questionne sur la recherche qui semble être sa première préoccupation: «Qu’est-ce-que le succès?»,
Ron Carter répond avec une leçon de sagesse dont il a le secret: «Le chemin que j’ai
pris me plaît, mes derniers efforts étaient honnêtes, chaque note jouée était sincère…
chaque occasion que j’ai de jouer, de trouver un nouvel arrangement de notes,
pour moi, c’est ça le succès.» Un ange passe…
|
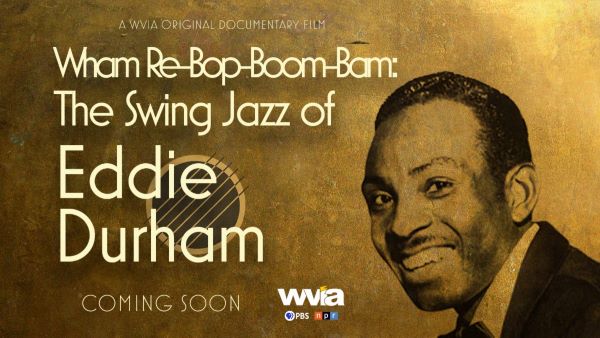
Wham-Re-Bop-Boom-Bam
The Swing Jazz of Eddie Durham
Documentaire de Kris Hendrickson/Loren Schoenberg
(PBS/NPR/WVIA/Chiaroscuro Records), 56 min., USA, version anglaise
Sortie le 1er février 2024 aux Etats-Unis sur le réseau de
l’American Public Television (250 stations sur les Etats-Unis)
Ce documentaire intéressant
comprend des archives riches en photos, vidéos, affiches, disques(1), sur Eddie Durham (comp,arr,g,tb, 19
août 1906, San Marco, TX – 6 mars 1987, New York, NY). La reconstitution et une
mise à disposition publique de ce patrimoine ont été rendues possibles grâce au
travail initial essentiel de conservation active par sa famille, notamment
Topsy Durham, sa fille, qui porte le prénom d’un de ses titres fétiches chez
Count Basie en 1937.
D’autre part, la mise en
scène de ces archives est bien valorisée par la réalisation claire et un
montage rythmé de Kris Hendrickson, comme
par l’apport de Loren Schoenberg (s), qui, par son vécu musical et d’enseignant,
sa mission de messenger, s’attache à
faire vivre le jazz dans tous ses projets comme le National Jazz Museum in
Harlem. Cette équipe d’afficionados d’Eddie
Durham, arrangeur créatif à la personnalité pétillante et profonde, montre un
parcours attentif et perceptif aux aventures et expériences humaines traduites dans
son expression artistique. Le documentaire comprend des interventions sur les
différentes facettes de son art et anecdotes ainsi que les témoignages d’étudiants
à Juilliard qui ont travaillé des arrangements d’Eddie jamais enregistrés: un
son, une respiration swing, autant de défis et de gages d’une nouveauté
réjouissante à vivre, à ressentir au sein-même d’un orchestre.
Le
film nous transporte dans sa biographie, depuis son Texas profond, avec un père
surnommé «Bronco» (sauvage!), violoniste métayer très bricoleur qui fera bouger
sa famille pour la nourrir, mais aussi pour produire le Durham Brothers
Orchestra comprenant Joe (b), Allen (tb), Roosevelt (vln,p,g), Earl (p), Clyde
(b), Sylvester (p-org) puis plus tard Eddie (g,tb): un apprentissage accéléré
de la vraie vie débrouillarde, et de l’art du jazz enraciné dans le blues et la
danse. Eddie en retirera une intelligence agile et inventive, productive dans
le repérage des atouts de chacun pour les combiner dans une énergie collective
fusionnelle, ce qu'il fait aussi facilement qu’il comprend une panne et répare sa
voiture ou construit un meuble. Pas étonnant qu’il ait été l’arrangeur d’«In
the Mood» pour le Glenn Miller Orchestra, un hymne rythmico-mélodique au
ronronnement envoutant pour des générations de danseurs. Car c’est une époque
où le jazz et la danse ne font qu’un, comme pratique sociale de tous les moments, un réconfort
indispensable contre l’Amérique des insécurités des plus démunis, de la
ségrégation, de la crise de 1929 qui, elle, prend fin au tournant 1937-1938, à
la faveur de la réactivation de l’industrie de guerre, un fléau chassant
l’autre. De 1924 à 1939, Eddie fait son chemin, dort dans les bus, fait la route
avec les cirques, les minstrels,
saisit sa chance au sein des Territory Bands, la pépinière ambulante des jazzmen
en herbe, des Blues Devils de Walter Page (b,tu,bar,lead, 1900-1957) comprenant
entre autres Count Basie et Jimmy Rushing au sein de l’orchestre de Bennie Moten à Kansas City(2): tous les talents (Ben Webster, Lester Young…) finissent par se
regrouper autour de Count Basie en 1935. Après un furtif passage chez Cab
Calloway, Eddie poursuit chez Jimmie Lunceford et rejoint de nouveau Count Basie en 1937. A partir de 1938, il fait des
arrangements pour Ina Ray Hutton (orchestre féminin), Glenn
Miller avec les Inks Spots, Artie Shaw, Benny Goodman.
On est en pleine Swing Era avec des ballrooms (dont le Savoy à Harlem) remplis de centaines de personnes, et pour faire entendre le
potentiel rythmique et les solos de guitare dans les big bands, Eddie avait
commencé à amplifier électriquement le son depuis le début des années 1930: grâce
à ses longs doigts, il laisse libre cours à son imagination qui lui permet de développer en
parallèle des chorégraphies instrumentales pour accentuer visuellement l’effet
swing du call & response, des riffs entre les différentes sections
instrumentales, un spectacle de la scène qui dope encore l’ambiance dans la salle avec les lindy hoppers qui voltigent sur la piste. Le 18 mars 1938, Eddie grave le premier
enregistrement de guitare électrifiée («Laughing at Life» sur une Gibson ES150) avec le
Kansas City Five composé de Freddie Green (g), Buck Clayton (tp), Walter Page
(b), Jo Jones (dm), pour Milt Gabler, le disquaire et patron actif du label Commodore à New York. Pendant qu’Eddie
peaufine la rythmique souple et blues de ses arrangements avec guitare,
l’Amérique a retrouvé du travail et l’Europe y émigre pour fuir les fascismes,
ramenant les derniers musiciens américains installés à Paris où ils ont été
adulés depuis 1918: l’atmosphère de fête effrénée qui précède la Seconde Guerre a
ainsi traversé l’Atlantique et dure jusqu’à l’attaque de Pearl Harbour (7 décembre
1941) où la mobilisation militaire consécutive va donner à Eddie l'opportunité de détecter et combiner les points forts individuels
dans ses arrangements, pour dynamiser le potentiel collectif des
orchestres féminins(3) qui remplacent les hommes partis: ce seront les Sweethearts
of Rhythm, les Durhamettes, les Darlings of Rhythm, les Syncoettes, The Eddie
Durham All-Girl Orchestra accompagnant Ella Fitzgerald à l’Apollo. Le
documentaire en profite pour faire une focale sur le rôle des femmes instrumentistes dans le jazz
dès l'origine, dont la magnifique Mary Lou Williams.
Après guerre, Eddie poursuit son travail dans un orchestre féminin et compose. Puis il se met en semi-retraite
le temps de fonder une grande famille de cinq enfants, tout en ayant des activités
souvent bénévoles (écriture et dépôt de partitions Ascap pour des tiers, maison ouverte aux
musiciens jeunes ou chevronnés) et participe aux festivals de la Cavalcade of Jazz
(1945-1958) à Los Angeles, CA. Eddie accompagne Buddy Tate (1969), apparaît
dans L’Aventure
du Jazz de Louis Panassié (1972), fait partie du Harlem Blues
& Jazz Band créé par Al Vollmer en 1973, et part jouer en France avec les Buck Clayton Count’s Men en 1983. Il
fête ses 80 ans à la Saint Peter’s Church de New York, puis au retour d’une
croisière jazz en Scandinavie quelques mois plus tard, il décède d’une crise
cardiaque. Il n’était jamais malade et toujours très calme disent ses proches. Eddie
Durham a eu une belle vie car il a su bien la remplir, apprenant des autres autant qu’il leur faisait partager son expérience
artistique et de vie.
Le
film conclut sur son héritage actuel dans sa ville natale de San Marco qui a
donné son nom au parc où est organisé l’Eddie Durham Festival avec le Calaboose African
American Museum, à la
Texas State University, à Columbia University et Juilliard (New York), lors de
la célébration annuelle de sa musique au Hill Country Jazz Festival d’Austin,
TX, et grâce au All Star éponyme mené par Doug Lawrence (s,lead).
Alors
souhaitons à ce documentaire de franchir les frontières des USA, et au jazz
d’accroître sa mémoire, en reconstituant la vie de ses artistes et de leurs
œuvres par des moyens de conservation moins captifs, futiles et éphémères que
les réseaux sociaux auto-effaçables de l’air du temps. Les proches et les
amateurs sont souvent les meilleurs remparts contre les pertes de pans entiers
de l’histoire des arts étrangement peu protégés quand ils ne sont pas
académiques mais populaires.
Hélène Sportis
© Jazz Hot 2024
1. Cf. DAHR/Discography of American Historical Recordings:
|
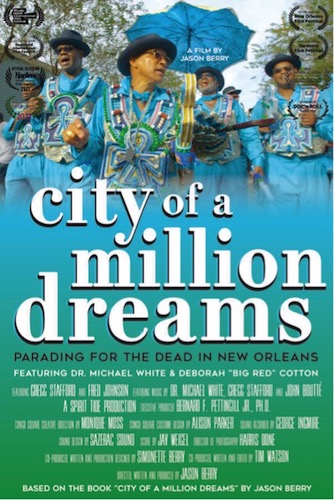
City of a Million Dreams
Parading for the Dead in New Orleans
Documentaire
de Jason Berry (réalisation et production, Spirit Tide), 90 min., USA, en
anglais avec une version sous-titrée en français, 2021, sorti aux Etats-Unis,
Royaume Uni
Bande annonce et site officiel: https://cityofamilliondreams.com
Détails de la production: www.imdb.com
City of a Million Dreams est tiré d’un livre (2018) éponyme de Jason Berry dont le sous-titre est: «A History of
New Orleans at Year 300», alors que le sous-titre du film est: «Parading
for the Dead in New Orleans». Jason est un journaliste d’investigation,
écrivain, réalisateur, et l’idée d’avoir pris pour le documentaire, l’axe et
l’histoire des parades funéraires de la ville, devenues légendaires, sont un
prisme intéressant pour retracer la construction spirituelle et artistique corrélée
à l’énergie de New Orleans, qu’elle soit la conséquence de son esprit rebelle, résistant,
faisant face aussi bien à la nature déchaînée –ouragans ou épidémies–, qu’aux
hommes déshumanisés –de l’esclavage à la ségrégation, la corruption ou la misère–,
mais venant aussi de l’ancrage dans ses ancêtres, les spirits, qui transmettent aux vivants la force d’espérer, de lutter,
de se dépasser pour essayer sans relâche de créer un monde plus juste.
A New
Orleans, les déshérités luttent contre l’adversité, en ralliant les morts, les vivants
et ceux à naître, agrégeant toutes les fois et rites protecteurs (syncrétisme religieux) contre les
forces maléfiques en général bien réelles et concrètes dans un vécu difficile, ralliant les traditions
indiennes aux différentes églises en passant par le vaudou ou les pratiques
sociales de toutes les communautés, notamment afro-américaine et sicilienne par
la pratique du jazz (dont le gospel et le blues), de la danse voire de la transe,
avec cette particularité de croire dans le surnaturel profane malgré
l’interdiction des clergés institués, le désespoir faisant feu de tout bois,
avec un bon sens sans exclusive!
Le documentaire comprend un très grand nombre
de belles archives dont les second lines lors des enterrements célèbres comme celui de Danny Barker (bjo,g, comp,
enseignant), une reconstitution des rites chorégraphiés à Congo Square, et la
trame narrative conduite en paroles et musique par Michael White (cl, comp, lead,
historien),
tant pour les aspects jazz qu’humains, et parfois jusqu’à un niveau très intime
quand il nous parle de sa vie «d’après 2005» ou que nous entrons avec lui dans
son domicile dévasté après l’ouragan Katrina, de même que dans son hommage poignant à
Deborah Cotton, journaliste consultante sur le film, une amie, décédée en 2017, des suites d’une fusillade entre gangs, lors d’une parade de fête des mères en
2013. Elle était venue d’Hollywood à New Orleans, peu avant Katrina en 2005,
pour écrire sur la cuisine; elle y est restée pour la cuisine, mais surtout pour
chroniquer avec finesse et admiration les second
lines, fanfares et Mardi Gras, les social
aid and pleasure clubs, signant Deb Big Red Cotton, en référence aux chants
des Black Indians. Dans son blog sur Gambit
Weekly, Deborah mettait en évidence ce lien indéfectible entre pratique
culturelle et entraide sociale, devenant une des activistes de la restauration
culturelle et sociale des rues de New Orleans après Katrina. A la suite de la
fusillade, elle avait milité pour inciter à réformer la justice pénale dans le
sens d’une meilleure réinsertion, d’un suivi plus attentif des jeunes notamment,
rendant visite en prison à celui qui l’avait blessée, car elle se sentait davantage survivante d’une situation
très dégradée du fait de l’abandon par l’Etat local mais surtout fédéral, que
victime d’une balle perdue d’un gamin qui ressemblait à son neveu.
Un des
aspects très captivant du film est la perception de la chaleur humaine dans ces
entrelacs sans cesse renaissant de couleurs, de mise en musique et en danse de
l’espace public, avec ses codes respectueux mais surtout affectueux vis-à-vis
des morts, pour les accompagner dignement vers ce monde qui ne peut être que meilleur que celui dans lequel ils ont vécu; de là-bas, ils seront une aide et un soutien précieux. Rappelons qu’à
l’époque des confinements-covid, Jazz at Lincoln Center, très new orleans du fait de la présence de
Wynton Marsalis, avait enregistré à distance, évidemment avec Dr. Michael
White, une marche funèbre pour un Memorial For Us All, c’est dire qu’on ne
rompt pas facilement avec les traditions: ne pas bien accompagner les morts est
inhumain, à New Orleans en particulier mais pas seulement.
Au fil des street parades et murals (peintures),
Jason Berry montre et décrypte une autre façon d’aborder la vie, en solidarité plutôt qu’en concurrence impitoyable. Cette manière est le fruit d’une lente maturation
de la douleur au fil des siècles, qui donne plus de sagesse et de poids aux
actes du quotidien, l’humain transcendant parfois l’horreur en beauté
collective, comme la naissance du jazz à New Orleans.
Le travail sur ce film a
duré 22 ans, incluant donc la période covid où il n’y eut plus de parades, second lines et Mardi Gras pendant 18 mois jusqu’à
l’automne 2021. Souhaitons à ce beau documentaire déjà multiprimé (New Orleans,
Harlem, Sarasota…) de trouver rapidement un distributeur en France; il est des leçons de vie, universelles, qui sont essentielles, et dont la France comme le reste du monde ont grand besoin dans la période d'effacement totalitaire que nous traversons…
|

Nothing But a Man
Un homme comme tant d'autres
Film
de Michael Roemer (réalisation, production: Roemer/Young/Du Art Films Laboratories), 90
min., USA, en anglais, 1964, actuellement à l’Action Christine à Paris 6e ou disponible en blu-ray
Vient de ressortir au cinéma (pour la première fois en
France) Nothing But a Man, une
pépite oubliée du passé, avec toute sa pulpe, sa densité, sa réalité, une force
et une épaisseur percutant sévèrement la superficialité du XXIe siècle virtuel aux débats nombrilistes et ethnocentrés. L’histoire se passe en
Alabama(1) au tout début de la Lutte
pour les Droits civiques (1954-1968), alors que chaque Afro-Américain ne sait
pas encore vraiment comment gérer les situations avec le dominant qui le
contraint jusque dans ses moyens de subsistance: un calcul psychologique subtil,
entre survie biologique immédiate et exigence d’une vie pleine, avec le respect
des valeurs humanistes du dominant envers le dominé; un calcul aussi ajusté en
fonction du risque, de la peur, du courage individuel et collectif. Film au
budget serré de 230 000$, chaque participant est payé 100$ par semaine; côté
musique, c’est un jeu de relations qui permet d’acheter à Berry Gordy, Jr.
(1929, Detroit, MI) pour 5000$ quelques disques des jeunes vedettes de la Motown pour la bande son, mais cette
rencontre n’est pas un hasard total dans ce bouillonnement activiste de l’année
1963 où le jeune producteur-fondateur du label mythique de Detroit a aussi discuté
avec le Dr. Martin
Luther King, Jr. au
début de l’année, pour conserver/préserver les droits d’enregistrement de la
Marche sur Washington du 28 août, après avoir enregistré le discours du leader une
première fois deux mois avant, à Detroit sur Gordy Records, en juin,
précisément à la période du début de tournage(1): car l’engagement pour essayer de sortir les USA de sa violence
institutionnelle ségrégationniste est le fait d’un milieu restreint mais très
mobilisé en politique, dans les secteurs économique, juridique, religieux, social et artistique, dans la diversité du jazz, dans la photo, le théâtre, la poésie, la peinture, le cinéma,
c’est un microcosme dans un microclimat qui va permettre de gagner enfin quelques
points sur les plus forts. Les deux acteurs principaux Ivan Dixon et Abbey Lincoln(2) comme le
reste du casting sont aussi très impliqués dans le Mouvement: le tournage
s’interrompt donc le 28 août pour que tous puissent aller à la Marche sur Washington pour l’emploi et la
liberté conduite par Martin Luther King, Jr. Quand le film arrive en
production à la mi-septembre, l’attentat du Ku Klux Klan à l’église baptiste de
Birmingham, AL, tue quatre adolescentes. La réalité a de nouveau dépassé la
fiction.
Le film combine la puissance des histoires universelles et le
regard clinique de la lèpre raciste: Josie, la fille institutrice du révérend
conservateur n’aime pas voir son père composer avec le pouvoir local pour
ce que lui pense être le moins mal pour sa paroisse; elle tombe amoureuse d’un
ouvrier du rail itinérant, un syndicaliste inséré dans un collectif de travail
soudé, Duff, qui n’a pas l’habitude de «composer», bien qu’ayant été informé
que le dernier lynchage mortel dans la localité remonte à huit ans. Ils
décident de se marier contre les avis aux raisons multiples de l’entourage, et
se retrouvent immédiatement confrontés aux risques supplémentaires quand il
s’agit de construire une vie de famille dans une société d’apartheid, sans protection sociale, utilisant le refus de travail vital en lynchage
modernisé pour mater les fortes têtes.
Le thème universel –l’amour en climat
hostile–, donne à Michael Roemer et Robert M. Young (1924, New York) une trame efficace
dont le scénario, les dialogues et cadrages cisellent les moindres nuances de
perceptions et de réactions qui interagissent au sein de la communauté
afro-américaine en cette période de gestation pour faire advenir une société
moins injuste. Pour affiner le trait et être au plus près de la réalité des
différentes stratégies humaines selon les personnalités face à la violence
raciste, Michael Roemer et Robert M. Young s’immergent trois mois au sein d’une
communauté en Alabama grâce à la NAACP, afin de bien saisir, sans trahir, l’acuité
de chaque posture face à l’indignité, au danger mortel, et suivre les
dynamiques de situations qui en découlent. Le résultat est du cinéma réel, vivant,
incarné, d’une authenticité faisant décerner au film deux prix à la Mostra de
Venise 1964; la légende dit que c’était le film préféré de Malcolm X
(1925-1965), mais il n’a pu être diffusé que dans les écoles et églises
afro-américaines à sa sortie.
Dès l’introduction du film, le spectateur est
immergé dans le travail sur les voies et submergé par les prêches et transes à
l’église baptiste; la suite l’emporte dans un torrent: pas une image, une
expression, un geste, ou un mot, inutile
ou à côté: une perfection de réalité, crue, un uppercut au cerveau, sauf pour
ceux qui n’en ont pas comme les deux assis juste derrière ce jour de projection à Paris, entre souvenirs de
vacances et jeux de séduction: un autre rappel à la dure réalité de notre
siècle, futile à en vomir, les deux niveaux d’expérience disait le clairvoyant
James Baldwin.
Le regard extralucide, comme au-delà des visages, au cœur de
la réflexion intime, rappelle les photos saisissantes de Francis Wolff(4), qui, comme Michael Roemer, a fui Berlin à la dernière limite en 1939… Michael a
pu bénéficier à 11 ans des Kindertransport,
une exfiltration de 10000 enfants allemands juifs par les Britanniques, et
retrouvera sa mère à Boston en 1945. Après
des études de littérature anglaise à Harvard où Michael Roemer rencontre Robert
M. Young –natif de New York et assurant la photo dans ce film–, son port
d’attache est l’Université de Yale, de 1966 à 2016, faisant profiter ses
étudiants de son esprit vif, de son immense culture et de sa profondeur
d’analyse. Il réalise en parallèle d’autres films ou documentaires indépendants,
ou à vocation pédagogique (plus d’une centaine), toujours soucieux de qualité
et de cohérence, utilisant par exemple la musique de Django Reinhardt à des
moments précis de son film introspectif Vengeance Is Mine (1984). Un de ses premiers documentaires TV avec son ami Robert Young, commandé par NBC en 1962, portait sur la pauvreté et la mafia dans un bidonville
de Palerme en Sicile(4): le résultat est
si percutant que NBC le refuse par
peur de choquer la «sensibilité» américaine(!), sans doute du second degré. Mais
l’expérience leur est néanmoins profitable car Nothing But a Man sera produit en indépendant pour avoir comme on
disait alors sur le plan symbolique, le final
cut, un terme de montage illustrant la liberté d’aller au bout de ses idées
sans pression financière, politique ou de bien-pensance, les plaies du cinéma
hollywoodien, accentuées à partir du maccarthysme (1946). Après avoir vécu très
longtemps à Yonkers (NY), à 95 ans, Michael Roemer vit sa retraite dans le
Vermont, amusé de se savoir le sujet de nouvelles curiosités avec la ressortie
de ses films, sans doute très lucide sur son temps, et sans aucun doute même sur
celui d’aujourd’hui, s’agissant par exemple de bien différencier la liberté d’être
de l’addiction d’avoir. Quand le film est ressorti aux Etats-Unis en 1993 (trente ans après, il y avait eu prescription de son offense aux dominants!), la Library of Congress l’inscrit en 1994 au National Film Registry. En 2004, le film est sorti en DVD aux Etats-Unis et Camélia le distributeur en France pense le sortir en DVD à la fin de l’année en version originale sous-titrée, à suivre donc.
Hélène Sportis
1. Film tourné à
Atlantic City et Cape May entre juin et début septembre 1963, dans le New
Jersey: on se rappelle les tensions et risques de tournage pour le film I Hate Your Guts/The Intruder de
Roger Corman (1961).
2. Abbey Lincoln est alors mariée depuis 1962 avec Max Roach lui-même très engagé dans le Mouvement des
droits civiques. Abbey Lincoln et Jazz Hot:
n°195, février 1964, n°232, juin 1967, n°381, février 1981, n°485, janvier 1992, n°524, octobre 1995, n°652, été 2010.
3. Francis Wolff (1907, Berlin - 1971, New York)
arrivé d’Allemagne nazie en octobre 1939, aura aussi cette particularité de
photographier l’indicible sur le visage et dans les yeux des musiciens afro-américains,
un effet miroir chez ceux qui ont senti l’haleine nazie dans leur dos et su à
quel point être interdit de travail est une condamnation à mort. Comme Michael
Roemer, Francis Wolff a choisi de faire de son art, l’observation, un outil
précieux pour documenter le jazz chez Blue Note dont il était une des figures tutélaires, et où il est mort pour essayer de préserver un parfum d’indépendance de
production, après et malgré les reventes successives financières du label à
partir de 1965.
4. Le titre du documentaire est Cortile Cascino dont les rush seront utilisés en
1993 par le fils de Robert Young et sa belle-fille Susan Todd, pour faire un
documentaire complémentaire avec la femme filmée en 1961 dont la vie ne s’est
pas améliorée, ce sera Children
of Faith, Life and Death in a Sicilian Family primé au Festival de Sundance (Utah), le festival du film
indépendant repris par le Sundance Institute fondé par Robert Redford en 1985.
|

Ariaferma
Film de Leonardo Di Costanzo (coproduction italo-suisse, 2021), 117 min., en italien et sarde
Sortie le 16 novembre 2022, notamment au Grand Action (5e) à Paris
Le réalisateur italien de l’Intrusa (2017) –film poignant de réalisme et d'humanisme qui puise sa matière dans le quotidien de la région de Naples et utilise la maestria du documentaire– réitère avec un splendide opus, Ariaferma, qui se déroule au sein d’une prison en cours de désaffectation, enserrée par les montagnes pelées de Sardaigne, dans un temps suspendu par l’attente, où douze prisonniers et leurs gardiens insécurisés restent piégés ensemble, sans autre nourriture que des boîtes, sans autre issue que de s’entendre a minima pour sortir du bourbier où les autorités les ont laissés.
On pense instantanément à la phrase de Martin Luther King: «Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous mourrons tous ensemble comme des idiots.». Sans aller à la fraternité, entre le chef des gardiens, psychorigide, campé par Toni Servillo et Silvio Orlando, dans le rôle d’un mafieux qui porte des revendications et des solutions, s’instaure la simple logique de la survie de tous, avec ou sans la coopération de tous, avec des étincelles de convivialités véhiculées par la cuisine italienne, dans un climat où la tension hostile reste forte, y compris au sein de chaque groupe des prisonniers et des gardiens.
Le réalisateur a intelligemment mis ses deux premiers rôles à total contre-emploi pour créer l’atmosphère d’inconfort pesant et d’équilibre précaire. Les chants sardes scandent le récit comme dans un drame antique. Les prises de vues sont effectivement théâtrales, parfois poétiques, et toujours symboliques.
Douze prisonniers aux profils complexes, comme dans la vraie vie, sont servis par leurs interprètes: douze, assis autour d’une table avec l’Ispettore (le gardien-chef), une scène christique à la lueur de lumières de fortune. Un huis clos qui donne à réfléchir sur l’organisation chaotique de notre société construite sur la destruction tous azimuts avec son accumulation sans fin de dégâts, et pas seulement dans le système carcéral.
|

Hargrove
L'urgence de vivre…
Dernière tournée –mais la réalisatrice ne le sait pas– en
2018, l’écran ouvre sur l’Italie (Pérouse, Sorrente), on passe au New Morning-Paris
(dernier concert du trompettiste le 16 octobre 2018, le jour de ses 49 ans) et
à Sète. Puis on remonte dans le temps, avec Roy Hargrove qui parle de ses
débuts d’enfance, de son père collectionneur de disques qui partage ses
découvertes avec son entourage; on va à Cuba où le trompettiste prodige est accueilli
comme un nouveau Dizzy, vivant sans limite la musique afro-cubaine, comme son
prédécesseur, amateur de rythmes et danseur comme lui. Roy Hargrove avait rendu
un hommage à
Dizzy dans Jazz Hot…
Filmé, avec sa complicité, dans son quotidien, Roy savoure une
glace sur une place où les vibrations musicales de tous les musiciens du
festival la bonifie, comme la pizza à Greenwich Village; il chante en marchant,
s’achète des chaussures, des vêtements, explique sa conception du jazz, du rythme,
plaisante avec tout le monde. On voit que l’Italie lui plaît. Il est l’exact
contraire de la star!
Roy Hargrove jouant à la fenêtre de son hôtel en Italie © Eliane Henri by courtesy
Le documentaire capte parfaitement sa disponibilité, sa
bonne humeur face à un état de santé devenu compliqué pour les déplacements et être au top chaque soir. Mais quand la musique commence, tout change, c’est
magique: «Quand on démarre et que la
première note joue, je sors de mon propre corps… Si vous jouez du jazz, c’est
le chemin le plus court pour être un musicien complet car vous avez tous les
éléments, juste là, vous avez le rythme, vous avez l’harmonie, et même le
style… J’essaie d’apprendre tous les mots des songs car si vous connaissez les mots, vous pouvez vraiment jouer la mélodie. Mais ce n’est pas
simple, il faut rechercher dans les shows de Broadway quand ça a été écrit…
Shirley Horne est probablement mon interprète préférée… Chanter les paroles, c’est déjà jouer… Les standards, c’est la poésie des récits de nos
grands-parents, oubliée aujourd’hui.» Comme tout bon pédagogue, Roy phrase
«Prisoner of Love», se délecte des mots, délivrant le rythme et la magie de
cette chanson populaire.
Plus loin dans le documentaire, il reparle de son
père, de son grand-père, de sa famille, et de leurs rapports à la musique. Le montage
choisi par Eliane Henri est narratif, enrichi des sources, en regard du récit, par Roy Hargrove lui-même, y compris sur des situations tendues, comme avec son
manager, sorte de second père, ou tristes concernant l’impact de sa santé sur sa vie d’artiste, ou
philosophiques s’agissant de ses relations avec Dieu, son «collaborateur».
Des
musiciens qui l’ont côtoyé (Sonny Rollins, Antonio Hart, Wynton Marsalis,
Herbie Hancock, Gerald Cannon, Christian McBride, Frank Lacy …) expliquent
comment il remplissait parfaitement son rôle de messenger auprès des plus jeunes venus l’écouter, l’observer en
club, sans avoir jamais été enseignant dans une école; comment il ne vivait
que par et pour la musique jusqu’au petit matin, jouant du piano ou de la
trompette, quel que soit son état. Ils parlent également sans détour de tout ce
qui cohabite avec le jazz: l’alcool, la drogue, les conditions de vie, le
combat quotidien des artistes pour créer, exister, survivre, et surtout ce que
la musique puise dans l’artiste lui-même à tout instant, pour offrir son
expression, la plus vraie et la meilleure possible, au public, Roy, lui-même, rassurant
et tirant la même exigence des musiciens du groupe... Roy Hargrove est aussi
filmé seul jouant à sa fenêtre d’hôtel la nuit, un des instants de grâce
absolue du film, repris en coda.
Puis on le retrouve quelques jours après, au
soleil, devant la fontaine monumentale du Palais Longchamp de Marseille pour la
fin de sa tournée, prêt pour son dernier concert, mais aussi prêt à rentrer des
festivals, épuisé. Marseille, où il a commencé sa carrière de tournées à 17 ans, arrivant
tout droit de son Texas, avec la sensation d’être immergé en pays de culture,
buvant du bon vin, mangeant de la viande délicieuse, allant déguster les
meilleurs fruits de mer, et ayant un public qui le retient jusqu’au bout de la
nuit. Il sait que d’autres jazzmen avant lui ont été adoptés par la France, et
il ressent leur présence.
Les prises de vues d’Elaine Henri sont belles, colorées,
contrastées, que ce soit dans les villes, sur la Méditerranée, les plans de Roy
Hargrove ou des concerts. Des photos d’époque documentent encore la
compréhension de ce jeune homme, artiste et bohème à l’extrême, resté frais malgré
la profondeur de sa conscience, l’épaisseur de sa vie, drôle, curieux, tendre, joyeux
contre vents et marées, avec ses éclats de rire sans fard, ses yeux habités et
rêveurs, ses récits de griot comme ses chorus, inspirés et nourris par les spirits,
les gens invisibles, l’attention de ceux qui l’entourent dont il capte chaque
onde, chaque vibration. Sa perception est tous azimuts à un niveau insondable,
et c’est rare de pouvoir palper à ce point ce qui fait un artiste d’exception
comme Roy Hargrove, qui se livre ainsi sans peur, jusque dans ses rapports avec
la mort, en visite au cimetière St-Pierre de Marseille: sans doute le résultat
de sa complicité amicale de 28 ans avec la réalisatrice Elaine Henri qui a
réussi un film humain, dense, spontané, juste et rythmé, avec une manière de tourner très
blues, en prise directe avec la vie réelle.
 Roy Hargrove visitant le cimetière St-Pierre de Marseille © Eliane Henri by courtesy
Jazz Hot a
rencontré Roy Hargrove plusieurs fois, notamment pour le n°489 de mai 1992 avec
Antonio Hart en couverture figurant dans le film, mais aussi le regardant réfléchir
et commenter les discographies de Clifford Brown, Lee Morgan, Howard McGhee, Fats Navarro, Booker Little… tournant les
pages du Jazz Hot Spécial
2006 comme
on ouvre une malle aux trésors dont il connaît déjà beaucoup de pierres précieuses. Jazz Hot était également à ce dernier festival à Marseille
en 2018.
Eliane Henri a été très inspirée d’avoir demandé à Roy
Hargrove de nous laisser ce témoignage indispensable de l’auteur lui-même, de
sa vie, de son être, de son œuvre transmise en temps réel, et même de son
au-revoir car il savait son temps très compté.
Hélène Sportis
Roy Hargrove et Jazz Hot:
les interviews sont répertoriées dans le n°685-2018
...et de nombreux comptes rendus de concerts, festivals,
chroniques de disques et DVD sont également à lire dans Jazz Hot…
|
|
Ran Blake, image extraite du film © Antoine Polin by courtesy
Antoine POLIN
Ran Blake, Living with Imperfection
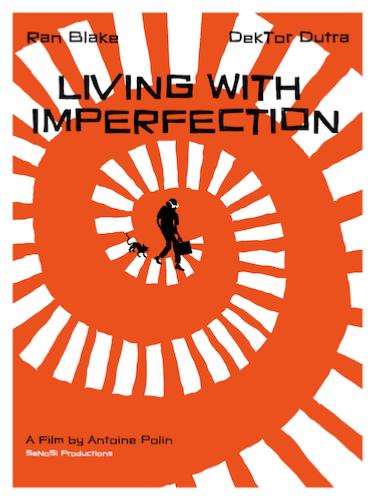
Ran Blake est un Messenger comme on
n'en fait plus. Musicien et compositeur d’exception, il est un pilier du New
England Conservatory of Music, à Boston. Pédagogue infatigable, il y enseigne
depuis 1967, où il a créé le Department of Third Stream Studies, rebaptisé
Contemporary Improvisation Department. Il a développé une pédagogie personnelle:
la musique à l’oreille, dans une approche de la musique plus intuitive, afin d'approfondir l’écoute et la mémoire musicale. Toujours attentif aux plus jeunes, il
prend plaisir à jouer et enregistrer avec ses élèves et anciens élèves (on
pense évidemment à Ricky Ford). Tout cela, sans jamais perdre de vue sa vie de musicien. Il a élaboré
une esthétique très originale, véritable synthèse des évolutions du jazz, et a
beaucoup enregistré, des trios et des duos (avec Claire Ritter, Sara Serpa, Christine Correa et, bien sûr, Jeanne Lee).
Le jeune guitariste, enseignant et réalisateur
Antoine Polin a eu l’idée de lui consacrer un documentaire Living
With Imperfection (durée: 67 min.) où l’on retrouve le Ran Blake qu’on
connaît: cinéphile, pédagogue, anxieux, attentif, rêveur, hypersensible. Un
film passionnant, d’une grande justesse, qui éclaire les facettes du
pianiste qui se prête au jeu avec sincérité. Malgré l’âge, rien ne freine ses nombreuses
activités (concerts, enregistrements, enseignement). Antoine Polin le filme au
plus près, saisit des instants formidables. Comme il nous le raconte dans cette interview, ce film est aussi
l’histoire de sa rencontre avec un aîné. Ran Blake a l’âge de Jazz Hot. Il est né le 20 avril 1935.
Avec un peu d’avance, nous lui souhaitons un joyeux anniversaire. Avant de lire
l’interview d’Antoine Polin, nous conseillons la lecture de l’entretien que
nous avait accordé Ran Blake et, bien sûr, l’écoute de ses disques pour se mettre dans le mood.
Propos recueillis par Mathieu Perez
Images du film et photos by courtesy of Antoine Polin
© Jazz Hot 2022
Antoine Polin
© Photo X, by courtesy of Antoine Polin
Jazz Hot: Quand rencontrez-vous Ran Blake? Connaissiez-vous sa musique, sa vie, son
parcours?
Antoine
Polin:J’ai rencontré Ran Blake à Tours en 2007 lors d’un stage. Je
connaissais son premier disque avec Jeanne Lee, The Newest Sound Around,
mais c’est à peu près tout. Dans ce stage, je l’ai vraiment découvert. Il nous
a parlés pendant une semaine de la relation qu’il établissait entre le cinéma
et la musique. C'était très étonnant mais surtout très enrichissant.
Qu’est-ce
qui vous touche le plus dans son œuvre? Avez-vous un disque, un thème, une de
ses compositions de prédilection?
Ce
qui me touche le plus dans l’œuvre de Ran, c’est sa cohérence, son identité
forte quel que soit le répertoire qu’il interprète. Comme beaucoup de grands
artistes, on le reconnaît tout de suite quand il joue, mais Ran a quelque chose
de plus: il a creusé un style qui lui est propre, sans compromis, une
esthétique qui est restée la même depuis les années 1960 (voire 1950): il n’y a
pas de «phase» dans la carrière de Ran Blake, juste une évolution très claire
et linéaire de son jeu. Un disque: The Blue Potato and Other Outrages. Un
morceau: «The Short Life of Barbara Monk».
Qu’est-ce
qui vous a donné envie de réaliser un film sur lui, en particulier? A-t-il été
d’accord immédiatement?
J’ai
toujours été très intéressé par le documentaire et le portrait en particulier.
J’ai fait part de mon projet à Ran en 2015. Il a tout de suite montré un grand
enthousiasme.
Entre
votre premier contact avec lui et le début du tournage, il s’est passé combien
de temps?
J'ai
fait un premier repérage photo à Boston en 2016. A l’époque, je n’étais ni
financé, ni produit. Aller tourner aux USA aurait été délicat financièrement. Alors, j’ai organisé une tournée en France en 2017 pour Ran.
Cette tournée que j’ai filmée (mais qui n’est pas dans le film), m’a servi de
repérage: il s’agissait pour moi de voir comment Ran se comportait devant la
caméra et donc quel film j’allais pouvoir faire.
Combien
de semaines a duré le tournage? Cela s’est-il passé durant un ou plusieurs
voyages? A quelles dates?
Au total,
le tournage a duré quatre mois, répartis sur trois voyages en 2018 et 2019.
J’ai choisi l’hiver, l’été et l’automne pour capter différentes atmosphères,
intérieures et extérieures.
C’est
un film autofinancé?
Mon
film est produit par Jean-Marie Gigon (SaNoSi Productions), ce qui m'a
permis (entre autres) de structurer la recherche de financements. J’ai eu
des aides de la SACEM, de la SCAM, du CNC de la Région Centre… que de dossiers…
si j’avais su!
Vous
étiez seul durant le tournage à vous occuper du son et de la caméra?
Oui,
j’étais seul. Evidemment, un preneur de son aurait été plus lourd dans le
budget, donc aurait potentiellement réduit le temps de tournage, mais la raison
principale est qu’il fallait que je sois seul pour établir cette confiance
entre Ran et moi et ainsi pouvoir vraiment filmer l’intime.
Face
à la caméra, Ran s’est-il prêté au jeu facilement? Dans le film, on le voit
dans sa vie de tous les jours, travaillant au lit, regardant des films…
Avait-il des craintes d’être montré ainsi?
Dès
le premier jour, Ran a complètement accepté la caméra. Il n’y prêtait quasiment
jamais attention. Il me faisait confiance. J’insiste vraiment sur cette notion
de confiance car même si je n’apparais pas à l’écran, ce film est aussi une
rencontre selon moi. Je suis le musicien qui fait un film sur le musicien qui
est passionné de cinéma. Le contact fut très naturel et Ran me laissait filmer
comme je l’entendais.
Ran Blake, image extraite du film © Antoine Polin by courtesy
Votre
film est une véritable méditation sur la vie, la vieillesse, la mort, la
mémoire. La nature et la structure du film s’est-elle précisée au fur et à
mesure du tournage ou aviez-vous une idée précise du film que vous vouliez
faire?
Effectivement,
à travers le portrait de Ran Blake, j’ai fait un film sur la vieillesse, sur la
mémoire, mais pas sur la mort. D’un corps fatigué, Ran scrute le passé, avec
ses réussites, ses regrets, ses joies et ses tristesses. Mais, à 87 ans, il est
toujours plein de projets, il aime toujours découvrir des films, rencontrer des
gens, enseigner, perfectionner son art… il est hyper actif. J’ai trouvé ça très
beau, très inspirant et je n’ai jamais vu le côté dégradant de la vieillesse.
Ce thème (la vieillesse) et cette réflexion sont apparus pour moi très tôt dans
le tournage. C’est évidemment aussi un film sur la solitude et la question de
sa nécessité à un accomplissement artistique si personnel.
Qu’est-ce
qui vous a le plus étonné en tournant ce film?
Ran
Blake. Comme ce que je dis plus haut: son appétit pour la vie, les rencontres,
la musique, les musiques, les films… Je ne m’attendais pas à ça.
Nous
connaissons la passion de Ran pour le cinéma. Ce qui est passionnant dans votre
film, c’est de voir à quel point sa créativité est stimulée par les vieux films.
Notamment lorsqu’il évoque le story-board de sa playlist avant un concert puis
se perd dans son monde. Saisir ce moment très intime dans la vie d'un artiste,
c’est un moment magique pour le réalisateur?
Oui,
tout à fait. Il y a eu un certain nombre de moments comme celui-ci lors du
tournage, où mes poils se sont hérissés. Pour moi le temps s’arrêtait, j’étais
avec lui. Il était impossible de faire de la mise en scène avec Ran, ça ne
marchait jamais. Alors j’ai filmé, filmé… jusqu’à ce que la caméra devienne
invisible. C’est comme ça que j’ai pu filmer ces moments que je trouve si
beaux. J'aurais aimé tous les mettre, mais il faut faire des choix… Je pense en
ressortir dans le futur sous forme de petits extraits.
A-t-il
été difficile de sélectionner les séquences montrées dans le film? Vous deviez
avoir des heures de rushes? L’avez-vous interrogé, par exemple, sur Mary Lou
Williams?
J’avais
120 heures de rushes… mais le montage du film s’est fait très naturellement, en
sept semaines, avec mon ami monteur Adrien Faucheux. Avec Ran, nous avons
évoqué énormément de sujets, de films, de musiciens… Pour moi, ils sont
présents dans mon film quand Ran, à maintes reprises, établit des listes de
noms des personnes qui l’ont marqué. On ne parle pas en détail dans le film de
Mary Lou Williams (ou d’autres musiciens) car très vite, ces discussions,
certes intéressantes, devenaient pointues et se seraient adressées à des
musiciens ou connaisseurs. Ce n’est pas le but de mon film. Il s’adresse
effectivement aux musiciens et connaisseurs, mais pas uniquement. Je l’espère!
Comment
procédiez-vous, vous l'interrogiez, le suiviez, le laissiez parler?
Je
l’ai suivi partout, j’étais chez lui une très grande partie de la journée et de
la soirée. Je l’interrogeais parfois, mais de manière très vague, j’aimais le
laisser aller où il voulait. Ran est le roi de la digression, mais ses propos
finissent toujours par faire sens, c’est ce que j’aimais et ce que je
recherchais.
Jeanne Lee et Ran Blake
© Photo X, by courtesy of Antoine Polin
Autre
trait fondamental de la personnalité de Ran que vous saisissez, c’est lorsqu’il
dit être «drogué au passé» et qu’il évoque notamment sa relation amicale,
musicale, amoureuse même avec Jeanne Lee. C’est la seule séquence où il y a une
archive?
Oui.
Je ne voulais pas faire de biographie: je trouve ça très délicat à faire en
documentaire. Archives, photos qui bougent au montage, interroger des personnes
connues qui parleraient de lui en disant combien Ran est formidable et
raconteraient des anecdotes. On voit ça souvent, et ça ne m’intéresse pas
vraiment. Le livre me paraît un support plus approprié pour une biographie.
D’ailleurs une bio’ de Ran Blake va sortir bientôt, écrite par Leo McFadden. Si
j’ai tout de même inséré une archive d’un concert avec Jeanne Lee, c’est que
cette femme, dont il a été extrêmement proche, représente encore énormément pour
lui, et ce, quotidiennement, c’est fou! Chez lui, elle vit encore. Ce qui
m’intéresse, c’est comment cette drogue (le passé) agit sur lui aujourd’hui.
Un
aspect très important de son quotidien est l’enseignement. Il est diminué
physiquement, mais continue à enseigner au New England Conservatory, à Boston,
et transmet son savoir, toujours disponible pour enregistrer avec les musiciens
plus jeunes et ses anciens élèves. La séquence est brève dans le film. Comment les
étudiants le perçoivent-ils?
Oui,
Ran est très impliqué dans l’enseignement et très concerné par les jeunes
générations de musiciens. Cette séquence est courte dans mon film pour
plusieurs raisons. Tout d’abord car filmer seul une classe entière avec une
caméra et un système de prise de son efficace mais sommaire relève du défi,
voire de l’impossible… Ensuite, la pédagogie de Ran Blake est très originale,
mais basée sur la mémoire et le travail sur du long terme. Filmer deux ou trois
cours n’a pas de sens. Il faudrait faire un film entier là-dessus pour rendre
compte de l’intérêt de cette évolution. Ses cours n’ont rien à voir avec des
cours de musique habituels. Il était donc nécessaire pour moi de montrer
l’implication de Ran dans la pédagogie et son intérêt qu’il porte à la jeune
génération, mais difficile à creuser: ça ne serait pas le même film.
Ran
est un mentor pour beaucoup de jeunes. Comme Gunther Schuller l'a été pour lui
pendant très longtemps. Les étudiants suivent généralement Ran durant toutes
leurs études et même après. Son enseignement se dispense sur le long terme. Il
a écrit un livre très bien là-dessus, Primacy of the Ear, qui traite de
l’apprentissage musical en général et non sur la technique musicale à
proprement parler.
Ran Blake avec des étudiants, image extraite du film © Antoine Polin by courtesy
A
la fin du film, on voit se préparer pour jouer au Kitano, à New York. Puis, on découvre Ran au piano, mais dans une autre salle de concert. Pourquoi ce
choix?
Ah,
vous connaissez soit le Kitano, soit le New England Conservatory, ou les deux!
Effectivement, c’est un petit tour de magie de cinéma. Le Kitano est un endroit
très cher et luxueux. Vous pensez bien qu’ils ne m’ont pas autorisé à filmer au
premier rang. J’étais donc dans le fond, loin, avec des têtes devant moi. L’image
est sans intérêt, même si la musique est belle. Et, puis, j’adore cette version
de «Douce Nuit» que Ran joue au concert que j’ai choisi de mettre à la fin de
mon film. C’est magnifique!
Que
pense Ran du film?
C’est
une question qu’on me pose souvent après avoir vu mon film et je me demande
pourquoi, car ce n’est pas toujours le cas quand j’assiste à des rencontres après
des documentaires du type «portraits». Je trouve ça très intéressant car ça
signifie, peut-être, que le spectateur s’est posé cette question en voyant ces
images, que quelque chose l’a peut-être dérangé en pénétrant dans l'intimité
d'un vieil homme affaibli. La vieillesse nous concerne tous, et nous
l’embrassons avec plus ou moins d’allégresse. C’est peut-être un moyen pour le
spectateur de demander: «Comment ça fait de se regarder quand on est vieux et
affaibli»? Ou alors il veut tout simplement savoir si Ran a aimé le film? Avec
ce film, j’ai rencontré un vrai ami. Nous avons été très proches durant ce long
tournage. Cette amitié très vite solidement forgée a balayé tout de suite toute
forme d’admiration, de déséquilibre relationnel pour laisser place à un respect
mutuel très naturel. Nous sommes amis, il me manque énormément.
Y
a-t-il des dates de projection prévues?
Le
film poursuit sa belle vie dans les festivals, nous cherchons activement des
moyens de le diffuser, notamment aux Etats-Unis, avec la production. Un pressage DVD aura lieu, mais
la date n’est pas encore connue.
INFORMATIONS:
www.sanosi-productions.com
https://vimeo.com/518961923
https://www.youtube.com/watch?v=J2cAHaAb6eM
Site, livre, musique, chaînes YouTube et deux vidéos de Ran Blake
https://www.ranblake.com
Livre: Primacy of the Ear
https://soundcloud.com/ran-blake
https://www.youtube.com/channel/UCDBnH3rpKvNZ_lWrZIDYByg/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCqjCJBQNjg6hwECZh2XuWHg
https://www.youtube.com/channel/UCQPB8g-BARRYE2gwWbzvbIQ
https://www.youtube.com/channel/UCEftQktDaBqBcACzGMXOlLA
New England Conservatory: https://www.youtube.com/watch?v=axwt6Fp5qRE
Archives INA, «Jim Crow», juillet 1963, Antibes-Juan-les-Pins:
https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/i06349872/ran-blake-jim-crow
RAN BLAKE ET JAZZ HOT: n°306-1974, n°342-1977, n°667-2014, n°674-2015, Jazz Hot 2019, Jazz Hot 2019,
Jazz Hot 2019, Jazz Hot 2021
*
|
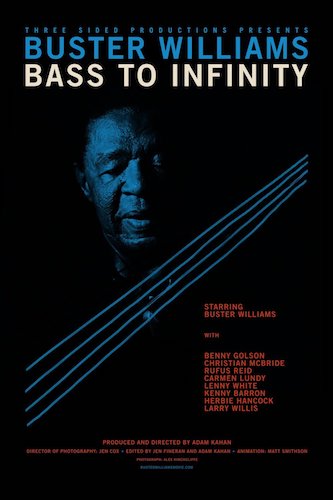
Buster WILLIAMS
Bass to Infinity
Documentaire
d’Adam Kahan (réalisation et production), 91 min., USA, version anglaise,
sorti en festivals en novembre 2019
Le
monde de Buster Williams vu par Buster Williams, est le matériau documentaire de
choix que nous offre Adam Kahan, bassiste à ses heures. Le résultat produit sur
le spectateur est suffisamment alternatif par un rendu naturel comme sans écran,
et étonnant par la proximité du réel (textures visuelle et sonore), pour être signalé
en premier lieu: ce travail à quatre mains réalisateur-artiste est très pertinent,
car on entre dans la vie et l’esprit très structurés du bassiste qui fêtera ses
80 ans le 17 avril 2022. Le film est lumineux par la spontanéité des rires avec
Benny Golson ou Lenny White entre deux plages musicales, et dense dans sa
perspective temporelle longue par
l’enracinement des parcours artistiques partagés avec Kenny Barron, son cadet
d’un an, ou Larry Willis, de 1942 comme Buster, car ils ont connu et travaillé
avec certains des pères fondateurs du seul art inventé, mais pas toujours respecté,
par le nouveau monde: le jazz.

Buster Williams chez le luthier
image extraite de Buster Williams: Bass to Infinity d’Adam Kahan
Enfin, on pénètre tout à la fois dans des lieux
savamment choisis, car quasi-vitaux pour l’artiste, comme chez David Gage
Strings, facteur de contrebasses, ou au Nation Jazz Museum d’Harlem, dans les
clubs et au Lincoln Center, ou à WBGO Radio avec un présentateur admiratif,
Christian McBride, en s’immergeant dans le jazz comme démarche artistique,
partie intégrante d’un tissu social dense et chaleureux, avec l’indispensable prise
de conscience du temps: celui qui fait l’apprentissage par l’expérience
commune, la profondeur, la maturité, la patine, l’art, le patrimoine, une
civilisation.
Ce «tout» est l’héritage collectif du jazz, collectivement
enrichi par les apports successifs de ses artistes, chacun étant déjà inscrit
dans cet ensemble, dans une sensation cinétique et infinie comme le swing ou le
phrasé du blues ou du gospel. C’est aussi très réjouissant de retrouver Buster,
dans la plénitude de son existence sereine d’artiste accompli et toujours
curieux, le regard pétillant, tel qu’il était lors de son interview par Jazz
Hot en 2001 (cf. notes), il y a juste
20 ans, comme si le temps (et la médiocrité des temps dont il parlait alors)
n’avait pas barre sur lui, n’avait pas eu raison de son intégrité et de sa
mission, participer et transmettre.
Buster Williams en action, image extraite de Buster Williams: Bass to Infinity d’Adam Kahan
La qualité de prise de son, les splendides gros plans, les clins d’œil cinématographiques (notamment à Hellzapoppin, H.C.
Potter, 1941), les informations documentaires et la discrétion bienvenue de
l’équipe de tournage à saluer, sont autant de points forts qui projettent le
spectateur dans cette impression de faire directement partie de l’intimité de
l’artiste avec ceux qu’il a choisis d’associer à cette aventure de tournage, jusque
dans sa pratique spirituelle ou sa fête d’anniversaire familiale. La
construction, le découpage et le montage du film impulsent également un rythme,
en plus des magnifiques parties jazz (live informel, archives, concerts) et des
échanges parlés et chantonnés. Le séquençage du récit quasi-initiatique, par le
maître-conteur Buster, de sa première tournée avec Gene Ammons et Sonny Stitt, scande
le documentaire lui-même avec un effet drôle et à rebondissements, pour relater
une aventure finalement assez rude pour un débutant confronté à ses héros dépendants
d’addictions diverses: une leçon de vie de quelques semaines, avec à l’image,
une animation (réalisée par Matt Smithson) ponctuant visuellement les intonations
redevenues juvéniles de l’apprenti jazzman découvrant la vraie vie sur
bande-son originale d’époque.
Larry Willis et Buster Williams, conversation, image extraite de Buster Williams: Bass to Infinity d’Adam Kahan
Le
documentaire est aussi parcouru de discussions,
de mots, de sons et d’images qui insistent sur l’importance en art de la
perception, celle du bruit du toucher du bois de la basse par un
musicien, ou le «parfum» laissé
par sa façon de jouer, les différentes sortes de vibrations, rondes et
chaudes
de la basse, des voix qui chantent, racontent ou méditent, du tintement
rituel bouddhiste,
ou de celles du feeling, souvent invisibles pour le public, mais
essentielles entre
jazzmen pour jouer en connexion, en totale confiance, pour libérer une
énergie
osmotique. Buster revient aussi sur ses perceptions fondatrices chéries
des
odeurs de cuisine du week-end, mêlées à la musique d’Ellington en
disques ou de
son père jouant de la basse; son père qui lui a transmis, en plus de
l’instrument,
du jazz et du plaisir des jams à la maison, une discipline de vie qui
seule
amène à la beauté, par la résistance à l’effort, par l’exigence pour
peaufiner
sans se lasser.
Dans
le monde de Buster, tout change tous les jours et c’est ça la magie de sa
pratique; chaque jour est une nouvelle aventure, chaque solo, une composition
originale, une pensée neuve, mais avec toujours comme responsabilité pour le
bassiste, d’être l’arc boutant, le support permanent du groupe, vision qu’il
partage avec son ami bassiste comme lui, Rufus Reid, et avec Herbie Hancock, racontant
comment Buster a ré-impulsé de l’énergie à leur sextet fatigué de la tournée,
par son introduction sur «Toys», déclenchant un set magique. Buster a un autre incontournable
dans son art, le lyrisme mélodique qui doit venir du cœur, comme chez Dexter
Gordon, Ben Webster, Art Farmer, et que tout vrai artiste travaille, de soir en
soir, pour découvrir quelque chose de plus. Le lyrisme mélodique qu’il a appris
avec des chanteuses sans concession sur la perfection à atteindre, Sarah
Vaughan, Nancy Wilson, Betty Carter, Shirley Horn; Sarah qui lui a acheté la basse
de ses rêves, mais dont l’oreille infaillible repérait la mauvaise note dans le
big band.
Benny Golson et Buster Williams, conversation, image extraite de Buster Williams: Bass to Infinity d’Adam Kahan
Dans le film, Carmen Lundy donne cette dimension de la voix jazz dans
un joli duo sur «But Beautiful» avec la basse de Buster. De thèmes joués en
histoires chorales, tous les spirits du jazz sont conviés et participent au
documentaire, pour rappeler que Thelonious Monk, Elmo Hope et Bud Powell
entretenaient
une véritable conversation musicale, de même que Duke Ellington et James
P.
Johnson, et c’est ainsi que Buster en revient à ce langage jazz, né du
maillage généreux et solide entre artistes,
entre générations, par delà les distances et le temps, un patrimoine
étendu à
la société entière par ses valeurs humanistes. La complicité avec Lenny
White, Larry Willis et Benny Golson est évocatrice. Dans ce mouvement
continuel
d’échanges et transmissions, les artistes produisent pour tous au sein
du
collectif jazz, et Buster sait que ce qu’il peut produire à la basse est
infini
et s’inscrit dans une histoire, que cela ne dépend que de son engagement
libre et
de son imagination.
Quant à Adam Kahan(1),
il avait sorti un premier opus autour d’un de ses héros, Rahsaan Roland Kirk, un
documentaire primé, réalisé entre 1999 et 2014, The Case of the Three Sided Dream(2), et nous attendons la sortie de son troisième opus jazz sur Sun
Ra.
Hélène Sportis
*
1. Site Vimeo d’Adam Kahan: https://vimeo.com/user7599031
Adam Kahan
est né le 30 mai 1966 à Stamford, CT, et a suivi un cursus en littérature
anglaise et des cours de cinéma en auditeur libre au City College de San
Francisco, CA mais il s’est principalement formé à l’ancienne, en autodidacte,
sur le tas. Il a appris le piano avec sa mère professeur de musique, puis la
trompette et la basse électrique (punk rock), et il est ensuite passé à la basse
acoustique devenue son instrument de prédilection, en même temps qu’il
s’ouvrait au jazz. Enfin, Adam a vécu en France (1996-1999) du côté de Grenoble
et Lille. Il habite depuis 1999 à New York. Il vient de recevoir sa première
subvention du National Endowment of Humanities pour son troisième documentaire
sur Sun Ra qui sortira prochainement.
|

Billie
Documentaire
de James Erskine, produit par Altitude/Reliance Entertainment Company-REP
Documentary/New Black Films/Belga Productions/Concord/BBC Music on
Screen/Polygram Entertainment, 96 min., Royaume Uni,
en version originale sous-titrée, sorti les 5 septembre 2019 (USA) et
30 septembre 2020 (France)
Bande annonce: https://www.youtube.com/watch?v=gHdCDAftsmQ
https://www.imdb.com/title/tt8019486/fullcredits?ref_=tt_cl_sm#cast
Avec Billie, le réalisateur britannique James
Erskine nous embarque dans une passionnante enquête chorale à deux voies/voix, autour
du destin croisé de deux femmes au parler-vrai qui les mènera toutes deux à un
décès prématuré, à vingt-quatre ans d’écart (en 1959 pour Billie Holiday),
comme si la révélation de vérités, toujours dangereuses pour les dominants,
menait invariablement à la tragédie. A l’ouverture du film, Linda Lipnack Kuehl
vient de décéder au petit matin du 6 février 1978, à Washington DC. Professeur
de lycée, elle écrivait aussi des articles (par exemple dans Paris Review)
notamment sur les droits des femmes, et, en 1969, elle avait commencé à interviewer
des personnes ayant côtoyé Billie Holiday dans toutes sortes de circonstances,
en raison de sa passion depuis ses 14 ans pour la chanteuse, déclenchée alors qu’elle
écoute l’album The Essential Billie
Holiday-The Carnegie Hall Concert, enregistré par Norman Granz (agent-producteur-activiste
anti-ségrégation qui enregistrera Billie à partir de 1952 et créateur du JATP) pour
son label Verve en 1956 (sorti en 1961, deux ans après le décès de Billie et
dans la période de mutations-charnière USA-Europe du producteur).
Neuf ans
d’enregistrements, de recoupements, de jeux de pistes, pour que Linda se
rapproche de la réalité d’Eleanora Fagan devenue Billie Holiday entre 1915 et 1959.
Au moment de donner vie au portrait, la mort empêche, une seconde fois, de
mettre en perspective cette réalité d’une artiste ségréguée, mondialement adulée, avec les pouvoirs malsains de son pays.
Linda était fille de syndicaliste, son père était issu d’une famille
d’immigrants, juive non pratiquante du Bronx, tout comme Lewis Allan (de son vrai
nom Abel Meeropol, 1903-Bronx, NY-1986 Longmeadow, MA) instituteur-activiste,
avant d’être connu comme l’auteur du célèbre brulot «Strange Fruit», magnifiquement
estampillé par la voix de Billie à partir de 1939, sorte de «Ballade des
pendus» (François Villon, 1431-1463) sur les lynchages mis en scène par la hideuse nébuleuse du
Ku Klux Klan. La culture de la révolte courageuse qui délie les langues malgré
les risques est sans doute le fil d’Ariane qui relie la plupart des protagonistes
de l’histoire; Lewis écrira d’autres chansons qui seront aussi son gagne-pain,
lui permettant d’adopter les enfants d’Ethel et Julius Rosenberg exécutés en
1953 par le maccarthysme, l’autre démon de l’Amérique.
Le plus touchant, dans
cette réalisation également bien travaillée sur le plan sociologique en
iconographie, est la reconstitution méticuleuse avec laquelle une équipe
internationale a œuvré: le producteur Barry Clark-Ewers a pu retrouver les deux
cents heures de bandes audio, et, avec James Erskine qui rêvait de faire un
film sur Billie, ils ont intelligemment intégré la famille de Linda pour
comprendre son cheminement de pensée et enchâsser judicieusement sa découverte du
parcours de son idole dans la narration de leur film; une coloriste de talent
brésilienne, Marina Amara, et la société Red Chillies, spécialisée en colorisation d’images
en Inde, une des patries du cinéma, une équipe en
Belgique et une autre au Royaume-Uni, ont conjugué leurs talents pour un
étalonnage couleurs réussi et un montage pertinent afin de restituer Billie
dans sa vraie vie, jouant sur les contrastes avec les séquences conservées en
noir et blanc pour alterner l’incarnation de Lady Day, le récit des proches et
le matériau impressionnant (ap)porté par Linda. Le choix des chansons
sous-titrées à dessein, documentées à l’écran, est complété par des photos et
fragments d’interviews intercalés à propos, pour faire apparaître les facettes
de la personnalité façonnée par les conditions d’existence de l’artiste depuis
son enfance: un indispensable et complexe travail d’allers-retours, miroir
entre le réel et l’interprétation vocale, car Billie chantait son malheur et
son bonheur, sa vie, celle de son entourage, sans fioriture ni pleurnicherie; sa
perception profonde et directe constituait l’expression brute de son feeling qui
pénétrait le public sans filtre1. Les sons et documents visuels d’époque nous
présentent la réalité dans son jus: sa mère, une pauvre femme, son père fêtard
et absent, son cousin fataliste sur la funeste destinée des adolescentes de
rues, ses ami-e-s d’enfance et du métier, ses contacts professionnels trop souvent
à double tranchant, ses proxénètes bruts de décoffrage, ses amant-e-s, ses
maris intéressés, ses enquêteurs dont ceux du Bureau des narcotiques pour
lesquels sa célébrité en faisait une bonne cliente pour leur pub’: une galerie
de portraits de l’Amérique dans toutes ses composantes sociales, pour le
meilleur et le pire, sans fard, où la pseudo-bonne-morale est toujours du côté
du pouvoir et du dollar.
Du sexe à l’argent en passant par le racisme, la prison,
les addictions ou l’expression artistique, dans chaque rapport de domination,
les questions de la journaliste se font insistantes pour arriver à démêler avec
précision ce qui a fait que Billie ne pourra se libérer qu’en mourant d’avoir
trop vécu, trop vite, trop lutté, trop fort, sans jamais se préserver des
prédateurs de toutes sortes, dans une adversité polymorphe, sans jamais se
renier, sans se cacher ses culpabilités non plus, son seul démon intérieur.
Bessie Smith, Louis Armstrong, Lester Young2, Billy Eckstine, Tallulah Bankhead ou
Orson Welles seront des points d’ancrage et de réconfort pour Billie mais
insuffisants pour s’y cramponner au-delà de 44 années vécues à 100 km/heure et
dans ce qu’elle considérait «en toute liberté», c’est-à-dire pour décider seule
de sa musique et d’elle-même, sachant qu’elle n’avait aucune prise sur tout le
reste.
Linda a eu l’intuition d’enregistrer des personnages peu connus
aujourd’hui comme Milt Gabler (qui a osé graver «Strange Fruit» sur son label
Commodore le 20 avril 1939 à New York alors qu’elle n’était pas dans sa maison
de disques), ou Barney Josephson, l’activiste précurseur de l’anti-ségrégation affichée
et pratiquée dans ses deux Café Society, ce qui le mènera à leurs pertes pendant
la chasse aux sorcières.
Un point très intéressant du documentaire permet
d’éclairer concrètement la personnalité ambiguë du producteur John Hammond
(héritier fortuné, ayant bien intégré le rapport de domination pour en tirer le
meilleur parti), par le biais d’un témoignage très raide du légendaire Jo Jones (1911,
Chicago-1985, NY, a travaillé avec Count Basie, Teddy Wilson, Lester Young, Ray
et Tommy Bryant) concernant sa nuisance à l’endroit de Billie. Car Billie était tout, sauf une
faible femme, et si elle prenait des coups, elle savait aussi en donner, au
propre comme au figuré, et avec des dominants, ça se paie toujours sur la
durée. Dans le film, on voit son expression de visage changer quand elle chante
à Paris, plus sûre et moins sur le qui-vive, ses yeux pétillent comme ceux
d’une gamine qui est là où elle voulait, contre vents et marées.
Mais les trêves sont de trop courtes durées pour consolider les rêves d'une autre
vie: sa chanson préférée, dit-elle de sa voix unique comme une empreinte,
«Don’t Explain», explique tout, entre le possible et l’impossible qu’elle a
tenté. N’ayant pas réussi à terminer son troisième divorce avant son décès, son
dernier mari-maquereau héritera de tout.
La fin du film se referme sur Linda comme elle l’avait ouvert.
En février 1978,
Linda s’était rendue à Washington pour voir un concert de Count Basie,
interviewé lui aussi sur Billie, mais au fil des entretiens, il était
devenu un
proche, très proche… de Linda. Pourquoi Linda est morte un jour de
blizzard avec son masque de nuit sur la figure? Sa «petite» sœur le
raconte aujourd’hui
avec une perception profonde des faits et enjeux, une «vérité», encore
et
toujours, comme pour reprendre le flambeau de Billie et Linda contre le
rouleau
compresseur qui détruit tout quand il est en danger.
Dans une de ses interviews
reprises dans le film, Billie dit l’essentiel: «j’ai toujours su que je
savais chanter mais que ça ne rapportait pas»; si elle parle souvent de son
travail avec modestie comme un artisan qui fait de son mieux pour donner le
meilleur au public, cette phrase montre qu’elle savait aussi s’évaluer en tant
qu’artiste ségréguée dans son pays: Billie était réaliste et combative
pour ce qui comptait pour elle, loin des clichés de la bien-pensance sur la
marginalité de cette «pauvre» Billie, plus rassurante morte déchue que flamboyante dans sa liberté débridée.
Un film à ne pas
manquer!!! Si nous retrouvons le chemin de la liberté collective et démasquée des
salles obscures, ou si le film sort en DVD ou en streaming en restant chacun-e isolé-e devant notre écran; «Rien n’est jamais acquis à l’homme… Sa vie Elle
ressemble à ces soldats sans arme, Qu’on avait habillés pour un autre destin… Ce
qu’il faut de malheur pour la moindre chanson…», un poème écrit en 1946 par
Louis Aragon sur la complexité de la condition humaine en butte au système de
pouvoir, si vrai pour Billie, toujours vrai pour nous aujourd’hui.
1. «Enfin, Billie
Holiday vient en France… La voix de Billie, espèce de philtre insinuant,
surprend à la première audition… Billie chante comme une pieuvre. Ça n’est pas
toujours rassurant d’abord; mais quand ça vous accroche, ça vous accroche avec
huit bras. Et ça ne lâche plus». Boris Vian, Jazz Hot n°85, février 1954.
Billie chante à
Pleyel (salle historique des concerts du Hot Club) le 1er février 1954.
Elle reviendra à Paris en 1958, peu de temps avant son décès et celui de Boris,
en 1959 tous les deux, lui le 23 juin à 39 ans, elle le 17 juillet à 44 ans,
tous les deux de problèmes cardiaques, tous les deux n’ayant cessé de lutter
pour repousser les limites face au venimeux conformisme normé.
2. Le 6 février 1959 –interview publiée dans le n°142 de Jazz Hot (avril 1959)– Lester Young confiait à François Postif: «Je sais que je vais
mourir avant un an.» Et il est en effet lui aussi décédé d’une crise
cardiaque le 15 mars 1959, quatre mois et 2 jours avant Billie, sa
jumelle par la destinée, en liberté d’esprit et musicale, de lutte
contre le rouleau compresseur, d’usure et d’expression. Lester avait 49
ans, et lui aussi n’avait pas sa langue dans sa poche: l’interview est
un rappel au réel cinglant, en 1959, la liberté de parole se paie cash.
«C’est toujours la même chose, partout où vous êtes. Vous luttez pour
vivre jusqu’à ce que la mort vous délivre, et alors vous avez gagné… Les
gens sont si mesquins et trouillards… Je vivais chez elle (Billie),
quand je suis arrivé à New York en 1934… Elle m’apprenait comment me
débrouiller dans la ville, vous savez, quand ça ne va pas tout seul…
Elle est toujours ma Lady Day.» Charlie Mingus interviewé par Linda dans
le film ne s’y trompe pas : la chasse institutionnelle faite contre
Billie ne concernait pas la drogue! La
télépathie était telle entre Billie et Lester que les musiciens qui ont
eu le privilège de les voir ensemble, en scène et hors scène, notaient
la rareté de leurs dialogues et pourtant l'incroyable entente musicale,
humaine et la proximité de sensibilité qui les unissaient au-delà des
mots. A la mort de Lester, lors de la cérémonie, on prête à Billie
d'avoir murmuré qu'elle serait la suivante à disparaître… Ce qui fut le
cas dans une année 1959 chargée en disparitions majeures.
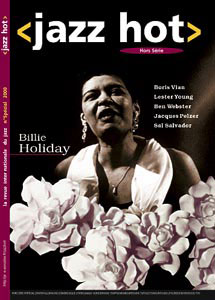
BILLIE HOLIDAY & JAZZ HOT: N°25-1938, N°40-1950, N°70-1952, N°85-1954, N°86-1954, N°114-1956, N°139-1959,N°147-1959, N°272-1971, N°363/364-1979, N°366-1979, N°367-1979, N°430-1986, N°498-1993, N° Spécial 2000, Sup. Internet N°625-2005, Sup. Internet N°630-2006, N°651-2010, N°671-2015
Site officiel de Billie Holiday: https://billieholiday.com/billie-holiday-timeline
|

Louis Panassié en 2018 © Jean-Pierre Raymond de Rivarola by courtesy
Louis PANASSIÉ
Ethnographie & Jazz: au nom du père
Louis Panassié est né le 29 mai 1934. Il est le fils
d’Hugues Panassié (1912-1974), cofondateur de Jazz Hot avec Charles Delaunay, Pierre Nourry et quelques autres. Cinéaste autodidacte, il a eu un
parcours tout sauf académique: il quitte l’école à 17 ans pour partir à l’aventure,
d’abord dans les commandos-parachutistes de la Marine nationale puis pour de
longs périples (tour de l’Afrique à moto, Paris-Hong Kong en jeep…). Ainsi, ses
premiers documentaires retracent ses différents voyages: L’Afrique insolite (1956-57), L’Asie
quotidienne (1959-60), Hommes et
paysages de Grèce (1961-62), Le
Guatemala (1962), Ceylan, l'île
resplendissante (1964-65), Terres et
peuples mexicains (1966-67), jusqu’à L’Aventure
du jazz qu’il tourne entre 1969 et 1972. Une parenthèse
dans la carrière du documentariste qui ne reviendra plus au jazz par le
cinéma, mais fonde le label Jazz Odyssey comptant une quinzaine de
références. Ce travail mené sous la supervision d'Hugues Panassié, aura
permis l’enregistrement de séquences inestimables pour la mémoire du
jazz.
La
filmographie de Louis Panassié est davantage marquée dans les décennies
suivantes par des films s’intéressant aux régions françaises (L’Âme corse, 1976-78; Splendeurs de la Provence, 1990-91) et
au catholicisme (Le retour vers Dieu,
1987; Le père Guy Gilbert et la bergerie
de Faucon, 2011).
Rencontre avec un personnage attachant, naturel et drôle, d'une humilité qui tranche avec les avis parfois péremptoires, même quand ils sont pertinents, d’Hugues
Panassié, un personnage essentiel de l'aventure du jazz –le film et
l'histoire du jazz cette fois, et pas seulement en France– quoi qu'en
dise la critique révisionniste en chaire à la Sorbonne et ailleurs aujourd'hui et depuis maintenant 70 ans.
Si on peut considérer Charles Delaunay comme un grand architecte du
jazz en tant qu'art aujourd'hui universel, un de ceux qui ont compris
dès l'origine que c'était un art en gestation, donc en mouvement et avec
ses dynamiques sociales et politiques, Hugues Panassié a eu le mérite
essentiel de définir avec précision ce qui identifie le jazz sur le plan
esthétique et expressif, avec un souci de précision
quasi-ethnographique et quasi-musicologique dans lequel il s'est parfois
trop enfermé, car un art populaire vivant n'est pas figé dans un cadre
ethnographique. Le «quasi» est là pour dire qu'il a œuvré en pionnier
amateur et non en universitaire (le jazz a plus besoin d'amateurs
savants que d'universitaires sclérosés), ce qui le rapproche
indubitablement de Louis Panassié, son fils, à double titre:
l’ethnographie intuitive et la curiosité fertile sans complexe.
Le
fils rend un tendre et juste hommage à la connaissance du jazz de son
géniteur, sans masquer tout à fait la distance qui les séparait, une
relation plus de respect que d'amour traditionnel entre père et fils, et
une déférence certaine pour la sensibilité au jazz du critique de jazz.
Il rend aussi, avec beaucoup d'honnêteté, à César ce qui lui
appartient, en particulier ce relationnel du père avec les musiciens
fondateurs du jazz qui ont permis l'existence de ce film extraordinaire,
à un moment clé où Louis Armstrong, Rosetta Tharpe, Duke Ellington
parmi d'autres sont encore de ce monde. Ils vont disparaître, comme
Hugues Panassié au début des années 1970, et ils peuvent témoigner,
grâce à ce film, du plus grand événement artistique du XXe siècle sur le plan qualitatif et humain.
Près de cinquante ans après sa première présentation à la Salle Pleyel, L'Aventure du jazz demeure une rareté. Le film, qui n'a jamais fait l'objet d'aucune
sortie VHS ou DVD semble-t-il, n'a été vu depuis qu'à l'occasion de
projections privées, notamment pour des écoles de musique. Il en a
longtemps été ainsi par la volonté du discret Louis Panassié d'autant
que les musiciens avaient gracieusement participé au tournage par amitié
pour Hugues Panassié, ce qui excluait toute exploitation commerciale du
film. Un accord avec l'ensemble des ayants droit reste à trouver pour
permettre aujourd'hui une large diffusion de ce précieux témoignage.
En attendant, sortira début décembre, en DVD, Near the Legends (SR Films), un documentaire de 52 min. réalisé par Sandro Raymond, dans lequel Louis Panassié raconte son Aventure du jazz et celle de son père, de larges extraits du film d'origine à l'appui.
Propos recueillis par Mathieu Perez
Photos Jean-Pierre Raymond de Rivarola by courtesy,
Archives Louis Panassié by courtesy
© Jazz Hot 2020
Jazz Hot: L’Aventure du jazz n’est pas votre
premier film. Avant cela, vous avez parcouru le monde pour réaliser des
documentaires. Comment est née votre vocation?
Louis Panassié: Un
jour à Montauban, vers 1955, j’ai vu une vieille Harley-Davidson à vendre. Je
me suis dit qu’il serait intéressant de l’acheter sans avoir l’idée de ce que
j’allais en faire. Très rapidement, j’ai compris qu’il fallait que je me
construise un projet: ce serait un tour de l’Afrique en Harley-Davidson. C’était
une aventure sportive. Je suis parti seul, avec deux caméras 16mm et un petit
stock de pellicules. Voilà comment ça a commencé. Avec le temps, je me suis mis
à affiner mon approche cinématographique. L’une des plus élaborées s’est faite
en Corse, en 1979-1980. Je suis un des rares «Français» (du continent) qui aient réalisé un film
où les Corses se reconnaissent…
Dès vos premiers
films, vous partez à l’aventure, et vous vous intéressez à d’autres cultures: le
Guatemala (1962), le Sri Lanka (1965), le Mexique (1967), etc.
J’étais à la recherche d’une approche un peu folklorique
qui, cinématographiquement, avait de l’allure. Au Guatemala ou au Mexique, il s’agissait
de sociétés indiennes très authentiques. Je n’ai pas le certificat d’études ni le baccalauréat; je
n’ai pas fait d’études universitaires. Pour autant, je me suis rendu compte que
le travail d’ethnographe –qui consiste à recueillir des images– était à ma
portée, parce que j’étais un bon photographe. Mon premier film, L’Afrique insolite, a été présenté avec
l’aide de l’Education nationale. Il a été montré à sept mille enfants de 8-10
ans, par groupe de mille, dans de très grandes salles. Le film a fait les quelques
sous qui ont permis un deuxième voyage: à Saigon, en 1959. Je suis parti avec
ma première épouse, Claudine.
Vous avez formé un tandem
avec votre épouse Claudine dès vos débuts dans le cinéma.
Quand je me suis marié, elle avait 17 ans. Pour le voyage en
Asie, elle est partie avec moi. Elle était bonne photographe. Quand on a
commencé à présenter le film sur la Grèce, en 1961, elle faisait le commentaire
avec moi. On a continué comme ça pendant très longtemps.
Claudine et Louis Panassié sur le tournage de L'Aventure du jazz
© Photo X, Archives Louis Panassié by courtesy
Pourquoi ce choix
d’un cinéma ethnographique?
N’ayant pas fait de longues études, je me suis retrouvé dans
l’obligation de me pencher avec tendresse et curiosité sur la vie des individus
que j’étais en train de filmer. Ce qui m’amène à oser dire que je dois d’être celui
que je suis aujourd’hui grâce à ceux que j’ai rencontrés, filmés et écoutés en
n’ayant pas d’a priori.
Vous aviez des liens
avec des cinéastes comme Jean Rouch?
Non, j’ai toujours vécu en marge du monde cinématographique.
On m’a aussi reproché de ne pas faire un travail d’ethnologue. Le
documentariste Mario Ruspoli était très critique à mon égard. L’ethnologue
creuse profond en fonction de son savoir. Moi, je n’avais pas ce savoir.
Comment vous
êtes-vous retrouvé à travailler à la télévision?
J’ai réussi à vendre mes films tournés au Guatemala et au Mexique à la BBC ainsi qu’à des chaînes
importantes du Canada et de Suisse. J’ai aussi fait des interludes, des shorts de trois minutes. L’ORTF m’en a acheté pas mal. Mais ça
n’allait pas plus loin... En 1968, l’acheteuse de films à la télévision
canadienne anglaise m’a dit qu’elle appréciait mes films, mais que je manquais
de bagages cinématographiques. Elle m’a proposé de me former pendant une
semaine à l’approche réalisation, direction de la photographie, montage, son,
production... En cinq jours, j’ai appris la technique en vitesse accélérée.
Jusque-là, je travaillais avec une caméra muette.
Pourquoi vous
êtes-vous intéressé au jazz après tant de films tournés à travers le monde?
Mon père me disait avec regret que personne n’avait
additionné des images de gens performant, encore dynamiques et à la hauteur, alors
qu’ils étaient âgés. Mon père doutait que j’arrive à faire ce film... Après ma
formation technique à la télé canadienne, je me suis demandé ce que j’allais
faire avec ce que je venais d’apprendre, et je savais les regrets de mon père quant
à l’absence de documents consistants sur un certain nombre de musiciens. Dans
le film, Louis Armstrong donne une prestation sans équivalent. Il raconte sa
vie et chante a cappella. Le destin de ce film tient à une semaine de stage!
Le point de départ deL’Aventure du jazz était de tourner
un film pour diffuser le jazz au grand public avec des interviews et des
séquences musicales, c’est ça?
Oui, ça a été un conflit avec mon père. Quand je me suis
lancé, je lui ai dit que je voulais le filmer. Il m’a dit d’aller d’abord aux Etats-Unis
et que si, à mon retour, je manquais d’images, je pourrais le filmer. Je lui ai
répondu que cela ne m’intéressait pas parce que je voulais, de façon un peu
naïve, qu’on le voie du fait qu’on
n’aborderait pas les grands thèmes qui auraient pu intéresser les amateurs avertis.
Je souhaitais que mon film amène des gens au jazz. Mon père disait le «vrai
jazz», moi la musique populaire. C’est exactement la même chose. Si vous voulez
savoir par quoi je suis touché musicalement, je vous dirais par la musique qui
arrive à mon cœur. J’étais avantagé probablement par le fait que je n’ai pas
intellectualisé mon approche de la musique de jazz. Le jazz, c’est une manière
de battre et une manière de jouer.
Votre film est, en
quelque sorte, le prolongement du livre La Bataille du jazz1 d’Hugues Panassié, sorti en 1965. Le séquençage du film suit
le livre.
C’est un livre remarquable.
L’Aventure du jazz est un document historique exceptionnel. Nombre
de musiciens sont morts peu de temps après le tournage (1969-1972): Charlie
Shavers (1971), Mezz Mezzrow (1972), Rosetta Tharpe (1973), Duke Ellington (1974), Milt
Buckner (1977)... Comment aviez-vous pris contact avec eux?
Mon père leur avait écrit. Quand j’arrivais, je me
présentais comme le fils d’Hugues Panassié avec un anglais très approximatif.
Sans cette introduction, ça n’aurait pas été possible. J’ai commencé à filmer
en 1969. Un an plus tard, j’ai montré les rushes à New York à tous les
musiciens qui avaient participé, y compris Louis Armstrong, pour qu’ils voient
ce qui avait déjà été fait.
Le film a été tourné
en trois voyages aux Etats-Unis: en 1969, 1970 et 1972.
Le premier voyage s’est fait avec beaucoup de difficulté. Je
devais trouver des musiciens disponibles au moment où j’avais besoin d’eux. Ce
n’était pas évident. Une autre grosse tranche de travaux était en 1970. J’étais
limité par le manque d’argent, parce qu’il n’y avait pas de producteur. Et
c’était assez complexe... On a présenté une première version. Un peu d’argent
est rentré. En 1972, j’ai filmé Duke Ellington, les Stars of Faith à
Philadelphie, Jo Jones avec George Benson et Jimmy Slyde. Je souhaitais
insister sur les danseurs, par rapport à ce que pensait mon père et les
musiciens. Jo Jones dit à un moment que l’œil du musicien observe ce que fait
le danseur et que plus le danseur est génial, plus le musicien est heureux dans
l’improvisation. Là, on est dans un univers qui est très loin de celui des concerts.
Je n’ai jamais filmé les musiciens en concert. Je n’ai utilisé aucune archive.
Les gens qui voient le film aujourd’hui sont étonnés d’un climat inhabituel.
Pourquoi ne pas avoir
filmé les musiciens en concert?
Dans un concert, je n’aurais rien pu contrôler. Rien! Or, je
voulais obtenir les meilleurs résultats en suivant tout ce que mon père avait
préparé. J’avais loué le Half-Note2 pour l’occasion.
Hugues Panassié s’est-il beaucoup investi dans le choix des musiciens?
Mon père m’avait suggéré certains regroupements de musiciens,
les morceaux qu’il faudrait faire jouer en fonction des musiciens que je
réussirais à regrouper. Il me précisait même le tempo à suivre. Moi, je n’y
connaissais rien, j’étais perdu. Donc, il s’est créé une collaboration très
originale. Et on voulait un film relatant au mieux ce qui pouvait correspondre
aux chapitres qui nous intéressaient. C’était tellement difficile d’avoir la
moindre certitude de réussir ce que mon père voulait... John Lee Hooker et
Memphis Slim ont été filmés chez mon père. J’ai eu de la chance.
Duke Ellington sur le tournage de L'Aventure du jazz © Photo X, Archives Louis Panassié by courtesy
Quand vous demandiez
aux musiciens de jouer tel morceau, à tel tempo, ils acceptaient?
Oui. Par exemple, mon père considérait comme très surprenant
«Chinoiserie» que joue Duke Ellington et son orchestre. Ça déconcerte beaucoup
de personnes. Je ne sais pas ce qui l’a poussé à demander ce morceau. Je ne lui
ai pas posé la question.
Sur votre site web,
vous publiez une correspondance avec votre père. Il n’aimait pas le
téléphone...
Quand mon père est mort, j’ai récupéré ses lettres. Comme je
craignais que ces lettres ne soient perdues, je les ai données à la
bibliothèque de Villefranche-de-Rouergue3. A chaque fois que j’étais dans une
situation critique –quand il fallait remplacer un musicien qui était prévu, par
exemple– je lui téléphonais. Il était anti-téléphone, c’est Madeleine Gautier
qui répondait. Pendant le tournage, il s’est mis à accepter le téléphone quand
c’était moi. A chaque fois, il répondait à mes demandes dans l’instant, et il ne
se trompait jamais.
Dans l’une de ces
lettres, il raconte qu’il est épaté de la scène tournée dans l’église de
Philadelphie, parce que cela n’avait jamais été fait.
Jamais fait, il faut se méfier... Mais l’avoir fait avec de
beaux cadrages, c’est possible…
Comment s’est déroulé
le tournage?
Il fallait travailler très vite, nous n’avions pas d’équipe.
Au maximum, on était trois: ma femme, Claudine, était responsable des prises de
son –en n’étant pas ingénieur du son– sur un Nagra4, elle avait la
responsabilité de trois micros. On a eu du pot!
Le rapport avec les musiciens
que vous avez filmés était-il chaleureux?
Ah, oui! Ma décontraction a dû me rendre service. Et puis,
j’ai quelques racines noires dans la famille. Il y a des cheveux crépus…
Il est intéressant de
voir comment des amitiés nées au début des années 1930 entre Hugues Panassié et
ces musiciens ont perduré pendant quarante ans.
Duke connaissait mon père depuis toujours. J’étais
impressionné. Et son orchestre était une grosse machine. Mon père tenait
absolument à ce qu’il soit présent dans le film. Quand Louis Armstrong commente
le blues, il le fait avec tellement d’humanité et de simplicité! On arrive à
l’humanité profonde de cet homme-là. C’est la vie même. Mon père et lui
s’écrivaient régulièrement.
Dans le film, Louis
Armstrong chante «Do You Know What It Means to Miss New Orleans?» a cappella,
dans une belle séquence, et aussi «That’s My Desire» en français.
Je savais que je ne pourrais pas lui faire jouer de
trompette. J’avais espéré lui faire jouer quelque chose dans l’embouchure
seulement. Ça n’est pas venu. Très normalement, il a proposé une illustration a
capella. Au point que lors d’une émission de télévision, tournée peu avant sa
mort, où il fallait une illustration qui n’avait pas été préparée, il a dit: «Je vous propose de chanter a capella comme
je l’ai fait dans le film que Louis Panassié est en train de tourner». Un
témoin me l’a rapporté.
Claudine Panassié et Louis Armstrong sur le tournage de L'Aventure du jazz
© Photo X, Archives Louis Panassié by courtesy
Louis Armstrong, Duke
Ellington, Lionel Hampton étaient parmi les amis les plus anciens d’Hugues
Panassié.
Il faut regarder les premières couvertures de Jazz Hot. Ça situe la richesse des
relations entre eux.
Hormis Armstrong,
quels musiciens présents dans le film étaient les plus proches de votre père?
Buck Clayton, Sister Rosetta Tharpe, Memphis Slim, Milt
Buckner, Jo Jones…
Votre père avait-il
un regret particulier sur un musicien qui n’avait pu être dans le film?
Earl Hines.
Qui sont les Panassié
Stompers, composés de Buck Clayton (tp),
Eddie Barefield (as), Budd Johnson (ss), Vic Dickenson (tb), Tiny Grimes (g),
Sonny White (p), Milt Hinton (b), Jimmy Crawford (dm)?
C’étaient huit solistes de qualité qui avaient, tous, le droit
de considérer que l’orchestre devait porter le nom de l’un des huit. Donc, on a
eu l’idée de les appeler «Panassié Stompers».
Pourquoi avoir choisi
de tourner dans une église de Philadelphie plutôt qu’à Harlem?
Parce que Sister Rosetta Tharpe habitait à Philadelphie. Les
Stars of Faith aussi5.
Dans son livre,
Hugues Panassié explique le rôle essentiel de la batterie dans le jazz. Dans
votre film, les batteurs sont très présents. Pour le cinéaste, ce devait être
un plaisir de filmer Cozy Cole et Jo Jones…
Un bon batteur, c’est un cinéma extraordinaire!
Dans votre film, vous
filmez les solos en entier, ce qui est passionnant pour le spectateur.
Sauf que quelquefois les caméras se déchargeaient en cours
d’interprétation. Car, comme il n’y avait pas eu de répétition –les musiciens
n’ont jamais accepté d’en faire– je ne pouvais pas savoir de combien de
pellicules j’allais avoir besoin. Dans le film, dans la séquence du blues, tout
d’un coup, on est obligé de shunter le son alors qu’il y a un trompettiste qui
se débrouille drôlement bien. On me l’a reproché... Mais soit il fallait
supprimer le morceau, soit supprimer cette intervention du trompettiste dans
son chorus, soit shunter le son...
Vous rendiez-vous
dans des clubs de New York lorsque vous ne tourniez pas?
Non, les
dancings étaient fermés. Mon père avait connu ça: le jazz comme musique
de danse. J’allais voir Edgar Battle (tp) à Harlem…
Mais il ne restait plus grand-chose de ce que mon père avait pu
connaître...
Dans une interview
très complète à Thierry Maligne (Filmer le jazz)6, vous racontez qu’Hugues Panassié s’est aussi beaucoup
investi dans le montage du film.
J’ai dit à mon père: «Vous
sentez des choses que je ne suis pas capable de sentir avec la même profondeur
et la même exaltation dans les interprétations filmées par moi. Je vous demande
de faire le plan du film, que je respecterai».
A quel moment
avez-vous eu cette conversation avec lui?
Dès qu’on a eu les premiers rushes. 
Louis, Claudine et Hugues en tournage dans le bureau
d'Hugues Panassié © Photo X,
Archives Louis Panassié by courtesy
Comment l’avez-vous
convaincu de le filmer, lui qui était si réticent à cette idée?
Je lui ai dit que si je ne le filmais pas, je ne ferais pas
le film. D’ailleurs, il n’aimait pas les séquences où il est interviewé, mais il
a été très touché par ce que les musiciens disaient de lui et de son travail.
Il n’y a pas d’équivalent filmé pour Charles Delaunay ou d’autres.
Comment se sont organisées
les sessions de montage avec votre père?
On lui montrait les rushes à l’état brut. Il les a vus trois
ou quatre fois. Il disait ce qui lui plaisait le plus, et je notais tout ce
qu’il me demandait.
Quelle a été la
réaction d’Hugues Panassié quand il a vu le film une fois monté?
Il a été ébloui! Il n’en revenait pas. Il ne pensait pas que
j’y arriverais, parce qu’il savait que je n’étais pas un amateur de jazz.
Pourquoi n’êtes-vous
pas un amateur de jazz?
Si vous me demandez de parler des musiciens, j’ai eu une
expérience personnelle avec eux. Pour le reste, je suis ignare. J’ai fait une
ou deux fois le stage de Montauban. J’écoutais et j’ai entendu du jazz toute ma
vie, mais je ne suis jamais entré dans cette chapelle. Si la musique touche mon
cœur, si j’ai envie de taper des mains, si je suis joyeux et heureux devant ce
que j’entends, c’est que c’est bon. Je suis toujours revenu à la musique du
cœur.
Dédier le film au «peuple
noir», c’était votre idée ou celle de votre père?
C’est mon idée, mon style à moi. C’est comme pour mon film
sur la Corse, je l’ai dédié au peuple corse.
Le film est à la fois
un document historique et une façon d’illustrer la pensée d’Hugues Panassié.C’est aussi une déclaration d’amour à votre
père…
Ce film est une déclaration de respect à mon père. Faire un
film sur mon père était mon intention première. J’ai voulu que mon père soit
filmé, et qu’il réponde à des questions qu’un amateur pointu pourrait considérer
comme banales en matière de jazz.
Quelle relation
aviez-vous avec lui pendant la préparation du film?
Ça nous a rapprochés. C’était une relation raisonnable,
respectueuse, traditionnelle entre un père et son fils, mais pas plus. A partir
du moment où le film a commencé, on a eu une relation complètement différente: cinq
années au top.
Vous avez aussi créé
les disques Jazz Odyssey.
Les disques Jazz Odyssey marchaient bien. Quand mon père est
mort, j’ai cherché parmi ses amis qui pourrait prendre la relève, mais je n’ai
trouvé personne. Mon père est mort deux fois. En 1972-1973, j’ai organisé
soixante concerts avec Milt Buckner et Jo Jones. Trente en duo, en France,
Suisse et Belgique. J’étais avec eux tout le temps. Puis, trente autres avec
Buckner, Jones et Jimmy Slyde.
Comment a été reçu
le film à sa sortie?
En 1971, quand L’Aventure
du jazz a été prêt, la deuxième chaîne, qui passait des brèves à 19h30, a
accepté de passer des extraits du film. Je n’ai pas toujours su faire ce qu’il
aurait fallu pour que la télévision française s’intéresse davantage à mes
films, avec une restriction pour L’Aventure
du jazz. J’ai demandé une autorisation limitée d’utilisation aux musiciens,
qui me donnait la possibilité de passer le film seulement quand j’étais
présent.

Sur la question de la
diffusion du film, nous renvoyons les lecteurs à votre interview publiée dans Filmer le jazz6. Comment les spectateurs
ont-ils réagi?
Quand j’ai
présenté le film à Pleyel, on était dans un
climat de polémique qui perdurait, et qui était soigneusement entretenu
par
certaines personnes. Mais, à partir de ce moment-là, il y a eu un début
de
reconstruction de l’image de mon père. Quand je demandais aux
spectateurs
quelle partie ils préféraient, celle avec les explications de mon père
ou la
séquence musicale, tout le monde disait les explications. Quand je
montrais le
film à des enfants et que je leur posais la même question, ils me
disaient les
danseurs et les batteurs. A la salle Pleyel, en 1971 et 1974, le film a
été
présenté 72 fois. Ça a été très difficile au départ… Comme il fallait
trouver
des spectateurs, on a décidé avec des amis, en 1972, de distribuer cent
mille
tracts dans les restaurants universitaires. Et ça a déclenché une
multitude de
nouveaux spectateurs, des jeunes. Ça leur a plu. Ils en ont parlé autour
d’eux, et il y a eu un monde fou. On a même été programmés dans Le Grand Échiquier de Jacques Chancel. Mais au moment de la
programmation, une grève a éclaté… L’émission est reportée de quatre ou
six
semaines. Après sa diffusion, une foule s’est bousculée pour aller voir
le film, mais c’était la fin de la programmation à Pleyel, et on ne
pouvait pas
ajouter d’autres projections... C’était un coup dur. Ça résume les aléas
des
espoirs qu’on peut mettre dans une émission de télévision.
Vous me disiez que
vous n’avez jamais été satisfait du titre «L’Aventure du jazz».
Il y avait un conflit chez les spectateurs potentiels sur le
titre du film et la présence du blues et du gospel, parce qu’ils me disaient
que le blues et le gospel, ça n’est pas du jazz. (Rires) La souffrance de toute ma vie a été de ne pas savoir trouver
un titre pour le film. «L’aventure du jazz», ça n’est pas un bon titre, parce
que vous ne savez pas ce que vous allez voir. C’est dur pour un réalisateur...
Vous continuez de
présenter ce film à travers le France. Que ressentez-vous en le revoyant?
Ce qui est épanouissant pour moi, c’est la qualité technique
du film qui, tant d’années plus tard, laisse à penser qu’il est relativement
récent. Ce n’est pas un film daté. Et, pourtant, il a été tourné entre 1969 et 1972!
1. Hugues Panassié, La Bataille du jazz,
Albin Michel, 1965
2. Jazz-club de New York en activité de 1957 à 1974 en deux localisations.
3.
La Bibliothèque de Villefranche-de-Rouergue détient les archives
d'Hugues Panassié qu'elle a racheté à sa mort le 8 décembre 1974, sous
l'impulsion de son maire d'alors, Robert Fabre, amateur de jazz et par
ailleurs célèbre pour avoir été l'un des trois signataires du Programme
commun de gouvernement, au nom du Parti radical (de gauche), avec
François Mitterrand (Parti socialiste) et Georges Marchais (Parti
communiste français), signé en 1972, qui fut dénoncé en 1977.
4.
Le Nagra est un magnétophone à bande, inventé en 1951 par un ingénieur
polonais, Stefan Kudelski, qui devint une légende à partir des années
soixante, réunissant une qualité d'enregistrement de haut niveau avec un
format très réduit, rendu célèbre par la CIA dans sa version noire («SN» pour série noire) et par la série télévisée américaine Mission Impossible (Mission: Impossible). En 1972, il devait s'agir du Nagra IV-S (stéréo) qui permettait la synchronisation son-images.
5. Sister Rosetta Tharpe (voc, g), 1915-1973 est morte à Philadelphie. Les Stars of Faith sont un groupe vocal de gospel de Philadelphie formé en 1958 par d'anciens membres des Clara Ward Singers: Marion Williams, Frances Steadman, Kitty Parham, Henrietta Waddy et Esther Ford. La composition du groupe a évolué avec le temps: Mattie Harper a remplacé Esther Ford en 1960. Marion Williams a quitté le groupe en 1965 pour une carrière de soliste. Dorothy Blackwell est arrivée en 1967 et Sadie Keys, la fille de Frances Steadman, en 1968, et le groupe n'a cessé d'évoluer avec le temps.
6. Filmer le jazz, sous la direction de Thierry
Maligne, Presses universitaires de Bordeaux («L’Aventure du Jazz, un film
à quatre mains», entretien avec Thierry
Maligne, pp. 97-146), 2011
*
CONTACT: https://sites.google.com/site/louispanassie/home
Chaîne YouTube de Louis Panassié : https://www.youtube.com/user/Panassie19/videos
HUGUES PANASSIÉ & JAZZ HOT: n°660-2012, n°661-2012
Hugues Panassié est bien entendu omniprésent dans Jazz Hot de 1935 à 1939, puis de 1945 à 1947 (date de la rupture au sein des hot clubs et de Jazz Hot), dans les tribunes, les articles de fond, les chroniques de disques.
MUSICIENS ET DANSEURS FILMÉS DANS L’AVENTURE DU JAZZ:
Louis Armstrong, Eddie Barefield Orchestra (Eddie
Barefield, Bernard Upson, Milt Sealey, Joe Marshall), Edgar Battle, George
Benson avec Jo Jones et le tap dancer Jimmy Slyde, Milt Buckner et Jo Jones,
Cozy Cole, Duke Ellington Orchestra, Lionel Hampton, John Lee Hooker, Cliff
Jackson, Mezz Mezzrow, Panassié Stompers (Buck Clayton, Eddie Barefield, Budd
Johnson, Vic Dickenson, Tiny Grimes, Sonny White, Milt Hinton, Jimmy Crawford), Charlie Shavers, Zutty Singleton,
Memphis Slim, Willie «The Lion» Smith, Stars of Faith, Buddy Tate Orchestra
(Pat Jenkins, Ben Richardson, Buddy Tate, Eli Robinson, George Baker, Ted
Sturgis, Cozy Cole), Sister Rosetta Tharpe, Dick Vance Orchestra, les danseurs
Gigi Brown et Edward Johnson, les danseurs de Lou Parks.
EXTRAITS DU FILM
Les musiciens parlant d'Hugues Panassié
https://www.youtube.com/watch?v=UBaWmM2jGhw
Milt Buckner (org), Jo Jones (dm), «La Belle Claudine»
Gigi Brown et Edward Johnson dansent sur «Boogie Chillun» de John Lee Hooker
Jo Jones (dm) «Caravan»
CATALOGUE
JAZZ ODYSSEY par Jérôme Partage
LP 1969-72. L’Aventure du jazz, Volume 1, Jazz Odyssey 001, réédité sur le double LP JO 005 (=CD Frémeaux & Associés 5666)
LP 1969-72. L’Aventure du jazz, Volume 2, Jazz Odyssey 002, réédité sur le double LP JO 005 (=CD Frémeaux & Associés 5666)
LP 1969-73. Jo Jones, The
Drums, Jazz Odyssey 008 (=CD Frémeaux & Associés 5672)
LP
1969-74. Willie Smith/Milt Buckner/Jo Jones/John lee Hooker/Billy Butler/Al Casey/Cliff Jackson/Sister Rosetta Tharpe/Charlie Shavers, Inédits, Jazz Odyssey 014
45t 1971. Memphis
Slim/Sister Rosetta Tharpe, Jazz Odyssey 003
LP
1971. Milt Buckner/Jo Jones, Deux géants du jazz, Jazz Odyssey 004 (=CD Frémeaux
& Associés 5684)
LP 1972. Willie Smith/Jo Jones, The Lion and the Tiger, Jazz Odyssey 006
(=CD Frémeaux & Associés 5678)
LP 1972. Milt Buckner/Jo
Jones, Buck and Jo, Jazz Odyssey 007 (=CD Frémeaux
& Associés 5684)
45t 1972. Little Mary, Jazz
Odyssey 101
LP
1973-74. Milt Buckner/Jo Jones, Blues for Diane, Jazz Odyssey 011 (=CD Frémeaux
& Associés 5684)
LP 1974. Willie
Smith/Jo Jones, Le Lion, le Tigre et la Madelon, Jazz Odyssey
009
LP
1974. Jo Jones/Zutty Singleton/Cozy Cole/Michael Silva, Drums Odyssey, Jazz Odyssey 010
LP 1974. Billy Butler/Al Casey, Guitar Odyssey, Jazz Odyssey 012 (=CD Frémeaux &
Associés 5689)
LP
1974. Olive Brown, The New Empress of the Blues, Jazz Odyssey 013
|

Da 5 Bloods
Frères de sang
Film de Spike Lee, musique
Terence Blanchard, produit par 40 Acres & A Mule Filmworks , Rahway Road
Productions, 154 min., USA, en version originale sous-titrée, sorti
le 12 juin 2020 sur Netflix,
Bande annonce et
extraits: https://www.netflix.com/fr/title/81045635
https://www.imdb.com/title/tt9777644/soundtrack
https://www.imdb.com/title/tt9777644/fullcredits/?ref_=tt_ov_st_sm
A juste titre, James
Baldwin disait qu’il attendait une «autre» production cinématographique qui
aborde l’histoire du point de vue du «deuxième niveau d’expérience» et Spike Lee
est certainement un des représentants les plus prolifiques de ce cinéma en contrepoint,
construisant son travail comme une mosaïque faite de focus sur des événements
de l’histoire américaine, filmés sous un autre angle. Ce qui est toujours très
juste dans sa façon d’aborder le récit, est que partant de références et de
codes culturels afro-américains, Spike Lee arrive directement au cœur de l’éternel
humain, et qu’au-delà de la saveur et des clins d’œil propres à l’Afro-Amérique,
les thématiques et enjeux sont évidemment les histoires de tous, aussi universelles que La femme du boulanger de Pagnol, un chef-d’œuvre intemporel.
Le film raconte une
histoire simple, ce sont toujours les meilleures pour broder et approfondir,
comme sur les standards de jazz: quatre vétérans afro-américains de la guerre du Vietnam y
retournent une génération après (un côté Vingt
ans après d’Alexandre Dumas), pour ramener les restes du corps de leur chef
de groupe, aussi leur chef spirituel, Stormin’ Norman («La Tourmente»), mort
accidentellement lors d’une attaque; mais pas seulement… Ils sont aussi à la
recherche d’un «trésor», des lingots d’or tombés du ciel qu’ils ont enterrés
dans la jungle pour financer le combat des droits civiques de cette époque, selon le
souhait de leur chef. Le groupe est rejoint par le fils de Paul, torturé par ses
fantômes, ses aigreurs de vie, et curieusement soutien de Donald Trump: ce fils
s’appelle David, quête l’attention de son père et assure la fonction symbolique
en tant que professeur d’histoire.
Ce rôle est sans doute celui que
Spike Lee
aurait pu endosser s’il avait été plus jeune comme dans ses premiers
films:
celui de l’observateur qui va aller au bout de cette jungle touffue
d’empilements d’intérêts et de conflits à démêler et à régler pour
sortir dignement
de l’affaire, par l’analyse des tenants et aboutissants d’un conflit
entre
nations, s’emboîtant en poupées russes jusqu’aux tourments
psychologiques
individuels, en passant par les luttes collectives et les racismes
multiples, parfois inattendus. Chaque personnage (américain, français,
vietnamien du Sud
et du Nord) symbolise une sensibilité de cette guerre du Vietnam, des
problématiques parfois paradoxales, des façons de penser qui mutent au
fil des
circonstances.
Cette manière chorale de tourner le scénario rappelle le beau Miracle at St. Anna (Spike Lee, musique
de Terence Blanchard, 160mn, 2008, Usa-Italie) sur la campagne d’Italie,
jusqu’au surnaturel qui intervient ici aussi en flashs d’explication, en
compléments d’information, de même que les images d’archives sociales
et
politiques, qui jalonnent la Grande Histoire, ponctuent les souvenirs
personnels
et enrichissent encore le débat.
Enfin, le film rend hommage au cinéma (Apocalypse Now, peut-être aussi à cause
de Marlon Brando, l’ami d’Harry Belafonte, un des argentiers des droits civiques, l’ami
de Spike Lee, la mémoire vivante dans BlacKKKlansman, Spike Lee, 2018),
aux Temptations de Detroit, le groupe
mythique de la Motown, en reprenant leurs prénoms: Otis (Williams), le
parrain médecin amoureux d’une alors-prostituée locale, David (Ruffin) le
fils-fil conducteur du récit, Melvin (Franklin) le chercheur d’or, Eddie (Kendricks)
le vendeur de voitures crâneur et ruiné, et Paul (Williams), le névrosé
trumpiste. Norman (Whitfield) étant leur auteur-compositeur de textes plus
engagés et là, le penseur-chef au combat, fédérateur de tous les instants.
La
France est représentée par ses deux faces, la deuxième génération campée par
une fille de la grande bourgeoisie ex-coloniale essayant de compenser ce qu’a
fait sa famille sur place, par son ONG de déminage, et l’ancienne génération
jouée par un Jean Reno corrompu et manipulateur post-colonial à souhait.
Comme
souvent chez Spike Lee, le côté shakespearien de la mise en scène horlogère se conjugue avec l’autre
versant du théâtre, Bertolt Brecht, qui interrompt le récit par des faits réels
marquants pour faire interagir et réfléchir le spectateur séance tenante. A
l’évidence, une façon alternative de filmer, une perception différente du réel,
un feeling plus direct qui auraient
intéressé le cinéphile-philosophe et compagnon du Dr. Martin Luther King, Jr., James
Baldwin.
Le
hasard étant
facétieux, le film est sorti pendant les manifestations de protestation
«Black
Lives Matter», suite à l’assassinat filmé de George Floyd, en pleine
campagne
électorale masquée, confinée et chahutée aux Etats-Unis, avec un mode de
diffusion par ordinateur individuel révélateur des mutations, pas
forcément du goût des cinéphiles qui préfèrent les salles obscures, mais
alors que le confinement de la vie économique et sociale empêche de s’y
rendre –le cas encore aujourd’hui,
car l’obligation du port du masque en salle est une atteinte aux libertés publiques.
On
repasse alors, chez soi, du film au quotidien, avec la sensation insolite que la
situation est encore plus fragile aujourd’hui qu'à la période de la Guerre du Vietnam;
à croire que les humains n’apprennent jamais rien de ceux qui les gouvernent… «Une
guerre ne se finit jamais, ni dans la tête, ni dans la réalité» dit un des
frères de ce sang versé sans compter. Le film se termine sur un remake de la guerre pour le magot, puis
sur une note plus optimiste d’un trésor qui trouve finalement des chemins humanistes.
Spike Lee reste fan des fins apaisées, au moins en partie, ne serait-ce-que
pour redonner du sens là où il n’y en a plus du tout.
|
|
Musiques de l'âme
Deux documentaires sur Arte
Aretha Franklin - Soul
Sister est un
documentaire récent (de France Swimberge, production Program33/Arte, 2020,
France, 52min.) sur le parcours d’une femme dont «le deuxième niveau d’expérience»
(James Baldwin) a fondé l’inspiration, l’expressivité et le caractère
irréductible. Le film met en perspective tous les filtres de cette star
jusqu’au bout du cortège de Cadillac roses prévu pour son enterrement: de sa
ville de Detroit, MI, aux avant-postes des combats pour les droits civiques dans
le laboratoire de l’industrie taylorisée, produisant talents musicaux, rythme
et salles de spectacles à profusion, jusqu’à sa lutte en tant que fille, femme,
mère, promotrice de sa communauté maltraitée, pour imposer le r-e-s-p-e-c-t, et
sœur de cœur d’Angela Davis, une communiste en Amérique. Une documentation
visuelle accompagne les interviews, notamment des images d’Aretha au piano, de
ses mains, de son image sur les murals de sa ville.
A voir avant le 1er décembre 2021.
https://www.arte.tv/fr/videos/090610-000-A/aretha-franklin-soul-sister

A la manière tzigane (de János Darvas,
production EuroArts/MDR/Arte, 2020, Allemagne, 53 min.) est un voyage au pays des primas qui sont des solistes si
exceptionnels qu’ils reconnus comme chefs spirituels par leur communauté. Leur
liberté musicale sans borne est la clé de leur virtuosité qui fascine Claude
Debussy en 1910 lors d’un voyage en Hongrie, lui faisant dire à propos de Béla
Radics (1867-1930, Hongrois): «Ce violoniste joue comme un démon… il aime
beaucoup plus la musique que nous.», et Maurice Ravel qui essaie d’approcher au
plus près de l’âme sensible de la violoniste Jelly d'Arányi (1893-1966) avec la
rhapsodie Tzigane écrite en 1924. Deux
musiciens Barnabás Kelemen (violoniste) et Lajos Sárközi Jr. (multi-instrumentiste)
issus de cette lignée nous racontent cette histoire de la musique: Pali Pertis
(1906-1947), grand-père de Barnabás Kelemen, a fait le voyage jusqu’à Paris à
l’été 1939 (Django Reinhardt était à Londres) et Jëno Farkas (1899-1949) jouait
alors dans les cafés réputés de Budapest et dans les films allemands.
A voir
avant le 27 novembre 2020.
https://www.arte.tv/fr/videos/089114-000-A/a-la-maniere-tzigane
Jazz du voyage: l’accent, le son et l'attaque de l’Europe Centrale et Orientale
Django Reinhardt & Stéphane Grappelly Quintette du Hot Club de France, Pierre «Baro» Ferret, Marcel Bianchi (g), Louis Vola (b), «Tears», 1937
Django Reinhardt & Stéphane Grappelly, Premier mouvement du concerto en ré mineur de Jean-Sébastien Bach, 1937
Django Reinhardt solo, «Parfum», 1937
Django Reinhardt & Stéphane Grappelly Quintette du Hot Club de France en live, «J’attendrai», Londres été 1939
Joseph Reinhardt, Stephane Grappelli, Vivian Villerstein, Babik Reinhardt, Eugene «Ninine» Vees, Mitzo et Loulou Weiss, Emmanuel Soudieux...
Marius Preda «Straight no Chaser»
Art Tatum et György Cziffra
Stochelo ROSENBERG, Florin NICULESCU, Rocky GRESSET, «Les yeux noirs»
Jascha Heifetz, «Bess you is my woman now», «My Man’s Gone Now» (Gershwin's Porgy and Bess, arr. Heifetz)
Trio Rosenberg, «Nuages» en Hongrie
Angelo Debarre, Ranji Debarre, Miraldo Vidal (g), Fabrizio Montemarano (b), Monteroduni, Italie, 2014
Les points communs entre les
deux pratiques sociales de la musique sont nombreux, allant des conditions de
vie des deux communautés à leur liberté débridée, en passant par le moyen de
transmission orale (Aretha dit ne pas lire la musique et apprendre de sa sœur,
et les jeunes de Lajos ont un apprentissage peu conventionnel), les deux mettant
l’accent l’imprégnation par l’échange humain pour percevoir le feeling. Pas sûr que ces âmes hypersensibles
se formeraient avec la distanciation a-sociale et les masques… L’art sans
ferment l’humain se résume décidément à une exécution!
|
|
Les années 68
1968: The Global Revolt
Documentaire de Don Kent (1968: The Global Revolt), produit par Arte, Artline Films, Gebrueder Beetz Filmproduktion, Griga Filmes, 194 min., 2018, Allemagne-France-Norvège
https://www.arte.tv/fr/videos/072424-001-A/les-annees-68-1-2
https://www.arte.tv/fr/videos/072424-002-A/les-annees-68-2-2
https://www.imdb.com/title/tt8448848/fullcredits?ref_=ttrel_ql_1
https://www.youtube.com/watch?v=Ok-pnBszF94
Un documentaire en deux parties, Les années 68, est actuellement disponible sur Arte: partie 1: La vague (1965-1969) et Partie 2: L'explosion (1970-1975), de 97 min. chacun. Le réalisateur Don Kent,
digne héritier britannique des chroniqueurs historiques (il a vécu la
période), a su mettre en évidence qu’un sujet (privé ou public,
philosophique ou scientifique), un art, une expression n’existent pas
seuls, en suspension dans l’air, a nihilo, in abstracto,
en un seul point circonscrit, sur la planète; il illustre aussi le fait
que les réactions de causes à effets ne s’arrêtent pas aux portes des
patelins, provinces ou Etats, à l’intérieur de notre seule petite
planète percluse de géostratégies d’intérêts divergents. De l’esthétique
(au sens étymologique de perception profonde), aux arts populaires et à
la politique: il y a zéro pas, c’est la vie dans ses différentes
expressions. Des protestions pour les Droits civiques à celles contre la
Guerre du Vietnam, aux revendications de libre parole des étudiants,
des opprimés sociaux, économiques, culturels, politiques (dont les
femmes, homosexuel/le/s et combats pour la planète), soutenus par
d'autres moins opprimés, mais tous ensemble défenseurs de libertés
fondamentales et de la gestion des ressources, aux expériences
alternatives d’Etats non alignés revendiquant l’auto-détermination, le
droit à l’auto-défense (Black Panthers réfugiés et Festival Panafricain
d’Alger, 1969), il s’agit d’un continuum de réflexion humaine
universelle, d’une recherche collective, d’une quête Peace & Love, parfois drôle, mais le plus souvent dangereuse du fait de la violence «légitime» (ou non) de la répression étatique.
Ce
travail, bien fait, montre le niveau consistant et profond des luttes
populaires internationales d’alors, des Pays de l’Est aux Etats-Unis en passant par Cuba,
de la Chine au Japon, de l'Amérique-du-Sud à l’Afrique et l’Europe,
quand aujourd’hui la vie cérébrale se concentre dans l'écran des jeux
vidéos/réseaux sociaux/TV/smartphone, en disant sans vergogne: «Vous
n’avez pas honte de nous léguer ce monde dans cet état!». Ce véritable reset mental (nettoyage-réinitialisation de données) provoquant l'effacement mémoriel après cette décennie de brain storming (émulation
imaginative collective pour trouver des idées-solutions alternatives)
–seul socle de conscience historique pour continuer à défendre les
libertés individuelles et collectives– ce reset mental
donc, a aujourd’hui détruit massivement la Terre et les humains au lieu
de contenir a minima l’appétit des dominants démultiplié par les
algorithmes; il est certain que garder le linge numérique sans se
mouiller correspond davantage au regain du «Moi» nombriliste
des quatre dernières décennies, en s’illusionnant sur le fait que si je
ne m’occupe de rien et de personne, les prédateurs ne s’occuperont pas
de moi, et je vivrais en paix en m’autodisculpant du fait que je pourrais
polluer, voyager, profiter, sans rien détruire, sans voir la misère, sans voir la vie dans sa réalité, les assassinats politiques (un très beau blues d’Otis Spann pour Martin Luther King: https://www.youtube.com/watch?v=jduG-J9972E)1: faut-il être puéril pour y croire?
Les
enfants désirés (modification notable due aux droits à la contraception
et à l’avortement à cette époque) post 1968 vont être élevés dans cette
insouciance Peace & Love, de
la conquête d’une idée du bonheur dans la démocratie, caressée par
leurs parents, déjà grands-parents aujourd’hui, leur ôtant toute
résistance endurante à la violence d’Etat par jeunisme érigé en ennemi
de la mémoire populaire, statuant que les «acquis» de naissance sont dus
et peuvent être remplacés par des placebos de libertés virtuelles, et
qu’avoir une (im)posture alimentaire suffit à se déculpabiliser, quand
d’autres crèvent d’inégalités et de pollutions dues à la consommation de
masse: la conscience –l’intérêt, la conviction?– de classe, du statut
social confèrent aux privilégiés le droit de chérir leur somnolence
plutôt que s’exposer, avec un peu de courage, au moins par la pensée et
la parole: il a fallu deux mois de bataille pour confronter l’opinion et
les Etats concernant l’abandon inadmissible des plus faibles dans le
meurtre collectif que nous connaissons actuellement au sujet d’un virus.
Comme le formule clairement Erri de Luca, écrivain italien: «la
génération suivante n’a rien gardé de l’expérience révolutionnaire,
elle l’a refusée en bloc, elle l’a ignorée en bloc… ce genre d’héritage
ne se transmet pas, on s’en empare ou non… tout le monde s’occupe de ses
petites affaires… j’appartenais à une génération anti-fasciste, c’était
quelque chose que nous avaient transmis nos parents, ceux qui avaient
souffert non seulement de vingt ans de fascisme mais aussi de la guerre
où le fascisme les avaient entraînés… on a dû finalement accepter de
s’engager dans un combat bien plus important qu’une simple révolte… En
1969, la police italienne tirait sur les ouvriers et les travailleurs
agricoles qui manifestaient, c’était une police fasciste... il n’y a pas
eu d’épuration après guerre... les fascistes étaient restés en place.»
Ces
idées nous font instantanément penser au cinéma italien des années
1970, sans concession pour les dominants et les dominés, raide dans les
moindres travers de ceux qui se plaignent sans jamais s’impliquer, raide
avec le terrorisme d’Etat, le rapport frontal de domination, le pouvoir
(attentat de Piazza Fontana en 1969, «stratégie de la tension»). Tom Zé (avec Caetano Velozo, Gilberto Gil, mouvement tropicaliste politico-musical contre la dictature brésilienne né en 1967) dit avec un bon sens lapidaire: «Sous une dictature, penser est un crime.» Evidemment! Mais ce qui va sans le dire, va encore mieux en le disant. Les images d’archives et témoins directs sont encore là –de toutes opinions– et parlent, ne les ratez pas! S’endormir
dans le confinement cérébral est le seul virus réellement mortel pour
l’humanité –c’est notre actualité de 2020– mais ça, la pensée unique
aura toujours intérêt à le taire!
Hélène Sportis
1. Lyrics de «Blues for Martin», 1968, écrit lors de l’assassinat de Martin Luther King
Otis Spann (p, voc, 21 mars 1924 ou 1930, Jackson ou Belzoni, MI - 24 avril 1970, Chicago, IL)
Oh, did you hear the news
Coming out of Memphis Tennessee yesterday?
Yes fellows, I know you had to've heard the news
That happened down in Memphis Tennessee yesterday
There came a sniper
And wiped Martin Luther King's life away
On the 4th of April in the year 1968
On the 4th of April in the year 1968
You know there come a mean man
Pop a bullet through Dr. King's head
Oh, when his wife and kids came down
All they could do is moan
Oh, when his wife and kids came down
All they could do is moan
Now the world's in a revolt
‘Cause Dr. King is gone.
Oh, as-tu entendu les infos
Venant de Memphis Tennessee hier?
Oui les gars, je sais que vous devez avoir entendu les infos
De ce qui s'est passé hier à Memphis Tennessee
Un tireur d’élite est venu
Effacer la vie de Martin Luther King
Le 4 avril de l'année 1968
le 4 avril de l'année 1968
Tu sais qu'un homme mal intentionné
A tiré une balle dans la tête du Dr King
Oh, quand sa femme et ses enfants sont descendus
Ils ne pouvaient que gémir
Oh, quand sa femme et ses enfants sont descendus
Ils ne pouvaient que gémir
Maintenant le monde est révolté
Car Dr King n’est plus.
© Jazz Hot 2020
|

I Called Him Morgan
Documentaire de Kasper Collin, produit par Kasper Collin Produktion/Submarine Deluxe/Film Rise, 92 min., 2016, Suède-USA, en version originale sous-titrée, sorti le 27 juillet 2017 sur Netflix
https://www.imdb.com/title/tt4170344
Bande annonce: https://www.youtube.com/watch?v=yxLByThNvWU
La récente disparition de Jymie Merritt (1926-2020, voir nos «Tears»), qui fut le contrebassiste de Lee Morgan (1938-1972, Jazz Hot Spécial 2006), est l’occasion de revenir sur le documentaire I Called him Morgan dans lequel il intervient: un drame shakespearien qui se déroule entre le fleuve Hudson et l’East River. Une tragédie qui mène Lee Morgan, trompettiste surdoué, à une fin violente et prématurée, à seulement 33 ans. Ce long-métrage haletant est construit uniquement sur les récits des protagonistes et témoins directs, essentiellement des musiciens et des proches, dont le principal —autour duquel s’est bâti le film et qui nous est parvenu de façon quasi miraculeuse– est celui d’Helen More-Morgan, l’épouse de Lee, auteur des coups de feu qui le blessèrent mortellement dans la nuit du 18 au 19 février 1972.
Les circonstances ayant permis le recueil de sa parole sont une histoire dans l’histoire. On doit ce précieux témoignage à un jeune professeur, Larry Reni Thomas qui donne des cours sur les civilisations anciennes à des adultes dans un lycée de Wilmington, en Caroline-du-Nord, à la fin des années 1980. Parmi eux, une dame, d’une soixantaine d’années, qui n’a semble-t-il pas suivi de grandes études mais d’une grande vivacité d’esprit. Celle-ci lui apprend, alors qu’il se présente à elle comme étant aussi animateur de radio jazz, qu’elle est la femme de Lee Morgan, celle-là même dont tout admirateur du trompettiste connaît la terrible responsabilité. Larry Reni Thomas propose à Helen Morgan de l’interviewer. Mais ce n’est que huit ans plus tard, à sa propre demande, que le professeur et présentateur pourra enregistrer son récit de vie sur une cassette audio. L’interview se déroule en février 1996. Hélène décèdera en mars.
Vingt ans après, le réalisateur suédois et amateur de jazz –déjà auteur d’un My Name Is Albert Ayler en 2006– Kasper Collin (né en 1972), nous fait revivre l’histoire de ce couple qui ne réchappe pas des terribles épreuves individuelles traversées avant même de se former. Née en 1926 dans une zone rurale de la Caroline-du-Nord, Helen a un premier enfant dès 13 ans, puis un second l’année suivante. Déterminée à vivre une autre vie, elle abandonne la garde de sa progéniture non désirée à ses grands-parents et s’installe en ville, à Wilmington, NC. A 17 ans, elle épouse un homme de deux fois son âge (rencontré la semaine précédente!), mais qui meurt noyé. Helen s’installe alors à proximité de sa belle-famille, à New York. Avec autant d’énergie que de débrouillardise, elle y fait sa place. Elle se construit une vie de femme indépendante qui fréquente qui lui plaît et fait ce qu’elle veut; ce qui ne l’empêche pas de renouer avec son fils aîné, Al Harrisson, qu’on entend également dans le film, qui vient la trouver à 21 ans. En outre, le monde du jazz l’attire: elle fréquente les clubs et les jam-sessions. Cuisinière hors-pair, elle tient salon et table ouverte dans son petit appartement, au sud de Central Park, près du Birdland, où les amis –et notamment les musiciens– se succèdent, persuadés de l’excellence du gueuleton, alors que leur pitance n’est pas toujours assurée.
C’est ainsi que Lee Morgan se retrouve au domicile d’Helen More un soir d’hiver, en 1967. Le jeune prodige de Philadelphie, qui a déjà à son actif une brillante carrière de sideman et de leader1, est en plein déshérence, rongé par la drogue. Il a mis son manteau au clou pour se payer une dose, ne travaille plus. Helen tombe amoureuse de Lee, qui a à peu près l’âge de son fils, et le prend en charge. Ils emménagent dans le Bronx, loin des autres musiciens; Helen l’envoie en cure de désintoxication, le remet au travail. Elle est sa femme; c’est un mariage de fait, sans officialisation institutionnelle. Elle est sa confidente, son infirmière, sa gouvernante et son manager, prenant aussi la direction de ses affaires: c’est elle qui signe les contrats et organise tout. Lee revient à la vie et au firmament du jazz. Il s’investit, à l’initiative de son ami, le contrebassiste Paul West, dans la transmission vers les jeunes musiciens, lui-même se sentant très reconnaissant de l’enseignement des Anciens au sein du Jazzmobile Workshop. Il s’implique politiquement dans la lutte pour les Droits civiques2. Le couple connaît une période de bonheur; Lee compose pour sa femme «Helen’s Ritual»3. Mais Lee demeure une personnalité fragile. Il est toujours dépendant de la drogue et peut-être aussi étouffé par l’amour trop «maternel» d’Helen. Il entame une liaison avec une amie de jeunesse, Judith Johnson qui livre aussi sa version des faits dans le documentaire. Le drame survient le soir du 18 février 1972: Lee Morgan est programmé avec son groupe au Slugs’ Saloon, dans l’East Village. New York est prise dans une tempête de neige et Lee a failli ne pas arriver; il a eu un accident de voiture avec Judith sur le chemin. Helen a décidé de venir ce soir-là, et une altercation éclate entre les trois protagonistes. Lee met Helen dehors, mais elle revient à l’intérieur un pistolet à la main, celui que Lee lui a donné, elle tire. Lee meurt le matin du 19 février de l’arrivée trop tardive de l’ambulance bloquée par la neige.
Plaidant coupable, Helen Morgan écope d’une courte peine. Quelques années plus tard, elle quitte New York pour revenir à Wilmington. Là, elle s’investit au sein de l’église de quartier pour aider les autres. Toujours pleine de ressources, elle devient une personnalité de premier plan au sein de la communauté. Parmi les prises de paroles à la fois drôles, touchantes, extrêmement précises et sensibles des musiciens –Billy Harper, Jymie Merritt, Bennie Maupin, Wayne Shorter, Charli Persip, Tootie Heath, Larry Ridley–, qui chacune éclairent le parcours de Lee Morgan et la vie de couple avec Helen, l’intervention finale de Paul West livre la conclusion de ce drame: «J’étais fâché contre elle. C’était ma première réaction, la haine. J’étais fâché contre elle d’avoir commis cet acte sur quelqu’un que je considérais comme un ami, quelqu’un qui a tellement contribué à notre musique dans sa courte vie. (…) Cela dit, je ressentais de la compassion. Parce que j’avais conscience que c’était cette femme qui avait littéralement sorti cet homme du caniveau. (…) Et c’est elle qui lui a permis de redevenir un artiste, un être humain.»
I Called him Morgan est l’inéluctable tragédie de deux vies difficiles, de deux fortes personnalités sur fond de jazz, de vie nocturne et d'intensité des sentiments. C'est aussi et surtout le portrait, remarquablement porté à l'écran, d'une femme qui a forgé sa destinée par sa seule volonté, et a passé la majeure partie de sa vie à exercer des solidarités de proximité avec autant d'énergie que d'intelligence.
Jérôme Partage
1. Originaire de Philadelphie (un creuset qui restera très présent dans son parcours par le choix de ses partenaires), Lee Morgan s’est imposé par une maturité musicale exceptionnelle, dès l’âge de 18 ans, d’abord dans le big band de Dizzy Gillespie (1956-58), puis au sein des Jazz Messengers d’Art Blakey (1958-61, puis 1964-65). Parallèlement, il commence à enregistrer sous son nom pour le label Blue Note dès 1956. Le gamin talentueux et insouciant qui –à l’image de ses copains, dont Charli Persip qui évoque son souvenir dans le documentaire– aime les habits à la mode, les voitures et les jolies filles, commence à consommer de l’héroïne durant son premier passage chez les Messengers et doit quitter le groupe (ainsi que le pianiste Bobby Timmons) en 1961, épuisé par la drogue. Il se met alors en retrait durant près de deux ans, retournant à Philadelphie, période durant laquelle il tente, semble-t-il, de «décrocher». Il opère un retour en force en décembre 1963 en enregistrant un disque majeur, The Sindewinder (Blue Note). Mais alors qu’il a débuté une seconde carrière où se manifeste un formidable renouvellement artistique, Lee Morgan est rattrapé par ses démons (à la suite d’une overdose, il se brûle même gravement à la tête en tombant inconscient contre un radiateur), lesquels l'ont de nouveau mis en marge de la scène jazz lorsqu'il rencontre Helen More en 1967. Voir sa biographie et discographie détaillée dans le Jazz Hot Special 2006.
2. Jymie Merritt compose à sa demande le titre «Angela», en hommage à Angela Davis, qui figure sur son ultime enregistrement du 28 janvier 1972 (We Remember You, voir chronique dans Jazz Hot n°490-1992):
https://www.youtube.com/watch?v=P4XYhNr4RVo
3. Ce titre apparaît dans l’album Caramba (1968, Blue Note).
© Jazz Hot 2020
|

En Política
En Politique
Documentaire
de Jean-Gabriel Tregoat et Penda Houzangbe, produit par petit à
petit production, DHR/AVIFCinemas, Vosges Télévision, 2018, 107mn, France,sortie le 18 mars 2020
Ce documentaire
(le second de ce tandem) est tourné dans les Asturies (nord-ouest de
l’Espagne), à l’occasion des élections «autonomiques» (dans les communautés autonomes) de 2015, mais
impressionne d’emblée par sa portée universelle et intemporelle (depuis l’Antiquité) de toute situation où de
nouveaux venus en politique institutionnelle –là au Parlement des Asturies–
même rompus au militantisme actif moderne, se retrouvent à négocier ferme,
surtout avec eux-mêmes, pour savoir jusqu’où ne pas aller pour ne pas se corrompre,
ne pas renier son programme ni trahir l’électorat, et arriver à cibler
l’objectif essentiel: obtenir des contreparties incertaines dans des
marchandages pour commencer à peser, mais avec le risque de compromission, ou préserver
l’intégrité pour tenter de gagner les élections suivantes afin de vraiment
changer la façon de faire de la politique.
Le film ouvre sur une partie de
football métaphorique présentant les protagonistes, leur engagement, la solidarité,
les aléas de la vie publique et suit les partisans de Podemos dans leurs échanges avec des électeurs, avec les
questions toujours pendantes: «Comment
trouver de la crédibilité quand on n’a jamais été élu, et une fois élue, que
faire pour la gauche (disloquée) quand elle arrive au pouvoir, même
numériquement majoritaire, si un de ses partis s’est déjà discrédité dans des
liaisons dangereuses?»
Les ressorts dramatiques, du fait des enjeux réels pour
la population luttant avec très peu d’atouts contre les dégâts de la crise de
2008 (en Espagne, la tension politique est restée palpable depuis 1937), vient
aussi du travail imaginatif de construction narrative pour donner à «tout»
voir dans un éventail de nuances très ouvert, de la voix off d’un journaliste imaginaire qui observe, renseigne le spectateur sur des éléments rajoutant de la
complexité, aux débats tous azimuts, internes, entre partis, au
sein du Parlement, voire avec d’anciens camarades «de la rue», en
passant par les incontournables tweets qui montrent l’effet délétère de ce type
de communication instantanée.
Au fil de la crise financière qui a tout
contaminé jusqu’aux comportements des individus dans ce chaos régressif, plusieurs
réalisateurs œuvrent pour dégager des pistes de réflexions sur nos temps
modernes de régression sociale, moins poétique que chez Charlot, des Mille et Une Nuits de Miguel Gomes (2015, 3 parties) dont l’imaginaire
débridé porte la misérable réalité du Portugal,
à J’veux du soleil (2019, 76mn), road movie de Gilles Perret et François
Ruffin sur l’épisode des
Gilets Jaunes en France, en passant par Adults
in the Room (2015, 124 mn) de Costa Gravas,
retraçant l’autre facette de l’Europe mettant à genou la Grèce. Le combat, les
espoirs et la dynamique politique pour «l’après» sont des thèmes de
prédilections pour les réalisateurs de documentaires et de fictions depuis
toujours, avec sans doute la prime au néo-réalisme italien dont le Nous nous sommes tant aimés d’Ettore
Scola (1974, 124 mn) restera un chef d’œuvre aigre-doux d’analyse sociale et
politique sur le «avant, après». De l’autre côté de l’Atlantique,
la tension dans le berceau du jazz qui aurait
pu être le «nouveau» monde en 1776, puis en 1865, puis en 1964,
vient de cette difficulté à penser cet «après» démocratique, sans
rapport de domination. En Política continue cette tradition d’analyse approfondie des mécanismes de pouvoir et des
possibilités de le morceler, de l’équilibrer, de le partager, indispensable
pour la démocratie actuellement en péril dans la mondialisation, donc aussi en
Europe, car lorsque le minimum de sécurité vitale n’est plus assuré, l’individu
n’a plus l’esprit à réfléchir «l’après» avec d’autres, il se
concentre sur sa propre survie, son espace mental rétrécit, et le contrat
social, porté à bout de textes par nos philosophes des Lumières, vole en
éclats. Rendez-vous au cinéma le 18 mars, comme pour fêter l’anniversaire du
début de la Commune de Paris en 1871, une xième période de l’histoire qui a
rêvé l’«après».
|
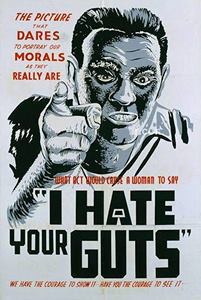
I Hate Your Guts / The Intruder
Film de Roger Corman (5 avril 1926, Détroit, MI), produit par Gene (24
septembre 1927, Détroit, MI) et Roger Corman, Los Altos Productions 1961, 80mn,
USA, musique Herman Stein (1915-2007), avec William Shatner, Frank Maxwell,
Charles Barnes, Leo Gordon
(disponible sur Arte.tv jusqu'au 16 mai 2020).
https://www.youtube.com/watch?v=ijFwO0iuIeY(bande annonce)
https://www.youtube.com/watch?v=zwgMuDQzm2I (film complet en VO non sous-titré)
https://www.imdb.com/title/tt0055019/fullcredits/?ref_=tt_ov_st_sm
Ce film s’inspire,
en 1961, des événements de Little Rocks, AR, en 19571, d’une actualité encore
brûlante, puisque l’année qui précède le tournage, des élèves afro-américains
n’avaient encore pas pu intégrer le lycée de Sikeston, MO, où la production du
film plante son décor pendant trois semaines très inquiétantes pour tous.
Autant dire que la tension n’a pas besoin d’être feinte puisque la force de
cette fiction réside dans la réalité de la ségrégation vécue au jour le jour,
celle qu’on ne peut pas simuler, la peur réelle au fond des yeux qui ne peut
être «jouée», qui transpire sur la peau, la haine des dominants
pathologiques dans les sourires carnassiers, les rires vulgaires, dans la
méchanceté qui dispute la galerie de portraits au crétinisme clinique.
Comme
pour ses autres films, Roger Corman, a l’efficacité de sa formation
d’ingénieur
et le talent des dramaturges antiques: pas un mot ni une expression
fugace inutile, la foule raciste est recrutée sur place et n’a pas
besoin de
«formation» dramatique car elle est «parfaite» dans le
rôle; la musique est d’une implacable pesanteur malsaine sauf dans trois
scènes
où des airs parkériens aèrent un peu l’atmosphère; rien n’est laissé au
hasard, toutes les idées sont exploitées jusqu’à la corde (sans jeu de
mots). Les
problématiques abordées sont le drame américain, du racisme dans toutes
ses dimensions à la loi du plus fort classique (argent, sexe, âge,
corruption, armes,
attentats), en passant par le péril rouge (judéo-communiste pour être
précis). Le proviseur du lycée est campé par
Charles Beaumont, l’écrivain du roman dont il a tiré lui-même aussi le
scénario
pour le film2. Tout est en place pour régler son compte au Sud profond.
Est-il besoin de rajouter
qu’en 1960, Gene Corman, le frère cadet coproducteur du film, travaille avec
Harry Belafonte (l’infatigable activiste grand argentier pour le Mouvement des
droits civiques, encore aux côtés de Spike Lee en 2018 dans BlacKKKlansman) sur le disque My Lord What a Mornin’3 dont le
livret est écrit par Langston Hughes (1902-1967), le poète de la Harlem
Renaissance poursuivi pour communisme, et qui a vécu à Paris, comme Roger Corman,
25 ans plus tard. Car dans l’Amérique de la chasse aux sorcières, l’espace
rétrécit tant que les courageux se connaissent, se soutiennent, même s’ils
pensent différemment, le propre de la démocratie pour ceux qui la pratiquent.
A
propos de courage, le titre initial I
Hate our Guts est de loin le meilleur car le film s’attache à faire la
«gamme Pantone» de toutes les formes de lâchetés et de
«tripes» (guts)
justement, de l’individu à la foule, de celui qui croit être un grand homme (le
rôle de L’Intrus, titre resté au film
pour la postérité), en fait un nazillon à la petite semaine qui hait ceux qui
ont du courage, à celui qui est bien dans sa peau, voudrait vivre en paix, avec
la modestie de son métier de camelot-vendeur-bonimenteur mais seul fin
psychologue pour pouvoir rétablir le contrat social en douceur dans un pays explosif.
Il y a aussi le
journaliste qui va d’abord se soumettre à son actionnaire-potentat local, avant
d’arriver à comprendre ce qu’il doit faire en conscience contre la ségrégation
et de le payer le prix fort. La partition des femmes du film est aussi large et
souvent même plus complexe.
Enfin, la palme du courage et de la maturité
revient à Joey, l’élève qui va s’avancer «dans la vallée de la
mort», scène qui rappelle Marlon Brando, encore un soutien de Martin Luther King, dans son martyre Sur les Quais d’Elia Kazan (1954), vallée où son révérend vient de laisser la vie lors de l’explosion de son église, scène
prémonitoire de la réalité de cet attentat du 15 septembre 1963 dans
une église de Birmingham en Alabama qui tua 4 jeunes filles et en blessa
22 autres, connue des amateurs de jazz par l’émouvante composition «Alabama» de John Coltrane, autre soutien de Martin Luther King.
Lorsqu’on
voit la perfection de ce film à petit budget,
dans un cadrage et une photo magnifiques en noir et blanc, théâtral
comme un drame antique, avec une narration et une analyse aussi aboutie,
on se demande comment le cinéma dépense souvent autant d’argent pour ne
rien dire. A ne rater sous aucun prétexte.
|

LA LONGUE MARCHE VERS L’ÉGALITÉ
UN BLUES SANS FIN
«Vos armes sont les mots» (The Great Debaters)
A
propos de plusieurs films récemment diffusés sur différentes chaînes de
télévision, sur le grand écran des salles de cinéma et disponibles le
plus souvent en DVD: Green Book, Selma, The Great Debaters, Lee Daniels’ The Butler, Ray, King: de Montgomery à Memphis, Detroit, Miracle at St. Anna, I Am Not Your Negro. Quatre de ces films ont déjà fait l'objet de chroniques dans ces colonnes (Detroit, Ray, Green Book, King), et quatre autres (Selma, The Great Debaters, Lee Daniels' The Butler, I Am Not Your Negro) sont chroniqués ci-dessous après le texte d'introduction…
«Ma mère venait d’un milieu très modeste
et elle en avait gardé les habitudes. Plus jeune, elle lavait le linge
de familles blanches, pour quelques cents. Et si le travail ne leur
allait pas, les gens lui jetaient le linge à la figure pour qu’elle
recommence. Vous pouvez vous faire une idée de ce qu’était sa vie quand
vous voyez la mère de Ray Charles dans le film Ray (1). J’ai pleuré
quand j’ai vu ce film… Toujours est-il que lorsque mon père a fait
fortune, il a engagé une bonne. Ma mère l’a renvoyée! Elle ne voulait
pas que quelqu’un d’autre s’occupe de la maison.» Mighty Mo Rodgers, Jazz Hot n°684, été 2018
Dans son livre Le diable trouve à faire (The Devil Finds Work:
The Dial Press 1976, New York, France: Capricci 2018, traduction
Pauline Soulat) James Baldwin (1924, Harlem NYC-1987, St-Paul-de-Vence)
donne «sa» lecture, au travers de «son» expérience afro-américaine de la
réalité, de films «classiques» qui, pour différentes raisons, l’ont
interpellé, qu’il s’y retrouve ou, le plus souvent, qu’il ne s’y
retrouve pas du tout. Il précise alors en quoi ces films constituent une
déstabilisation, une violence, une modification –voire une dégradation–
de l’image de soi par le fait de subir la perception erronée des
autres, allant jusqu’au dégoût de soi découlant du simple regard de
«l’autre»; il s’agit des deux niveaux d’expériences entre deux
populations au sein d’une même nation –les Etats-Unis– (la condition des
femmes étant un autre niveau d’expérience) que James Baldwin met en
évidence par des extraits commentés de films. Textes et films sont
également repris dans le documentaire de Raoul Peck Je ne suis pas votre nègre (I Am Not Your Negro).
Selma, The Great Debaters, Green Book (8), Lee Daniels’ The Butler, comme Ray (1), King, de Montgomery à Memphis (2), Detroit (3), Miracle à Santa Anna (4), ont précisément en commun de proposer une perception alternative
de ce deuxième niveau d’expérience, théorisé par James Baldwin dans I Am Not Your Negro,
titre d’un documentaire qui vaut par la présence, l’intelligence et la
voix de James Baldwin, de revisiter le langage cinématographique
dominant, qu’il soit consensuel ou critique, avec d’autres yeux,
d’autres points de vue.
En effet, pour combattre le révisionnisme ambiant (la propension
systématisée actuelle à réécrire l’histoire en fonction de la
conjoncture, des intérêts du moment, y compris des documentaristes),
autant que pour tenter le plus honnêtement possible l’aventure
démocratique, il est indispensable, vital, de croiser les perceptions,
les expériences de vie. Car celui qui profite d’un privilège, activement
en l’acceptant ou passivement ou encore en le contestant parce que
c’est simplement une réalité installée de longue date (l’homme par
rapport à la femme, la majorité religieuse ou ethnique par rapport à la
minorité, le riche par rapport au pauvre, le valide par rapport au
handicapé, etc.) a rarement la bonne foi d’admettre l’étendue de
l’inhumanité de la condition de ceux-celles qui sont soumis(es). Parce
que cela constituerait une «faiblesse» dans le rapport de domination
qui, seul, l’anime vis-à-vis de l’autre pour les actifs, par simple
préservation du confort autant qu’inconscience pour la plupart, et pour
les plus ouverts parce que n’ayant pas conscience de l’autre niveau
d’expérience, il est difficile d’en saisir les conséquences au fond de
soi, donc d’en envisager le caractère insupportable.
Ainsi, dans Selma qui relate la grande marche pour les Droits
civiques à laquelle se joignit Martin Luther King, ou dans les
entretiens et les rencontres relatés dans I Am Not Your Negro par
James Baldwin, dès qu’une avancée démocratique au nom de l’humanisme le
plus essentiel doit être concédée par le pouvoir, sous la pression de
ceux qui luttent, pour aller vers l’égalité et l’équité (l’absolu de la
justice), ce n’est jamais possible «ici et maintenant» sans contrepartie
pour le dominant, invalidant et pervertissant l’avancée elle-même par
une concession contradictoire: chaque pénible pas franchi vers la
dignité ne l’est qu’obtenu de très haute lutte, et après beaucoup de
violences pour ternir l’image de ces luttes exemplaires et justifier une
contrepartie. D’où la tension extrême et les émeutes inflammables entre
communautés aux Etats-Unis où le pouvoir et l’argent ont toujours été
les références de réussite, où la charité ne supporte pas la solidarité
et la conquête sociale.
Avec d’autres films comme La Couleur des sentiments (5), La Couleur pourpre (6), Colère en Louisiane (7), Une Saison blanche et sèche (9), Mississippi Burning (10), le cinéma de Spike Lee dans son ensemble, ces films et
documentaires sont donc des contributions salutaires à une
reconstruction mentale souhaitable du monde qui s’incarne avec les
langues parlées, les dialectes, par les accents, dans les gestes, les
expressions, les regards, les intonations, les références, les codes
culturels, les préjugés de l’éducation selon le temps et le lieu. Mais
il faudra encore beaucoup de temps, de livres, de scénarios, de films,
de documentaires, pour rééquilibrer, contrebalancer et finalement
enrichir la production existante, déjà écrite, filmée, et surtout gravée
dans notre inconscient collectif comme sur un microsillon, et qui
véhicule le rapport de domination en technicolors.
Si on peut écrire ça à propos de la réalité afro-américaine, cela
vaut aussi pour d’autres minorités et pour les femmes –qui sont plus de
la moitié de l’humanité– comme l’expliquaient clairement Claude McKay
(1889-1948) dans «Un sacré bout de chemin» (A Long Way from Home, 1937, traduit par Michel Fabre, Editions André Dimanche-Marseille 2001: «… pour chaque changement … en direction d’une égalité, les femmes devront se battre en tant que femmes.» page 367), Chester Himes (1909-1984, La Croisade de Lee Gordon)
ou James Baldwin (1924-1987) qui ciblent dans leurs ouvrages les dégâts
irréversibles sur les plans humains, sociaux, psychologiques mais aussi
artistiques et économiques, engendrés par le rapport de domination qui
contrevient au besoin fondamental d’égalité sans lequel il n’est pas
possible, sauf pour les démagogues, de parler de justice, de liberté, de
fraternité ou de démocratie.
Car ces dégâts irréversibles s’aggravent au fil du temps, deviennent
plus complexes, plus pervers, le compteur tourne et le cumul augmente.
Martin Luther King avait une conscience aigue de cette urgence: «Nous ne pouvons plus attendre… car il est temps d’encaisser notre chèque de retard.»
Quand le révérend-prêcheur fait place au révolutionnaire social, même
non violent, son propos devient insupportable pour les dominants: il a
toujours su qu’il en paierait le prix de sa vie comme cela apparaît dans
le film Selma et dans le documentaire King. Un autre fin
connaisseur des rapports corrompus de domination, Rudyard Kipling
(1865-1936) dans la société anglo-indienne à la charnière XIXe-XXe
siècles, avait très tôt formalisé cette inévitable «comptabilité»en
écrivant cet aphorisme: «Rien n’est réglé tant que tout n’est pas complètement et équitablement réglé».
Si les dominants se
rassurent, corruption et démagogie aidant, dans la période de régression
que nous traversons en ce début de XXIe siècle (accroissement de toutes
les inégalités, disparition des libertés fondamentales), et si la
planète, pas plus que les Afro-Américains ou les femmes, ne prennent le
chemin de régler leurs comptes en dépit d’une propagande malsaine et
perverse, ces films et ces documentaires, parmi quelques autres, ont
choisi de ne pas occulter la réalité et proposent une autre vision de
l’humanité…
Hélène et Yves Sportis
© Jazz Hot 2020
1. Ray, de Taylor Hackford, musique Ray Charles, Craig Armstrong, 152mn, 2004, USA
https://www.imdb.com/title/tt0350258/reference
https://www.youtube.com/watch?v=jVHCQfcugdw
2. The Martin Luther King Film Project (King, de Montgomery à Memphis),
d’Ely Landau et Richard Kaplan, avec la participation de Joseph
Mankiewicz et Sidney Lumet, Prod. Kino Lorber/Library of Congress,
175mn,1970, USA, dist. France 2016 par ZED (www.zed.fr)
https://www.jazzhot.net/PBCPPlayer.asp?ID=1864865
https://www.youtube.com/watch?v=-WN1_EEqRpg
https://www.imdb.com/title/tt0065944/
3. Detroit, de Kathryn Bigelow, 143mn, 2017, USA
https://jazzhot.oxatis.com/PBCPPlayer.asp?ID=2027123#Detroit
https://www.youtube.com/watch?v=OAigWWYe1TE
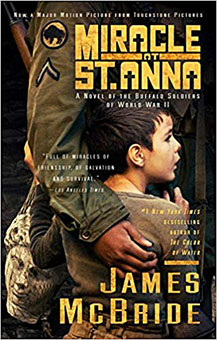 4. Miracle at St. Anna (Miracle à Santa Anna), de Spike Lee, musique de Terence Blanchard, 160mn, 2008, Usa-Italie 4. Miracle at St. Anna (Miracle à Santa Anna), de Spike Lee, musique de Terence Blanchard, 160mn, 2008, Usa-Italie
https://www.imdb.com/title/tt1046997/
https://www.youtube.com/watch?v=OxZ9NK1YDD4
5. The Help (La couleur des sentiments), de Tate Taylor, d’après Kathryn Stockett, 146mn, musique Thomas Newman, 2011, USA
https://www.imdb.com/title/tt1454029/fullcredits/?ref_=tt_ov_st_sm
https://www.youtube.com/watch?v=2-aolLbrH8k
6. La Couleur pourpre (The Color Purple), de Steven Spielberg, d’après Alice Walker, Prix Pulitzer 1983, 154mn, musique Quincy Jones, 1985, USA
https://www.imdb.com/title/tt0088939/fullcredits/?ref_=tt_ov_st_sm
https://www.youtube.com/watch?v=6_OgJ7hB8TE
7. A Gathering of Old Men (Colère en Louisiane), de Volker Schlöndorff d’après Ernest Gaines, 91mn, musique Ron Carter, 1987, USA-RFA
https://www.imdb.com/title/tt0093076/releaseinfo
8. Green Book, de Peter Farrelly, 130mn, musique Kris Bowers, 2018, USA
https://jazzhot.oxatis.com/PBCPPlayer.asp?ID=2027123#GreenBook
https://www.youtube.com/watch?v=vDFnYOOovp8&list=PLszdKGvlcAUeSOb8fq-BMDSk0Zly4rZVN&index=1
9. A Dry White Season (Une saison blanche et sèche), d’Euzhan Palcy, d’après André P.Brink, 97mn, musique de Dave Grusin, 1989, USA
https://www.imdb.com/title/tt0097243/fullcredits/?ref_=tt_ov_st_sm
https://www.youtube.com/watch?v=u3bw7yZmtGI
10. Mississippi Burning, d’Alan Parker, d’après des faits lors du Freedom Summer de 1964, 128mn, musique de Trevor Jones, 1988, USA
https://www.imdb.com/title/tt0095647/fullcredits
https://www.youtube.com/watch?v=987lXKJqHbY
*

SELMA
Selma, film, Ava DuVernay, 2014, 128mn, Cloud Eight Films/Harpo Films/Pathé/Plan B Entertainment, USA/Royaume-Uni
Selma
parle de l’impossibilité pour un Afro-Américain en 1965 (population
majoritaire en Alabama) de s’inscrire pour voter, malgré le 15e
amendement de la Constitution des Etats-Unis ratifié en 1870 qui
garantit le droit de vote aux Afro-Américains. Il s’agit donc d’un combat
d’arrière-garde ségrégationniste, en réaction directe au Civil Rights Act de
1964 du 3 juillet 1964 (la discrimination est illégale). L’angle
particulier de la réalisatrice Ava DuVernay est de faire entrer le
spectateur dans le détail concret et pratique des vies, pensées, débats
juridiques et politiques qui se croisent, aussi à l’intérieur du
Mouvement des Droits Civiques, aussi entre femmes et hommes, au travers
de personnages, soit historiques comme Martin Luther King et ceux qui
les entourent –famille, amis, opposants–, soit inconnus dans leurs
quotidiens heurtés de ce début d’année 1965.
Ils vont former,
ensemble, les marches (février-mars) de ceux qui se sont impliqués dans
la réflexion, l’organisation, la participation et le partage
d'expériences antérieures (depuis décembre 1955, «Montgomery-Rosa
Parks», donc depuis dix ans de luttes «non-violentes» mais violentes
dans la réalité des faits et des pouvoirs) pour la mise en place de
stratégies, d’action ou d’attente, en fonction de l’autocrate local, de
l’évaluation de la prise de risque sur les vies des non-violents, en
fonction de l’impact médiatico-politique intérieur et international, des
négociations en cours avec le pouvoir fédéral lui-même ferraillant avec
d'autres pouvoirs –locaux, FBI de J.E. Hoover, mafias, économiques–, de
la prison injustifiée, des pressions entre opinions publiques, de
l’impact de la religion, des moyens matériels ou de temps nécessaires de
formation à la non-violence, de la fatigue et de la lassitude, autant
de facteurs aléatoires et combinables pour arriver à inverser le rapport
de force.
L’expérience est terrible physiquement et en tensions extrêmes,
émotionnellement, mais la marche va jusqu’à Montgomery et obligera à
voter un nouveau texte de loi, le Voting Right Act (Loi du 6 août 1965), très contraignant, pour obliger les dominants
historiques au moins à respecter la Constitution de l'Union. Un chemin
effroyable, à marche forcée, la peur au ventre, car le retour en arrière
n’est plus possible; un chemin qui dévoile sans détours les raisons et
conditions de l’assassinat ultérieur de Martin Luther King en 1968.
• Martin Luther King, Autobiographie, Textes réunis par Clayborne Carson, 2017
https://jazzhot.oxatis.com/PBCPPlayer.asp?ID=2027125#Luther
• 28 Mars 1963, I Have a Dream, un rêve d'égalité: Retour sur le discours de Martin Luther King, Jr. (Jazz Hot n°665, 2013)
*
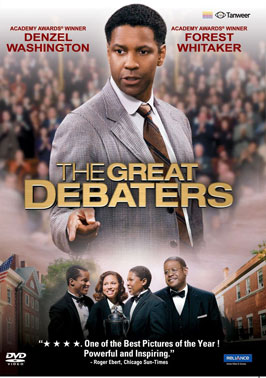
THE GREAT DEBATERS
LE GRAND DÉBAT
The Great Debaters (Le grand débat), Film, Denzel Washington, 2007, prod. Denzel Washington, 126mn, USA
Melvin
Beaunorus Tolson (dans la vraie vie 1898-1966), un enfant de la Harlem
Renaissance (selon Alain LeRoy Locke sur l’impérative nécessité pour les
Afro-Américains d’être éduqués pour faire valoir leurs talents: The New Negro,
1925), éduqué, diplômé, poète, explique à ses élèves l’importance de
maîtriser parfaitement l’art du discours : le langage et l’organisation
de la pensée.
Le spectateur est transporté au Wiley College
«réservé» aux élèves afro-américains à Marshall au Texas (Etat du Sud),
en plein désastre humain suite à la Crise de 1929, dans une atmosphère
irrespirable de ségrégation et de lynchage. Le défi du film est de
progressivement faire se concentrer l’attention sur l'importance d'un
entrainement «au débat», malgré et en raison-même de l’environnement
délétère, de montrer la confrontation de ces jeunes apprenants, au
langage châtié et à la pensée structurée, à leur soumission à des
racistes au vocabulaire limité mais détenteurs puisque blancs du pouvoir
«légitime» de vie et de mort: un renversement de situation qui fait
également la part belle à une élève qui amène ses outils alternatifs à l’équipe masculine. Une phrase revient en riff pendant tout le film: «à une loi injuste nul n’est tenu d'obéir»
mantra de Saint Augustin, philosophe chrétien-berbère d’Algérie qui, en
matière de loi «injuste», avait eu le loisir de faire le tour de la
question. Le film, grâce à la licence permise à toute œuvre, pousse
l’expérience jusqu’à faire débattre et gagner l’équipe de Wiley contre
Harvard, université wasp (white anglo-saxon protestant)
par excellence, au prix d'un travail acharné sur des années mais qui
fait sens, y compris et surtout psychologiquement, pour acquérir les
codes et le mental d’«égaux», la force de ne plus se soumettre. Le
professeur ne craint pas non plus d’aller «éduquer» les fermiers la nuit
pour qu’ils s’organisent et se défendent, quels que soient les risques
vitaux encourus.
L’image
de soi, le courage de transformer en discours de combat, de mise en
accusation de la société, un exercice à l’origine formel et de formation
au pouvoir arbitraire des élites, juste pour le besoin d'excitation
d’une société qui ne jure que par la rivalité et l'inégalité qu'elle
doit générer, sont au cœur du film: ce sont les deux niveaux
d’expériences mis en évidence par James Baldwin, entre ceux qui se
battent pour écraser les autres (plus ou moins consciemment), et ceux
obligés de se battre pour ne pas mourir, qui réinventent une alternative
solidaire autant par nécessité vitale que par culture. C'est aussi
l'histoire et le fondement du jazz.
*
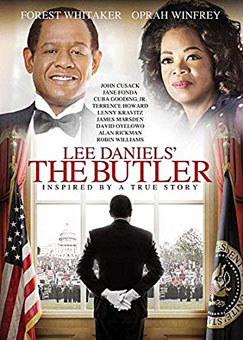
LEE DANIELS’ THE BUTLER
LE MAJORDOME
Lee Daniels’ The Butler (Le Majordome), Film, Lee Daniels, 132mn, 2013, Laura Ziskin Productions et Windy Hill Pictures, USA
Le
scénario, inspiré d’une histoire vraie, a le mérite de passer en revue
une grande partie des culpabilités de l’Amérique: la maltraitance, le
viol, le meurtre, l’exploitation, les injustices de toutes natures,
toutes liés à la ségrégation érigée en système, sur quatre générations,
et les différentes formes de résistances et aptitudes que les
Afro-Américains ont dû développer face à cette violence récurrente pour
survivre et se réinventer, de l’observation méfiante des maîtres pour
éviter que les situations ne dégénèrent, à l’évasion, en passant par
l’action politique des Black Panthers, la fonction armée et violente ou
les mouvements pour les droits civiques de non-violents.
Parti de
sa Géorgie natale, le Majordome finira par travailler 30 ans à la
Maison Blanche et, une fois à la retraite, y sera reçu en tant qu’hôte
de marque du nouveau Président Obama. La succession des Présidents
américains est une galerie de sept portraits peu recommandables, quelles
que soient les apparences qu’ils veulent donner, ou parfois ne veulent
même plus se donner la peine de sauver. Le père et le fils, par la
distance de leur condition, de leur vécu, de leur différence de ressenti
à la soumission, se trouvent en opposition, conflit symbolique fort qui
décrit les débats internes à la société afro-américaine, pour décrypter
comment le pouvoir blanc peut y compris se servir de ses serviteurs
noirs «qui se tiennent bien»
comme répond, de manière prémonitoire, James Baldwin à l’évocation de la
prophétie de Robert Kennedy, qui promet un «Président noir» dans 40 ans
en 1968, qui se réalisera avec l'élection de Barack Obama. Car Barack
Obama s'est en effet «bien tenu».
La fin du film permet de rester
sur une note d’espoir –le père et le fils se réconcilient dans la lutte
solidaire pour l'égalité: le fils qui lui reste devient député, l’autre
enfant étant mort au Vietnam–, et avec la lueur de 2008 qui n’aurait pas
manqué d’être également ternie, si le bilan des deux mandats de Barak
Obama avaient été relatés, compte tenu de la dégradation
socio-économique et de sécurité des conditions de vie des
Afro-Américains depuis lors, de la dégradation de l'inconscient
collectif des Américain(e)s et sa résultante: l'élection de Donald
Trump.
Une mécanique infernale qui ressemble à l’absurde
d'Albert Camus dont personne ne sort jamais, ni les victimes, ni les
bourreaux, par la force séculaire de la reproduction du modèle social
inégalitaire à l’œuvre dans toute son inertie perverse. Même sur le plan
des relations entre les personnes (hors institutions), rien n’est
simple ni jamais acquis dans cette insécurité générale ; la survie
consiste à durer, passer les épreuves, par des moyens qui ne sont pas
enseignés dans les écoles. Chacun essaie de se frayer un chemin, à
tâtons, sans être vraiment sûr de ce qu’il fait, ni pour lui, ni pour
les autres.
*
 I AM NOT YOUR NEGRO
I AM NOT YOUR NEGRO
JE NE SUIS PAS VOTRE NÈGRE
I Am Not Your Negro (Je ne suis pas votre nègre), Film Documentaire, Raoul Peck, 2016, 93mn, Velvet Film, France/USA/Belgique/Suisse
Raoul Peck a réalisé précédemment Lumumba, inspiré de l'histoire de Patrice Lumumba (indépendance du Congo), ainsi que Le Jeune Karl Marx, sur la jeunesse de Karl Marx et Friedrich Engels en Allemagne, à Paris et à Londres. Il
a également été ministre de la Culture de la République d'Haïti de 1995
à 1997. Le cinéaste a été président de la Fémis de 2010 à 2019 (Ecole
nationale supérieure des métiers de l'image et du son, Université de
Paris).
Le
documentaire a remporté de nombreuses récompenses (Oscars 2017, César
en 2018, British Academy Film Award 2018…) et a été plébiscité par la
presse («Un film qui change la vie», selon le New York Times mis en avant par Arte pour la promotion du film). En France, le film est sorti en salles en 2017 et a été diffusé sur Arte et YouTube sous le titre français de Je ne suis pas votre nègre.
En VO, c’est l’acteur Samuel L. Jackson qui donne sa voix au texte; en
version française, c’est Joey Starr (rappeur, acteur et producteur).
Les
mots essentiels de James Baldwin, la qualité du montage et de la
recherche de Raoul Peck, dont la biographie explique en partie la
sensibilité, malgré nos quelques critiques, font de ce documentaire une
belle réussite, un indispensable pour tou(te)s car c'est une grand
moment de philosophie, une leçon de vie, exprimés par James Baldwin avec
des mots sincères, directs, clairs et précis totalement dénués de
pédanterie, de la perversité, du conformisme et de la bien-pensance
d'aujourd'hui; un message particulièrement déterminant pour les amateurs
de jazz s'ils veulent approfondir leur connaissance de ce qu'est le
jazz. James Baldwin, né à Harlem, est le digne enfant de la Harlem
Renaissance, dont il porte l'universalité et l’attachement au Siècle des
Lumières. La densité de sa pensée se prête mieux au livre qu’au
documentaire, malgré le plaisir de le retrouver à formuler lui-même sa
pensée, à moins que l’on ait la volonté de réécouter de nombreuses fois
ce documentaire pour saisir toutes les nuances et articulations de
pensée…
Coproduit, conçu et réalisé par le réalisateur
haïtien Raoul Peck (Port-au-Prince, 1953), ce documentaire se fonde essentiellement sur les écrits (un
texte inachevé et inédit de James Baldwin, intitulé «Remember This House») et
la parole enregistrée et filmée de James Baldwin dans des émissions (Dick Cavett Show, 1968),
à l’occasion
de conférences dans des universités comme Cambridge, et sur des images
d’actualités de 1950 à nos jours, avec des images également de James
Baldwin en compagnie de nombreux participants de la lutte pour les civil rights (Harry Belafonte, Sidney Poitier, Marlon Brando…). Le tout est augmenté d’images d’archives
sur le mouvement des civil rights (droits civiques) et les différents mouvements de lutte des Afro-Américains, sur une musique de
fond où domine le jazz-blues malgré l’évitable Bob Dylan pour accompagner
l’assassinat de Medgar Evers, et parfois une musique dramatique grand public
comme pour l’ouverture du documentaire, quelque peu déplacée parce
que le leitmotiv de James Baldwin n’est pas la fiction mais la réalité, et que
pour un enfant de Harlem, sa réalité, c’est le jazz et le blues qui la traduisent le mieux.
A l’aide des mots de James Baldwin (1924-1987), le réalisateur met en
perspective la conquête, jamais acquise par les Afro-Américains, de l'égalité, des civils
rights promis pourtant par une constitution républicaine du
Siècle des Lumières ancienne de deux siècles, améliorée depuis par la lutte des
Afro-Américains. Le récit doit tout au
texte de James Baldwin, en projet à l’été 1979 comme expliqué dans un
courrier
du 30 juin à son éditeur, Jay Acton, sur une autre histoire des
Etats-Unis
fondée sur la lutte et les assassinats de trois militants, amis de James
Baldwin, luttant pour la cause
de l’égalité des Afro-Américains en
Amérique: Medgar Evers (membre de la National Association for the
Advancement
of Colored People, 1925-1963, assassiné dans son garage par un membre
des White
Citizens’ Council, une organisation suprémaciste); Malcolm X (1925-1965,
membre
de Nation of Islam jusqu’à 1964, puis de sa propre obédience, assassiné
par des
black muslims avec la complicité passive ou active du FBI); et Martin
Luther
King (1929-1968, assassiné par un militant suprémaciste, James Earl Ray,
thèse
parfois contestée). Comme le dit le natif de Harlem: «L’histoire des Noirs
en Amérique, c’est l’histoire de l’Amérique, et ce n’est pas une belle
histoire.»
Le film vaut d’abord et essentiellement par la
parole et les mots, puissants, précis et choisis avec scrupule, nuance
et discernement, de
James Baldwin, qui déplace l’habituelle thématique médiatique, politique
ou
universitaire de «la question noire aux Etats-Unis» vers la seule et
vraie question
qu’impose la réalité des faits: «L’inégalité dans la société américaine
est la source de violences dont sont victimes les Afro-Américains».
Derrière la redéfinition des
problèmes américains à partir de la réalité (les fantasmes du racisme
générés
par l’action des dominants) plutôt qu’à partir des victimes (les
Afro-Américains), se situe le seul avenir de la nation américaine. Plus
largement, la confrontation des vécus, du réel («les niveaux
d’expériences»), l'abandon de l'immaturité par la population blanche,
sont la
seule solution pour une future vie commune et pacifique. Par son
analyse, chirurgicale de
précision (la description très factuelle, avec des mots du quotidien, de
ce qu’est être afro-américain aux
Etats-Unis: l’inégalité, l’indignité, l'absence de liberté, la négation,
la terreur, la violence, la
mort au quotidien), James Baldwin éclaircit et intensifie (la cruauté du
réel) la
réflexion pour qui est en état de la comprendre, qui en a la volonté,
c’est-à-dire aussi de sentir dans sa chair, le caractère
insupportable de l’inégalité, la négation, l’indignité, l'absence de liberté, la terreur, la violence,
la mort au quotidien, même si James Baldwin ne se fait aucune illusion: «Certains Blancs
n’ont pas de haine pour les Noirs, ils les ignorent.»
Il raconte ainsi
l’impasse personnelle d’une rencontre amoureuse d’une jeune fille euro-américaine avec
laquelle un jeune afro-américain ne peut se montrer en public, partager la rue et le
métro, et sa découverte de l’inégalité, de la ségrégation et de la peur: «Nous avons créé une légende à partir d’un
massacre. Ça fait un choc à 6-7 ans, alors que vous admirez Gary Cooper, de
découvrir que les Indiens, c’est vous!» James Baldwin est féru de
cinéma, et
le cinéma est souvent l'illustration –c'est particulièrement bien mis en
valeur dans ce documentaire– de son analyse de la réalité de la
société américaine, pour confronter les «niveaux d'expérience» des
populations afro et euro-américaines, une confrontation qui ne se fait
pas dans la réalité dans une société ségréguée, empêchant toute prise de
conscience par absence de sensibilité, de maturité.
Il évoque les «niveaux d’expérience» (le vécu)
différents de la population euro-américaine («les Blancs») et
afro-américaines
(«les Noirs»), et de ce refus, par confort, par corruption, par
immaturité cultivée, par esprit ludique et jouissif, par boulimie
consommatrice, par
volonté donc, pour les uns de comprendre l’indignité de ce que vivent
les autres:
«Les Blancs sont devenus des monstres
moraux.» La solution, que James Baldwin propose toujours malgré son
manque
d’espoir, passe par le renoncement que s'imposeraient les
Euro-Américains eux-mêmes à cette
corruption et à cette infantilisation qui consistent à penser comme
«naturel» ou «évident» qu’un Euro-Américain
possède, en Amérique, par naissance, un statut privilégié par rapport à
un Afro-Américain. James Baldwin fait de cette impératif la seule issue
de la nation américaine, et reste toujours prudent et réaliste:
«Le pays rêve d’une solution finale.»
Ce décryptage et cette redéfinition des
questions, cette pensée alternative qui puise sa force dans la vraie vie, de James Baldwin s’étendent à toutes les réalités d’indignité et aux débats qu’elles
soulèvent partout et tout le temps. On parle en Europe, en France, en
Allemagne de la «question juive» (sous des formes très perverses encore de nos jours), quand il faudrait parler de la France,
de l’Allemagne, etc.; on parle de la «question des femmes», quand il faudrait parler des
hommes; de la «question des banlieues», «des pauvres», quand il faudrait parler
des dominants, des inégalités, des riches, etc.
Cette parole de James Baldwin est donc
lumineuse car elle éclaire d’un jour, d’un angle nouveau, et reste très
actuelle, universelle. Comme le montre en partie le documentaire par des
images des années
2010, l’Amérique n’a pas évolué sur le fond de manière positive, son
inconscient collectif reste inchangé comme l'élection de Donald Trump le
confirme. Malgré
l’ascension sociale de quelques Afro-Américains, dont le Président Obama
élu en
2008 («Si on se tient bien, on peut devenir Président»
dit James Baldwin en 1968), 50 ans après la mort de Martin Luther King, Jr.,
en 2018, la ségrégation, les
inégalités sociales, le racisme et le suprémacisme sont restés des
tares ancrées
au plus profond de l’inconscient collectif américain, et une une réalité douloureuse pour les Afro-Américains, de toutes conditions
sociales, de tous les âges, des deux sexes, sur le terrain et dans les têtes, palpable par tout visiteur
étranger, génératrices de
violences racistes et qui empêchent une solidarité de la
nation
américaine. De ce fait, la nation américaine n’existe toujours pas, et même,
l’accroissement des inégalités aux Etats-Unis et en Europe, sur le modèle
économique américain oligarchique qui accentue les inégalités, et
fondées maintenant sur le modèle communautaire religieux entériné par
les Etats
au service de l’oligarchie, génère l’apparition de fractures béantes au
sein
des sociétés en Europe, dans des nations millénaires,
similaires sans être exactement les mêmes (l’histoire
est différente) aux fractures américaines, toujours instrumentalisées
par l'ensemble des pouvoirs pour diviser les résistances (cf. le film The Butler).
Le documentaire, écrit à distance de l’auteur, 30 ans
après sa mort, pervertit parfois son objectif par volonté quelque peu forcée et anachronique de réécriture
ou d’actualisation, pas nécessaire tant la pensée de James Baldwin est limpide, universelle et éternelle. Il instrumentalise aussi par moments (rares) les mots de James Baldwin dans la version
française. Par exemple, le mot «negro» doit se traduire par «noir». Il est employé en anglais par les interlocuteurs de Baldwin ou par Baldwin lui-même même s’il en
sent le caractère insupportable et le rectifie et/ou le remplace parfois par le concept de
«l’homme noir», de «population noire ou blanche» (negro people, white people).
Il est alternativement
traduit en français par «noir» ou «nègre», avec la volonté
d’accentuer le message, car en français, les mots
ne portent pas la même connotation. Cette surcharge n’est pas
nécessaire; par exemple la question initiale de Dick Cavett à James
Baldwin: «Pourquoi les Noirs
(negroes) ne sont pas optimistes?» fait bouillir intérieurement James
Baldwin qui répond pourtant avec un sourire contrarié et une répartie cinglante:«Tant que les gens parleront de cette
manière. La question n’est pas les Noirs (negroes), ici, –et il rectifie– de l’homme noir, ici, mais le sort de ce
pays.»). La voix grave de Samuel L. Jackson avec des sous-titres plus scrupuleux plutôt que celle de Joey Starr avec une traduction contestable, aurait davantage servi l'expression par James Baldwin de l’autre «niveau d'expérience».
Dans le film, les mots du titre «I am not your negro»
n’existent pas dans
les mots de James Baldwin. Ce titre «coup de poing» peut se traduire par
«Je ne suis pas votre serviteur, anonyme», un
faux sens par rapport au message plus profond et digne de James Baldwin
(«Je suis un homme»). C'est peut-être le message de Raoul Peck pour
accentuer la puissance de son film qu'il doit à James Baldwin. Ça ne
s'imposait pas, «Je suis un homme» était tout aussi direct, «punchy» et plus proche du message universaliste de James Baldwin. Citons le
passage qui a, semble-t-il, servi
à ce titre extrapolé: «Ce que les Blancs doivent faire, c'est essayer de trouver au fond d'eux-mêmes pourquoi, tout
d'abord, il leur a été nécessaire d'avoir "un Noir”; parce que je ne suis pas "un
Noir”. Je ne suis pas "un Noir”, je suis un homme. Si je ne suis pas "un Noir”, et si
vous, les Blancs, l’avez inventé, vous devez vous demander: pourquoi?»
Cette
pensée, lumineuse, a-t-elle
besoin d'autre chose? A-t-elle besoin de jouer sur la traduction en
français entre «noir» et «nègre» pour accentuer l'effet? Nous ne le
pensons pas. Les
qualificatifs de «noir», «blanc», donnés a priori, globalement, comme
première
description d'un être humain, sans autre explication historique, géographique, biographique, socio-culturelle, sont une ignominie, comme ceux
de «juif», d’«arabe», etc., donnés à priori par simple racisme, et passés aujourd'hui dans le langage courant alors que s'exerce, comme jamais, un contrôle liberticide de la pensée et du langage. Pour le comprendre, il faut
l’avoir ressenti, c'est-à-dire le prendre en plein visage. Pas besoin
de «nègre», «youpin», «rital», «feuj», «beur», etc., pour sentir
l’insulte et l'exclusion, les mots «polis» de la bonne société sont
aussi «éloquents».
James Baldwin et d’autres ont travaillé à
modifier ce vocabulaire fondé sur l’inconscient collectif ségrégationniste et raciste,
car les mots sont au quotidien l’expression profonde, enfouie, de la pensée et la base des relations humaines.
La volonté, une étape nécessaire, de faire évoluer le
vocabulaire pour qui pense, comme James Baldwin que ces termes de «noir» et
«blanc» sont indignes de l’être humain, nous a fait préférer à Jazz Hot de
choisir de décrire les
personnes par leurs actes et quand cela apporte une explication, par
l’origine géographique, même lointaine dans le temps (afro-américain),
et
uniquement quand cela est nécessaire sur les questions touchant
justement au
racisme aussi bien qu’aux arts, à la politique, l’histoire ou la
géographie. Mais
ce choix n’est toujours pas partagé, et y compris dans ce documentaire
pour la version française. Les qualificatifs de «blanc», de «noir» sont
de
ces préjugés, irrationnels, que James Baldwin n’a cessé de combattre
pour poser
la question essentielle: «Si je ne suis
pas "un Noir”, et si vous, les Blancs, vous l’avez inventé, vous devez vous
demander: pourquoi?» Pour comprendre cette pensée, il faut en sentir la douleur au creux de l’estomac, quelle que soit son
origine: les fameux niveaux d'expérience de James Baldwin.
Enfin,
le film se termine sur un contresens par
rapport à son objectif avoué et par rapport à la pensée de James
Baldwin: une
série de portraits de personnes de tous les âges et de tous les sexes
censés
représenter la diversité afro-américaine pour «faire penser» (un procédé
de propagande, la publicité y a couramment recours, et non de
réflexion) qu’ils sont «comme
nous», démarche à contresens et complaisante, comme si ces personnes
avaient
besoin par leur apparence normalisée de se justifier d’exister. Il n’y a
dans
cette galerie que des personnes «présentables» selon les critères
normalisateurs de la société des années 2010. Pas de moches,
pas de laids, pas de gros, de mal habillés, d'hirsutes, d’obèses même.
C'est la négation de ceux qui ne sont pas
dans la norme. James Baldwin n’aurait pas aimé. Heureusement, quelques
dernières images et quelques mots de James Baldwin en toute fin nous
rappellent l'essentiel de ce bon documentaire.
Un très
bon documentaire même, à transcrire car le texte est dense et nécessite
relecture, porté par les mots d’un penseur hors normes, James Baldwin,
doué de
pédagogie, de rigueur intellectuelle, d’honnêteté (le résumé de sa biographie et les raisons de son retour au pays pour
payer sa dette), d’humour, de mémoire et d’une rationalité rassurante dans
notre époque qui manque de toutes ces qualités.
James
Baldwin est mort en France, peut-être
par hasard, peut-être par nécessité, car la France, celle des années
1950-1960-1970,
qui n’existe plus aujourd’hui –même si ce n’est pas son Harlem familial,
avec
sa musique, son poulet frit et ses visages– il le dit et le fait
comprendre,
lui a appris à dominer la terreur, à percevoir, par son expérience, son
vécu, ce
qu’était l’égalité au quotidien, à penser une alternative. Les idéaux
(au moins) de la grande Révolution –l'égalité d’abord car d'elle
dépendent les deux autres pieds de cet édifice, la liberté et la
fraternité– ont bercé la pensée de la Harlem Renaissance jusqu'à la
lutte des civil rights, Martin Luther King et James Baldwin. James Baldwin n’est pas le premier, ni le seul à le
sentir et à le dire. Le regretté Ernest Gaines qui vient de disparaître, et avant lui Claude McKay, Chester Himes, Richard Wright, Langston Hugues et quelques autres, artistes et pas seulement, passés par la France,
nous racontent dans leurs œuvres avec talent et sincérité leur soif d'égalité.
Ironie de
l’histoire, la France, qui cofinance ce film en
2017, a laissé en 2018 des promoteurs immobiliers détruire une grande
partie de
la maison de St-Paul-de-Vence où a résidé depuis 1970 l’écrivain lors de
ses
séjours en France, un philosophe indispensable à la richesse de la vie
culturelle de son pays
d’adoption (local et national) aux côtés des Jacques Prévert, Simone
Signoret,
Yves Montand, la famille Renoir et quelques autres. Comme aurait pu dire
Simone: «La France n’est plus ce qu’elle était…», et ça se sent jusque
dans la version
française de ce (bon) documentaire.
*
|
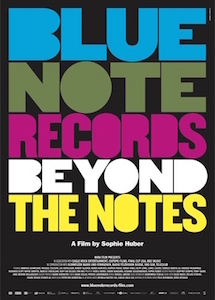
BLUE NOTE RECORDS BEYOND THE NOTES
Blue Note Records Beyond the Notes, Film Documentaire de Sophie Hubert, produit par Mira Film/Eagle Rock Entertainment, 85mn, Suisse-USA, 2018, en
version originale sous-titrée (disponible en DVD) https://bluenoterecords-film.com/fr
Blue Note Records
Beyond the Notes sort en DVD à l’occasion des 80 ans de la célèbre maison de disques qui
organise chaque année son festival, au mois de novembre à Paris. Sa richesse
documentaire (interviews passées et récentes, photos, vidéos, extraits des
prises de studio non exploitées où l’on peut saisir quelques brefs échanges
entre producteurs et musiciens…) en fait un témoignage précieux de cette
histoire particulière du jazz, celle de Blue Note, label entré dans la légende comme
étant toujours à la pointe des «révolutions» successives, rendues possibles par la personnalité d’Alfred Lion qui
liait amitié, cherchait à comprendre son temps, parlait beaucoup avec les
musiciens, les encourageait à jouer de nouveaux morceaux, payait les
répétitions, pendant que Francis Wolff avait toute latitude pour cadrer ses
photos. Son talent de photographe fut aussi indispensable à l’identité
artistique de Blue Note, comme celui du graphiste Reid Miles (1927-1993) qui, à
partir du milieu des années 1950, créé les visuels des pochettes de disques: une
véritable équipe d’artisans d’art. Les archives photographiques de Francis
Wolff sont d’ailleurs dévoilées dans le film par Michael Cuscuna (producteur
indépendant et consultant depuis 1984 pour Blue Note sur les rééditions,
également créateur du label Mosaic Records) qui en est aujourd’hui propriétaire.
Le documentaire n’évoque que brièvement les circonstances de la création du label et le
parcours originel de ses deux figures tutélaires, Alfred Lion (1908, Berlin-1987,
San Diego, CA) et Francis Wolff (1907, Berlin-1971, New York, NY) qui se
retrouvent à New York pour échapper au nazisme. Lou Donaldson relate
souvenirs et anecdotes avec un humour irrésistible, tout comme Rudy Van Gelder
(1924-2016)1, le grand
ingénieur du son de Blue Note (mais aussi Prestige, Verve…); ils décrivent la
proximité des deux producteurs avec les musiciens (on imagine que le racisme
dont étaient victimes les Afro-Américains faisaient écho à leur propre
parcours); Alfred Lion et Francis Wolff étaient avant tout soucieux
d’enregistrer les disques qu’ils avaient envie d’entendre. Lou Donaldson
qualifie de crapules les producteurs de l’époque: «sauf Alfred qui respectait
tout le monde».
Blue Note, à ses débuts, porte son intérêt sur les musiciens du premier jazz: Albert Ammons, Meade Lux Lewis,
Sidney Bechet, James P. Johnson ou encore Sidney DeParis. Puis, comme Charles
Delaunay à Paris, les deux amis perçoivent la valeur du bebop émergeant, Alfred
Lion se prenant d’une véritable fascination, doublée d’une profonde amitié, pour
Thelonious Monk. Débute ainsi une série de quatre longues sessions (1947-1952)
bien que la musique de Monk peine à trouver son public. Dans la foulée, deux
autres figures du bop, Art Blakey puis Bud Powell rejoignent également Blue
Note, tandis que les années 1950 voient l’arrivée d’une foule de jeunes talents
dont les noms vont s’inscrire dans l’histoire du jazz: Clifford Brown, Lou
Donaldson, Horace Silver, Lee Morgan, Hank Mobley, pour n’en citer que
quelques-uns, puis John Coltrane avec l’album Blue Trane (1957,
une nouvelle «révolution» pour le label). C’est
ainsi, au fil des sessions Blue Note (mais aussi d’autres labels
indépendants comme Prestige, Riverside, Atlantic, Contemporary…), que
se poursuit en s'élargissant la grande histoire du jazz. Ce foisonnement
créatif est favorisé
par l’atmosphère conviviale entretenue par Alfred Lion et Francis Wolff
vis-à-vis des artistes, lesquels, en confiance, font venir d’autres
musiciens, à l'instar d'Ike Quebec et Duke Pearson, véritables recruteurs du label. Herbie
Hancock et Wayne Shorter, au détour d’une récente session avec Robert
Glasper,
longuement filmée, racontent leurs souvenirs avec malice: Art Blakey,
Miles,
Alfred Lion et Francis Wolff dont Herbie décrit en riant la fameuse petite danse
qu’il
entreprenait pendant les prises lorsque la musique lui plaisait
vraiment. Ils
expliquent également que, du fait qu’il n’y avait pas de pression, les
deux
producteurs laissaient émerger la musique sans entrave pour atteindre le
cœur de l’expression. Les moyens du label restent au début
artisanaux: Rudy Van Gelder se remémore avec amusement que, durant les
six
premières années de sa collaboration avec Blue Note (1953-59), le salon
de ses
parents a tenu lieu de studio d’enregistrement, jusqu’à ce qu’il fasse
construire son célèbre studio à Englewood Cliffs, dans le New Jersey.
Les années 1960 sont marquées par l'intensification de la lutte pour les Droits
civiques qui imprègne le travail des musiciens2.
Elles seront également fécondes avec Grant Green, Jimmy Smith, Dexter
Gordon, Freddie Hubbard, Joe Henderson
ou les membres du quintet de Miles Davis (qui «adorait» Alfred Lion):
Wayne
Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter et Tony Williams. Mais la belle
histoire
prend fin en 1966, alors que Blue Note continue d’élargir le spectre du
jazz avec les musiciens free (Andrew Hill, Eric Dolphy, Ornette
Coleman…). Le documentaire attribue paradoxalement les difficultés du
label aux succès inattendus de The Sidewinder (1963) de Lee Morgan et Song for My Father (1963-64) d’Horace Silver car les distributeurs auraient mis Blue Note sous pression pour ne
plus enregistrer qu’en fonction du nombre de ventes. Ce n’est pas la
philosophie d’Alfred Lion, qui reste un artisan d’art dans l’âme, et face aux
délais de paiement rallongés par les distributeurs et en raison de problèmes de santé, il est
contraint, selon le documentaire, de vendre Blue Note à Liberty Records, une grande compagnie dont les objectifs sont purement commerciaux.
Alfred Lion et Francis Wolff restent un temps sous contrat en tant que
salariés de leur repreneur, puis opposé à la méthode de travail, bureaucratique et à la politique mercantile de Liberty Records,
Alfred Lion quitte le navire en 1967, tandis que Francis Wolff demeure en place
jusqu’à sa mort, en 1971.
Comme pour Stax3,
la volonté de prédation de l’industrie musicale, avatar de la société de consommation de masse, a eu raison d’une aventure
artistique indépendante, fondatrice dans le jazz. Bien sûr, Blue Note Records, qui passe sous
le pavillon d’EMI en 1979 (par le rachat de Liberty Records) puis d’Universal
Music en 2012 (EMI étant racheté à son tour) existe toujours, riche du
prestigieux catalogue de son âge d’or (lequel constitue encore aujourd’hui 50%
des ventes totales du label) et continue de sortir de nouvelles productions. Le
documentaire illustre d’ailleurs très bien, à travers l’interview de Bruce
Lundvall (1935-2015), président de Blue Note Group entre 1984 et 20114, chargé de réactiver la marque après l’arrêt
de 1979, la nouvelle philosophie du label qui cherche à étendre son audience
au-delà des seuls amateurs de jazz. Une stratégie qui passe par le hip-hop dans
les années 1980 (les DJ utilisant volontiers des samples issus du catalogue
Blue Note) ou, au début des années 2000, par la chanteuse pop-folk Norah Jones,
devenue le fleuron de l’ère Lundvall. Nouveau président depuis 2012, le
musicien et producteur Don Was (1952) se félicite bien sûr de cette évolution
hors jazz expliquée aussi par des musiciens d’aujourd’hui, entre jazz et
hip-hop: Robert Glasper (p, ep), Ambrose Akinmusire (tp), Marcus Strickland
(ts), Lionel Loueke (eg), Derrick Hodge (b) et Kendrick Scott (dm): on apprend
par ces jeunes musiciens que la politique des années Reagan (1980-88),
consistait à supprimer les programmes éducatifs et artistiques dans les
quartiers défavorisés (sans doute jugés trop coûteux), privant toute une
génération de l’accès à la pratique instrumentale (ce qui a fortement nuit à la
transmission culturelle en matière de jazz), se rabattant sur d’autres outils
d’expression (comme le hip-hop). Ils insistent sur le fait que cette carence
d’éducation musicale a surtout provoqué, par désœuvrement, une explosion de
violence et de criminalité, dont eux-mêmes se sentent les rescapés. Ils
craignent encore davantage de violence pour l’avenir s’ils n’arrivent pas à
passer le relais aux plus jeunes. C’est l’information la plus inquiétante du
documentaire, même si le message en filigrane de la nouvelle «révolution» Blue
Note est de conclure que le jazz n’est plus qu’une des étapes de son histoire
de la même façon que les grands festivals historiques gardent l’étiquette jazz
en programmant des musiques commerciales. Ce récent
film a en tous cas le mérite de mettre en évidence deux modes de production opposés:
l'un artistique, l’autre répondant à des impératifs financiers.
Jérôme Partage et Hélène Sportis
1. Voir nos Tears.
2. Dont l’album Free for All d’Art Blakey (février 1964),
enregistré entre la Marche sur Washington (août 1963) et la Marche de Selma à
Montgomery (mars 1965) avec le titre de Freddie Hubbard, «The Core» en hommage au Congress of Racial Equality.
3. Voir notre chronique.
4. Voir aussi son
interview dans Jazz Hot n°536 (décembre 1996-janvier 1997).
© Jazz Hot 2019
|
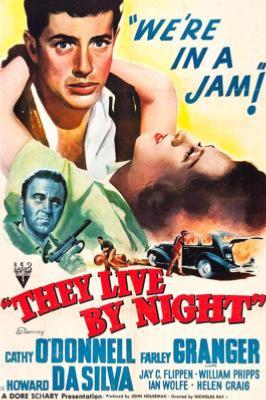
They Live By Night
Les Amants de la nuit
Premier film
de Nicholas Ray (1911-1979), produit par John Houseman, RKO, 95 mn, USA, 1948,
en version originale sous-titrée, avec Avec Farley Granger, Cathy O'Donnell,
Howard Da Silva et Marie Bryant1.
https://www.cinematheque.fr/cycle/nicholas-ray-526.html
Ce roadmovie fait
partie de la rétrospective de l’œuvre de Nicholas Ray présentée par la
Cinémathèque de Paris du 29 août au 28 Septembre 2019; il est une sorte
de matrice d’un Nicholas Ray originel, de sa vie d’avant le cinéma, quand il
partageait les expériences jazz, cabaret, littérature et poésie délirante de
Max Gordon (1892-1978) au Vanguard, celles d’Alan Lomax (1915-2002) collectant
les musiques de l’Amérique pour le Gouvernement, dont «Back Where I Come
From» (https://www.loc.gov/item/afc2004004.ms040114/), de sa vie quand il
côtoyait Lead Belly et Woody Guthrie, le Group Theatre d’Elia Kazan ou qu’il
travaillait sur Voice of America (à
partir de 1942), «la voix de l’Amérique», où il avait été recruté
par son futur producteur John Houseman. Toutes ces expériences sont regroupées dans
ce premier film… un état des lieux de sa construction culturelle.
L’histoire est celle des perdants de l’organisation du monde, jeunes, sans
compréhension des règles du jeu imposées par le dessus du panier, qui courent à
deux vers leur perte, s’accrochant désespérément l’un à l’autre d’un bout à
l’autre du film, en essayant en vain mais sans jamais y renoncer, de tenter la
vie de ceux qui ont eu les bons codes à la naissance (entre crise économique,
violence familiale et institutions répressives, résultant des observations et
vécu du réalisateur). Dans leur course, ils passeront une soirée dans un
restaurant chic tenu par la pègre officielle à New Orleans, où chante Marie
Bryant («Your Red Wagon», ton
«carma» dirait-on aujourd’hui quand le sort s’acharne sur ceux qui
s’exposent sans savoir faire autrement), Marie Bryant, qui était aussi une
grande danseuse (elle a donné des leçons à Marlon Brando dans l’école de
Katherine Dunham), chorégraphe (Gene Kelly) et actrice (https://www.imdb.com/name/nm0117183/);
de Louis Armstrong à Duke Ellington, en passant par Lionel Hampton, Ethel
Waters, Nat King Cole ou Lester Young entre autres, Marie Bryant était reconnue
et adulée.
La magie de ce film réside dans sa valeur documentaire de reconstitution
historique de réseaux relationnels très denses et fertiles, à une époque où les
données personnelles n’étaient pas des produits à vendre sans paiement, mais des
expériences partagées pour créer de l’artisanat d’art sous toutes ses formes
par l’émulation et les échanges d’humains en chair et en os.
Hélène Sportis
|

Stax, le label soul légendaire
Documentaire de Stéphane Carrel et Lionel Baillon, produit par Arte
France/Flair Production/Universal Music France, 53 min., France, 2018, en
version originale sous-titrée (disponible jusqu’au 24/09/19: www.arte.tv) L’histoire du
label Stax (1957-1975) est celle d’une expérience
solidaire mixte peu commune dans une Amérique agitée par les luttes
liées au mouvement
pour les Droits civiques. Il s’est en effet construit comme creuset
incontournable d'une nouvelle création musicale se voulant
authentiquement afro-américaine, la «soul music», et comme un
acteur à part entière du combat pour la dignité et l’égalité mené par les
Afro-Américains (avec de multiples ramifications le liant à un espace artistique et politique bien plus large), bien qu’aucun projet militant ne présidât à sa
création. Le documentaire, drôle
et émouvant, évoque les fondateurs de Stax, Jim
Stewart (1930-), employé de banque amateur de country music, et
sa sœur,
Estelle Axton (1918-2004), institutrice qui hypothèque la maison
conjugale sans avertir son mari pour établir leurs locaux (un studio
d’enregistrement
et un magasin de disques) dans un cinéma désaffecté du quartier
afro-américain
de Memphis, Tennessee. Ce qui aurait pu se limiter à un simple choix
économique aboutit à
une entreprise intercommunautaire, le magasin de disques –tenu par
Estelle
Axton–, devenant un lieu de vie fréquenté par les gamins et les jeunes
musiciens
du voisinage. Mieux encore, Estelle recommande à son frère les plus
talentueux
qui se retrouvent ainsi à enregistrer pour la compagnie qui s'appelle
alors Satellite Records. Jim Stewart finit par délaisser
la country pour le rhythm and blues et connaît une première réussite
commerciale en 1960 avec le duo entre Rufus Thomas (voc) et sa fille
Carla (voc): «Cause I Love You» (1960), lequel attire l'attention d'Atlantic Records, la célèbre maison disques fondée par Ahmet Ertegün (Erroll Garner, Ray Charles...),
qui noue un premier partenariat avec Satellite Records. Après un
deuxième succès important, avec le titre «Last Night», des Mar-Keys
(1961)1 -une formation, au départ, de
musiciens euro-américains mais qui inclut rapidement des membres
afro-américains-, le label prend le nom de Stax (une autre firme du nom
de Satellite le poursuivant en justice). Autre «tube» issu de la politique intégrationniste
de Stax, celui du quartet «mixte», Booker T. & The M.G.'s (du nom du pianiste/organiste Booker T. Jones) avec «Green
Onions» en 1962. Comptant également dans ses rangs Steve Cropper (g), Booker T. & The M.G.'s devient le nouvel orchestre maison2. Steve Cropper accompagne par la suite d'autres artistes venus enregistrer à Memphis, à la demande d'Atlantic: Otis Redding (voc) en 19623 -dont le guitariste évoque le souvenir avec émotion- et le duo Sam & Dave4,
lequel se retrouve à collaborer également avec le compositeur du label,
Isaac Hayes, recruté en 1964 par sa fréquentation du magasin de
disques.
Progressivement, Stax propose une musique plus enracinée et reflétant l’expression de la communauté afro-américaine de
Memphis sous l'impulsion d'Al Bell (1940-) dont Jim Stewart (décidément étranger à tout sentiment raciste) fait son bras droit à partir de 1965. En ce sens, Stax est positionné à l’opposé
de Motown laquelle cherche à séduire le grand public avec un rhythm and blues
édulcoré. Les deux labels n'en sont pas moins emblématiques de cette nouvelle «soul music», rencontre entre le rhythm and blues, le blues, le jazz et le gospel, initiée et popularisée par Ray Charles5. Homme
et femme «de bonne volonté», comme aurait dit
Martin Luther King, Jim Stewart et Estelle Axton créent ainsi, dans un
Tennessee
férocement raciste, un environnement artistique non ségrégé. La
production musicale du label n'en fait pas moins écho aux événements
marquant la lutte pour les Droits civiques, tel «Soul Man» de Sam & Dave en 19676.
Un peu plus tôt, en mars 1967, une tournée triomphale en
Grande-Bretagne et en France avait pourtant permis aux musiciens de Stax
de recevoir une reconnaissance artistique qu'ils ne pouvaient espérer
dans leur pays (comme les jazzmen avant eux).
Mais cette belle histoire humaine et musicale est victime d’un réel
tragique et d’une volonté de prédation. Tout d’abord, la brutale
disparition d’Otis Redding (10 décembre 1967) et l’assassinat de Martin
Luther
King (4 avril 1968) causent un véritable traumatisme au sein du label,
tandis
que le second provoque une dégradation des relations intercommunautaires
à Memphis (notamment) et le
départ des musiciens euro-américains de Stax. Dans la foulée, Atlantic
Records (récemment
racheté par Warner) profite d’une clause léonine de son contrat de
distribution (signé après l'arrivée d'Al Bell) pour le déposséder de
l’intégralité de son catalogue et de la plupart
de ses artistes. Pour survivre, le label de Memphis démultiplie les
enregistrements (vingt-sept albums en un mois!) grâce à la combativité
d’Al
Bell, à présent vice-président. De nouveaux musiciens
permettent à Stax de se relever, comme les Staple Singers7 et surtout Isaac Hayes (désormais sur le devant de la scène)8.
Ce dernier est un partisan pacifique du mouvement «black power»,
de même que le militantisme d’Al Bell amène Stax à se porter à la pointe
de la lutte
antiraciste, ce qui entraîne quelques remous en interne (le départ
d'Estelle Axton notamment). Un investissement marqué par le
meeting-concert «Wattstax»9,
du 20 août 1972 à Los Angeles, avec
Jesse Jackson, commémorant, in situ, les émeutes de Watts d'août 1965.
Mais l’aventure de ce label indépendant et engagé prend
définitivement fin en 1975, coulé par son nouveau distributeur CBS
Records,
souhaitant éliminer un concurrent gênant, avec la complicité du milieu
bancaire de Memphis qui fut peu empressé de sauver de la faillite cette
firme indépendante, si singulière et remuante10.
Une passionnante leçon de musique, d’histoire, de sociologie, d'économie et de politique: une histoire humaine.
Jérôme Partage
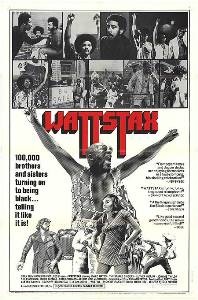
1. Le documentaire commet une inversion chronologique dans son récit en évoquant le succès des Mar-Keys avant celui de Rufus & Carla («Cause I Love You»: https://www.youtube.com/watch?v=fBzYt1UXKMY).
2. Steve Cropper (né en 1941), membre des Mar-Keys et co-auteur de «Last Night» (https://www.youtube.com/watch?v=FNkXUSt9IRU) est également à l'origine du «Green
Onions» de Booker T. & The M.G.'s (https://www.youtube.com/watch?v=gjgjoSsOvi4). Il poursuivra sa collaboration avec Stax jusqu'en 1970. On le retrouve en 1980 dans l'orchestre des Blues Brothers (et des Blues Brothers 2000, 1998), film de John Landis. Par ailleurs, Booker T. & The M.G.'s composeront la musique du film Uptight (Point noir, 1968) de Jules Dassin, un thriller engagé (à l'image du réalisateur
qui fut victime du maccarthysme) sorti juste après l'assassinat de
Martin Luther King: https://www.youtube.com/watch?v=2alRL6oRx7w
3.
Venu chez Stax pour conduire le guitariste Johnny Jenkins (1939-2006), Otis Redding
(1941-1967) insiste pour chanter à la fin de la session. Sa performance
impressionne Jim Stewart qui sort un premier titre sous le nom du
chanteur, «These Arms of Mine» (https://www.youtube.com/watch?v=aUaO50nWnvg). Plusieurs autres ballades langoureuses feront la renommée d'Otis Redding qui devient la plus grande vedette de Stax.
4. Le duo constitué par Sam Moore (1935-) et David Prater (1937-1988), surnommé «Double Dynamite», se fait connaître avec «Hold On, I'm Coming» (https://www.youtube.com/watch?v=Fowldx4hRtI).
Dans le documentaire, Sam Moore raconte (avec humour) son effroi quand
Atlantic l'envoya chez Stax, dans l'Etat sudiste du Tennessee, perspective peu réjouissante pour un Afro-Américain.
5. «The Genius of Soul» développa ce genre à partir du titre «I Got a Woman» dont la mélodie fut empruntée à une chanson gospel, «It Must Be Jesus». Le mot «soul» apparaît pour la première fois avec le titre de l'album Soul Brothers (1958, Atlantic Records) qui réunit Ray Charles et Milt Jackson.
6.
Lors des émeutes de Détroit (23-27 juillet 1967), parmi les plus
meurtrières et destructrices de l'histoire des Etats-Unis, les magasins
tenus par des Afro-Américains furent marqués de l'inscription «soul brothers» afin qu'ils soient épargnés par les manifestants. Inspirés par cet événement, Isaac Hayes et le parolier David Porter composèrent «Soul Man» pour raconter la lutte de leur communauté (https://www.youtube.com/watch?v=1EnM8urBBWI).
7.
Originaire de Chicago, cette formation familiale a accompagné Martin
Luther King notamment pendant les marches de Selma à Montgomery, en mars
1965.
8. Compositeur, pianiste, chanteur, Isaac Hayes accède à la notoriété avec l'album Hot Buttered Soul (1969: https://www.youtube.com/watch?v=SQegEoll5Lc). Il connaîtra également le succès au cinéma, en signant la musique de Shaft (de Gordon Parks, 1971), récompensée d'un Oscar (https://www.youtube.com/watch?v=kfdW4687b_w), et comme compositeur/acteur dans le film italien Uomi duri (Les Durs, Duccio Tessari, 1974) avec Lino Ventura: https://www.youtube.com/watch?v=riyOBFpc888
9.
Le concert dura plus de six heures et réunit pacifiquement plus de 100
000 personnes, avec la participation d'Isaac Hayes, Carla et Rufus
Thomas, The Staple Singers, Albert King, entre autres. Il fit l'objet
d'un documentaire, Wattstax (de Mel Stuart, 1973): https://www.youtube.com/watch?v=9xJw7g1wvRw
10.
Le catalogue du label fut ensuite exploité par Fantasy jusqu'à son
rachat par Concord Records en 2007, lequel sort depuis de nouveaux
enregistrements sous le nom de Stax.
|
Du
13 au 23 septembre, en tournée d’avant-première en France, en présence
du réalisateur ou des ex-salariés, sera projeté le documentaire de Lech
Kowalski sur le combat digne, solitaire et déterminé des GM&S de
l’usine de La Souterraine, pour leurs emplois, qui sortira en salles le 9
octobre, après diffusion sur Arte en juin dernier. La France,
démantelée de ses outils de productions et de ses emplois depuis les
années 1970 pour se réduire comme une peau de chagrin à une activité
touristique stérile, est secouée par les conflits sociaux filmés par des
professionnels, parfois incarcérés pour avoir fait leur travail
d’information, comme Lech Kowalski en septembre 2017, arrêté pour
n’avoir pas coupé les caméras sur injonction policière. Le parquet a
«classé sans suite» deux mois plus tard, sans doute suite à une pétition
de plus de 400 cinéastes. Lech Kowalski connait «la musique»; il a été
l’assistant de Tom Riechman qui a tourné le documentaire poignant sur
Charlie Mingus à Greenwich Village (1966-1967, 58 min.) comprenant
l’expulsion lamentable de son domicile avec ses affaires sur le trottoir
(youtube.com/watch?v=lesvRFiyhLc). En 1984, Lech Kowalski fait le documentaire Rock Soup (La soupe aux cailloux, 81 min., lechkowalski.com/fr/video/item/38/rock-soup),
sur l’évacuation manu militari d’un collectif autonome de «sans
domicile» pour récupérer et valoriser une mini parcelle du Lower East
Side au sud de New York dont la pression immobilière rapporte tant, que
chaque mètre carré doit être privatisé.
Un deuxième documentaire suivra, après l’évacuation, Chico & The People (20 min., lechkowalski.com/fr/video/item/39/chico-the-people), sur l’enregistrement à Tompkins Square de la musique de Rock Soup par Chico Freeman, des musiciens et les personnes victimes de
l’évacuation. Cette tournée d’avant-première en présence du réalisateur
et des protagonistes, comme l’essence de sa réflexion sur le réel au fil
de sa «road-move-vie», rappelleront à ceux qui l’ont vu J’veux du soleil de Gilles Perret et François Ruffin (2019, 80 min.); car partout ceux
qui se battent pour survivre, ne comprendront jamais pourquoi ils seront
inexorablement dépossédés du presque rien qu’ils sont vitalement
obligés d’essayer de préserver, contre ceux qui ont déjà beaucoup plus
qu’il n’en faut pour vivre. Ne résistons pas aux hypothèses de réponses
de Jules, berger provençal dans Crésus (Fernandel, Jean Giono, 1960, 100 min.), qui réfléchit à partir des bicyclettes (youtube.com/watch?v=e2tbtRulv0U), des grives et des chachas avec son institutrice… (youtube.com/watch?v=jdgw3puddCg). Tous les films de Lech Kowalski sont disponibles sur son site (lechkowalski.com/fr/).
Hélène Sportis
© Jazz Hot 2019
|

Amazing Grace
Documentaire d’Alan Elliott et
Sydney Pollack, produit (entre autres) par Sundial Pictures, Al's Records &
Tapes Production, 40 Acres & A Mule (Spike Lee), Aretha Franklin…, 87 min.,
USA, 1972-2018, V.O. sous-titrée. Sortie au cinéma en France le 6 juin
2019; sortie DVD prévue le 6 août 2019.
www.amazing-grace-movie.com
Janvier
1972. Aretha Franklin a 29 ans. The Queen of soul est une star
internationale mais également une militante féministe et des
Droits civiques1. Ce n’est pas par hasard que
la fille du Révérend Clarence LaVaughn Franklin opère
un retour aux sources du gospel dans la modeste New Bethel Baptist Church2 située dans le quartier de Watts, à Los
Angeles (théâtre des émeutes de 1965). Huit ans après la signature du Civil Rights Act et quatre ans après
l’assassinat de Martin Luther King3, la
chanteuse donne deux récitals, essentiellement composés de gospels
traditionnels les 13 et 14 janvier en vue d’un double album live, Amazing Grace4,
qui sera publié par Atlantic Records, et deviendra le plus gros succès
commercial de l’histoire pour un disque de gospel
(deux millions d’exemplaires vendus aux Etats-Unis). La Warner Bros.,
propriétaire
du label, souhaite également filmer les concerts, espérant renouer avec
la lucrative performance du documentaire musical de Michael Wadleigh, Woodstock (1970). Après avoir écarté le réalisateur Jim Signorelli, elle confie à Sydney Pollack (1934-2008)5, le
soin de superviser le tournage, lequel accepte au seul nom d’Aretha Franklin. Las, en raison d’une soi-disant «erreur» technique
(«oubli des claps de début et de fin»: impensables avec Sydney Pollack), la synchronisation entre les images et le
son se serait avéré impossible. Quelles que soient les raisons, les bandes restent dans les cartons.
Au début des années 1990, un jeune producteur d’Atlantic
Records, Alan Elliott,
en apprend l’existence. En 2007, il rencontre Sydney Pollack qui lui
donne sa
bénédiction pour en racheter les droits à la Warner (Alan Elliott
hypothèque sa maison
pour cela). Avec les nouvelles techniques numériques, le trésor
devient enfin exploitable: en trois semaines, les quelques vingt heures
de rushes (répétitions et concerts) sont synchronisées. En 2011, Alan
Elliott
organise une première projection du film monté. Aretha Franklin
l’apprend et
engage une procédure judiciaire qui bloque la diffusion du documentaire.
Ses
raisons demeurant obscures et confirment que l'erreur technique de 1972
n'a sans doute jamais existé. La sortie est donc bloquée jusqu’au décès d'Aretha en août 2018. C’est enfin sa nièce,
Sabrina Owens, en charge de l’héritage, qui autorise la sortie du film
après qu’il ait été visionné par la famille d’Aretha Franklin. Amazing Grace est un document
saisissant, loin des captations léchées de concert que l’on connaît
aujourd’hui. Le film, en embrassant musiciens et public comme un tout,
immerge
totalement le spectateur dans son fauteuil de cinéma au cœur de la
petite église. Le public, qui affiche sa ferveur, est ainsi un acteur à
part entière
(call and response propre à
l’église afro-américaine et
manifestations vivantes de la foi: pleurs, apostrophes, danses,
transes…).
De même, Sydney Pollack et ses cadreurs apparaissent régulièrement dans
le
champ (on voit même le réalisateur prendre des photos), ce qui nous
donne
l’impression d’assister au tournage lui-même et de vivre véritablement
l’expérience. L’office –il ne s’agit pas de concerts– est dirigé,
avec un humour irrésistible, par le célèbre pasteur James Cleveland (p,
voc),
une figure du gospel6. Quant à l’accompagnement, il
est fourni sur le plan vocal par le Southern California Community Choir,
conduit par Alexander Hamilton, et dont les membres finissent par se muer, surtout
au cours de la seconde soirée, en spectateurs transis par la performance
d’Aretha Franklin; sur le plan instrumental, on retrouve Ken Lupper (org),
Cornell Dupree (eg), Chuck Rainey (eb), Bernard Purdie (dm) et Pancho Morales
(perc), des musiciens professionnels déjà réputés.
Au sommet de son expression, Aretha Franklin s’exprime ici dans un contexte ancré
dans le réel, au sein de sa communauté et en présence de ses proches: en
particulier son père, le très célèbre et imposant C. L. Franklin, et sa mère de substitution, Clara Ward7,
le second soir. Le premier, invité à
prendre la parole, relate ses souvenirs avec sa fille encore enfant,
rappelant
que, pour celui qui sait écouter et ressentir, elle n’a jamais été autre
chose
qu’une chanteuse de gospel. En allant se rasseoir, il lui éponge la
figure alors qu’elle s’est installée au piano. On perçoit alors une
manifestation ce que ce qui pourrait être l'embarras d'Aretha. Autre
séquence marquante de ce
documentaire, l’interprétation incandescente par Aretha Franklin du
célèbre
cantique «Amazing Grace» (à la fin du premier soir) au cours
duquel James Cleveland abandonne le piano, submergé par l’émotion,
tandis que celle
du public est à son paroxysme.
Enfin, quand, durant le morceau «Never Grow
Old», le révérend Cleveland prend la parole pour évoquer «cet
endroit où les faibles seront hors de portée des méchants», «cet
endroit où vont les saints et où ils ne vieilliront pas», on pense à
Martin Luther King qui, la veille de sa mort, disait avoir vu la «Terre
promise», celle de la fraternité, et qui serait l’issue du combat pour les
Droits civiques et pour l'égalité. De fait, bien que jamais nommé, l’ombre du pasteur de
Montgomery plane sur l’assemblée.
Débarrassée
du contexte show-business et des assistances gigantesques des scènes à
grand spectacle, Aretha Franklin, bien qu’au
centre de l’action par son talent hors norme, n’a rien ici d’une diva au
sens médiatique du terme. Elle rejoint simplement la simplicité,
l'authenticité et la puissance de la profondeur d'une expression comme
le ferait Mahalia Jackson qui devait décéder quinze jours plus tard.
Aretha devient l’une des protagonistes, la plus en vue en raison de sa
voix exceptionnelle, de ce témoignage culturel fabuleux,
intense, dans un moment collectif et solidaire magnifiquement filmé
par Sydney Pollack. Un film essentiel sur l’histoire de la musique et de
l’Afro-Amérique8.
Jérôme Partage
1. Sa célèbre version de la
chanson «Respect» d’Otis Redding, en 1967, est devenue un hymne
pour ces deux causes. Voir nos Tears (Jazz Hot n°685).
2. Le révérend Clarence LaVaughn Franklin
(1915-1984), personnalité éminente au sein de la communauté
afro-américaine,
exerça son ministère à la New Bethel Baptist Church de Détroit où sa
fille
prodige fit ses débuts. Militant des Droits civiques, ami de Martin
Luther King
et de Mahalia Jackson (qui fut l’un des mentors d’Aretha et est décédée
peu après l'enregistrement, le 27 janvier 1972 ), il organisa à
Détroit, en 1963, une «Walk to Freedom» lors de laquelle le leader
afro-américain prononça une première version de son discours I Have a
Dream, deux mois avant la marche sur Washington.
3. Aretha fut également un
soutien actif du mouvement, donnant de nombreux benefit concerts, notamment en 1963 pendant la campagne de
Birmingham. Peu avant son assassinat, Martin Luther King lui remit, à
l’occasion d’un concert à Détroit, en présence de son père, le «Southern
Christian Leadership Conference Leadership Award» (voir photo et
article: dreamdeferred.org.uk).
Lors de ses funérailles, en avril
1968, elle donna une poignante interprétation de «Precious Lord Take My
Hand» qu’elle chante également sur Amazing Grace. Par ailleurs, elle prit
fait et cause pour Angela Davis en 1970.
4. Atlantic/Flashback Records
8122-75717-2. Extraits disponibles à l’écoute.
5. La présence de Sydney Pollack dans ce projet ne doit également rien au hasard: sa filmographie a
multiplié les thématiques et les collaborations notamment liées aux
Droits civiques: Sidney Poitiers, Quincy Jones (Trente minutes de sursis, 1965), Burt Lancaster (Les Chasseurs de scalps, 1968), On achève bien les chevaux (1969), charge terrible sur la négation de la dignité humaine.
 6. James Cleveland (1931-1991), originaire de Chicago, a eu une carrière à
succès en tant que pianiste, chanteur, composeur et arrangeur. Il a sorti de
nombreux enregistrements, essentiellement live, pour le label Savoy. Très lié à
la famille Franklin (il fut un temps directeur musical de la New Bethel Baptist
Church de Detroit et vécut chez les Franklin), ce pédagogue et promoteur très
dynamique du gospel fut l’un des soutiens de la jeune Aretha (voir biographie et discographie dans Jazz Hot n°541). 6. James Cleveland (1931-1991), originaire de Chicago, a eu une carrière à
succès en tant que pianiste, chanteur, composeur et arrangeur. Il a sorti de
nombreux enregistrements, essentiellement live, pour le label Savoy. Très lié à
la famille Franklin (il fut un temps directeur musical de la New Bethel Baptist
Church de Detroit et vécut chez les Franklin), ce pédagogue et promoteur très
dynamique du gospel fut l’un des soutiens de la jeune Aretha (voir biographie et discographie dans Jazz Hot n°541).
7. Célébrité du monde du gospel, Clara
Ward (1924-1973) fut, avec Mahalia Jackson et Marion Williams, l’autre figure
tutélaire qui marqua la jeune Aretha Franklin. Elle fit ses débuts au sein du
groupe familial conduit par sa mère Gertrude, The Ward Singers (1931-1952) et
effectua le reste de sa carrière sous son nom. Elle entretint une longue
liaison avec C.L. Franklin (séparé de la mère d’Aretha depuis ses 6 ans,
laquelle décédera quatre ans plus tard) et eut un rôle déterminent dans le
déclenchement de la vocation d’Aretha et de ses sœurs.
8. On retrouve dans Jazz Hot de nombreux numéros sur la musique religieuse afro-américaine, en particulier la série «I Hear
Music in the Air» du n°531 (1996) au n°542 (1997), n° Spécial 1997.
© Jazz Hot 2019
|

Archie Shepp in Session at Arte Studio
Documentaire/concert de David Guedj, produit par Arte
France/Oléo Film/Archieball, 50 min., France, 2019, en version originale
sous-titrée (disponible sur Arte.tv jusqu’au 13/02/20)
A 82 ans, Archie Shepp raconte sa vie d'homme et retrace
son parcours artistique à travers une alternance d’anecdotes et de
morceaux joués en studio en compagnie de son quartet (Carl-Henri Morisset, p,
Matyas Szandai, b, Steve McCraven, dm). Cet enregistrement, qui a eu lieu le 14
mai 2019, crée une forme d’intimité entre le saxophoniste et le spectateur,
tant par la sobriété de sa mise en scène qui permet ainsi d’aller à l’essentiel,
au fond du propos, que par le naturel des échanges live entre
les musiciens. Les tensions racistes et la condition des Afro-Américains
constituent le fil rouge de son récit: du lynchage d’un homme (épisode
traumatisant qui a précédé de peu sa naissance), à sa propre peur de marcher
dans les rues de New York au bras de sa première épouse, blanche (souvenir se
plaçant en parallèle de celui qu’il restitue de Charlie Parker qui, dans la
même situation, affichait une décontraction totale). Une thématique illustrée
musicalement par un poignant «Sometime I Feel Like a Motherless Child», chanté,
ou encore un «Dedication to Bessie Smith's Blues» de sa composition. Archie
évoque également John Coltrane, le «grand-frère», Miles Davis ou son propre
père, musicien semi-professionnel qui l'a initié au banjo. On retiendra une
séquence savoureuse: la démonstration de hambone (ou juba dance, danse
remontant à la période de l’esclavage, consistant à se taper ou tapoter jambes,
bras, poitrine et joues comme une percussion) donnée par Steve McCraven, dont
on perçoit ici la complicité ancienne avec le créateur d’Attica Blues.
Un documentaire qui agit comme
un «révélateur» accessible à tous les publics pour
arriver à faire le lien entre réalité de la vie, perception sensorielle et
expressivité musicale, pour comprendre et ressentir l’origine de la
profonde humanité de cet art appelé «jazz».
|
Swing Time in Limousin
Documentaire de Dilip et Dominique Varma,
produit par Plus2com! Productions, 75 mn, France, 2018
A voir jusqu’au mardi 11 juin 2019 au cinéma Le Saint André des Arts, Paris 6e, http://cinesaintandre.fr/
en présence des réalisateurs (4 juin) et de Claude-Alain Christophe, président du Hot Club de Limoges (11 juin)
Ce documentaire a été réalisé dans le cadre de la série d’événements organisés en 2018-2019, Hot Vienne, Limoges se la joue jazz, Harlem à Limoges, autour du legs à la Ville par Jean-Marie Masse (Limoges, 1921-2015, homme de radio, producteur et batteur), de ses archives1. Mais revenons au documentaire qui raconte, sans s'étendre et sans approfondir l'histoire du jazz en France (les amateurs de jazz trouveront les repères avec la création de ce hot club de Limoges en 1948 et la vision du jazz exposée par les acteurs de ce film), la filiation d’Hugues Panassié (donc plutôt en province) au travers d’un groupe d’amis qui se fédèrent autour de rencontres avec des musiciens afro-américains, de concerts, d’un hot club, d’une radio2, de musiciens du cru, dont les enfants deviendront parfois amoureux du jazz, voire musiciens eux-mêmes (comme Pierre et Simon Boyer, l’un saxophoniste, l’autre batteur).
La maîtrise claire et dense par le montage alterné d’archives, considérables, à traiter avec des regards très récents (Liz McComb, Dany Doriz et Gigi Chauveau, les «décideurs-acteurs» de cette aventure qui continue, chacun avec la sensibilité de sa propre mémoire) permet de reconstituer une chronologie, d’illustrer et d’éclairer les propos sur cette partie de l’histoire de l’implantation du «jazz d’Amérique» en France provinciale, de focaliser sur l’importance des liens humains et de la transmission orale de proximité quand on n’a pas toujours les moyens de mettre en valeur des artistes; le temps, la patience, la volonté, la disponibilité, l’imagination, l’écoute, les collections, les techniques successives, les savoir-faire mis en commun (disques, photographie, film, archivage, organisation, son, radio…), l'amour du jazz sans calcul et sans limite, toujours dans la convivialité de la table et des échanges, compensent largement et avantageusement des moyens professionnels de structures commerciales, car il y a une véritable ligne artistique qui se dégage de cet ensemble.
Le talent des réalisateurs est surtout, et enfin, d’avoir posé cette première pierre solide pour la reconstitution de l’histoire très singulière d’artistes ségrégués chez eux, accueillis au sein des familles avec une réelle amitié, reconnus, certains mêmes adulés pour leur art, partout en France, et pas seulement à Paris comme on pourrait le penser trop souvent, dans le sillage des armées de libération des deux guerres. Ce qui aurait pu n’être que sinistre (la ségrégation, le racisme des deux côtés de l’Atlantique, les guerres mondiales, des militaires –parfois musiciens– non nationaux stationnés à l’étranger) a muté en véritable fête d’échanges et d’ouverture, révélant l’art du jazz avec ses valeurs: l’universalité, la liberté, la chaleur humaine, le rapprochement de la «tête et du corps» (la danse), retrouvant ainsi une perception enfin complète, un sens et une pratique populaires de l’art: d’indispensables reconquête et réappropriation du réel, dans le monde des apparences.
Ce documentaire reconstitue également une dimension aujourd'hui complètement occultée, c'est-à-dire la dimension véritablement démocratique qui a présidé à la vie du jazz pendant quelques décennies en France (l'histoire des hot clubs, des familles, des ami-e-s, dévoué-e-s au jazz, des organisateurs bénévoles, des collectionneurs, véritables musées vivants capables et responsables de transmission) qui ont, sur le mode associatif et sans subventions, fait vivre le jazz, en toute indépendance depuis les années 1930 jusqu'aux années 1980, et jusqu'à l'accaparement par la politique et par le ministère de la Culture de ce secteur du jazz, si valorisant sur le plan marchand et de «l'image», justement par sa dimension artistique indépendante, intègre dans ses motivations, et qui a permis une telle diversité esthétique et d'expressions, y compris dans la mise en valeur d'artistes de différentes générations. Ici, c'est la jazz mainstream, le blues et le gospel, dans d'autres lieux, si on pouvait faire d'autres documentaires aussi denses que celui-là, ce serait le jazz traditionnel, le bebop, le jazz de Django, le free.
Même si aujourd'hui, il en subsiste quelques traces, comme ce hot club de Limoges, cette histoire indépendante et populaire du jazz en France, qui a si bien accompagné le jazz, un art populaire, est aujourd'hui du passé, vaincue par l'esprit mercantile et normalisé de la société de consommation, de masse et de mode, si antidémocratique, et par l'esprit de système d'institutions qui ont perverti l'histoire à grand renfort de subventions et de clientélisme.
Nul doute que les artisans de ce bon documentaire, primé au New York Jazz Film Festival 2018, et invité d’honneur à Sarasota, Floride3, n'ont pas été si loin dans leurs réflexions, et c'est ce qui fait la fraîcheur et la bonne humeur de ce documentaire qui s'attarde sur la dimension humaine et artistique de cette autre «aventure du jazz» (en référence au film de Louis Panassié sorti en 1972), mais qui restitue, sans en avoir l'air, un monde aujourd'hui oublié reposant sur d'autres valeurs, malgré ses imperfections d’alors…
Si et quand le DVD sortira? Nous vous tiendrons évidemment informés!
Hélène Sportis
© Jazz Hot 2019
|
Green Book
Sur les routes du Sud
Film de Peter Farrelly, musique et coach musical Kris Bowers, avec Mahershala Ali et Viggo Mortensen, produit par Jim Burke/Brian Currie/Peter Farrelly/Nick Vallelonga/Charles B. Wessler, Participant Media, DreamWorks, 130 mn, USA, 2018, en version originale sous-titrée
Ce roadmovie multiprimé, notamment pour le casting, raconte l’histoire (vraie) du chemin improbable de deux nécessités de survies aux antipodes (instruction, métiers, sensibilités, quartiers, communautés, pratiques sociales et individuelles…) et à fronts renversés des idées reçues bien étiquetées (toujours fausses sur «la vie des autres»), pendant huit semaines d’une tournée haute en couleurs dans le sud des Etats-Unis, en 1962. Cette «association» paradoxale forcée a le mérite de contraindre les duettistes (Mahershala Ali et Viggo Mortensen), un pianiste élégant, psychologue et belle plume, et «son» chauffeur, ex-videur de club new yorkais mafieux, enfant du Bronx, à réfléchir sur des expériences/observations partagées, sur les autres et eux-mêmes.
Le rôle de «pont» qui mettra un peu de douceur dans le rapprochement entre les rugosités de ces deux peurs, est campée par Dolores (Linda Cardellini), la jolie femme cuisinière humaniste à la tête bien structurée de Tony «Lip»(embobineur) Villelonga, qui deviendra la complice indirecte du pianiste Don Shirley au parcours très singulier.
Un film bien ancré dans le feeling-tone, travaillant la perception du réel des émotions jusqu’à vider tous les abcès, tous les excès, tous les non-dits; jusqu’à rendre nette et indéfectible une amitié qui durera jusqu’à 2013, par décès des deux amis, à moins de deux mois d’intervalle.
Une histoire si humainement forte que, perçue aussi par Nick enfant, le fils de Tony, il l’écrira pour la graver sur l’écran. Le réalisateur Peter Farrelly, descendant de grands parents irlandais immigrants, a le doigté et la précision des nuances de ceux qui portent les épaisseurs de plusieurs vies antérieures.
Pourquoi le titre Green Book? C’était le nom du guide des lieux (hôtels, restaurants, bars…) réservés aux Afro-Américains dans le Sud pendant la ségrégation, et qui est confié à Tony pour «faciliter» le voyage de l’artiste; l’opscule avait été imaginé et publié par Victor Hugo Green (ça ne s’invente pas), de Harlem, NY (1892-1960), employé des Postes, édité de 1936 -pour les Afro-Américains qui ont fini aussi par acheter des voitures (pour les profits, pas de ségrégation!) devenues économiquement accessibles et obligatoires pour migrer et trouver du travail par la combinaison « explosive » du taylorisme, du diesel, du New Deal post-crise de 1929- jusqu’en 1966, deux ans après le Civil Rights Act du 2 juillet 1964 interdisant les discriminations, point d’aboutissement du combat de Martin Luther King.
Au début du film, un indice en forme de clin d’œil à Charles Mingus (une affiche de concert) qui, lui aussi, a été rejeté par les cadres racistes de la musique classique par peur de la concurrence. Un film qui ne laisse rien au hasard, et qui permettra à beaucoup de découvrir un personnage, Don Shirley (1927-2013), le grand pianiste, concertiste, compositeur classique et pas seulement car il se frotta aussi à la musique populaire, un autre André Previn, en quelque sorte, afro-américain au lieu d'euro-américain.
Il eut le privilège et la particularité d'étudier la musique à Leningrad dès l'âge de 9 ans (en 1936, inimaginable!!!) en raison de ses dispositions exceptionnelles pour la musique et le piano en particulier. Il donna son premier concert classique professionnel à 18 ans avec le Boston Pops dans une soirée consacrée à Tchaïkovski. Il a également étudié la psychologie à l'Université, et il l'a pratiqué professionnellement. Sa carrière est donc atypique entre concerts classiques (il fut l'un des trois pianistes solistes invités à la Scala de Milan avec Arthur Rubinstein et Sviatoslav Richter, pour un concert consacré à Gershwin), concerts de jazz (il réalisait une synthèse entre sa manière classique et ses racines très originale), ses activités de psychologue à partir de son expérience musicale. Il connut même un important succès public avec un très beau thème «Water Boy» qui fait directement référence à ses racines afro-américaines, jamaïcaines en particulier. Il multiplia les récitals en mêlant tout ce qui fait sa richesse et sa complexité. Des enregistrements témoignent de sont art. C'est donc un film, qui pour avoir distrait un important public avec humour et amertume en inversant les rôles dans la société américaine, n'en est pas moins très profond, et d'abord par le caractère authentique de cette histoire qui en dit plus sur les questions sociales, raciales et artistiques qui traversent encore la société américaine que beaucoup d'ouvrages savants. La performance des acteurs est également remarquable.
Hélène Sportis
© Jazz Hot 2019
Pr. Don
Shirley
Live
2001, benefit concert in Detroit MI, «Happy Talk» (Rogers-Hammerstein), Robert Field (b)
https://www.youtube.com/watch?v=EQdUljb4tLc
Live
1955, Don Shirley (p), Richard Davis (b), «How High is the Moon» , TV
program, Laszlo Pictures
https://www.youtube.com/watch?v=H6XZ7XiNdi8
Biographie audio
https://www.youtube.com/watch?v=uF9zsNlAP5k
https://www.youtube.com/watch?v=-FVl6SfQi-Y
Lost Bohemia, documentaire de Josef Astor, 2010, Laszlo
Pictures, USA, 77 mn
https://www.imdb.com/title/tt1763245/fullcredits?ref_=ttpl_ql_dt_1
https://www.youtube.com/watch?v=jptfPNncs-w
(minute 0’43'')
|
 Ragtime Ragtime
Drame historique de Milos Forman (155 min., USA, 1981)
Re-sortie en France le 27 mars 2019
Contrairement à ce que son titre pourrait laisser croire,
Ragtime de Milos Forman n’est pas un
film musical. Cette œuvre méconnue du cinéaste américano-tchèque, sortie en
1981 (l’année suivante en France), fut un échec commercial et demeura invisible
durant plus de trente ans. Elle ressort aujourd’hui au cinéma, dans une version
restaurée, et en DVD (Arte Éditions), un an tout juste après la disparition de
son auteur. Elle dresse un tableau baroque de la bonne société new-yorkaise de 1906 et,
en contre-champ, celle rude mais bouillonnante des émigrés d’Europe de l’Est
(l’ascension inattendue de l’un de ces nouveaux arrivants renvoie au propre
parcours du réalisateur) et enfin celle de la communauté afro-américaine,
vivant déjà au rythme des musiques syncopées. On y suit les destins croisés
d’Evelyne, jeune femme en quête d’émancipation, rêvant de s’accomplir dans le
milieu du spectacle et d’une paisible famille bourgeoise (le mari, l’épouse et
le beau-frère), corsetée dans les conventions, et se trouvant percutée par le
combat pour sa propre dignité du pianiste Coalhouse Walker Jr., victime d’une injustice
raciste.
Ce qui débute comme une fresque élégante et colorée de la
Belle Epoque, se transforme au fil du récit en une critique acide de la société
américaine qui, tout en embrassant la modernité et les promesses du XXe siècle
naissant, fonctionne encore sur des schémas de pensée inégalitaire face auquel
une partie des protagonistes est amenée à se positionner progressivement selon
sa morale personnelle.
Ragtime parvient à traiter avec une profondeur certaine, et sans se départir d’une forme de légèreté et d’humour, de la question
du choix de vie, par ambition ou par sens moral intégré ou conscientisé.
Jérôme Partage
© Jazz Hot 2019
|
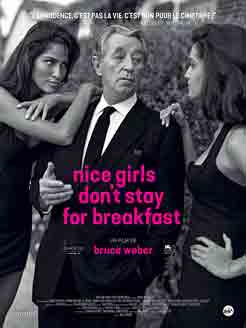
Ce
portrait de Robert Mitchum (6 août 1917-Bridgeport, CT / 1er juillet
1997-Santa Barbara, CA) est le travail de Bruce Weber (29 mars
1946-Greensburg, PA) photographe et réalisateur, notamment connu par les
amateurs de jazz pour Let's Get Lost, film-portrait sur le trompettiste
Chet Baker (sortie 1988, USA, 120mn) ou ses photos du pianiste-chanteur
de New Orleans, Harry Connick Jr.
Le noir et blanc est l’un de ses
moyens d'expression pour approcher, au plus près du grain, l'âme et
l'art de ceux qu'il admire; là, pour Robert Mitchum, il met en relief
ses facettes pour certaines moins sues (acteur, poète, auteur,
compositeur, chanteur, entertainer de shows TV) en le faisant aussi se
dévoiler, par ses propos, sa gestuelle, sa dégaine, ses regards, ses
silences, ses masques, ses addictions, ses souvenirs et ceux de ses
proches, personnels et professionnels.
Ses fils conducteurs sont les
femmes, une histoire du cinéma sur presque 60 ans, les deux
intelligemment insérés en contrepoint du travail d'enregistrement d'un
disque filmé en 1991: toutes ces dimensions révèlent une
hypersensibilité cachée sous la brusquerie désinvolte, le cocktail
captivant. Ce qui touche le plus chez Robert Mitchum est son sens direct
du réel, sa façon d'affronter, produits de la fêlure d'une biographie
de départ qui ne cessera de le tourmenter, mais aussi lui donnera
l'épaisseur du vécu dans tout ce qu'il entreprendra. Ce n'est pas le
courage qui lui manque car il s'est échappé à 14 ans d'un pénitencier de
Géorgie; déjà acteur, ce sera la prison pour drogue et il enverra
paître la redoutable HUAC (Commission des activités anti-américaines de
la chasse anti-communiste dite «chasse aux sorcières») à qui il dit
qu'il ne répond jamais à des gens avec qui il ne prendrait pas un verre:
un caractère bien trempé, plutôt dans le whiskey (ses racines
irlandaises). Un film 100% Mitchum sans sucre ajouté, l'hommage rendu à
un homme-artiste, plus que mérité, de la part d'un amateur d'art
authentiquement populaire.

Mitchum x Weber
par Bruce Weber
Mitchum x Weber, La Rabbia, Paris, parution 20 février 2019, édition numérotée 1500 ex., 68p, format 240mm x 315mm, http://www.larabbia.com/books/mitchum-x-weber/
Afin
de (re)garder une légende, de réfléchir sur des détails de sa
personnalité, de pouvoir approfondir, s’attarder, ou revenir sur les
expressions complexes de Robert Mitchum, Bruce Weber a conçu un recueil
de photographies (en partie de lui-même), documents d’archives, phrases
et textes, comme un journal de son film. C’est une idée pertinente car
le temps de tourner les pages est plus lent que celui de l’image-cinéma,
comme le grain de l’écran est plus gros mais aussi plus fugace que
celui du papier cartonné, et les deux médias donnent ainsi des
perceptions complémentaires pour décrypter un taiseux complexe et très
expressif dans son travail artistique qui puise dans son vécu.
Hélène Sportis
© Jazz Hot n°686, hiver 2018-2019
|
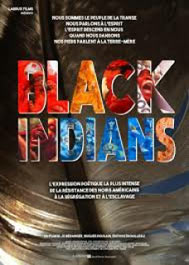 Black Indians Black Indians
Documentaire de Jo Béranger, Hugues Poulain, Edith Patrouilleau,
produit par Lardux Films, 92 mn, France, en version originale sous titrée, sorties en salles le 31 octobre 2018
Ce film nous (re)plonge dans une partie de l’histoire afro-amérindienne peu connue car peu glorieuse pour les esclavagistes devenus suprémacistes, avec des procès, encore jusqu’à ce jour, en raison des droits de propriété du sol y compris de la part de certains «Natives» (Amérindiens) contre les «Freedmen» (Afro-Amérindiens) manipulés pour des questions d’intérêts et même de racismes historiques. La transcendance artistique a permis à une minorité d’environ 270 000 âmes à ce jour, issues des rencontres entre esclaves d’Afrique et Indiens natifs depuis le début du XVIe siècle, en particulier à New Orleans –qui sera fondée en 1718– mais pas seulement, de continuer à survivre dans l’injustice et l’inégalité du racisme, mais surtout de les/se dépasser pour exister et vibrer avec l’énergie du désespoir, par la pérennisation des artisanats d’arts ancestraux, en réalisant des costumes, de pierreries, perles, fils, aluminium récupéré découpé/ciselé, plumes, fourrures, tissus aux couleurs chatoyantes dont les formes, l’ampleur, comme les accessoires –chaussures, coiffes, maquillages, bijoux percussifs– sont autant de secrets transmis par la pratique et l’oralité: autour des tables, les hommes, les femmes, les enfants cousent, brodent, collent, ouvragent, enrichissent, répètent, se parlent, chantent, organisent inlassablement pendant des milliers d’heures, soutenus par la pratique sociale de la syncope hypnotique des tambours, de la danse, de la transe, de la magie des prêches, des phrasés gospel d’églises, des mises en scène savamment orchestrées et de la distribution des rôles très précis de chacun pour le Mardi Gras (mi-mars) puis la St. Joseph trois jours après. Tous ces savoirs, dits et non dits, codifiés mais laissant l’imagination vagabonder, viennent des rites aux confins du vaudou, du chamanisme, du culte yoruba des orishas, du besoin vital d’incantation pour se ressourcer auprès des esprits des ancêtres et trouver le courage d’affronter l’adversité. Une quarantaine de tribus rivalisent d’ingéniosité poétique et de concentration pour «paraître» dans la période du New Orleans Jazz & Heritage Festival (créé par George Wein en 1970) qui coïncide avec le Carnaval, avec un mantra commun sans équivoque: «On ne pliera pas, on ne veut pas.» Pas étonnant que les autorités les regardent de travers car, loin d’être des rêveurs, ces survivants ont été de tous les combats et de toutes les résistances: contre l’esclavage, pendant les boycotts, les guerres civiles et internationales, les émeutes, la lutte pour les droits civiques version Martin Luther King et version Black Power des Black Panthers jusque dans les années 1970, comme ils vont aujourd’hui soutenir avec détermination et fêter leurs anciens à l’Hospice St. Margaret's, avec une croyance indestructible: «On vibre parce qu’on est l’humanité», une foi inébranlable puisée en tapant des pieds en rythme, dans la terre de Congo Square (quartier de Tremé), ancien territoire sacré des esprits Houmas mais aussi lieu de l’ancien marché aux esclaves. Le documentaire nous immerge dans l’atmosphère chaude, humide, odorante et épicée des bayous, de « NOla », de l’Old Man River «Mississippi», en nous présentant au «Big Chief» David Montana, neveu du révéré Chief Allison «Tootie» Montana (1922-2005), le Chief des Chiefs pendant plus d’un demi-siècle, couseur infatigable lui aussi mais mort en Conseil municipal alors qu’il parlait de la violence policière à New Orleans… Tout ça ne s’invente pas car rien n’est laissé au hasard quand les esprits veillent. David Montana vient en tournée en France du 20 au 31 octobre, un personnage «haut en couleurs» au propre comme au figuré. Un film à ne pas rater dès sa sortie le mercredi 31 octobre, car les malveillants esprits du profit guettent le nombre de spectateurs pour nous empêcher de voir ce qui nous intéresse et qui les dérangent.
Hélène Sportis et Jérôme Partage
Black Indians (http://www.lardux.net/article557)
Documentaire de Jo Béranger (http://www.lardux.com/article86), Hugues Poulain, Edith Patrouilleau, produit par Lardux Films (http://www.lardux.net/article557?rubrique1), 92 mn, France, en version originale sous titrée, sorties en salles le 31 octobre 2018:Paris/Espace St Michel, Marciac/Ciné JIM, Clermont/Ciné Capitole, Lyon/Comoedia, Port de Bouc/Le Méliès, Montreuil/Le Méliès, Saint Ouen l'Aumone/Utopia, Villeneuve d'Ascq/Kino Ciné, Orléans/Cinéma Les Carmes, Aubervilliers/Le Studio, Périgueux/CGR Cinéma, Montpellier/Utopia, Fontenay sous Bois/Kosmos, Saint Denis/l'Ecran, Marseille/Le Gyptis, Cannes/les Arcades.
© Jazz Hot n°685, automne 2018
|
 Detroit Detroit
Drame historique de Kathryn Bigelow (143 min., USA, 2017)
Sortie en France le 11 octobre 2017
Ce
film réalisé par Kathryn Bigelow sur un scénario de Mark Boal,
journaliste, a été sorti en mémoire des 50 ans des événements; il
relate, dans une reconstitution factuelle clinique, plusieurs scènes
survenues lors des émeutes de juillet 1967 à Détroit, tant dans des
ambiances collectives (scènes de rues, des locaux de polices, concours
pour la Motown, tribunaux) que de huis-clos, dont l’une des exactions
s’est déroulée à l’Algiers Motel. Ce rappel historique de violence
institutionnelle extrême permet une nouvelle fois de mettre en
perspective les motifs (raciaux) avec les conséquences multifactorielles
graves et durables sur une société, et de comprendre à quel point la
trame dramatique d’une situation antérieure donnée ne se redresse
jamais, car elle oblige les humains à se dépasser, ce qu’ils ne font que
très rarement, surtout quand leurs avantages et privilèges en
dépendent. A Detroit plus encore qu’ailleurs aux Etats-Unis, et y
compris sous la récente présidence Obama, les difficultés des
Afro-Américains, n’ont fait qu’empirer (augmentation des inégalités à la
fin de son second mandat), allant jusqu’à la déclaration de faillite
de la ville en juillet 2013: «Motor City» a perdu son industries, ses
emplois, 60% de sa population, 90% de sa superficie habitable, la moitié
des 40% restants de ses habitants étant sans emploi, ils sont à la rue,
les collections d’art sont en péril, les retraites publiques, les
prestations de sécurités, sanitaires et sociales ont été drastiquement
réduites, mettant des personnes âgées à la porte des maisons de
retraites, parfois à la rue aussi. Le bilan aujourd’hui: les finances
municipales seraient assainies au prix de cette saignée, l’automobile a
fait place à la mode du moment, l’agriculture bio, surtout quand le prix
de la main d’œuvre reprend le chemin des champs de coton. Ce qui fait
que certains manipulateurs pensent que Kathryn Bigelow et Mark Boal
n’étaient pas «légitimes» pour faire un tel film, est que rappeler les
périodes ouvertement honteuses de l’histoire d’un Etat envers ses
citoyens, empêche les esprits de s’endormir dans un révisionnisme
déculpabilisant. On pourrait croire que la musique, la Motown, ne
concerne que les oreilles et le plaisir, c'est pourtant bien plus
compliqué...
Jazz Hot
Jazz Hot n°682, hiver 2017-2018
|
A Great Day in Paris
Cinéma Le St André des Arts (Paris 6e), 17 mai 2017
Le
17 mai, Michka Saäl nous conviait à la première du film A
Great Day in Parisau cinéma Le St André des Arts à Paris. Cet événement s’inscrit
dans le cadre des découvertes de St André, sélection authentique
s’il en est, tant A
Great Day in Parisest surtout une histoire d’amitié. Tout à commencé en 2008, pour
les 50 ans de la fameuse photo «A
Great Day in Harlem» d’Art Kane, donnant à Ricky Ford l’idée
de reproduire l’évènement à Paris avec des musiciens de Jazz qui
vivent en France. Après presque un an de gestation, une photo a
enfin été prise à Montmartre, scène immortalisée par le
photographe Philip Lévy-Stab. La
cinéaste d’origine tunisienne Michka Saäl, formée en histoire de
l’art et en sociologie à Paris et en Cinéma à Montréal,
passionnée par les liens qui unissent les êtres, a ainsi décidé
de réaliser un court-métrage sur l’exil des musiciens de jazz. Ce
documentaire, sur la réunion de plus de soixante-dix jazzwomen et
jazzmen vivant en France, est entrecoupé d'entretiens avec des
musiciens comme John
Betsch, Sangoma Everett, Bobby Few, Ricky Ford, Kirk Lightsey, Steve
Potts, et quelques autres, réalisés le plus souvent à domicile,
favorisant ainsi les anecdotes et l’humour. A cela s'ajoute des
prises de vues de Montmartre, lieu de retrouvailles pour cette petite
communauté d'artistes; la dernière séquence étant, bien sûr, le
moment de la prise de vue sur les marches.

Ce
17 mai, au
cinéma St André des Arts, Sangoma
Everett, Bobby Few, et Ricky Ford avaient fait le déplacement, ainsi
que Curtis
Young, historien du jazz,et quelques amis et fidèles tels que Trevor,
Alfie. Le public, très réactif, a ponctué la projection de ses
exclamations et de ses rires.Michka
Saäl, visiblement très émue, a pris la parole à la fin de la
projection pour rappeler la genèse et les étapes de construction du
film, après quoi elle fut très applaudie. Bobby et à Ricky sont
intervenus pour témoigner à leur tour et ont tenu à remercier
Michka pour sa persévérance.
Pour
ma part, je suis intervenu au nom de Jazz Hot pour rappeler qu’en
2016, pour célébrer «l’International Jazz Day», la chanteuse
Denise King et le danseur chorégraphe Brian Scott Bagley avaient
aussi organisé une photo sur l’esplanade du Trocadéro (voir Jazz
Hotn°675).
Texte et photo: Patrick Martineau
© Jazz Hot n°680, été 2017
|

Miles Ahead
Biographie de Don Cheadle (100 min., USA, 2015)
Sortie en France le 17 juillet 2016 et le 24 janvier 2017 (VOD)
L'idée
d’un film sur la vie de Miles Davis est apparue de manière détournée à Don
Cheadle en 2006, lorsque le trompettiste a fait son entrée au «Rock
and Roll Hall of Fame». Soutenu par le neveu du jazzman, le projet de
l'acteur (qui est également un "fan") a manqué de s’interrompre à
plusieurs reprises, faute d’argent. Cheadle est cependant parvenu à réunir les
fonds nécessaires en 2014, grâce au financement participatif, faisant de ce «biopic»
un film complètement indépendant, bénéficiant également de l’appui et de la notoriété de l’acteur
britannique Ewan McGregor. Distribué aux Etats-Unis par Sony, propriétaire d’un
grand nombre des albums de Miles, à travers sa filiale, Columbia Records, le
film a connu une promotion discrète. Il a été présenté en clôture du festival
du film de New York, en octobre 2015, avant de sortir, le 1er avril
2016, dans seulement quatre cinémas américains! En France, le film est
arrivé dans l’été 2016, de façon tout aussi furtive, si ce n’est l’avant-première
organisée à Marseille par le festival Jazz des Cinq Continents. Il est depuis
janvier dernier visible en «vidéo à la demande» (VOD).
Plutôt
qu’un récit de carrière, Miles Aheadévoque les démons du trompettiste pris dans une course-poursuite, à la
recherche d’un enregistrement volé, et épaulé dans sa quête par un journaliste
du magazine Rolling Stone, (Dave Braven alias Ewan McGregor). L’action se situe pendant la période de retrait
de Miles, à la fin des années soixante-dix, entrecoupée de flash-backs. On
notera à ce titre les similitudes avec Born
to Be Blue sur Chet Baker. Les deux films choisissant d’aborder
 (sans doute pour son intensité dramatique) des moments d’extrême
vulnérabilité du
héros-musicien, d’éloignement de la scène et du public ainsi que
l’emprise de
la drogue. Ces thèmes – notamment l’addiction – étaient également présents (et
pour cause) dans d’autres biopics jazz comme Bird (Clint Eastwood, 1988) ou Ray(Taylor Hackford, 2004). Mais ces long-métrages relataient la vie de leur sujet
sur le long-court. (sans doute pour son intensité dramatique) des moments d’extrême
vulnérabilité du
héros-musicien, d’éloignement de la scène et du public ainsi que
l’emprise de
la drogue. Ces thèmes – notamment l’addiction – étaient également présents (et
pour cause) dans d’autres biopics jazz comme Bird (Clint Eastwood, 1988) ou Ray(Taylor Hackford, 2004). Mais ces long-métrages relataient la vie de leur sujet
sur le long-court.
Malgré toute la bonne
volonté de Don Cheadle pour incarner le jazzman, restituant ses mimiques, sa
voix, ses postures et utilisant même une de ses trompettes, l’histoire peine à
décoller et à faire oublier les inexactitudes. Supervisée au départ par Herbie
Hancock, la direction musicale du film a été finalement assurée par Robert Glasper
et c’est l’élément le plus réussi de cette œuvre! Il faut, par ailleurs,
rappeler qu’en 2016, à l’occasion du 90e anniversaire de Miles, le
pianiste a également publié Everything’s
Beautiful (Columbia-Legacy), un
album aux accents jazz, hip hop
et soul sur lequel il mêle habilement des enregistrements originaux du trompettiste
à des samples inédits, comme des instructions données par Miles en studio
après de faux départs.
Michel Antonelli
© Jazz Hot n°679, printemps 2017
|

Born to Be Blue
Biographie de Robert Budreau (97 min., Royaume-Uni, Canada, USA, 2015)
Sortie en France le 11 janvier 2017
Ce «biopic»,
agrémenté d’éléments de fiction, consacré à Chet Baker, relate la période où l’existence
du musicien bascule après ce tristement célèbre épisode de 1966 où le
trompettiste est passé à tabac dans un parking. Agression qui lui laisse la
mâchoire fracassée, le privant de la capacité de jouer de son instrument. Le
film raconte comment sa petite amie, Jane, parvient à lui faire traverser cette
épreuve et remonter sur scène.
Dans l’atmosphère
glauque d’un Los Angeles à la James Ellroy, l’ange déchu, ancienne belle
gueule, cherche à fuir les démons qui le hanteront toute sa vie. Le climat
musical est bien restitué et la photographie, qui alterne couleur et noir et
blanc, nous fait penser à des pochettes d’albums de l’époque. Ethan Hawke, dans
le rôle de Chet, félin déglingué par la drogue, livre une prestation au fil du
rasoir et se prête parfaitement à revêtir les oripeaux de l’ex-vedette du jazz
weast coast dont le succès reposa davantage sur l’image que sur la qualité du
jeu. Le défi est ainsi porté sur la scène du Birdland où il doit s’exécuter
devant ses pairs, en l’occurrence Dizzy Gillespie et un Miles Davis assez
impitoyable.
Ce film est à voir en parallèle avec Let’s Get Lost (1988) deBruce Weber, formidable documentaire où Chet Baker se livre à cœur
ouvert, ôtant tout élan nostalgique vis-à-vis de son personnage. Le
titre Born to Be Blue est tiré d’une
composition du trompettiste qui a été aussi enregistrée par Grant Green et
Freddie Hubbard.
Michel Antonelli
© Jazz Hot n°679, printemps 2017
|
Le 14 février, Bobby Few (p) avait convié, à La Java, unparterre d’amis du jazz à l’avant-première d’un film à son sujet, Musical
Hurricane de Nicolas Barachin. Un projet qui a fait l’objet d’un financement
participatif, sur la base du constat qu’aucun documentaire n’avait jusqu’alors
été consacré à cette belle figure du jazz, dotée d’une personnalité très
attachante. Nous eûmes l’occasion de nous entretenir avec le réalisateur juste
avant la projection, qui nous expliqua que la levée de fonds avait permis de
réunir l’équivalent de 7000€, somme nécessaire au financement du montage et de
l’étalonnage, mais sans toutefois autoriser une rémunération du travail
nécessité par le film. Barachin n’oublie d’ailleurs pas de mentionner cet
aspect désintéressé des passionnés de jazz, qui est bien souvent le lot des
musiciens eux-mêmes, évoquant tout spécialement la générosité de jazzmen comme
Bobby Few en la matière. Outre le plaisir de découvrir ou redécouvrir les
différentes étapes de la carrière du pianiste (apprentissage de la musique dès
l’âge de 7 ans à Cleveland, amitié avec Albert Ayler, séjours à New York, en
Europe et à Paris), on est agréablement surpris du fait que le musicien mette
en parallèle son arrivée dans la capitale française au moment où, selon ses
propres dires, une révolution avait lieu à Paris, et son expérience avec Steve
Lacy, qu’il crédite de la naissance d’un goût jamais démenti pour le free jazz.
Ce dernier avait d’ailleurs débuté par le dixieland et le jazz traditionnel, et
on sent que Bobby n’aime rien tant que ce grand écart entre le jazz hot et les
formes les plus aventureuses de la musique afro-américaine. Le réalisateur du
film insiste sur le contraste entre la gentillesse un peu surannée de Bobby
Few, et sa défense de l’idée que, désormais, le monde a sans doute à nouveau
besoin d’une révolution («les choses sont un petit peu trop tranquilles
en ce moment»). Bobby Few ne précise d’ailleurs pas si cette révolution
qu’il appelle de ses vœux est une révolution sociétale ou seulement musicale,
mais cet oubli volontaire traduit mieux que tout autre sa malice coutumière. Le
sous-titre de «Musical Hurricane» s’explique par le fait que Bobby
y décrit son effet «ouragan» (déjà approché dans Jazz Hot n°677
pour évoquer une performance en solo), qui lui permet de faire jaillir d’un
chaos de formes apparent des mélodies, citations et autres fragments de
compositions célèbres. Avec une ironie somme toute mordante, il ajoute que
cette idée lui est venue du fait qu’il n’a sans doute jamais joué les mélodies
et les accords de manière fidèle, leur préférant l’inspiration du moment et la
grâce de l’instant, en bon libertaire passionné de nature qu’il est.
La projection fut suivie d'un concert improvisé du
pianiste, en trio avec Harry Swift (b) et Ichiro Onoe (dm), assisté de quelques
musiciens venus spécialement soutenir Bobby pour un titre d’inspiration très
free (Rasul Siddik, tp, François Lemonnier, tb, Jacques de Lignieres, ts,
Chance Evans,ts) et nous n’oublierons pas l’émotion vive et sincère du pianiste
à l’issue de la projection du film, acclamé et applaudi comme il se devait par
l’ensemble des personnes présentes dans la salle.
Jean-Pierre Alenda
Photo: Patrick Martineau
Jazz Hot n°679, printemps 2017
|

La La Land
Biographie de Damien Chaselle (128 min., USA, 2016)
Sortie en France le 25 janvier 2017
La première vocation de Damien Chazelle (32 ans) était d’être batteur
de jazz. Ne s’estimant pas suffisamment talentueux, il s’orienta vers des
études de cinéma. L’apprentissage de l’instrument, parfois douloureux, il l’a
raconté dans son premier film, Whiplash(2013) qui mettait face à face un maître abusif et son élève. Avec ce deuxième long-métrage, La La Land, Damien Chazelle (également
scénariste) place encore une fois son histoire dans un contexte jazz:
cette comédie musicale, qui se veut un hommage aux classiques du genre des
années 40 à 60, met en scène la rencontre et la relation entre Mia (la touchante
Emma Stone), actrice tentant de faire carrière à Hollywood, et Sebastian (le
fringuant Ryan Gosling) pianiste de jazz courant le cachet et dont l’ambition est
d’ouvrir un club à Los Angeles. Soit deux personnages portés par leur rêve (en
l’occurrence le rêve américain, celui qui appelle à s’élever, à accomplir), qui
vont bien entendu tomber amoureux, mais également devoir effectuer des choix
entre leurs aspirations et leur amour. A ce titre, notamment, le film – largement
salué pour ses vertus euphorisantes –, sans être véritablement profond, n’est
pas si léger. Sebastian, qui vit au milieu de ses reliques (portrait de
Coltrane, etc.), est de ces amateurs de jazz intransigeants qui n’acceptent pas
sa mise au goût du jour à des fins commerciales et fustige le grand public trop
ignare pour s’y intéresser. Il rêve d’un club où l’on joue un jazz «pur
et dur», celui de Basie, de Parker, et dont l’inévitable succès sera l’accomplissement
de son grand-œuvre: «sauver le jazz»! Cause perdue pour son
ami Keith, leader d’un groupe à la mode (interprété par le musicien de «néo-soul»
John Legend), qui lui, à l’inverse, recherche l’adhésion facile du public. Ce
décalage assumé de façon bravache (et qui rappelle le discours de beaucoup de jeunes
jazzmen parisiens jouant middle jazz) nous rend bien sûr le personnage éminemment
sympathique (l’occasion de saluer également le jeu de l’acteur qui est un authentique
musicien) tout comme le réalisateur qui parle à travers lui. On est donc d’autant
plus déçu, qu’en dehors de quelques scènes de club assez réussies, le jazz soit
absent de la bande originale signée de Justin Hurwitz. Comble du ridicule,
quand après un morceau très swing, Sebastian se met au piano et exprime ses
sentiments pour Mia, il nous inflige la bluette mièvre («Mia &
Sebastian’s Theme») qui est la
chanson principale du film. Il est fort dommage que le réalisateur n’ait pas
mis son propos en pratique en nous servant tout du long de la chanson de
Broadway (et pas la meilleure), au demeurant pas très bien chantée par les
acteurs. Exception faite du thème d’ouverture, «Another Day of Sun»,
auquel est associé une excellente scène de danse; les autres manquant malheureusement
d’ampleur. Au final, La La Land aligne
les bonnes intentions et les références pertinentes (comme la reconstitution,
dans une jolie scène finale, du Caveau de La Huchette) mais ne parvient pas à faire
aboutir les idées qui auraient constitué sa réussite. Tant pis, on peut
toujours se consoler en revoyant un chef d’œuvre de la comédie musicale jazz,
tel Stormy Weather.
Jérôme Partage
© Jazz Hot n°678, hiver 2016-2017
|
  Antoine Hervé Antoine Hervé
La Leçon de jazz : Keith Jarrett
Long As You Know, You’re Living
Yours, Fortune Smiles, Coral, Köln part IIc, Spiral Dance, The
Windup, Don’t Ever Leave Me, Bregenz part I, Köln part IIa,
Bregenz part II, Stella By Starlight, Over the Rainbow, Basin Street
Blues, My Song, Variations in Jazz
Antoine Hervé (p)
Durée: 1 h 38'
Enregistré à Grenoble (38)
RV Productions 122 (Harmonia Mundi)
En public, et seul au piano, Antoine
Hervé, dont la réputation musicale n'est plus à faire, se propose
d'analyser, commenter et démontrer avec beaucoup d'admiration et
d'humour, et un grand sens de la pédagogie, les subtilités et
l'originalité du jeu de piano de Keith Jarrett à travers quelques
unes de ses œuvres les plus marquantes. La presque totalité des
interventions étant filmées en contre-plongée sur le clavier,
elles raviront les pianistes amateurs, qui n'ont pas eu la chance de
fréquenter les classes de jazz des conservatoires, même s'il existe
par ailleurs dans le commerce, de nombreuses transcriptions écrites
des disques de Jarrett. Retraçant tout d'abord la carrière
précoce du pianiste et compositeur, il parcourt plusieurs étapes de
son œuvre en commençant par la période, encore marquée très "rock", des duos avec Gary Burton, en jouant un
medley de «Long As You Know, Fortune Smiles, et Coral»
trois thèmes des années 70.
Puis il évoque «Facing You»,
premier de la longue série des mémorables concerts en solo,
enregistrés pour ECM. S'intéressant ensuite au célèbre Köln
Concert, il insiste alors sur l'énergie, et le feeling déployés
par Jarrett dans cette entreprise, où, souvent installés à la
main gauche à la manière d'un ensemble de bongos et de congas,les
rythmes sont repris à la main droite par des "notes
fantômes", tandis que ce qui reste de doigts libres s'emploie
à l'improvisation, à la manière d'un Rakhmaninov façon "rock'n'roll".
La répétition de courtes cellules
mélodiques, les chromatismes imbriqués, le souci de faire chanter
le piano, la relation fusionnelle avec l'instrument par une
gestuelle exubérante à la recherche de "l'énergie",
où, les pieds ancrés dans le sol, le buste courbé au dessus des
cordes il fait littéralement corps avec le piano, tout cela est
lumineusement expliqué. Pour la période du « quartet
européen » avec Jan Garbarek, le musicien-conférencier
s'attache à décortiquer finement dans «Spiral Dance»
et «The Wind Up», les formules rythmiques les plus
complexes et l'utilisation des modes pentatoniques propres au style
de Jarrett.
Passant ensuite à la longue saga (déjà
plus de trente ans d'existence) du trio «Standards»,
(avec Gary Peacock et Jack DeJohnette), Antoine Hervé insiste à
nouveau sur la dynamique et le toucher particulier déployés pour
les phrases «en cloche» (lorsque les notes attaquées
avec vigueur, semblent comme disparaître puis revenir). Il relève
les accords "parfaits" hérités de l'univers médiéval
et baroque que Jarrett semble bien connaître, ainsi que l'influence
de Bach, Debussy, Ravel, et même celle des rythmiques particulières
des gamelans balinais sur son jeu, sans oublier sa filiation avec le
pianiste Paul Bley.
Avant de conclure avec le célébrissime
thème de «My Song», les enrichissements harmoniques
de la grille d'accords bien connue de «Over the Rainbow»
et une interprétation magnifique de «My Romance»,
Antoine Hervé nous livre (pour «Stella By Starlight»)
une fine analyse d'une des bottes secrètes de Jarrett. Celle-là
même qui fascine les spectateurs les plus assidus de tous ses
concerts en trio qui se livrent alors, pendant quelques secondes, au
petit jeu de «qui trouvera le premier»... le nom du
morceau avant la fin de son "introduction". Jarrett
s'ingénie souvent alors, à dissimuler le thème par de multiples
ruses faites de variations rythmiques et d'harmonies mystérieuses,
jusqu'à ce qu'enfin, après quelques mesures, deux ou trois petites
notes ne mettent fin au suspense. Alors, le bassiste et le batteur,
peut-être plongés eux aussi jusque là dans la même expectative,
rejoignent enfin le pianiste une fois thème , tempo et tonalité
révélés, pour un développement lui aussi riche de surprises.
Magistrale démonstration qui rend à elle seule ce DVD
incontournable. Absolument passionnant!
Daniel Chauvet
© Jazz Hot n°668, été 2014
|
  Treme Treme
David Simon et Eric Overmeyer
HBO
Home Entrertainment (Warner Bros.)
Plus que des ouvrages pseudo-savants sur le jazz comme il en paraît
régulièrement en France, la première saison de la fiction Treme offre une véritable entrée dans le monde du jazz et en
particulier de La Nouvelle-Orléans. Cette série, produite par la chaîne HBO et
réalisée par les créateurs de The Wire (sur la vie politico-judiciaire de
Baltimore), est une superbe fresque de l’après-Katrina. Le titre est
révélateur: il s’agit d’un quartier dont la vitalité est particulièrement
symbolique de l’importance culturelle de New Orleans (Shannon Powell et Lucien
Barbarin- entre beaucoup d’autres- y sont nés). Sur le plan
musical, on retrouve d’authentiques performances et apparitions du Rebirth
Brass Band, de Coco Robicheaux, Donald Harrison (as), Troy Andrews (tb), Tom
McDermott (p), Terence Blanchard, John Boutté (voc), Kermit Ruffins, Allen
Toussaint, Dr. John, etc. La musique n’y est pas qu’un prétexte, elle est au
cœur du scénario avec le personnage d’Albert Lambreaux (un Indian big chief,
joué par le sobre Clarke Peters) et son fils (trompettiste bebop… infidèle à la
tradition familiale!), d’Antoine Batiste (tromboniste joué par le
truculent Wendell Pierce), du DJ passionné joué par Steve Zahn. On entend
toutes les musiques de New Orleans, funk, blues, marching bands, swing, r ‘n b
et les propos mêmes des personnages évoquent Jessie Hill, Wynton, Smiley Lewis,
Wardell Quezergue… La lutte pour la survie personnelle et pour la survie d’une
culture est envisagée sous toutes ses formes, de la protestation politique
incarnée par le prof de fac à la virulence incontrôlable joué par John Goodman
à la recherche d’un frère perdu dans les méandres de la gestion administrative
en passant par une chef de restaurant qui lutte pour son établissement. La
densité des références culturelles est impressionnante et elles sont, bien sûr
(quand on connaît le savoir-faire cinématographique américain), intégrées à un
scénario passionnant où les personnages sont magnifiquement construits, servis
par des acteurs et des dialogues attachants. Cette série, par sa pédagogie
indirecte, est sans doute la meilleure façon d’entrer dans la culture du jazz.
Jean Szlamowicz
© Jazz Hot n°657, automne 2011
|
 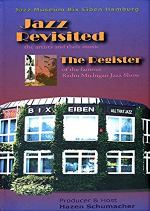 Jazz Revisited Jazz Revisited
Hazen J. Schumacher
Jazz Museum Bix Eiben Hamburg
www.bixeibenhamburg.com
Un DVD et deux CD nous ont été adressés par ce centre
culturel dont le projet de préservation du patrimoine est exemplaire. Il s’agit
d’un «work in progress» de centralisation d’archives. Le point de départ
vient d’Hazen J. Schumacher Jr de l’Université du Michigan (Ann Arbor) qui a
fait don d’environ 1550 bandes magnétiques qui sont les émissions
radiophoniques «Jazz Revisited» de 1967 à 1997. L’un des deux volets du DVD
que l’on trouve en fait sur Youtube,
nous présente Hazen J. Schumacher Jr et son aventure (consacrée aux disques de
1917 à 1947). L’un des principes de l’émission était de présenter des versions
différentes d’un même thème, façon ludique de démontrer qu’en jazz c’est la
façon de jouer qui importe plus que le thème qui n’est qu’un alibi à
l’expression. Le CD JazzBix Sugar nous propose six versions de ce thème par
Louis Armstrong, Lee Wiley (voc) avec Muggsy Spanier, Benny Goodman en quartet,
Billie Holiday avec Teddy Wilson, et Ziggy Elman. Il s’agit d’un CD hors
commerce dont le but est de faire connaître le Jazz Museum. Notons que le Jazz
Museum a mis à disposition ces 700 heures et 9000 titres à la Lufthansa pour
l’agrément de ses passagers. Pour célébrer l’évènement, JazzBix distribute un
CD d’un titre, « Over the Waves » par Sharkey Bonano (tp) & his Sharks of
Rhythm, annonçant «The legendary US-radio show will be on air in the airlines». Il semble que d’autres compagnies aériennes peuvent s’adresser au Jazz
Museum pour en faire autant. Le Jazz Museum est installé à Hambourg dans des
locaux neufs amenés à s’agrandir avec l’arrivée d’autres donations annoncées.
Il s’agit pour l’instant de collections privées que l’on centralise, range,
classe, avant de devenir d’accès publique. La première partie du DVD de
présentation du Museum que vous pouvez aussi trouver sur Dailymotion,
présente le lieu. La plus grande partie est logée dans un bâtiment de 1400 m2,
répartie en sections (où elle est répertoriée). Actuellement, il y a environ 95
000 78tours, 75000 33tours, 1000 45tours, 6500 cassettes, 150 rouleaux de piano
mécanique, 500 disques d’un amateur américain sans renseignements («Secret
Jazz»), environ 2000 CD (livrets en cours d’être scannés pour faire un
catalogue imagé), 1000 disques pour la radio, les bandes de Schumacher, 4000
livres, 400 photos, 400 photos, des magazines, films et partitions (http://www.bixeibenhamburg.com/stamps/118/118_fr.html).
Il y a une section «Besides the jazz» (à côté du jazz), c'est-à-dire la
variété de l’époque à laquelle le Jazz Museum se consacre, les «débuts» (1917?) à vers 1960, ce qui touche donc au domaine publique (pour l’instant). Ce que
beaucoup rêvent de faire est donc en chantier un peu partout, avec le Jazz
Museum de Hambourg ou encore le SwissJazzOrama. Et ceci va demander un
investissement en temps humain considérable et qui laisse perplexe. Mais
l’obligation de mémoire impose de le faire.
Nous souhaitons succès au Jazz
Museum d’Hambourg.
Michel Laplace
© Jazz Hot n°657, automne 2011
|

V comme Vian
Téléfilm de Philippe Le Guay avec Laurent Lucas, Julie Gayet (90 min., France, 2010)
Diffusion: France 2, 15 juin 2011, 20h35
C’était la première fois que l’on allait voir la vie de
Boris Vian mise sous pellicule. Et on allait voir ce que l’on allait voir. Un
an que le film restait dans les tiroirs de France 2, attendant le moment
propice. Le moment, c’était mercredi, juste avant l’été, en prémices à
l’exposition que la BnF consacrera à Vian en octobre prochain.
Le pari n’était pas évident, et le parti-pris intéressant: le scénario, que l’on doit à Didier Vinson, s’est focalisé sur l’année 1946,
année charnière pour Boris Vian qui, tout en exerçant son métier d’ingénieur,
écrivit en quelques mois L’Écume des jours, J’irai cracher sur vos tombes etL’Automne à Pékin, tout en consacrant la plupart de ses soirées au jazz.
Le pivot, un peu simpliste, du film, réside dans le fait
que l’échec de L’Écume des jours au prix de la Pléiade, décerné par Gallimard à
un auteur «maison», marqua pour Boris Vian le début de la fin de sa carrière
d’écrivain. On assiste dès lors à une lente descente aux enfers artistique et
personnelle.
Le paradoxe de ce V comme Vian, c’est qu’il oscille entre
une extrême simplification des situations et des personnages (chez Gallimard,
on est vieux, les cheveux sont blancs, et on est souvent agacé par la jeunesse
et la fougue des jeunes auteurs, représentés par le seule Boris Vian ; la
guerre se résume à un simple échange œufs contre tickets de rationnement…), et
une ultra-précision qui perdra les moins vianistes des téléspectateurs
(L’affaire Vernon Sullivan est traitée de manière peu compréhensible, les liens
entre Boris Vian et le Collège de ‘Pataphysique sont pour le moins
énigmatiques…).
Le montage également n’est pas très heureux. Commencer
par la fin, relativement à la vie de Vian, il n’y a rien là d’original mais
pourquoi pas. Sauf que l’on se perd très rapidement dans la chronologie, et les
délires de Boris Vian sur son lit d’hôpital, s’ils prêtent parfois à sourire
(l’apparition des deux pontes de chez Gallimard, Arland et Paulan, déguisés
comme leurs personnages de L’Automne à Pékin), amènent à une série de scènes
inutiles et souvent de mauvais goût (Jean Paulan fantasmé en chirurgien boucher; l’infirmier noir, devenu Vernon Sullivan, qui séduit sa première épouse
Michelle).
Autre maladresse dans la réalisation: Philippe Le Guay
teste plusieurs genres cinématographiques, sans ne jamais en choisir aucun. On
assiste tour à tour à quelques scènes d’animation inutiles, de fausses images
d’archives qui se mêlent aux vraies (la découverte du Tabou, par Boris et
Michelle Vian comme chacun sait…), et des séquences oniriques mal amenées.
Enfin, à observer les dialogues entre les protagonistes,
le téléspectateur éprouve quelques difficultés à se transporter dans le Paris
des années 1940: le langage est simplifié, le tutoiement souvent de mise, et
il faut revoir cette scène où Vian attrape Sartre et Queneau par l’épaule pour
les faire rentrer dans son appartement!
Quelques notes positives toutefois: le jeu subtil des
protagonistes (Laurent Lucas incarne avec justesse un Boris Vian malade et
désespéré; Julie Gayet et Anne-Lena Strasse campent respectivement et
talentueusement Michelle et Ursula, et Arnaud Simon interprète un Major plus
vrai que nature), la belle reconstitution des décors majeurs (le Tabou, les
Trois Baudets, l’appartement du Faubourg Poissonnière et celui la Cité Véron,
tourné sur place), et la jolie et discrète musique de Pierre Bertrand.
Pari raté donc, pour cette première adaptation de la vie
de Boris Vian. On attend la prochaine…
Christelle Gonzalo
© Jazz Hot n°655, printemps 2011
|

Festival international de films documentaires
Centre Beaubourg, 24 mars au 5 avril 2011
Du 24 mars au 5 avril se
déroulait le 33e Festival international de films documentaires,
sous-titré «Cinéma du réel» au Centre Beaubourg, l'usine multicolore
située aux confins du Marais et des Halles à Paris. Le 1er avril, blague: nous arrivons et la salle est pleine (pas une petite salle, une
grande), donc nous ne pouvons entrer pour voir un film sur Archie Sheep
au 1er Festival panafricain d'Alger en 1969, un autre de 1967 sur Don
Cherry à Paris et un dernier sur une nuit avant l'incarcération de
Charles Mingus en 1968: mais c'est connu, le jazz ne fait pas
recette... le 2 avril, jour d'été à Paris, nous retournons à Beaubourg
une heure avant pour être sûrs d'entrer (la salle s'est également
totalement remplie malgré le soleil) pour voir un documentaire de 20 mn
tourné par Richard Leacock (documentariste anglais né le 18 juillet 1921
à Londres et mort le 23 mars 2011 à Paris; de 1942 à 1945, il est
opérateur de combat dans l'armée américaine en Birmanie, Chine, Inde et
dans l'Arctique) intitulé Jazz Dance (avec Roger Tilton et Robert M.
Campbell). Ce film a été tourné en 1954 au Central Plaza Dance Hall de
New York avec 2 caméras datant de la guerre dont les plans ne pouvait
durer que 18 à 20 secondes; de ce fait, lorsqu'un des deux tournait,
l'autre préparait la seconde caméra en relais; et après montage, les
plans donnent l'impression d'être longs; d'autre part, l'objet étant de
filmer l'ambiance d'un club de jazz avec des danseurs, il a dû être
post synchronisé au niveau du son (ce qui n'est pas toujours raccord
mais qui donne assez bien le change), enfin il est à voir à plusieurs
titres: des prises de vue splendides (les effets de tissus volant à
toute vitesse dans la lumière, les jupes rondes bord à bord comme deux
disques tournant sur deux platines se jouxtant), ou drôles (deux
liquides qui swinguent de façon synchro dans deux verres identiques),
l'observation, sentence silencieuse contre la ségrégation encore en
cours à cette époque: les spectateurs et danseurs sont blancs et venus
visiblement s'encanailler; seuls deux danseurs hommes aux larges
sourires chargés de l'animation de la salle mais sans faire danser les
dames (excellents tapdancer et en «couple masculin», l'un, au polo rayé
et casquette, l'autre en costume) et certains des musiciens sont
afro-américains. La séance est tournée sur quatre tempos allant du plus
lent au plus rapide («Jazz Me Blues», «Ballin' the Jack», «Royal Garden
Blues», «The Saints») et l'orchestre est composé de Willie The Lion
Smith (p), Jimmy McPartland (tp/voc), Pee Wee Russell (cl), Jimmy Archey
(tb), George Pops Foster (b), George Wettling (dm). Ce film de vingt
minutes est donc une prouesse physique et technique, lien:
http://www.richardleacock.com/#14880/Jazz-Dance
Enfin, rappelons que Mura Dehn (aussi journaliste occasionnelle pour
Jazz Hot car elle était l'amie des Delaunay) a filmé des danseurs
afro-américains avant et pendant la guerre de 1939-1945 (The Spirits
Move, www.youtube.com/watch?v=NUmGBFusL_I).
Hélène Sportis
© Jazz Hot n°655, printemps 2011
Roger Tilton, Jazz Dance, 1954
Central Plaza Dance Hall in New York City. Featuring Jimmy McPartland (tp,voc), Jimmy Archey (tb), Pee Wee Russell (cl), Willie "The Lion" Smith (p) George "Pops" Foster (b), George Wettling (dm), «When the Saints Go Marching In, Ballin' the Jack, Royal Garden Blues, Jazz Me Blues». Danseurs: Al Minns et Leon James
https://www.youtube.com/watch?v=fYdo_J3Puns
|
 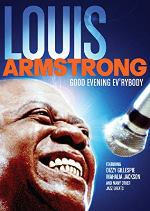 Louis Armstrong Louis Armstrong
Good Evening Ev'rybody
Titres communiqués sur le boîtier
Enregistré en juillet 1970, Newport
Durée: 1h 32’
Image Entertainment 0602527314020
Un témoignage incontournable qui célèbre la grandeur artistique de Louis
Armstrong. On a connu des vidéos (de mauvaise qualité) qui proposaient ces
extraits de concert (Newport Jazz Festival 1970. Jazz Antica; Anatomy of a
performance). Albert Spevak a refait un montage et la qualité d’image et du son
sont parfaites. Le boîtier est imprécis, aussi allons-nous décrire le contenu
de ce document exceptionnel. Louis Armstrong qui ne joue pas de trompette est
entouré d’un All Star de circonstance: Tyree Glenn (tb), Dave McKenna (p), Jack
Lesberg (b), Oliver Jackson (dm) et le remarquable professionnel Bobby Hackett
(cnt) qui avec affection pour Satch contrôle le bon déroulement de tout. Il n’y
a pas de clarinettiste mais on voit un autre trombone qui nous paraît être
Benny Morton. Le DVD débute par la répétition. D’abord, «Hello Dolly» par Louis
et le All Star (les séquences musicales sont aérées par des commentaires de
Louis Armstrong). On voit Joe Newman saluer Louis, Dizzy lui tendre…le pied.
Puis, répétition d’ "Heebie Jeebies» (Bobby Hackett), «Jeepers Creepers» (Joe
Newman), «Mack the Knife» (Jimmy Owens), «Them There Eyes» (Wild Bill Davison),
«Pennies from Heaven» par Louis avec Hackett, discussion avec George Wein, «Blueberry
Hill» par Louis et Hackett (excellent, avec la sourdine straight). A noter qu’à
l’inverse d’aujourd’hui où les balances des produits de marketing qu’on nomme
stars sont fermées au public, les répétitions de ces créateurs étaient
ouvertes, d’où pas mal de monde en scène…ce qui ne perturbe en rien le roi
Louis. Atmosphère bon enfant qu’on ne vivra plus.
Le film se poursuit par la répétition de l’Eureka
Brass Band dans lequel brille l’alto de Capt John Handy (toujours aussi méconnu
des «spécialistes» français) pour ce «The Saints ». Louis s’amuse avec Willie
Humphrey (pas moins méconnu chez nous). A noter la présence de Dizzy à la
trompette dans cette parade, loin de l’élitisme aujourd’hui de rigueur. Vient
un «Just a Closer Walk» par Handy, Jim Robinson, Percy Humphrey (tp), Hackett
et Louis qui impose le grandiose à ces quelques notes. Nous passons ensuite
dans l’ordre des titres indiqués sur le boîtier aux extraits du concert (courts
morceaux en entier, souvent avec l’annonce): «I Want a Little Girl» par DeDe
Pierce (cnt, voc) (et le PHJB comptant Capt John Handy, Willie Humphrey, Jim
Robinson, Cie Frazier, etc), «Thanks a Million» par Bobby Hackett (Dizzy et
Davison se joignent à la coda), «Way Down Yonder» par Joe Newman (Dizzy vient
l’embrasser), «I’m Confessin’ », plein d’humour, par Dizzy Gillespie (qui imite
Louis), «Them There Eyes» par Wild Bill Davison (Ray Nance et Hackett
participent à la coda), «Nobody Knows» par Jimmy Owens (solo de bugle à
cylindres joué ad lib –beau, bien que sonnant un peu bas à nos oreilles), «In
The Market For You» par Ray Nance (cnt, voc), «Ain’t Misbehavin’» par Dizzy,
extraits de «Sleepy Time» par les six trompettes (lead mené par Joe Newman)
puis par Louis Armstrong avec Hackett et le All Star qui interprètent ensuite «Pennies
from Heaven» et «Blueberry Hill ». Ed Williams annonce Mahalia Jackson qui
chante avec ferveur quatre titres. Louis Armstrong la rejoint pour «Just a
Closer Walk », ainsi que l’Eureka Brass Band mené par Percy Humphrey et le All
Star avec un Hackett qui veille sur tout. Tout ce monde poursuit dans une «Grand
Finale» par «The Saints» et «Mack the Knife ». Le film se termine par, bien
sûr, «What a Wonderful World» (en répétition). Il y a trois bonus: «Sleepy Time
Down South », «Preservation Hall» (DeDe Pierce chante et joue «Bourbon Street
Parade ») et l’interview de George Wein, artisan de l’évènement («The Story
Behind the Film» avec des extraits des séquences du film). Il y a des manques,
comme la prestation du New Orleans Ragtime Orchestra (avec Lionel Ferbos, tp)
et celle de l’Eureka Brass Band («Lord Lord Lord », «Panama »). On écoutera les
commentaires de Louis Armstrong affirmant que Bobby Hackett est son trompette
préféré (ce qu’Hugues Panassié et ses disciples n’ont pas assimilé) et
soulignant par ailleurs que dans l’évolution «some play ten notes and not a
good one»! Bref on ne s’ennuie pas. Finalement ce DVD est aussi un hommage à
l’excellence de Bobby Hackett, fin styliste. Cette nouvelle version est produite
en association, notamment, avec la Louis Armstrong Educational Foundation, Inc.
Michel Laplace
© Jazz Hot n°655, printemps 2011
|
 J.M.H. Trio J.M.H. Trio
Live at the Hocco Jazz Studio
Lady
Be Good, Seven Steps to Heaven, Cry Me a River, Cheek to Cheek, The Best Is Yet
to Come, Too Young to Go Steady, Just in Time, Have Yourself a Merry Christmas,
That Old Black Magic, Never Say Yes, Too Close for Comfort, Bebop Complicity +
Interview
Jean-Michel Hauser (dm), Vincent Bourgeyx (p), Pierre-Yves Sorin (b), Virginia
Constantine (voc), Patrick Artero (flh)
Enregistré le 14 janvier 2010 à Paris
Durée: 1h 1' + 16' 10 (interview)
Jazzing Complicity sans numéro (www.myspace.com/jmhtrio)
Le DVD live de Jazzing Complicity qui nous donne à entendre le JMH Trio,
autrement dit le trio-quartet-quintet (ça dépend des moments), disons le trio à
géométrie variable de Jean-Marie Hauser, enregistré au Hocco Club de Paris, est
un bon exemple de ce que peuvent donner de bons groupes de boîtes de jazz. Voir
ça, sur un grand écran chez soi, est une merveille. On s'y croirait. Jean-Marie
Hauser, longtemps batteur d'accompagnement de grands interprètes, est également
un excellent batteur de jazz avec un toucher de batterie très élégant et très
jouissif. Il joue tout à fait en équilibre avec le bassiste Pierre-Yves Sorin,
lui aussi tout en nuances et avec le pianiste Vincent Bourgeyx, au phrasé
aérien et vigoureux. Une ambiance jazz de boîte de jazz que vient rehausser la
mignonne chanteuse Virginia Constantine, très bonne swingueuse, venue de
Londres pour l'occasion. Plus un invité, le bugliste Patrick Artero (Virgina
Constantine scatte à l'unisson du bugle sur «Just in Time», une splendeur). Ce
jazz mainstream, c'est le jazz comme on l'aime, et il a sa touche de nouveauté,
quoi qu'en disent les pisse-froid, qui veulent du neuf à tout prix et
s'extasient sur un excrément pour peu qu'il fume encore. Avis à ceux qui vivent
loin des caves de Paris ou d'ailleurs, ce DVD, c'est une soirée jazz comme si
on y était.
Michel Bedin
© Jazz Hot n°654, hiver 2010
|
 Jean-Pierre Derouard Swing Music Band Jean-Pierre Derouard Swing Music Band
Hommage à Count Basie
Titres
indiqués à l’image
Guy Bodet, Gilles Relisieux, Pascal Gachet, Ronald Baker (tp), Philippe
Desmoulins, Ramon Fossati, Laurent Lair, Vincent Renaudineau (tb), Esaie Cid,
Raphaël Illes (as), David Sauzay (ts, cl), Eric Breton (ts), Eric Levrard (bs),
Antoine Delaunay (p), Ted Scheips (g), David Salesse (b), Jean-Pierre Derouard
(dm)
Enregistré en 2010
Autoproduction (info@jeanpierrederouard.com)
C’est un big band bien dans l’esprit de Basie même si le répertoire regarde
aussi du côté de Duke («In A Mellow Tone», «Things Ain’t What They Used
To Be» mettant en vedette le remarquable Esaie Cid, dans l’esprit Johnny
Hodges) et des standards («All of Me» chanté par Ronald Baker). Les solos de
trompette sont assumés par Pascal Gachet («Wind Machine», «Vine Street
Rumble»). Laurent Lair (tb) est aussi un bon soliste. La précision du
travail de lead trompette est dû à Guy Bodet qui s’impose, tardivement dans sa
carrière, comme un spécialiste de cette exigeante discipline («All of
Me», etc). Quant au batteur! Une merveille de mise en place, de
swing, sans effet gratuit. Jean-Pierre Derouard est un vrai batteur de big
band, toujours impressionnant en solo («Wind Machine», «Magic
Flea», bonus « Sing Sing Sing» avec Sauzay à la clarinette). Bien filmé
et d’une bonne qualité de son, ce DVD est indispensable aux amateurs de big
band.
Michel Laplace
© Jazz Hot n°653, automne 2010
|
 Alexis Tcholakian Trio Alexis Tcholakian Trio
Play Time
You
Don’t Know What Love Is, I Remember Clifford, E & Y, With a Song in My
Heart, For All We Know, God Bless the Child
Alexis Tcholakian (p), Claude Mouton (b), Thierry Tardieu (dm)
Enregistré live au Swan Club de Paris
Durée: 1h 3’ 14’’ + 25’ 2’’ (interview)
Aphrodite Records 106018-7 (www.aphrodite-records.com)
Ce DVD, fort bien réalisé, le premier du label Aphrodite Records, a été
enregistré live au Swan Club de Paris, ce qui restitue excellemment l’ambiance
particulière des bons clubs de jazz. Un jazz intime, expressif, harmonieux,
mainstream, tonique, par le trio piano-basse-batterie d’Alexis Tcholakian. Ce
trio est superbe. Au piano, donc, Alexis Tcholakian, qui, dès les premières
mesures, n’est plus là, mais dans la musique, avec elle, fredonnant par devers
soi en semi-teinte à l’unisson les impros qu’il distille, tout comme le faisait
Bud Powell, Oscar Peterson et d’autres. Il fascine, virtuose, mais sans
étalage, avec une fluidité, une énergie, qui passent par une grande musicalité
et de belles inventions. Ce sont les mêmes caractéristiques pour le
contrebassiste Claude Mouton, aussi talentueux aux doigts qu’à l’archet, très
impliqué, également, dans sa musique, qui l’absorbe entièrement. Ces deux-là se
renvoient la balle, jubilant de satisfaction quand ils ont placé leurs
trouvailles. Et pareillement, mais avec davantage de distance, pour le batteur,
Thierry Tardieu, qui souligne et porte les accents. Du beau jazz mainstream
comme on l’aime, élégant, vigoureux et sans afféterie. Une seule composition,
très tendre, du pianiste, «E & Y» au milieu de cinq standards des années
40-50, revus sans aucune trahison. Le trio Tcholakian-Mouton-Tardieu,
finalement, est un brillant trio où nul n’écrase personne, où chacun est là
pour servir les autres et, par conséquent, pour servir la musique. Un DVD qu’on
reverra avec plaisir.
Michel Bedin
© Jazz Hot n°652, été 2010
|
 Art Blakey's Jazz Messengers Art Blakey's Jazz Messengers
Tokyo 1961 + London 1965
11 titres
Art Blakey (dm)
Avec Lee Morgan (tp), Wayne Shorter (ts), Curtis Fuller (tb), Bobby Timmons
(p), Jymie Merritt (b) le 11 janvier 1961, Tokyo
et avec Lee Morgan (tp), John Gilmore (ts), John Hicks (p), Victor Sproles (b)
le 7 mars 1965, Londres
Durée: 86’
Impro-Jazz 519 (Socadisc)
 Art Blakey's Jazz Messengers Art Blakey's Jazz Messengers
Live in San Remo
6 titres
Art Blakey (dm), Freddie Hubbard (tp), Wayne Shorter (ts), Curtis Fuller (tb),
Cedar Walton (p), Reggie Workman (b)
Enregistré le 23 mars 1963, San Remo (Italie)
Durée: 53’ 15”
Impro-Jazz 531 (Socadisc)
En dépit de la qualité moyenne des images, voici des documents indispensables à
l’amateur de jazz car sont réunies ici parmi les plus beaux combos de Monsieur
Blakey. Par la grâce de l’enregistrement d’émissions de télévision (à Tokyo ou
Londres) et d’un concert dans le mythique festival de San Remo, on a ainsi une
vision non dénuée de nostalgie de ce que fut le grand creuset des Jazz
Messengers de 1961 à 1965, sous la forme de trois moutures de luxe. La
première, à Tokyo en 1961, est certainement la plus explosive tirée par
d’exceptionnels Lee Morgan et Bobby Timons, et poussée par un Art Blakey au
sommet de son énergie qui n’a pourtant jamais été faible. Le répertoire («The
Summit », «Dat Dere», un incendiaire «A Night in Tunisia», «Yama», «Moanin’
», «Blues March») est à la mesure de ce déferlement et même Wayne Shorter
qu’on a vu plus tranquille s’emporte dans cette vague. Jymie Merrit est ce
grand bassiste qui a donné aux côtés de Blakey cette couleur explosive sans
pareille. Il possède un son très mingusien (puissant marqué par le blues) qui a
cette qualité de dynamiser. Les performances du batteur comme celle de Lee
Morgan sont hors normes, le sommet de l’Art avec et sans jeu de mot car
l’intensité de l’origine côtoie la virtuosité expressive. On note la présence
d’un big band local de Nobuo Hara sur deux titres qui aurait pu s’abstenir tant
cette musique ne supporte pas l’exécution. Cela dit, ça ne dérange pas
l’explosif Lee Morgan (qui mène «Pierre et le loup» dans «Blues March»), ni le
swing churchy de Timmons. Si on veut respecter la chronologie, on abordera d’abord le concert de San Remo
en 1963 (l’autre DVD), en sextet avec le regretté Freddie Hubbard, les
excellents Curtis Fuller, Cedar Walton, Reggie Workman, et toujours Wayne
Shorter. Le tempérament est important, et quand les Morgan, Merritt et Timmons
ne sont plus là, quelle que soit la puissance de Blakey, le discours
s’infléchit vers plus de virtuosité et de suavité, mais beaucoup moins
d’intensité, et dans ce nectar des dieux, la mouture de 1961 se situe à un
nuage au-dessus.
Retour de Lee Morgan en 1965 dans une formation à l’intensité plus intériorisée
(«Lamont for Stacy»), marquée par cette tonalité d’époque qui donne plus de
gravité à l’ensemble. Pour cette émission présentée par Humphrey Littleton (qui
évoque Jazz Hot dans un de ses commentaires), c’est une formation rare avec
John Gilmore (dans l’esprit des grands ténors du temps, Rollins et Coltrane)
qui deviendra plus tard l’un des piliers de l’orchestre de Sun Ra, le jeune
John Hicks qui bien entendu a écouté McCoy Tyner.
La distance qui sépare 1965 de 1961 n’est pas très importante en durée et
pourtant il y a un monde entre l’atmosphère presque joyeuse de 1961 et celle
tendue de 1965. L’histoire et le quartet de John Coltrane sont passés par là,
le nouveau quintet de Miles Davis aussi, et si la musique reste profonde, elle
porte moins la marque du leader Art Blakey, dont le jeu est même parfois dénué
de ses signatures habituelles pour faire place à des nappes de sons sur ses
cymbales. Pour nous résumer, il n’y a rien là que de l’essentiel!
Yves Sportis
© Jazz Hot n°651, printemps 2010
|
 Baden Powell Baden Powell
Velho Amigo
Documentaire
Durée: 54’ 21”
Universal 066 888-9 (Universal)
Réalisé par Jean-Claude Guiter qui nous avait déjà donné à chroniquer Baden
Powell, Live (Frémeaux & Associés 4011, cf. Jazz Hot n°631), ce
documentaire sous-titré O Universo Musical de Baden Powell est un magnifique
film sur l’itinéraire artistique d’un musicien majeur du Brésil. Baden Powell
est un grand guitariste et compositeur, on le sait, et ce qui ressort de cette
heure passée en sa compagnie, à travers les âges (belles images d’archives avec
Pinxinghina, Vinicius de Moraes, Billy Blanco, Pierre Barouh…) et les
continents, à Paris ou dans son Brésil natal, avec un retour au village de sa
famille, c’est l’idée que la beauté de la musique est une traduction de la
personnalité des musiciens. Ce documentaire est très précieux en ce sens qu’il
reconstitue la complexité de la construction d’un tel artiste, de l’apprentissage
de la musique classique à l’imprégnation d’un environnement de musique
populaire, aux rencontres indispensables, et aux prises de risques nécessaires:
celle d’abord de partir à l’aventure à Rio, à Paris. C’est ce type de film qui
permet d’approcher le processus de la création. Sans oublier le plaisir évident
de retrouver en live la simplicité de Baden Powell donnant à entendre une
musique d’une grande complexité et pourtant si universellement abordable.
Yves Sportis
© Jazz Hot n°651, printemps 2010
|
 Ben Webster & Dexter Gordon Ben Webster & Dexter Gordon
Tenor Titans: Copenhagen 1969, London 1965
5
titres par le quintet de Ben Webster enregistré à Londres le 20 décembre 1964
Ben Webster (ts), Ronnie Scott (ts), Stan Tracey (p), Rick Laird (b), Jackie
Dougan (dm)
4 titres par le quartet de Dexter Gordon enregistrés à Copenhague en mars 1969
Dexter Gordon (ts) Kenny Drew (p), Niels-Henning Ørsted Pedersen (b), Makaya
Ntshoko (dm)
Durée: 48’
Impro-Jazz 516 (Socadisc)
Pour la première fois en DVD, mais pas ensemble contrairement à ce que laisse
penser l’image de couverture et contrairement aussi au CD du même titre (Tenor Titans)
édité par Storyville (Jazz Hot n°546). Nous n’allons pas bouder notre plaisir pour autant de retrouver les deux
géants. La partie de Ben Webster, accompagné par une rythmique anglaise, comme
il se devait au royaume de Sa Majesté, nous permet de découvrir Stan Tracey au
piano et surtout l’excellent Ronnie Scott (sur «Night in Tunisia») qui ne
bronche pas devant les assauts et le volume de «Big» Ben, échangeant avec un
brio certain. Le répertoire est marqué sans surprise par l’empreinte ellingtonienne
(«Sunday», «Chelsea Bridge», «Perdido»), avec en plus «A Night in Tunisia» et
«Over the Rainbow». Le Titan est fidèle à son surnom du jour, avec un son plus
rauque que feutré et cette puissante poésie que ne dit pas son apparence
tranquillement massive.
La partie de Dexter est enregistré au Café Montmartre, ce qui constitue en soi
un document (l’ambiance y est très «familiale» et jeune), et Dexter est secondé
par une formation qui sert aussi parfois son aîné Ben, puisqu’on y retrouve les
grands Kenny Drew et NHØP. Le batteur sud-africain Makata Ntshoko est
parfaitement à l’aise dans ce contexte. Deux thèmes seulement, mais longs sans
fatiguer, un surprenant «Those Were the Days» et un de ses standards «Fried
Bananas », toujours aussi réussi avec cette sonorité qui doit tant à son aîné
Ben, à Lester Young aussi, et en fait tant au talent de Dexter lui-même, et
toujours cette splendide voix swinguant les présentations. Un régal teinté bien
sûr de nostalgie pour tant de beauté dans tant de simplicité.
Yves Sportis
© Jazz Hot n°651, printemps 2010
|
 Benny Carter Benny Carter
Symphony in Riffs
Publié
en 1989
Durée: 58’
Rhapsody Films (www.rhapsodyfilms.com)
Burt Lancaster est le narrateur de luxe de ce splendide portrait de Benny
Carter, une légende du jazz, musicien multi-instrumentiste, le plus souvent
connu comme arrangeur, leader de big band et saxophoniste alto; mais il chante
et joue aussi excellemment de la clarinette, du ténor, du piano et de la
trompette, son instrument favori comme il l’indique dans l’interview qui sert
de fil conducteur à cet excellent DVD, brillamment illustré de documents: photos,
films, concerts, coupures de presse, témoignages. Ella Fitzgerald, André Previn, Leonard Feather, Quincy Jones et bien d’autres
disent tout le bien qu’ils pensent de ce musicien très distingué qui reconnaît
d’emblée trois admirations: Louis Armstrong, Duke Ellington et Johnny Hodges.
On le retrouve ici parlant de sa longue vie (1907-2003) riche des rencontres
les plus extraordinaires, recevant de multiples récompenses, dont les plus récentes
des mains d’un Bill Clinton dont les yeux disent clairement qu’il est à ce
moment plus saxophoniste que président. Le portrait n’est ni chronologique, ni thématique, simplement une sorte de
tranche de vie qui l’amène dans un club (accompagné par le regretté James
Williams), dans des salles de concert à travers le monde, ou dans des lieux
symboliques de l’histoire qu’il évoque dans l’interview, l’Apollo avec Ralph
Cooper où il retrouve sa jeunesse à la mémoire des belles danseuses de revue,
le Savoy Ballroom, les clubs, une évocation aussi de New York, d’Harlem avec
images. On revit quelque peu son voyage des années 30 en Europe, la France avec
l’épisode du «kidnapping» de sa fille, la Grande-Bretagne. Toutes les
évocations sont illustrées de films ou photos d’époque. On part en train à travers les Etats-Unis voyage qui l’amène sur la Côte Ouest
à Hollywood au début des années 40, où il s’installe et devient un arrangeur,
compositeur très demandé, paraissant parfois à l’écran, composant avec une
facilité exceptionnelle (on le voit at home au travail au piano), réussissant
indéniablement puisqu’il conduit princièrement une Rolls Royce pour aller à son
boulot. On participe avec lui à la longue marche pour la reconnaissance des droits de
la population afro-américaine. On refait avec lui les tournées internationales, le JATP, au Japon surtout, on
participe à des sessions d’enregistrements au studio RCA de NYC avec les Eddie
Lockjaw Davis, Jimmy Heath entre beaucoup d’autres musiciens savants, a des
remises de récompenses attribuées par toutes sortes d’instances culturelles, de
la musique, du cinéma, des arts. On évoque sa carrière d’enseignant, car Benny Carter est devenu Docteur de nombre
d’universités et écoles américaines où il se plaît à faire des conférences
(Harvard, Princeton, Rutgers…), à former des jeunes musiciens (Stanley Jordan,
Harry Allen…). On part en croisière sur le France rebaptisé Norway avec ses vieux amis, les
Clark Terry, Buddy Tate, Illinois Jacquet, Flip Phillips, Red Holloway qui
l’ont baptisé le «King», une élection par ses pairs qui en dit long. On le voit
évoquer des souvenirs, avec une mémoire phénoménale sur le pont du navire avec
Dizzy Gillespie, et toutes ces tranches de vie sont rythmées par son discours
musical sinueux et délicatement voluptueux à l’alto, ses douces compositions
qui sont autant de standards, le tout marqué du sceau de la distinction, de
l’élégance où l’on reconnaît l’importance du modèle ellingtonien avec plus de
discrétion car il reste un modeste dans l’âme en référence à ses modèles. Sa
vie familiale semble d’ailleurs à l’aune de cet ordonnancement parfait. On peut
en savoir plus en consultant son site: www.bennycarter.com.
Ce musicien dont on
vient de fêter le siècle (Jazz Hot n°644),
doté d’une discographie exceptionnelle et inépuisable, reste pour la plupart
des amateurs un monument à découvrir.
Yves Sportis
© Jazz Hot n°651, printemps 2010
|
 Charles Mingus Charles Mingus
Live in '64
So
Long Eric, Peggy’s Blue Skylight, Meditations on Integration, So Long Eric,
Orange Was the Color of Her Dress Then Blue Silk, Parkeriana, Take the ‘A’
Train, So Long Eric (répétition), So Long Eric, Meditations on Integration
(répétition), Meditations on Integration
Charles Mingus (b), Eric Dolphy (as), Clifford Jordan (ts), Jaki Byard (p),
Dannie Richmond (dm) + Johnny Coles (tp) les
12-13 avril 1964
Enregistré les 12, 13 et 19 avril 1964 en Norvège, Suède et Belgique
Durée: 2h 01’ 35”
Naxos/Jazz Icons 2.119006 (Abeille Musique)
Charles Mingus est effectivement une icône, mais il n’est pas la seule de cet
enregistrement. Cette tournée eut une destinée particulièrement malheureuse,
avec d’abord Johnny Coles qui dut la quitter pour raison de santé (il est
absent le 19 avril), avant surtout qu’Eric Dolphy qui prolongea son séjour en
Europe ne disparaisse deux mois plus tard emporté par une crise de diabète
alors qu’il se rendait à Berlin. Sa vitalité ici laisse beaucoup de regrets,
d’autant que la tonalité de son jeu est de celle qui a le plus coloré l’univers
de Mingus. Sur ce plan, ce quintet-quartet, ne présente que des personnalités
musicales fortes car, en dehors du leader en pleine force de l’âge, Jaki Byard
possède un jeu à nul autre pareil. La complicité de Dannie Richmond avec Mingus
sur le plan de la musicalité est aussi remarquable à entendre qu’à voir dans
ces trois chapitres européens. Enfin Clifford Jordan, lui aussi disparu,
apporte cette puissance du blues qui est l’une des couleurs indispensables à
l’univers du grand contrebassiste, compositeur et génie du jazz qu’est Charles
Mingus. Ces images sont un moment de poésie, d’émotion où tout est simple,
évident et pourtant sophistiqué. Certains musiciens sont irremplaçables.
Yves Sportis
© Jazz Hot n°651, printemps 2010
|
 Charlie Parker Charlie Parker
Improvisation
2 DVDs:
14 titres, présentations de Nat Hentoff et Norman Granz, Portrait de Norman
Granz par Nat Hentoff, autres rushes de Gjon Mili et interviews d’Hank Jones,
Roy Haynes, Jimmy Heath, About Parker: interviews de Jay McShann, Phil Woods, Ira
Gitler, James Moody, Slide Hampton, Roy Haynes, Jimmy Heath
Jammin’ the Blues-1944: Harry Edison (tp), Lester Young (ts), Marlow Morris
(b), Barney Kessel (g), John Simmons (b), Illinois Jacquet (ts), Marie Bryant
(voc), Archie Savage (p), Red Callender (b), Sidney Catlett (dm), Jo Jones (dm)
Mili’Studio Sequence-1950: Ella Fitzgerald (voc), Harry Sweets Edison (tp),
Bill Harris (tb), Charlie Parker (as), Coleman Hawkins (ts), Lester Young (ts),
Flip Philips (ts), Hank Jones (p), Oscar Peterson (p), Ray Brown (b), Buddy
Rich (dm)
At Côte d’Azur-1966: Duke Ellington (p), John Lamb (b), Sam Woodyard (dm)
Montreux Jazz Festival-1977: Roy Eldridge (tp, voc), Vic Dickenson (tb), Al Grey (tb), Benny Carter (as),
Zoot Sims (ts), Count Basie (p), Ray Brown (b), Jimmy Smith (dm)
Dizzy Gillespie (tp), Clark Terry (tp), Eddy Lockjaw Davis (ts), Niels Henning
Ørsted Pedersen (b), Bobby Durham (dm)
1979. Joe Pass (g)
1979. Ella Fitzgerald (voc), Paul Smith (p), Keter Betts (b), Mickey Rocker
(dm)
Enregistré de 1950 à 1979
Durée: 1h 08’ 45” + 1h 22’ 11”
Norman Granz Presents/Eagle Vision EREDV425 (Naïve)
Trente ans de jazz en images provenant des archives de Norman Granz dont les
fameuses images (complètes) et photographies de la séance au studio de Gjon
Mili en 1950 (post-synchronisée), célèbre photographe et cinéaste ici, il n’y a
là que de l’Histoire et de l’Excellence, dans des registres variés. Charlie
Parker en live, c’est rare et c’est beau, d’autant qu’il y a à ses côtés un
Coleman Hawkins magistral (son chorus sert de thème à l’ensemble des DVDs).
Lester Young en live c’est encore plus exceptionnel, d’autant qu’Ella
intervient. Ces séances sont célèbres, et les voici sur un simple DVD à la
portée de tous. Dans le registre historique, il y a encore le Jammin’ the Blues
original de 1944, film «photographique» sur le jazz de Gjon Mili, où Norman
Granz est directeur technique, duquel le photographe Herman Leonard s’est
inspiré pour bâtir ses atmosphères. C’est essentiel pour tout, les images,
cadrages, les musiciens (Lester Young, Red Callender, Harry Edison, Marie
Bryant, splendide dans une manière proche de Billie Holiday…) et la musique est
belle.
Le reste, pour sembler moins rare, n’en est pas moins fascinant. La lecture de
la notice permet de deviner, mais l’écoute du trio d’Ellington jouant «The
Shepherd» à la fondation Maeght en guise de «Blues for Joan Miro» en 1966
(repris sur le DVD at Antibes plus haut), de l’orchestre autour du Count en
1977 est une splendeur de swing, avec ses Roy Eldridge, Benny Carter, Ray
Brown, etc., comme Dizzy Gillespie et Clark Terry la même année (Ali &
Frazier, en référence au célèbre combat de boxe), avec Eddie Davis et la
rythmique parfaite Oscar Peterson, NHØP, Bobby Durham, comme Ella en 1979. Il manque bien entendu quelques dieux de l’Olympe du jazz de cet âge d’or
finissant, mais il faut avouer que ce film est d’une densité exceptionnelle, un
document autant qu’un plaisir.
Les nombreuses interviews (cf. notice) apportent plus (Gitler, Granz, Harry
Edison) ou moins de renseignements car les souvenirs sont souvent lointains.
Hank Jones en profite même pour nous faire partager son élégant humour sur le
chapitre de la mémoire défaillante. Il faut dire que les carrières de ces
musiciens sont si remplies par l’extraordinaire qu’on leur pardonnera
volontiers quelques oublis à 50 ans de distance.
Yves Sportis
© Jazz Hot n°651, printemps 2010
|
 Dave Brubeck Dave Brubeck
Live in '64 & '66
10 titres
Dave Brubeck (p), Paul Desmond (as), Eugene Wright
(b), Joe Morello (dm)
Enregistré les 10 octobre 1964 à Bruxelles et 6 novembre 1966 à Berlin
Naxos/Jazz Icons 2.119005 (Abeille Musique)
Filmé pour la télévision belge ou en concert à Berlin, l’élégance de ce
quartet, sur tous les registres du blues au traditionnel, des standards aux
célébrissimes originaux («Take Five»), a quelque chose de figé qui ne franchit
pas l’épreuve du temps. Même si beaucoup apprécient la sonorité polie de
Desmond, elle a pris avec le temps ce côté trop caricaturalement propre qui la
rend assez immature dans son systématisme en rapport avec les belles sonorités
humaines que nous a fournies le jazz de toutes les époques. Dave Brubeck est un
expert du jazz qui a bien vieilli et dont la musique a gagné ce qui manquait à
son travail de jeunesse, en dépit des réelles innovations qu’il apporta alors.
Dans ces vidéos, toujours agréables, on prend bien conscience que les musiques
de système (comme le furent partiellement le MJQ, le third stream en général ou
ici le quartet de Dave Brubeck) ont indéniablement moins de profondeur que les
musiques de culture qui paraissent gagner en beauté avec le temps. C’est une
grande leçon artistique, et cela n’enlève rien à la qualité superlative de la
technique de ces musiciens. Dave Brubeck en particulier est un maître du piano,
qui joue le jazz comme la musique classique, en grand interprète («Koto Song»).
Il lui manque alors l’impact du vécu dans son jazz, et c’est sans doute ce qui
fait son charme aujourd’hui, car sa très longue carrière lui a permis
d’acquérir cette humanité, cette profondeur qui fait les grands artistes plus
que les grands interprètes.
Yves Sportis
© Jazz Hot n°651, printemps 2010
|
 Dexter Gordon Dexter Gordon
Live in San Francisco
On
Green Dolphin Street, Polka Dots and Moonbeans, Tanya
Dester Gordon (ts), George Cables (p), Rufus Reid (b), Eddie Gladen (dm)
Enregistré en 1979, San Francisco
Durée: 58’
Impro-Jazz 529 (Socadisc)
Vous pouvez revenir sur la biographie et la discographie de Dexter Gordon dans
le Spécial 2007 de Jazz Hot pour
situer cet enregistrement qui se place lors du retour at home (aux USA et en
Californie) du grand ténor à la fin des années 70, dans un club, le Maintenance
Shop. La musique est splendide, en particulier ce lent «Polka Dots» qui
restitue toutes les qualités du ténor: une manière de trainer sur le temps, un
swing et une sonorité chaleureuse, une économie de notes mais des notes
lourdes, émouvantes. La profondeur du ténor trouve dans un beau trio un
complément parfait où on remarque la belle virtuosité de George Cables. Cette
musique dégage une formidable impression de puissance, comme dans ce long «Tanya»
de Donald Byrd, un long blues en mineur.
Yves Sportis
© Jazz Hot n°651, printemps 2010
|
 Duke Ellington Duke Ellington
At the Côte d'Azur With Ella Fitzgerald and Joan Miró / The Last Session
Duke
Ellington Orchestra, Duke Ellingon Trio, Ella Fitzgerald Trio +
Duke Ellington
Orchestra, Duke Ellington Quartet avec Joe Pass (g), Ray Brown (b), Louie
Bellson (dm)
Enregistré en été 1966 et le 8 janvier 1973
Durée: 1h 06’ 41” + 1h 36’ 39”
Norman Granz Presents/Eagle Vision EREDV431 (Naïve)
Deux DVDs consacrés à l’un des dix monstres sacrés du jazz, entouré parfois
d’une de ses égales en la personne d’Ella Fitzgerald, voilà qui ne peut que
générer l’enthousiasme impatient, quels que soient les défauts divers (son,
cadrage…) qui émaillent ce véritable document historique.
Le premier de ces DVDs restituent des images de la tournée estivale de 1966 qui
amena le Duke Ellington Orchestra (et ses légendes Johnny Hodges, Paul
Gonsalves, Cootie Williams, Lawrence Brown, Harry Carney…) pour la première
fois au festival d’Antibes-Juan-les-Pins, avec et sans Ella (son trio plus
l’Orchestra) selon les jours, et même, curiosité, en trio (John Lamb et Sam
Woodyard sur une batterie minimaliste) à la fondation Maeght de
St-Paul-de-Vence, ou en ballade avec Joan Miró à travers les jardins peuplés de
sculptures monumentales – il y avait une exposition Miró –, échangeant quelques
amabilités dont on ne connaîtra pas vraiment le fond. En ouverture, Duke évoque
la tournée en France de cette année, sa sensibilité à l’art et à la Fondation
Maeght, Billy Strayhorn et Ella, et son sens du récit, sa belle voix, donnent
un attrait supplémentaire au fait de le retrouver. Une interview pas
essentielle de Nat Hentoff est offerte en bonus.
Le second DVD est une répétition enregistrée du Duke en quartet avec les
excellents musiciens notés plus haut sur une série de thèmes plus ou moins
habituels, joués dans une configuration inhabituelle, avec le délicat Louie
Bellson à tous les sens du terme accompagne avec une attention bienveillante
les deux compères Ray et Duke, malgré la présence assez envahissante de Joe
Pass qui n’a pas saisi le caractère exceptionnel du moment. Une interview
légère de Ray Brown en bonus dénote la dévotion des musiciens non seulement
pour la musique du Duke mais également pour le musicien et l’homme. Cette vidéo en studio permet enfin de découvrir, pour les amateurs, Norman
Granz at work, grand catalyseur de
génies dans le jazz, producteur d’exception, et Stanley Dance, critique émérite
de la musique du Duke et du jazz en général.
Par-delà l’anecdotique, ces images nous remettent en mémoire le Duke en live,
cette aisance naturelle dans tous les contextes, cette aristocratie délicate
qui sait ménager les susceptibilités et obtient avec une force tranquille le
résultat qu’elle recherche par la qualité d’une écoute exceptionnelle, et la
profondeur d’une musique enracinée, sans concession, que ce soit en big band,
en trio ou quartet.
Yves Sportis
© Jazz Hot n°651, printemps 2010
|
 Irio De Paula / Fabrizio Bosso Irio De Paula / Fabrizio Bosso
At Teatro Olimpico in Vicenza
Canto de Ossanha, Oh Ba-la-la, Just Friends, Wave, Samba de Verão,
Garota de Ipanema, Mack the Knife, You don’t Know What Love Is, Estate
Irio De Paula (g), Fabrizio Bosso (tp) except 1 et 6
Enregistré en mai 2007, Vicenza
Durée: 1h 06’ 17”
Azzurra Production 1036 (www.azzurramusic.it)
Voici réunis en duo, deux musiciens d’exception, de deux horizons
sensiblement différents, le Brésil et l’Italie, mais ils ont en commun l’Italie
(où Irio s’est installé de longue date), la musique, le jazz en particulier et
le lyrisme. Irio, l’Ancien, continue sa savante synthèse où le jazz passe par
le filtre de racines brésiliennes totalement actives, sans appauvrissement ou
détournement complaisant. Fabrizio, le Jeune, est un trompettiste d’exception,
tant par la virtuosité que par la musicalité, la qualité de l’expression, et si
vous ne me croyez pas, vous donnerez crédit à un prestigieux confrère, Enrico
Rava, qui ne dit rien moins que: «Fabrizio Bosso est certainement l’une des
plus belles choses qui soit arrivée au jazz italien dans cette décennie. Je ne
me souviens pas d’un trompettiste qui m’ait autant stupéfié ces dernières
années, et pas seulement en Italie, je pèse mes mots.» Si vous souhaitez les
découvrir, Fabrizio était justement notre invité dans le n°632 où Enrico Rava
est en couverture, et Irio nous parlait longuement dans le n°643… La rencontre
d’Irio qui réunit les mêmes qualités d’excellence est donc un moment magique
dans ce magnifique Théâtre Olympique de Vicenza lors de l’édition festivalière
2007. Irio est un frère de Baden Powell par sa capacité d’occuper l’espace avec
sa seule guitare, créant mélodie, improvisation et accompagnement à lui seul.
Fabrizio est un digne émule de Wynton Marsalis. Il utilise tous les effets
expressifs possibles avec brio et naturel. Il est capable de longueur de phrase
sans limite (en souffle continu), et des nuances les plus subtiles comme de
l’émotion la plus profonde. Un musicien phénoménal dont la musicalité ne
souffre jamais car il reste très italien, il sait faire chanter son instrument,
sans démonstration. Fabrizio mérite tous les détours de la terre (Vicenza
semble être une ville magnifique) et son entente avec Irio est un instant de
grâce dans un décor antique à la mesure de l’événement artistique: quoi de plus
naturel que des dieux dans un théâtre olympique.
Yves Sportis
© Jazz Hot n°651, printemps 2010
|
 John Coltrane John Coltrane
Live in '60, '61 & '65
John Coltrane (ts, ss), avec en 1960 Stan Getz (ts)*, Wynton Kelly (p),
Oscar Peterson (p)*, Paul Chambers (b), Jimmy Cobb (dm) puis en 1961 Eric
Dolphy (as, fl), McCoy Tyner (p), Reggie Workman (b), Elvin Jones (dm); puis en
1965 McCoy Tyner (p), Jimmy Garrison (b), Elvin Jones (dm)
Enregistré les 28 mars 1960 (Allemagne), 4 décembre 1961 (Allemagne) et
1er août 1965 (Belgique)
Naxos/Jazz Icons 2.119007 (Abeille Musique)
Trois époques, trois dimensions d’une même personnalité exceptionnelle
du jazz et pour l’amateur du grand saxophoniste, il n’y a rien à jeter, car
l’évolution de la musique, évidente dans cette confrontation, traduit toujours
les qualités essentielles de John Coltrane: conviction ou vérité de
l’expression, puissance et virtuosité. Aucune des musiques n’est «facile» et le
nom même des intervenants en situe le niveau.
Pour la première séance à Dusseldorf, John Coltrane est entouré pour
l’interprétation de standards d’une des meilleures sections rythmiques de
l’histoire du jazz avec le trio des exceptionnels Wynton Kelly, Paul Chambers
et Jimmy Cobb, et cet enregistrement nous propose en bonus la réunion sur un
thème de Stan Getz, Oscar Peterson et Coltrane, ce qui est une curiosité
historique pas déplaisante ni privée d’enseignement: Peterson et Coltrane sont
deux formidables torrents impétueux du jazz qui emportent tout sur leur
passage, même leurs sidemen…
Un an et demi plus tard, la musique est devenue celle de Coltrane, même
s’il n’en est pas l’auteur, et son quartet a enfin trouvé en McCoy Tyner et
Elvin Jones les deux compléments clés de la sonorité de l’ensemble. Autre
plaisir, on note la présence d’Eric Dolphy dont l’apport à l’ensemble n’est pas
déterminant mais qui reste toujours un grand plaisir à écouter.
Enfin, à Comblain-la-Tour, en Belgique quatre ans plus tard, nous
sommes dans ce qu’on pourrait appeler l’âge d’or du musicien avec son quartet
régulier (le sombre Jimmy Garrison à la basse remplace Reggie Workman): une
énergie paroxystique, un extraordinaire McCoy Tyner déterminant pour la
musicalité du groupe, un Elvin Jones qui tisse un véritable fond sonore
assombri par Garrison, et un Coltrane qui est sur un nuage délivre un feu d’une
intensité de conviction rarement atteinte dans le jazz. Sans doute la plus
pleinement, originalement coltranienne des trois périodes, avec un «My Favorite
Things» d’anthologie (pour le chorus de McCoy) dont nos amis belges survivants
pourront rétroactivement goûter toutes les nuances qui ont pu leur échapper sur
le moment. Il est vrai qu’assister un tel incendie par seulement quatre
musiciens a de quoi étourdir et réchauffer.
Le livret fait appel à la compétence de Michael Cuscuna, Ashley Kahn et
les consultants ont pour nom Don Sickler et Hal Miller.
Yves Sportis
© Jazz Hot n°651, printemps 2010
|
 Miles Davis Quintet Miles Davis Quintet
Milan 1964
Miles Davis (tp), Wayne Shorter (ts), Herbie Hancock (p), Ron Carter
(b), Tony Williams (dm)
Enregistré le 11 octobre 1964, Milan
Durée: 1h
Impro-Jazz 525 (Socadisc)
Il s’agit d’un enregistrement au Teatro Dell’Arte de Milan du Miles
Davis Quintet, version première partie des années 60, l’une des moutures les
plus célèbres puisque chacun des musiciens est devenu depuis une star à part
entière. La tenue de scène encore très classique ne peut cacher ce que cette
musique a d’étonnamment actuel. C’est le signe que l’ombre de Miles plane
toujours sur le jazz d’aujourd’hui et qu’elle a défini pour de longues années
une esthétique et même un état d’esprit de la musique de jazz. Déconstruction
du rythme et des mélodies, rupture de la pulsation traditionnelle, place
majeure accordée à l’harmonie, recul de l’expressivité naturelle, de la culture
native au profit d’une atmosphère décalée… Quand on compare par exemple avec
les enregistrements de Dizzy Gillespie, Dexter Gordon, John Coltrane, Art
Blakey et Lee Morgan de la même époque et même plus tardifs, on est frappé par
le fait que la voie choisie par Miles dès cette époque invente un monde sonore
nouveau, non dépourvu des qualités du jazz (le phrasé reste) mais plutôt de
l’esprit de cette musique; une volonté très claire de se situer ailleurs que
dans le jazz. Wayne Shorter est encore hésitant, l’ombre de Coltrane dans son
jeu est encore sensible, Ron Carter est très appliqué comme Tony Williams. Seul
Herbie Hancock a déjà adopté ce nouveau langage et lui apporte une contribution
pleine et mûre. Bien entendu, les musiciens ne changent pas de personnalité,
mais la musique, elle, a changé de monde. Ce ne sera pas la dernière évolution
de Miles, mais cet épisode est de ceux qui ont le plus marqué le futur du jazz
tel qu’il se pratique aujourd’hui. On pourrait s’interroger d’ailleurs sur cette
propension chez Miles depuis toujours à vouloir sortir son jazz du sillon
culturel. C’est sans doute que Miles se sentait plus concerné par l’expression
artistique que par l’expression d’une culture et qu’il ambitionnait d’autres
publics que celui du seul jazz. Il n’est pas le seul – Louis Armstrong, Billie
Holiday, Ella Fitzgerald, Nat King Cole, le MJQ, Ray Charles…– mais les
méthodes ont varié. C’est un vieux et grand débat qui revient pour Miles à
celui de la forme et du fond, et pour le cas de Miles– une grande carrière et
un grand écart esthétique – ce n’est pas aussi tranché; cela explique que la
musique de Miles a donné lieu à beaucoup de polémiques.
Yves Sportis
© Jazz Hot n°651, printemps 2010
|
 Omara Portuondo Omara Portuondo
Live in Montréal
Buena Vista Social Club, Siboney, Hermosa Habana, Tiene sabor, Flor de
Amor, Tabu, Amor de mis amores, Drume negrita, No me llores, He venido a
decirte, As Time Goes By, Casa calor, Veinte años, Mueve la cintura mulato, Dos
gardenias para ti, Besame mucho, La Sitiera, Guantanamera.
Bonus track: Portrait of Omara Portuondo
Enregistré au Festival International de Jazz de Montréal de 2005
EmArcy 7078970 (Universal)
On sait qu’aujourd’hui le titre de Festival de Jazz recouvre des
manifestations qui débordent très largement le domaine du jazz. Le festival de
Montréal n’échappe pas à ce processus. Omara Portuondo, chacun le sait, n’est
pas une jazzwoman mais une des grandes voix de la musique cubaine que beaucoup
ont découvert à travers le travail mené par Ry Cooder et son Buena Vista
Social. Mais Omara hante les scènes depuis le début des années cinquante
lorsqu’elle s’intègre au mouvement du filín à La Havane aux côtés de grands
noms comme José Antonio Méndez, Portillo de la Luz, Orlando de la Rosa… et bien
d’autres. Sa carrière est parsemée d’enregistrements de qualité.
C’est un plaisir de la découvrir sur ce DVD avec un répertoire puisé
parmi les plus grands compositeurs – cubains pour l’essentiel. Sans effets et
sans artifices Omara offre une prestation éblouissante avec, outre
l’accompagnement de ses musiciens habituels – excellents Thompson (ts, ss),
Chicoy (g), F. García (b) et les deux jeunes filles Osiris Valdés et Yelaine
Puentes alternant le violon et les chœurs, celui de l’Orchestre de Chambre de
Montréal. Omara plane sur cette scène aussi complice de ses musiciens
personnels que du luxueux ensemble. Dix-huit thèmes sont au programme et certains ont… du swing comme ce
vieux thème de Orestes López «Buena Vista Social Club» (Cette composition n’est
pas récente comme certains pourraient l’imaginer à la suite du film). Le Son
émerge à travers «Mueve la cintura mulato». «Siboney» rappelle quel grand
compositeur était Ernesto Lecuona. «Veinte años» rend hommage à la grande Rita
Montaner. «Dos Gardenias» est un thème historique. Et Omara n’oublie pas le
thème popularisé par Bola de Nieve «Time Goes By». C’est une partie de
l’histoire de la musique cubaine que l’on traverse en visionnant et écoutant ce DVD. Sur le plan photographique le travail est de grande qualité. Les prises
de vue sont judicieuses, les moments importants, les moments d’émotion sont
bien mis en valeur. Les musiciens ne sont jamais oubliés et la complicité est
soulignée. En bonus on peut découvrir Omara en 1955, chantant, avec le Cuarteto
Las d’Aida, une publicité pour les cigarettes Winston. Pratique habituelle des
années cinquante à Cuba ! Sont proposées quelques belles photographies des
années de jeunesse. S’ajoutent des extraits de concerts destinés à présenter le
disque Flor de Amor.
Ce DVD devrait constituer une motivation pour partir à
la recherche de plus anciens enregistrements d’Omara Portuondo que peu à peu on
se décide à rééditer.
Patrick Dalmace
© Jazz Hot n°651, printemps 2010
|
 Pharoah Sanders Pharoah Sanders
Live in San Francisco!
Doktor
Pitt, Blues for Santa Cruz, Kazuko*, interview
Pharoah Sanders (ts), John Hicks (p), Walter Booker (b), Idris Muhammad (dm) et
Pharoah Sanders (ts), Paul Arslanian (harmonium)*
Enregistré en avril 1981, San Francico et en juillet 1982, Marin Headlands*
Durée: 1h 00’ 28”
Evidence 30182 90009 (Socadisc)
Cet hommage aux regrettés John Hicks et Walter Booker n’est pas une nouveauté
mais un rappel de ce que fut ce splendide quartet à l’orée des années 80, quand
certains disaient le jazz moribond. Pharoah Sanders a alors trouvé la plénitude
de son expression – un savant équilibre entre l’héritage coltranien et une
sérénité mélodique qui lui est propre – et il est brillamment secondé par une
rythmique de rêve: Hicks-Booker-Muhammad, rien de moins ! Autant dire que
l’énergie, la finesse, la virtuosité et la spiritualité sont au rendez-vous à
San Francisco. Les thèmes sont longs sans lassitude, l’intensité monumentale
portée par une conviction toute coltranienne. C’est de la belle et grande
musique, la grande descendance de cet art si rare en dépit des nombreuses
revendications souvent abusives. Le livret inexistant ne raconte donc rien de
ces concerts mais il reste des images pour apprécier cet ensemble: un
développement coltranien, un blues au long court d’une beauté simple (Sanders
évoque immanquablement un grand disparu, George Adams) mais tellement complexe
si on y réfléchit par ce qu’elle suppose d’enracinement. Quatre musiciens aussi
impliqués et possédant leur art, c’est un morceau de soirée à San Francisco qui
valait le déplacement.
Curiosité supplémentaire: on découvre un enregistrement de Sanders dans un
tunnel abandonné au milieu d’une forêt en compagnie d’un joueur d’harmonium.
Les musiciens jouent de la réverbération déjà présente dans les instruments, le
tunnel (harmonium) et leur jeu. Une interview, réalisée par Herb Wong, apporte
un complément.
Yves Sportis
© Jazz Hot n°651, printemps 2010
|
 Sarah Vaughan Sarah Vaughan
Live in '58 & '64
Sarah
Vaughan (voc) avec Ronnell Bright (p), Richard David (b), Art Morgan (dm) puis
Kirk Stuart (p), Buster Williams (b), George Hughes (dm)
Enregistré les 7 juin et 9 juillet 1958 (Pays-Bas et Suède) et le 10 janvier
1964 (Suède)
Naxos/Jazz Icons 2.119004 (Abeille Musique)
On retrouve les qualités vocales exceptionnelles de Sarah Vaughan filmée en
trois occasions lors de deux tournées européennes en 1958 (suède et Pays-Bas)
puis en 1964 (Suède à nouveau) toujours brillamment entourée de musiciens à son
écoute. Nous sommes ici dans l’excellence, et le plaisir est toujours très
grand de retrouver par le son et l’image des musicien(ne)s d’un tel niveau. La
voix très travaillée de la Diva propose des interprétations originales dont la
mise en place est raffinée. Il reste que même dans l’excellence, il y a des
nuances, et le vibrato presque classique et un peu systématique de Sarah
Vaughan rend parfois ses interprétations artificielles ou les prive de ce
supplément d’âme qui est l’esprit de cette musique. Mais ces remarques, très
personnelles, plutôt liées à l’écoute comparative de consœurs parfois moins
brillantes sur le plan technique mais plus expressives, ne doivent pas empêcher
d’écouter l’une des très grandes voix du jazz qui réussit aussi à être
émouvante selon les pièces.
Yves Sportis
© Jazz Hot n°651, printemps 2010
|
 The Jazz O'Maniac The Jazz O'Maniac
Sunset Café Stomp
Roland Pilz (cnt, voc), Ullo Bela (tb), Claus Jürgen Möller (cl),
Cristoph Ditting (as, ts), Andreas Clement (p), Owe Hansen (bj), Dietrich
Kleine-Horst (tu), Gunther Andernach (whb)
Enregistré les 10 et 13 mars 2005, Chicago, Racine (WI)
Durée: 1h 10’ 23”
Delmark DVD 1244
Phil Popsychala organise un Tribute to Bix au Marriott Hotel de Racine. Pour la
16e édition, il a invité un groupe allemand, les Jazz O’Maniacs, fondé en 1966
par le cornettiste Roland Pilz (né en 1948) et qui se consacre à la musique de…
Louis Armstrong. Il faut dire que cette manifestation comprend une
visite-concert au Meyers Ace Hardware de Chicago connu autrefois sous le nom de
Sunset Cafe (puis de Grand Terrace). Et l’on sait que le grand Louis y prit un
envol irrésistible. Mais l’alibi du passé ne donne pas forcement du talent aux
sympathiques activistes actuels du jazz traditionnel. Ils ont toutefois un rôle
humain. Celui, avec des moyens techniques modestes et une culture musicale plus
ciblée que celle de leurs modèles, de prodiguer à un public âgé la dose
nécessaire et suffisante de souvenirs. Le présent orchestre fonctionne bien
dans ce cadre délimité. Le trombone est assez faible, mais s’en sort bien dans «Sweet
Muntaz». Le clarinettiste Claus Jürgen Möller est typé Johnny Dodds et brille
assez bien dans «Weary Blues» (un peu long) devant quelques danseurs du
troisième âge, et dans «Hear Me Talkin’» (le son du piano Korg est affreux). Le
répertoire sort des standards rabâchés du jazz traditionnel, ce qui est un bon
point, et l’on remarque les bien utiles partitions sur le pupitre («Come On
Coot, Do That Thing»,…). Bien sûr les solos sont mémorisés pour faire vrai, et
souvent proche de ceux des disques du Hot Five. Du reste, le leader, Roland
Pilz joue du cornet et fait un scat dans l’esprit du Louis Armstrong de 1925-27.
Ceci est l’essentiel du concert de la Bixfest, mais le DVD commence par
l’arrivée en bus à la Meyers Ace Hardware où ces musiciens jouent quelques
titres dans un décors pagailleux. Si le tournage fait parfois amateur, la
qualité d’image est bonne. Dans ce lieu qui ne brille plus de l’éclat du passé,
nos passéistes instrumentaux font le bœuf (avec toutes les approximations que
veut le genre) sur «Willie the Weeper» (bien mené par Pilz) et «Blues My
Naughty Sweetie Gives to Me» exposé à la Noone par l’invité Norm Field
(clarinette système Albert). Dans ce morceau, le passage cornet (un beau Conn
modèle Victor gravé) et trompette de Mike Durham et Frank Youngwerth n’est pas
mal, mais par contre les deux trombones supplémentaires (Dave Ramey et Frank
Gualtieri) ne relèvent pas le niveau de la coulisse. On voit Phil Popsychala
faire un petit blabla à ses charmants touristes du jazz. Le DVD est découpé en
Play Movie, Audio Setup, Chapter Select, History interview (de David Meyers et
Tim Samuelson, de faible intérêt) et Recommandations (publicité pour les CD
Delmark).
Ce DVD est pour les inconditionnels du jazz
traditionnel et du Hot Five. C’est vrai que nous n’aurons jamais de vidéo du
vrai Hot Five de Louis Armstrong.
Michel Laplace
© Jazz Hot n°651, printemps 2010
|
|
|

