Le saxophoniste
Jérôme Sabbagh est né le 14 septembre 1973 à Boulogne-Billancourt (92). Après
avoir étudié avec Philippe Chagne, Eric Barret et Jean-Louis Chautemps, il part
étudier au Berklee College of Music, en 1993. A l’issue de sa formation, il
s’installe à New York qu’il ne quitte que pour des tournées qui lui permettent notamment
de renouer ponctuellement avec la
scène européenne et la France. Dès les premières années, il crée le collectif Flipside avec
Greg Tuohey (g), Matt Penman (b) et Darren Beckett (dm) en compagnie desquels
il se produit durant cinq ans. En 2000, il rencontre un autre Français
expatrié, Laurent Coq (cf. Jazz Hot
n°680). Intéressé tant par la relecture du
répertoire que par l’écriture, il s’exprime depuis plus de dix ans au sein de
son quartet formé de Ben Monder (g), Joe Martin (b) et Ted Poor (dm). Cette
constance dans ses amitiés musicales et dans ses collaborations est l’une des caractéristiques du ténor. De son activité de sideman, on
retient une semaine mémorable avec Paul Motian, au Village Vanguard, en
septembre 2011, au sein de son New Trio. En outre, on le retrouve aux côtés de
Victor Lewis, Greg Hutchinson, Bill Stewart, Reggie Workman, Guillermo Klein,
Andrew Cyrille, Billy Drummond, Daniel Humair ou Jean-Michel Pilc. Musicien
instinctif, il s’attache à ne pas dissocier le travail
de studio de la scène, avec un rapport à la tradition qui nourrit son
inspiration. Nous l’avons rencontré lors d’un concert parisien à l'Atelier de la Main d'Or (11e), avec le pianiste Danny Grissett (cf. Jazz Hot n°681).
Propos recueillis par Jean-Pierre Alenda
Photos Patrick Martineau
© Jazz Hot n°682, hiver 2017-2018
Jazz Hot: Etes-vous né dans une famille
de mélomanes?
Jérôme Sabbagh: De mélomanes oui, mais pas de musiciens. Mon père est amateur de
musique classique, mais plutôt réfractaire au jazz. Ce qui a trait au groove ne
le touche pas. Par ailleurs, je pense qu’il ne perçoit pas la forme dans le
jazz, et ça le dérange.
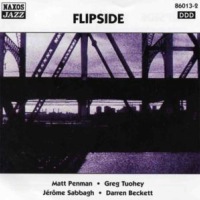
Vous avez étudié
aux Etats-Unis…
J’ai été à
Berklee pendant deux ans. J’y ai travaillé avec Joe Viola, Bill Pierce, George
Garzone, Hal Crook et Herb Pomeroy. J'ai aussi fait deux stages avec Dave
Liebman. Il m’arrive encore de prendre des cours. J’en ai également pris un
auprès de Chris Potter, parce qu’il y a chez lui des choses spécifiques qui
m'intéressent. Pendant plusieurs années, j'ai étudié avec Sophia Rosoff,
pianiste classique avec laquelle ont travaillé Barry Harris et Fred Hersch,
ainsi que des gens plus proches de ma génération comme Ben Street et Aaron
Parks. Sophia avait une manière de tout ramener au chant, à l’instinct, qui m’a
énormément aidé. Elle me faisait chanter la mélodie, battre le rythme sur ma
poitrine en marquant la pulsation avec les pieds. C’est une façon de ne pas
laisser l’intellect, la force des habitudes et les inhibitions faire obstacle à
la musique que j’essaie à mon tour de transmettre à mes élèves.
Ce côté choral s’entend dans la
relation que vous avez avec les standards...
Oui, quelle que soit la musique, j’essaie
toujours de chanter. Pour les standards, il y aussi l'exemple des grands
anciens: Ben Webster, par exemple, était vraiment un maître en la matière.
Jouer une mélodie, c'est tout un art. Ça m'attire au fond plus que la
virtuosité, la vélocité, la technique, même si celles-ci sont nécessaires
aussi, particulièrement pour beaucoup de musiques actuelles, ainsi que pour le
bebop, évidemment.
Il y a des musiciens qui ont probablement
besoin de plus de notes pour s’exprimer, non?
Certainement. Mais même –et surtout– sur
des tempos rapides et dans la volubilité, chez les plus grands, c’est surtout
dans la manière dont ils jouent les notes que quelque chose se passe. Le plus
important, c’est ce qu'il y a entre les notes, le phrasé, les inflexions, les
subtilités rythmiques qui sont impossibles à écrire. Au fond, c’est ce qui
distingue le jazz d’autres musiques. Chez les musiciens qui me touchent le plus,
de Frank Wess à Marc Ducret en passant par Tom Harrell, Billie Holiday ou Allan
Holdsworth, il y a surtout une adéquation de tous les instants entre la forme
et le fond. Il y a une évidence d’expression; beaucoup plus que le style dans lequel ils jouent. Le style m'importe
peu, ainsi que le nombre de notes à la minute. J'ai surtout envie d’entendre
des gens qui savent qui ils sont.
Etre installé aux
Etats-Unis, est-ce une forme de positionnement?
Non, pas
vraiment. C’est là que j'ai fait ma vie. J'avais envie de faire l'expérience de
New York après Berklee et, en tant que musicien de jazz, après avoir goûté à
l'excellence de la scène new-yorkaise, il est difficile d'en partir. Je m’y
sens bien.
La plupart de mes
projets musicaux sont nés ici, et je continue de les faire avancer. Je fais des
sessions, je rencontre de nouveaux musiciens. Je peux répéter chez moi avec un
groupe complet, et je n’ai jamais de problème avec les voisins. C’est très
new-yorkais, cet état d’esprit. Il y a une acceptation de la musique au
quotidien et une connaissance de cette musique qui font partie des habitudes,
sans parler de la possibilité d'écouter et de côtoyer les meilleurs musiciens
de jazz du monde tous les soirs.

Vous semblez
privilégier les petites formations…
En général, oui.
Par ailleurs, un lieu comme l'Atelier de la Main d'Or à Paris met
particulièrement en valeur des formations sans batterie, comme la nôtre. Ce
n’est pas un hasard si Fred Hersch ou Martial Solal y ont aussi joué en solo ou
en duo.
Vous
préoccupez-vous du son dans votre musique?
L’attention au
son, au timbre du saxophone fait clairement partie de mes préoccupations
majeures. J’ai toujours été inspiré par la voix humaine. D’une façon générale,
si j’écoute Billie Holiday, ça m’inspire autant que l’écoute de John
Coltrane. Parfois, je joue aussi du soprano avec Danny, ce qui rajoute une
couleur différente. Interpréter les
mélodies comme si j’étais un chanteur, c'est ce que je cherche à faire, oui.
Les musiciens que j’admire travaillent de cette façon, notamment sur les
ballades. J’ai un ami qui joue avec Houston Person. Comme beaucoup de gens de
cette génération, il connaît les paroles de tous les standards qu’il joue, et ça
informe la manière dont il les joue.
Est-ce que cette démarche vous amène à
composer avec le souci d’obtenir des mélodies mémorisables?
Ce n’est pas un choix conscient, c’est
lié à la manière dont j’écris: quand je compose, je chante et je me mets au
piano; ça m’amène, en effet, à écrire
des morceaux qui ont une mélodie reconnaissable. Il m’arrive aussi d’en
composer qui, malgré l’attachement que je porte aux standards, s’en éloignent.
Le groupe que j’ai depuis 2004 avec Ben Monder, Joe Martin et Ted Poor illustre
bien cette esthétique qui reflète des influences variées. Je mène en parallèle
un travail sur les standards qui s’illustre dans le duo avec Danny Grissett,
dans mon expérience du trio avec contrebasse, batterie, ainsi qu’un travail
qui s’articule autour de mes compositions, en quartet avec guitare. Ça reflète
mes intérêts; de plus, s’efforcer d’être soi-même dans des contextes
différents enrichit énormément. Je crois aussi que les groupes qui durent font
la force du jazz. Jouer de manière régulière ensemble permet plus de prises de
risques. C’est donc sur la durée que j’essaie de penser mes projets, quels
qu’ils soient. Avec le quartet, on a fait beaucoup de tournées. Il faut du
temps pour construire un groupe. Ce n’est pas un hasard pour moi si des groupes
révolutionnaires, comme les quintets de Miles ou le quartet de Coltrane, ont
été des formations durables. Après, il n’est pas facile d’arriver à faire durer
une formation –et encore moins plusieurs– dans le contexte d’aujourd’hui. Le
marché du jazz privilégie la nouveauté.

Comment
vivez-vous cette évolution?
J’arrive à faire
des tournées et des disques, et à faire vivre mes projets, ce n’est déjà pas
mal. Malgré une notoriété plus grande qu'il y a vingt ans, tout est de plus en
plus difficile, en partie parce que le jazz est concurrencé par d’autres formes
musicales jusque dans les festivals dit «de jazz». Sans être aussi restrictif
que Wynton Marsalis sur ce qui est du jazz ou pas, on peut se dire qu'il y a un
problème quand les festivals de jazz sont de plus en plus envahis par la pop,
la variété et les musiques du monde. Je n’ai rien contre ces musiques, mais
force est de constater qu’il y a moins de place pour le jazz qu'avant. Il y a
de moins en moins de festivals qui font un travail d'éducation du public, qui
font confiance à des artistes en émergence ou qui, simplement, ne cèdent pas à
la tentation de la rentabilité maximale. Il est vrai que ça n'est pas facile
d'équilibrer les comptes, j'en suis bien conscient, mais c’est un cercle
vicieux. Le jazz est moins populaire qu'avant, d’où la tentation de programmer
d'autres musiques et/ou les projets les plus vendeurs possibles, souvent au
détriment de la qualité, mais moins on programme de jazz, moins
il sera populaire. Par ailleurs, l'avènement du numérique et du streaming a
condamné beaucoup de maisons de disques à la faillite. Pour moi, il faut
réinventer l’économie du disque dans le jazz en revenant vers l'objet. Personne
ne peut gagner d'argent ou financer un disque avec le numérique, ni en
téléchargement et encore moins en streaming, sans en vendre des tonnes. En jazz, personne n'en vend des tonnes. Tout ça n'est pas viable
financièrement.
Comment le musicien de jazz peut-il défendre son art dans ce contexte?
Pour ma part, je suis encouragé par le succès remporté par l'édition en vinyle
–financée par une levée de fonds sur internet– du dernier disque de mon
quartet, The Turn, qui a élargi mon
public en séduisant beaucoup d’audiophiles et la presse de ce secteur. Je me
préoccupe beaucoup du son de mes disques; au final, le soin
apporté à l'enregistrement et la qualité de la réalisation du vinyle sont
précisément ce qui a permis à ce projet d'être bénéficiaire. Sans le vinyle,
j'aurais perdu de l’argent, alors que personne n'y croyait quand j’ai proposé de réaliser un vinyle. Je pense que dans ce qui est aujourd'hui une musique de
niche, comme le jazz, il y a matière à présenter un bel objet, enregistré avec
soin, que les gens auront envie d'acheter plus que d'écouter plus ou moins
gratuitement en streaming à une qualité inférieure. Ça n'est pas un hasard si
un label comme ECM, qui continue d'investir dans des productions de qualité, ne
permet pas à ses disques d'être à disposition sur les plateformes de streaming.
Quoi qu’il en soit, il faut arriver à trouver son public. Le crowdfunding peut y aider et permettre
de rester assez libre. Je pense que ma musique est au final accessible. Les
retours enthousiastes que j'ai à la sortie des concerts m'encouragent. C'est
malgré tout un défi, dans le monde d'aujourd'hui, de convaincre les directeurs de
festivals et les programmateurs de radio de me faire confiance. De manière
générale, je m'intéresse à l'économie du jazz. J'aimerais à terme m’impliquer
dans la gestion d'un club ou créer un label. Pour moi, la prochaine étape est
d'enregistrer un disque avec le nouveau projet que je dirige avec le guitariste
Greg Tuohey, avec Joe Martin et Kush Abadey. Je vais le faire à l’ancienne, sur
bandes analogiques, et essayer de consolider le succès remporté par The Turn en le sortant en vinyle. Si ça
marche, pourquoi ne pas essayer d'en faire profiter d'autres musiciens que
j'aime en créant un label?

Beaucoup de personnes ne savent même pas qui
joue sur les fichiers qui encombrent leur disque dur…
Absolument. On prête plus d'attention à
un disque quand l'acte de commencer à l’écouter demande un –léger– effort,
comme celui de mettre un vinyle sur une platine. Il y a moins de zapping avec
des supports physiques. C’est tellement facile de passer d'une plage à l'autre
sur un ordinateur, ça l'est beaucoup moins sur un vinyle. Il me semble
qu’écouter de la musique est devenu tellement facile que c'est complètement
galvaudé. On ne fait plus attention. Et surtout, on ne veut pas payer pour la
musique. Ça va ensemble. Quand j'étais adolescent ou jeune adulte, la parution
d'un album était un véritable événement culturel. On l'écoutait, seul ou à
plusieurs. On en parlait. Je repense avec nostalgie à ce qu’a représenté pour
moi la parution d’un album comme Amandla
de Miles Davis ou OK Computer de
Radiohead…
Parlez-nous de
votre expérience avec Daniel Humair…
C’était
enthousiasmant! Daniel a une grosse expérience de l’improvisation, et il a joué
avec les plus grands, dans tous les styles. Ça s’entend. Il est peintre et je
pense que ça influence aussi sa musique. Il a un sens de l’architecture des
improvisations qui est très sûr. Il sait quand continuer, quand partir sur
autre chose et quand s'arrêter. Ce sens instinctif de la forme est une qualité
que j'apprécie chez des batteurs très différents et qui est un vrai critère de
choix pour moi. Suite au disque I Will
Follow You avec Ben Monder et Daniel, j’ai aussi joué en trio avec Ben et
Paul Motian.
Comment s’est passé cette collaboration
avec Paul Motian?
Après un concert en trio pour lequel je l'avais appelé, Paul nous a booké une
semaine au Village Vanguard sous le nom de «New Trio», ce qui, soit dit en
passant, nous a un peu mis la pression à Ben et moi, qui sommes fans du trio
Motian-Lovano-Frisell. Cela dit, il était aussi beaucoup plus facile de jouer
avec Paul Motian que je l’aurais cru. Bien qu'ils soient très différents, comme
chez Daniel, il y avait une clarté d’intention et une force d’inspiration qui
montraient vraiment le chemin. Par ailleurs, le tempo était d’une solidité à
toute épreuve, même s’il n’était pas toujours explicite. Il m’avait dit de
choisir dans ses morceaux ceux que je voulais jouer et, du coup, j'avais eu la
chance de pouvoir les apprendre par cœur et les travailler. On a joué certains
des miens, aussi. Nous n’avions pas de répétition, et la liste des morceaux a
été établie dix minutes avant le concert. L’avant-dernier soir, Chick Corea vient
nous voir et me demande: «C’était quoi ce morceau à la fin?» C’était
une de mes compositions. Ça lui avait plu… Paul était déjà malade, mais je
n’en ai rien ressenti; il était complètement investi dans la musique, à tous
les instants. Tout ce qu'il faisait était juste. J'ai senti qu'il me faisait
confiance, qu'il voulait que je donne le meilleur, sans jamais en
parler. Ça a été une semaine importante pour moi, qui a fait germer d'autres
choses.

Vous avez également travaillé avec Laurent Coq…
Oui, j’ai fait
partie de son quartet. On a enregistré deux disques ensemble, avec Damion Reid
à la batterie et Brandon Owens, puis Joe Sanders à la contrebasse. J’étais très
impliqué dans ce quartet. J’ai beaucoup joué la musique de Laurent. C’est un
ami et on se suit mutuellement. Il a une voix originale, au piano et comme
compositeur. J'aime beaucoup son dernier disque en trio, Kinship. Par ailleurs, c'est quelqu'un d’entier, qui n’a pas peur
de dire les choses. C’est rafraîchissant.
Vous
considérez-vous comme un musicien cérébral?
Au contraire, je suis très
instinctif, je n’ai pas de système et je le revendique. Quand je joue, je ne
pense pas aux accords, aux notes et aux gammes. J'espère avoir suffisamment
travaillé pour pouvoir me laisser aller et que mon oreille me guide. Je suis
plus proche de ce que j’appellerais, en simplifiant, des improvisateurs
mélodiques que des gens qui ont un système harmonique très élaboré, même si des
musiciens comme John Coltrane ou Joe Henderson transcendent ces clivages.
Avez-vous
des projets avec Danny Grissett?
Oui,
nous allons certainement enregistrer, mais je ne sais pas encore quand. Cette
tournée nous a vraiment cimentés. Danny est un de mes pianistes
préférés aujourd’hui. Il est pour moi l'héritier de certains grands pianistes
américains: Hank Jones, Tommy Flanagan et plus proche de nous, Mulgrew Miller
et Kenny Kirkland, mais il a aussi trouvé sa voix. Il a commencé par le piano
classique; il est très ouvert, tout en restant attaché à la tradition. En fait,
nous avons en grande partie la même culture musicale et des valeurs communes.
C’est ce qui fait que nous jouons ensemble. Chez beaucoup
de musiciens qui me touchent, il y a une vraie connaissance de la tradition, un
vrai lien avec l'histoire, même si ça ne s'entend pas toujours de manière
directe.
Contact: www.jeromesabbagh.com
DISCOGRAPHIE
Leader/coleader
CD 1997. Flipside, Naxos Jazz 86013-2
CD 2004. North, Fresh Sound New Talent 203
CD 2006. Pogo, Bee Jazz 019
CD 2008. One Two Three, Bee Jazz 028
CD 2010. I Will Follow You, Bee Jazz 034
CD 2011. Plugged In, Bee Jazz 049
CD 2013. The Turn, Sunnyside 1385
CD 2014. Lean, Music Wizards (avec Simon Jermyn et Allison Miller)
Sideman
CD 2001. Pablo Ablanedo Octet, From Down There, Fresh Sound New Talent 109
CD 2002 .Pablo Ablanedo Octet, Alegria, Fresh Sound New Talent 156
CD 2003. Laurent Coq Quartet, Like a Tree in the City, Sunnyside 1117
CD 2009. Laurent Coq Quartet, Eight Fragments of Summer, 88 Trees 88TREES01
CD 2009. Guilherme Monteiro, Air, BJU Records 007
CD 2014. Marta Sanchez Quintet, Partenika, Fresh Sound New Talent 470
CD 2017. Marta Sanchez Quintet, Danza Imposible, Fresh Sound New Talent 533
VIDEOS
2003. Laurent Coq Quartet, «Sweet Sounds of Summer», Duc des Lombards (Paris,
10 octobre 2003)
Laurent Coq (p), Jérôme Sabbagh (ts), Brandon Owens
(b), Damion Reid (dm)
https://www.youtube.com/watch?v=CJ5ZFx5Kb6o
2008. Jérôme Sabbagh Quartet, «Rooftops»,
Washington (USA, 14 avril 2008)
Jérôme Sabbagh (ts), Ben
Monder (g), Joe Martin (b), Ted Poor (dm)
https://www.youtube.com/watch?v=n8-Bbx570A0&list=PLE1879DD9B59A82DB
2011. Jérôme Sabbagh / Ben Monder / Daniel Humair ,
«Comptine», Sunside (Paris, 9 avril 2011)
Jérôme Sabbagh (ts), Ben Monder (g), Daniel Humair
(dm)
https://www.youtube.com/watch?v=GAVAsBjE4pU
2014. Jérome Sabbagh & Danny Grissett, «It Could
Happen to You», Drawing Room (New York, USA, 2 février 2014)
Jérôme Sabbagh (ts), Danny Grissett (p)
https://www.youtube.com/watch?v=2buS__E8-O0
2014. Jérôme Sabbagh Quartet, Jazz Gallery (New
York, USA, 14 juin 2014)
Jérôme Sabbagh (ts), Ben Monder (g), Joe Martin
(b), Jochen Rueckert (dm)
https://www.youtube.com/watch?v=_XQyLsiZt1o
*
|

