
Ira Coleman, Vitoria-Gasteiz,
Espagne, 2009 © Jose Horna
Ira COLEMAN
Collective
Ira Coleman est né dans une famille d’artistes (le 29 avril 1956 à Stockholm) où
le jazz occupait une place essentielle. Son père est le peintre afro-américain
Walter Coleman (1924-1988)1. Sa mère est l’orfèvre et designer suédoise, Vivianna
Torun Bülow-Hübe (1927-2004)2. Leurs amis musiciens se nommaient Charles Mingus,
Max Roach, Billie Holiday, Art Taylor, etc. Le jazz est un art de vivre et une
ouverture sur le monde, Ira Coleman l’a bien compris. Il suffit de voir
son parcours professionnel. Après des études à Berklee (1982-1984), il
accompagne certains des musiciens les plus originaux et les plus intransigeants
de leur époque, notamment Betty Carter et Tony Williams, et il a enregistré avec
les grands du jazz, toutes générations confondues: Eddie Henderson, Monty
Alexander, Barney Wilen, Herbie Hancock, Pharoah Sanders, Mulgrew Miller,
Vincent Herring, etc. D’autres aventures
musicales l’ont amené en Afrique avec Dee Bridgewater, et aussi dans les
Caraïbes. A côté d’une discographie très étoffée en sideman, il a peu
enregistré en leader, car son plaisir, c’est le collectif.
Propos recueillis par Mathieu Perez
Photos Umberto Germinale et Jose Horna
© Jazz Hot 2020
Jazz Hot: Vos parents étaient artistes. Tous deux
aimaient le jazz. Pour eux, c’était une forme artistique à part entière.
Ira Coleman: Ma mère avait 12 ans quand elle a vu son premier concert de jazz: Duke
Ellington en 1939 à Stockholm. Ça a changé sa vie. Je viens d’une famille
d’artistes. Ma mère était orfèvre et designer. Ma grand-mère maternelle était
sculptrice. Mon grand-père, architecte urbaniste. Mon arrière-grand-père, peintre.
Et mon parrain est le sculpteur et musicien vénézuélien Narciso Debourg. Il a
cofondé le groupe de musique Los Incas. Il vit en France depuis les années
1950. Mes parents étaient curieux de tout et très ouverts culturellement. Ma
mère écoutait de la musique venue des quatre coins du monde. Donc, j’ai
toujours entendu de la musique. Puis, Mingus venait à la maison. Mon père
était plus Modern Jazz Quartet et Billie Holiday, pour laquelle ma mère a fait
des bijoux. Ma mère, plus Monk, Mingus, Max Roach…
Votre père s’est installé en France en 1951 pour vivre
sa vie d’artiste?
Mon père a fait la Seconde
Guerre mondiale. Il a été blessé en Italie. Il a été décoré de deux Purple
Heart et de la Bronze Star. Après la guerre, il est retourné aux Etats-Unis. Il
était issu d’une famille bourgeoise, cultivée. Mon grand-père avait une
compagnie d’assurance afro-américaine à Baltimore, mon père était le mouton
noir de la famille, il voulait être peintre; il a étudié les arts graphiques
contre la volonté de son père; il fréquentait le monde du jazz. Grâce à la G.I.
Bill, il a eu une bourse et s’est inscrit à la Parsons School of Design de New
York. Après sa formation, il s’est installé à Paris.
Quand a-t-il rencontré votre mère?
En 1955, en Suède. Ça a
été le coup de foudre. Je suis né un an plus tard. Assez vite, après ma
naissance, ils sont retournés à Paris. On a vécu là jusqu’en 1958. Ensuite, nous
nous sommes installés à Biot, dans les Alpes-Maritimes. Puis, mes parents se
sont séparés.
Votre père vivait de sa peinture?
Non, c’était dur. Il
faisait du graphisme, dessinait des pochettes de disques de jazz pour les éditions
françaises de disques américains importés par Eddie Barclay.
Que peignait-il?
Il peignait ses amis
musiciens. Il dessinait, peignait, faisait de l’aquarelle. Les expatriés
américains le connaissaient. Mon père est aussi le premier Afro-américain à
avoir escaladé le Mont-Blanc, en 1954. Donc, à Biot, tout le monde passait à la
maison: Louis Armstrong, Charles Mingus, Max Roach, Abbey Lincoln, Art Taylor,
Johnny Griffin, Chester Himes… Ils étaient tous des copains de mon père. Quand
ils étaient dans le Sud, ils logeaient à la maison. C’est comme ça que j’ai vu
Miles en concert avec ma mère en 1963, au Festival de Juan-les-Pins. C’est
drôle, j’y ai joué vingt-cinq ans plus tard avec Tony Williams. J’ai rencontré
un photographe qui m’a montré une photo de moi enfant avec ma mère…
Et votre mère créait des bijoux.
Il y a une photo de Billie
Holiday prise par Jean-Pierre Leloir. Elle porte des boucles d’oreille et un collier, que
ma mère a créés.
Le jazz était partout à la maison.
Plus les disques! Mes
parents devaient avoir cinq mille disques. Ils m’amenaient à tous les concerts.
Mais je n’ai commencé à jouer de la musique qu’à 18 ans.

Ira Coleman avec Dee Dee Bridgewater,
Vitoria-Gasteiz, Espagne, 2009 © Jose Horna
Qu’est-ce qui vous a attiré dans le fait de jouer
de la musique?
A un moment, j’ai voulu
savoir comment se faisait cette magie. Et j’ai toujours été attiré par la
contrebasse. Quand mon père travaillait sur la pochette de Olé de Coltrane, j’étais tout petit. Pendant que le disque jouait,
il paraît que je lui aurais dit qu’il y avait deux contrebassistes! Lui ne n’en
était pas rendu compte. Ma mère m’a raconté aussi que lorsqu’elle était
enceinte, elle n’écoutait que du Coltrane. Ce sont des anecdotes... La
contrebasse est un instrument qui me correspond.
Dans quel sens?
Je suis un peu timide. Je
ne veux pas être devant le groupe. Et je n’ai pas un don musical exceptionnel que
j’aurais entretenu dès l’enfance. Je n’ai pas l’oreille absolue ni le perfect pitch. Je joue collectif. J’aime
faire partie d’un groupe et bien faire sonner les autres. J’ai choisi le bon
instrument pour ça. Mais, ce n’est pas le plus facile.
En 1966, votre mère a rejoint le mouvement spirituel
Subud en Allemagne (1966-1978), puis s’est installée en Indonésie.
J’ai baigné un peu dans
ça... J’avais 12 ans. Je me souviens d’avoir fait le ramadan quand j’avais 16
ans. Les membres Subud se posaient des questions existentielles, d’altruisme.
Ils étaient ouverts à toutes les religions. Il n’y avait pas de dogmes. Ça
attire des gens qui ne sont pas sûrs d’eux-mêmes, qui se cherchent. Comme dans
toutes les religions, il y a des personnes qui en profitent. Je n’en fais plus
partie depuis très longtemps. Pour moi, c’est un chemin individuel qu’il faut
entreprendre. Je ne pousserai jamais des enfants à aller à l’église ou
ailleurs. On en parle avant.
La dimension spirituelle de la musique, vous l’avez
toujours ressentie?
Quand j’écoute A Love Supreme, je sens qu’il y a une
dimension plus grande que les notes. Ça reflète autre chose. C’est vrai dans la
peinture, aussi.
De quand datent vos débuts de musicien?
J’ai fait mon service
militaire dans les Forces françaises en Allemagne, dans le 9e régiment
d’artillerie de marine à Trier (Trèves). A côté, il y avait la base aérienne de
Bitburg où il y avait beaucoup d’Américains. Mais j’ai surtout rencontré des
musiciens allemands, comme le pianiste Georg Ruby. A cette époque, ma mère
était partie vivre en Indonésie avec ma sœur. Mon père était à Paris. Je me
suis retrouvé tout seul en Allemagne. Je me demandais ce que j’allais faire.
J’avais étudié l’électronique comme apprenti et commencé à jouer de la contrebasse.
Puis, en sortant l’armée, j’ai travaillé quelques mois dans une usine de
cigarettes. J’ai économisé ce que j’ai gagné, et je suis parti à Cologne. Georg
Ruby m’a conseillé de me présenter au conservatoire. J’avais assez d’argent
pour vivre pendant six mois. J’ai pris des cours avec un prof’ pendant trois ou
quatre mois. Je travaillais dix, douze heures par jour. J’ai réussi l’examen. A
la deuxième leçon au conservatoire, on m’a demandé de jouer une gamme en ré
bémol. Je ne la savais pas. (Rires)
Donc, j’ai tenu un semestre... Il y avait un programme de jazz, et je suis
passé du classique au jazz. Puis, en 1979, je suis parti aux Etats-Unis pour
voir ma famille. Et mon ami de Cologne m’avait parlé de Berklee. Il m’avait
encouragé à y étudier. Avec le recul, je regrette de ne pas avoir fini ma
formation classique. Je recommande ça à tous les contrebassistes, parce que c’est
important de pouvoir jouer différents types de musique. L’époque où un musicien
pouvait n’avoir qu’une seule spécialité est finie. J’ai toujours essayé de
jouer des musiques différentes. J’ai joué avec des musiciens sénégalais,
maliens, américains, latinos, etc.
Qu’est-ce qui est le plus formateur dans le
classique?
La discipline et cette approche
scientifique bien pensée avec des écoles de contrebasse bien définies. Ça apprend
à travailler l’instrument de manière efficace. Bien plus tard, j’ai pris des
cours pendant deux ans avec Homer Mensch, qui enseigne à Juilliard et à la
Manhattan School of Music. Il m’a beaucoup aidé sur la méthode de travail à
avoir. J’ai dû arrêter parce que j’étais en tournée tout le temps.
Le contrebassiste Jimmy Woode vous avait aussi encouragé?
Jimmy était comme un oncle.
Il vivait en Europe depuis les années 1950. Il avait travaillé avec Duke
Ellington, il connaissait mes parents. Je l’ai revu quand il vivait en Suisse.
Puis, il est reparti vivre aux Etats-Unis. Il m’a encouragé à jouer. Mais c’était
intimidant... Aller en Amérique, dans ce pays où tout le monde joue
monstrueusement... J’avais la trouille.
A Cologne, vous assistiez à des concerts de jazz?
J’habitais à deux pas du
Subway Jazz Club où j’ai vu Ron Carter, Ray Drummond, Buster Williams, etc. Ils
passaient tous.
Comment s’organisait votre vie quotidienne à cette
époque?
Je suis arrivé en décembre
1977 à Cologne, et j’en suis parti à l’été 1982. J’étais au conservatoire la plupart du temps.
Toutes les semaines, il y avait des concerts. Et j’ai commencé à jouer avec des
musiciens allemands et américains de mon âge.
Pouvez-vous partager un souvenir de concert
marquant?
Ron Carter à la basse-piccolo,
avec Ronnie Mathews et Kenny Washington, qui a exactement mon âge. J’ai parlé à
Ron. Il a été très gentil, m’a donné son numéro. J’ai rencontré plein de
musiciens comme ça au Subway. Les bassistes étaient très sympas. David
Williams, Clint Houston, Ray Drummond, etc. Et quand je suis arrivé à New York,
ils m’ont tous recommandé.
A la Berklee où vous étudiez de 1982 à 1984,
y avait-il beaucoup de contrebassistes?
Non, pas beaucoup, mais
les bassistes électriques étaient nombreux; c’était l’époque de la fusion. Peu
jouaient du straight-ahead.
Avec qui jouiez-vous?
Assez vite, j’ai joué avec
Terri Lyne Carrington, Greg Osby, Gene Jackson, etc.
Quel était votre état d’esprit?
Je partais pour apprendre
à jouer. J’avais hâte! J’avais déjà 27 ans… Puis, les profs ont commencé à
m’appeler pour jouer avec eux. Le premier à m’avoir appelé, c’était le
saxophoniste Allan Chase. Puis, tous les soirs, je jouais à des concerts
d’étudiants, parce qu’on avait toujours besoin d’un bassiste.
Qu’est-ce qui a été le plus formateur à la Berklee?
J’adorais les cours de
formation de l’oreille, d’harmonie, de dictée musicale, travailler la lecture; c’est tout ce qui me manquait. A ce jour, je travaille encore sur ça, ce sont
les fondamentaux. Si on arrête de
jouer une semaine, on perd. Il faut toujours entretenir.
Au départ, par l’intermédiaire de Max Roach, vous
auriez pu étudier à l’université d’Amherst, dans le Massachussetts.
Mon père et Max Roach
étaient copains. Au début des années 1950, ils traînaient ensemble à New York. Dans
les années 1960, quand il était de passage en France, Max venait chez nous.
Dans les années 1980, quand mon père est retourné vivre aux Etats-Unis, c’est
chez Max qu’il habitait. Il a même organisé une expo pour mon père à New York, c’était un ami de la famille. Un soir, en 1977, Max passe à Hambourg; je vais
le voir, je lui dis que j’aimerais étudier la musique, parce que c’est vraiment
ce que je veux faire. Il me dit alors qu’il dirige le département de musique de
l’université d’Amherst et que mon père, étant américain, on pourra sûrement se
débrouiller pour que j’étudie là-bas. Puis, à l’été 1979, je suis allé aux Etats-Unis.
J’ai passé un mois chez Max, dans le Connecticut. Ça a été une introduction à
ce monde du jazz. J’ai pu assister à l’enregistrement en studio de M’Boom.
Pourquoi avoir choisi la Berklee?
L’enseignement me
semblait plus élaboré.
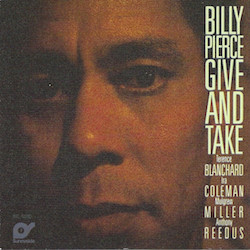
Votre rencontre avec Bill Pierce a été décisive. Il y enseignait ?
Oui, depuis 1975. Il jouait
à ce moment-là avec Art Blakey. Je l’ai vu plusieurs fois dans plusieurs
formations des Messengers. A la Berklee, il dirigeait un ensemble sur la musique
de Blakey.
Votre premier concert avec lui?
C’était à Boston, pour des
lycéens. Il y avait Alan Dawson (dm), James Williams (p), Pierce (ts) et moi.
C’est là que vous avez accompagné des musiciens
historiques?
Bobby Hutcherson est passé
à la Berklee. George Coleman aussi. Terri Lyne Carrington (dm) et moi, on les
accompagnait.
Avec qui rêviez-vous de jouer?
Herbie Hancock et Tony
Williams. Des années plus tard, quand j’ai joué avec Tony puis avec Herbie, ma
petite sœur m’a écrit une lettre très touchante. Elle me disait qu’elle était
heureuse que j’aie accompagné Herbie et Tony. C’est émouvant, parce que tout
ça, je ne l’avais pas exprimé avec des mots.
De quelle contrebassiste historique vous
sentez-vous le plus proche?
De Ron Carter. Il y a une
élégance, une consistance, un niveau supérieur. Je me suis reconnu dans sa
démarche. Moi aussi, je n’ai jamais été très solo. Ça me convient beaucoup
plus. J’aime le son très ancré. Vous connaissez le disque de Gene Harris, Gene Harris of the Three Sounds? Sa
ligne de basse sur «John Brown’s Body» est d’une beauté! C’est traditionnel
mais majestueux. Ron Carter est un grand Maître.
Quand êtes-vous arrivé à New York?
A l’automne 1984. Je
partageais un appartement avec Terri Lyne Carrington et Scott Robinson. Je
jouais dans la rue avec Vincent Herring, entre la 52e Rue et la 8e
Avenue ou à Brooklyn. J’ai fait des petites sessions, des petits boulots aussi.
Les gigs arrivaient petit à petit.
Quels furent les premiers gigs importants?
A l’été 1985, je suis
retourné à la Berklee pour valider mon
diplôme. Juste avant de partir, Steve Turre m’a entendu jouer avec Ronnie Mathews.
Il m’appelle pour un concert à Newark, où je rencontre Mulgrew Miller. Presque
au même moment, James Williams m’appelle aussi pour un gig... A la Berklee,
Mulgrew me passe un coup de fil. Il me dit qu’il va enregistrer son premier
disque en trio, mais il veut le faire avec ses contemporains. Il m’a envoyé sa
musique, et nous avons enregistré avec Marvin Smitty Smith. Puis, j’ai eu des engagements avec
Carl Allen. Il m’a dit alors qu’il jouait avec Freddie Hubbard, que Freddie voulait
monter un groupe avec des jeunes, et qu’il lui a proposé mon nom avec ceux de
Kenny Garrett et Donald Brown. Je connaissais la réputation de Freddie Hubbard,
un type très intense... J’ai demandé conseil à Bill Pierce, qui m’a dit de toujours
rester cordial avec lui, de garder mes distances, de prendre la musique au
sérieux.
Et Archie Shepp?
C’était juste avant
Freddie Hubbard. Je connaissais le fils d’Archie, Pavel Shepp, de la Berklee. Il
m’a dit que son père enseignait à Amherst, et qu’il auditionnait des bassistes
pour un engagement d’une semaine à Montréal, avec Smitty Smith et Kenny Werner.
J’ai sauté dans un bus pour aller passer une audition. On a joué «In a
Sentimental Mood», et il m’a dit que j’étais engagé!
Quel souvenir gardez-vous de cette semaine passée
avec lui?
C’était chaud! On a
commencé avec «Giant Steps»: on joue le thème puis Archie part pendant dix
minutes et, quand il revient, il joue un solo de dix minutes. Ils étaient tous
comme ça! Johnny Griffin, c’était pareil. On commence avec «Autumn Leaves» et on
le joue super vite! (Rires)
Combien de temps êtes-vous resté avec Freddie
Hubbard?
Six-huit mois. On a
fait une tournée en Europe. La première date, c’était au début de l’automne... à
Cologne, au Subway, Freddie prend le micro, me présente, dit que je suis de Cologne,
que je suis parti étudier à la Berklee, et que je vais maintenant montrer à tout
le monde ce que j’ai appris. J’avais la pression! (Rires)
Qui était dans la formation?
Mark Templeton, Kenny
Garrett, Carl Allen et moi. C’était une bonne tournée. Il y a une vidéo à
Berlin où on joue avec Dizzy Gillespie et Woody Shaw. (Rires)
Et musicalement, ça se passait comment?
Il commençait à jouer et
nous, on devait s’accrocher! (Rires) Pendant
cette tournée, Freddie jouait super! La toute première semaine avec lui,
c’était au Rick’s Café Américain, à Chicago. Il avait joué sans échauffement. Ses
lèvres saignaient… Il n’avait pas joué depuis une semaine. (Rires) Mais il a bien aimé notre
énergie, on était jeunes, Carl sonnait sublime, Donald venait de jouer avec Art
Blakey.
Que jouiez-vous?
Tous ses morceaux: «One of
a Kind», «One of Another Kind», «Red Clay», «Sky Dive», etc., j’adore!
Votre passage auprès de Freddie Hubbard a tout
déclenché?
La boule a commencé à
rouler. A partir de là, j’ai fait beaucoup de concerts locaux, je jouais avec
beaucoup de monde. Puis, en 1988, j’ai auditionné pour Betty Carter.
Comment est-ce venu?
Winard Harper m’a dit
qu’elle faisait passer des auditions et m’a conseillé de me présenter.
Comment s’était passée l’audition?
Elle m’a demandé de jouer
une ballade, puis un morceau rapide et un truc de reggae, et elle m’a dit que
c’était bon. A l’audition, il y avait Stephen Scott, âgé alors de 18 ans, au
piano, et Winard Harper.

Quelle a été votre relation avec Betty Carter?
Elle était très dure avec
les bassistes. Elle claquait ses doigts comme Ray Charles pose son pied. Elle
était très old school. Elle adorait
Miles. Elle essayait de changer la façon de chanter. Elle prenait de grandes
libertés avec la mélodie. Elle avait monté son label dans les années 1970. C’est
une femme qui s’est toujours battue. Ça a été un apprentissage formidable. Si
j’accompagne n’importe quel batteur qui a joué avec Betty Carter –Clifford
Barbaro, Jack DeJohnette, Lewis Nash, Winard Harper, Greg Hutchinson, Kenny
Washington– je trouve le point de référence tout de suite.
Elle était intransigeante…
Très, c’est le genre de personnes qui vous dit des choses
négatives tous les jours. Une fois, elle a demandé à Calvin Hill d’arrêter de
jouer; il ne s’est pas arrêté. Elle lui a alors pris les mains, Calvin a piqué
une crise! Il a failli se battre avec elle. Elle était dure! Elle s’est battue
avec Cecil Taylor une fois. Un jour, je suis allé la voir à la fin d’un concert lui dire que je n'en pouvais plus. Elle était sur la défensive, c'était le dernier soir. Je l’ai
remerciée de tout ce que j’avais appris grâce à elle, et là, j’ai vu cette femme
si dure fondre puis venir m’embrasser. Je croyais qu’elle me détestait... Six
mois plus tard, elle me rappelait parce que ça n’avait pas marché avec son nouveau
bassiste.
Et vous vous êtes revus?
De nombreuses fois, elle
était charmante. La dernière fois que je l’ai vue, c’était au festival de Nice
en 1998, quelques mois avant sa mort.
Vous avez beaucoup tourné avec elle?
Beaucoup. Six semaines
à chaque fois, et elles étaient bien organisées.
Combien de temps avez-vous fait partie de sa
formation?
Deux ans. Jusqu’en 1989.
Votre première tournée en Europe, c’était avec
Freddie Hubbard?
Oui.
Et la première fois au Japon?
Avec Tony Williams.

Après Betty Carter, vous avez enchaîné directement
avec Tony Williams?
Je travaillais pendant
l’été 1989. Ma mère me répétait toujours d’aller voir Art Taylor, un ami de la
famille. Mais je n’ai jamais voulu demander d’engagements aux amis de mes
parents, ce n’était pas concevable pour moi. Il m’arrivait de les croiser, bien
sûr, mais je ne leur demandais rien. Je n’ai jamais rien demandé à Max Roach,
par exemple. Je retrouve donc Art Taylor parce qu’il voulait monter un groupe
avec des jeunes. Il y avait Jacky Terrasson, Vincent Herring et moi. On a joué lors
d’un concert caritatif au Sweetwaters pour Woody Shaw qui était tombé sur les
rails du métro et avait été percuté par un train. Ce soir-là, tout le monde
était là. Après la performance, je croise le maître de cérémonie Paul West qui
me dit qu’on a besoin d’un bassiste tout de suite sur scène. Et je me retrouve avec
Bobby Enriquez, Vernell Fournier et George Benson. On joue trois morceaux.
Après ça, Mary Ann Topper, la manager de Tony Williams, me dit que, lorsqu’elle
m’a entendu, en arrivant au club, elle pensait que c’était Ron Carter. Puis, elle
me dit que Tony cherchait un bassiste, parce que Bob Hurst partait en tournée cet
été-là avec Branford Marsalis et Jeff Watts. C’est arrivé comme ça... D’ailleurs,
cinq minutes après ma rencontre avec Mary Ann, Milt Jackson m’engageait pour une
semaine au Village Vanguard. (Rires) C’est
comme ça que les choses se sont toujours faites. J’étais trop timide pour
demander à tous ces leaders qu’ils m’engagent. Et ce qui était sain, c’était que
l’ego n’avait pas le temps de gonfler. Il y en avait toujours un pour te dire
qu’il y avait mieux que toi…
Dans ces années, vous jouiez beaucoup au Bradley’s?
Parfois, j’y ai joué des
mois entiers! J’accompagnais James Williams, JoAnne Brackeen, George Cables,
Donald Brown, Mulgrew Miller, etc. Pendant que tu joues, tu jettes un œil au
bar et, là, tu vois Ron Carter, Ray Brown, Ray Drummond, Peter Washington,
David Williams, Tommy Flanagan, George Benson, Tony Bennett, Joni Mitchell, etc.
(Rires)
Comment avez-vous préparé l’audition avec Tony
Williams?
Mulgrew m’a fait des copies
de tous les morceaux. Je les ai préparés à fond avec lui. Je vais jouer ensuite un
set avec Tony et lui à New Heaven. Le premier morceau qu’on joue est «Red
Mask». Dès l’intro de Tony, j’ai cru qu’un train de marchandises me fonçait
dessus! (Rires) C’était d’une puissance!
Il fallait s’accrocher! Après ça, il m’a dit que c’était bon. J’ai joué
tout l’été avec lui. Six mois tard, on a fait le disque Native Heart. Bob Hurst a enregistré une moitié, moi l’autre. Quelques
mois après, Tony m’a proposé de rejoindre son groupe. Jusqu’à son décès, je
n’ai raté aucun de ses concerts.
Ça se passait comment avec lui?
C’était cordial. Il y
avait la distance qu’il fallait. Pour ce qui est du business, Tony était très
honnête. Une fois sur scène, seule la musique comptait.
Et musicalement?
Au début, quand je suis
arrivé dans le quintet avec des musiciens qui se connaissaient bien et qui jouaient
ensemble depuis trois ans, j’ai eu du mal à me synchroniser avec Tony, parce qu’il
jouait tellement de choses que ce n’est pas toujours facile de sentir sa
pulsation interne, son time set à lui.
Les six premiers mois, je n’y arrivais pas. Puis, un soir, au Village Vanguard,
on joue «Foreign Intrigue». Et ça a été comme une épiphanie. A partir de là,
j’ai trouvé ma place.
Qu’est-ce qui vous impressionnait le plus chez lui?
Je dis toujours qu’il
jouait fort, mais ne faisait pas de bruit. Il fallait s’accrocher pour jouer
avec lui, car, en plus de jouer mille choses, il entendait tout ce qu’on
faisait. Ça a été une grande leçon. Et il composait beaucoup. Il y avait
toujours des nouveaux trucs. Sa musique était très structurée. Parfois, il nous
ressortait un morceau d’un an auparavant et le jouait sans partition. J’ai
beaucoup appris avec lui. Une fois, on croise Miles à l’aéroport. Il demande à
Tony pourquoi il ne monte pas une équipe de basketball avec son groupe (Rires)... parce qu’on mesurait tous plus
de 1m80! (Rires)
Comment décririez-vous Tony Williams?
Je me souviens d’une
conférence qu’il avait faite au Lincoln Center sur les batteurs de jazz. Les
musiciens noirs l’avaient critiqué parce qu’il avait inclus Buddy Rich et
Shelly Manne. (Rires) Tony est le
premier batteur de fusion, mais il ne cachait pas son amour du straight-ahead et
des Beatles. Il a arrêté l’école très jeune pour se consacrer à la musique, mais
il n’a jamais cessé d’étudier. Il a pris des cours de composition pendant une
vingtaine d’années. Il prenait aussi des cours de course de voitures. A la fin
de sa vie, il apprenait l’allemand… Le festival de jazz de San Francisco lui
avait commandé une composition pour une soirée spéciale organisée en son honneur
au Herbst Theater. Il avait écrit «Rituals» qui a été interprété en ouverture par
le Kronos Quartet avec Herbie Hancock au piano et lui à la batterie. Puis, en
deuxième partie de soirée, il y avait le quintet, composé de Tony, Bill Pierce,
Wallace Roney, Mulgrew Miller et moi, et enfin un trio électrique. C’est le
dernier grand innovateur de la musique qui swingue. Tony était aussi quelqu’un
qui a toujours recherché une partenaire. Il s’est marié très jeune une première
fois, a divorcé, a eu des liaisons. J’ai assisté à la rencontre de Tony et de
sa femme Colleen, ils étaient faits l’un pour l’autre. Là, j’ai vu Tony
heureux, il est mort auprès de quelqu’un qu’il aimait très fort.
Quel album aimez-vous le plus?
Neptune,
peut-être.
Pendant l’aventure Tony Williams, vous travailliez
avec qui d’autre?
Dans mon time-off, je jouais avec Monty Alexander.
Là, c’était complètement différent. (Rires)
Ira Coleman avec Dee Dee Bridgewater, Juan-les-Pins, 2005 © Umberto Germinale-Phocus
Avant d’enregistrer Red Earth de Dee Dee Bridgewater au Mali, aviez-vous travaillé avec
des musiciens africains ou caribéens?
Pour Red Earth, Cheick Tidiane Seck a ouvert toutes les portes. C’était
lui le directeur musical. Il a donné tous les thèmes traditionnels à Dee Dee. Avant
ce voyage, j’avais fait deux disques avec Ernest Ranglin, Below The Bassline et In
Search of the Lost Riddim, qu’on avait enregistrés et produits à Dakar.
J’avais aussi travaillé avec Baaba Maal, et Kaouding Cissoko pour son
disque Kora Revolution.
Avez-vous entendu le blues chez les musiciens du
Mali?
Oui, absolument. Les
griots, ce sont des chanteurs de gospel. C’est une musique qui crie, comme le
blues.
Avec quels autres batteurs avez-vous eu une
relation comme avec Tony Williams?
Du niveau de Tony
Williams, je ne vois pas... J’ai eu ça avec Laurent de Wilde. Ça a été un vrai
échange. Je l’ai rencontré une semaine après mon arrivée à New York. C’est un
vieux copain. C’est avec lui que j’ai renoué avec le français. J’ai quitté la
France à 12 ans, il m’a fait apprécier ma culture française. On a beaucoup
joué dans les Alliances Françaises. Puis, quand il est revenu à Paris, j’ai
continué à faire des disques avec lui. On a fait plein de tournées en Asie notamment
avec lui et Philippe Soirat.
Mulgrew Miller est
peut-être le pianiste avec lequel vous avez eu la relation la plus forte…
Mulgrew était un mec super modeste, gentil,
généreux. Il ne savait pas dire de gros mots. C’était son côté école du sud
très correcte. Il était très spirituel, sans l’afficher. Pendant les concerts,
il disait au public que les musiciens de jazz s’étaient battus pour cette
musique. C’était triste de le voir partir si tôt.
1. Walter Coleman est né à Baltimore, MD le 24 octobre 1923. Les lois ségrégationnistes lui refusant l'entrée de toutes les écoles d'art du Maryland, après un bref passage par l'université, il travaille notamment comme créateur d'affiches de théâtre avant de s'enrôler dans l'armée en 1942. Blessé en Italie et fait prisonnier par l'armée allemande, il parvient à s'échapper près du Col du Brenner. Après la guerre, il bénéficie de la bourse d'étude pour les soldats démobilisés, la «G.I. Bill», grâce à laquelle il intègre la Parsons School of Design à New York. En 1951, il émigre à Paris, rejoignant son frère aîné, Emmett, architecte. Durant ces premières années, il peint pendant la journée et passe ses soirées à échanger avec les artistes et écrivains afro-américains qui se retrouvent au Café Tournon, près du jardin du Luxembourg. Il développe une technique particulière, donnant un effet vitré, autour des portraits d'artistes et en particulier de jazzmen, sa spécialité. Après la disparition de Billie Holliday (également originaire de Baltimore) en 1959, une série d'œuvres inspirées de ses chansons est exposée à New York et à Paris. Après trente-trois ans, il finira par revenir à Baltimore pour une rétrospective au Eubie Blake Cultural Center en 1986. IL décède en 1988 d'une brève maladie.
2. Fille d'un directeur de l'urbanisme et d'une sculptrice, Vivianna
Torun Bülow-Hübe, dite Torun, est née à Malmö le 4 décembre 1927, benjamine d'une fratrie de quatre enfants qui suivront tous des carrières artistiques. Torun étudie l'art à Stockholm en 1945, alors qu'elle est enceinte de son premier enfant dont elle épouse le père, un étudiant en journalisme. En 1948, elle passe l'été à Paris où elle rencontre Picasso, Braque, Matisse. A partir de 1952, elle expose ses bijoux fabriqués à Stockholm et à Paris. Elle s'installe en France en 1956 avec Walter Coleman, après avoir divorcé de son deuxième mari, un architecte français. De ce fait, elle fréquente les musiciens de jazz, dont Billie Holiday pour qui elle conçoit des bijoux. Deux ans plus tard, le couple s'établit à Biot (Alpes-Maritimes) où Torun renoue avec Picasso. Elle produit alors de nombreuses pièces (dont certaines deviennent célèbres comme la «montre Vivianna») tandis que de jeunes orfèvres suédois viennent travailler dans son atelier. En 1966, après la fin de son mariage avec Walter Coleman, elle s'engage dans le mouvement spirituel Subud et déménage en Allemagne en 1968. Elle étend ses créations à la coutellerie, la porcelaine et les sacs à main. En 1992 son travail fait l'objet de deux rétrospectives à Copenhague et à Paris, au Musée des Arts Décoratifs du Louvre. Première femme orfèvre de renommée internationale, elle est décédée à Copenhague en 2004.
*
CONTACT: www.iracoleman.com
IRA COLEMAN & JAZZ HOT: N°477-1990
|
DISCOGRAPHIE
Coleader
CD 2015. Niels Lan Doky/Ira Coleman/Jeff Tain Watts, Reunion, Artistshare
CD 2018. Ira Coleman/Dado Moroni/Enzo Zirilli, Enzirado, Abeat 186
 
Sideman
LP/CD 1985. Mulgrew Miller, Keys to the City, Landmark 1507/1019
LP/CD 1987. Bill Pierce, Give and Take, Sunnyside 1026
LP/CD 1988. Betty Carter, Look What I Got, Verve 835 661-2
CD 1988. Marlon Jordan, For You Only, CBS 66895 2
CD 1989. Carl Allen and Manhattan Projects, Dreamboat, Timeless 327
CD 1989. Carl Allen and Manhattan Projects, Piccadilly Square,
Timeless 406
CD 1989. Laurent de Wilde, Odd and Blue, IDA 023
CD 1989. Tony Williams, Native Heart, Blue Note 7 93170 2
CD 1990. Renee Rosnes, For the Moment, Blue Note 7 94859 2
CD 1990. Eddie Henderson-Laurent de
Wilde, Colors of Manhattan, IDA 027
CD 1991. Vincent Herring, Evidence, Landmark 1527
CD 1991. Bill Pierce, One for Chuck, Sunnyside 1053
CD 1991. John Swana and Friends, John Swana, Criss Cross Jazz 1055
CD 1991. Tony Williams, The Story of Neptune, Blue Note 7 98169-2
CD 1991. Bob Kenmotsu, The Spark, Asian Improv 0010
CD 1992. Franco Ambrosetti, Live at the Blue Note, Enja 7065-2
CD 1992. Monty Alexander, Caribbean Circle, Chesky 80
CD 1992. Billy Cobham, Reflected Journey, Purple Pyramid 2229
CD 1992. Billy Cobham, Mirror's Image, Cleopatra 2098,
Purple Pyramid 739.2
CD 1992. Tony Williams, Tokyo Live, Blue Note 0777 7 99031-2
CD 1993. Travis Shook, Travis Shook, Columbia 473770-2
CD 1993. Vincent Herring, Secret Love, MusicMasters Jazz
01612-65092-2
CD 1993. Peter Delano, Peter Delano, Verve 314 519 602-2
CD 1993. Othello Molineaux, It's About Time, Big World
Music 2010
CD 1993. Vincent Herring, Dawnbird, Landmark 1533-2
CD 1993. Vincent Herring, Folklore, MusicMasters Jazz
01612-65109-2
CD 1994. Billy Cobham, The Traveler, Evidence 22098-2
CD 1994. Jonny King, In From The Cold, Criss Cross Jazz 1093
CD 1994. Scott Wendholt, Through The Shadows, Criss Cross Jazz
1101
CD 1994. Barney Wilen, New York Romance, Venus 2084
CD 1994. Ulf Wakenius, New York Meeting, L+R Records 45082
CD 1994. Eric Felten, Gratitude, Soul Note 121296-2
CD/DVD 1994. Barbara Hendricks & Monty Alexander Trio, Tribute
to Duke Ellington, EMI Classics/Angel 7243 5 55346-2
CD 1994. Monty Alexander, Steamin’, Concord 4636
CD 1994. Barney Wilen, Talisman, IDA 037
CD 1994. Joanne Brackeen, Power Talk, Turnipseed Music 08
CD 1995. Kathleen Battle, So Many Stars, Sony 68473
CD 1995. Michael Rabinowitz, Gabrielle’s Balloon, Jazz
Focus 011
CD 1996. Monty Alexander's Ivory & Steel, To the Ends of the
Earth, Concord Picante 4721
CD 1996. Ernest Ranglin, Below the Bassline, Island Jamaica
Jazz 314-524 299-2
CD 1996. Laurent de Wilde, Spoon-a-Rhythm, Columbia 68635
CD 1996. Tony Williams, Young at Heart, Columbia/Legacy 69107
CD 1998. Joe Chambers, Mirrors, Blue Note 7243 4 96685-2
CD 1998. Ernest Ranglin, In Search of the Lost Riddim, Palm
Pictures 2001
CD 1998. Herbie Hancock, Gershwin's World, Verve 557 797-2
CD 1998. Antonio Faraò, Black Inside, Enja Records 9345-2
CD 1999. Arkadia Jazz All-Stars, Thank you, Duke!, Arkadia Jazz
7003
CD 1999. Arkadia Jazz All-Stars, Thank you, Joe!, Arkadia Jazz
7004
CD 1999. Dado Moroni, Out of the Night, Jazz Focus 032
CD 1999. Kaouding Cissoko, Kora Revolution, Palm Pictures 003-2
CD 1999. Tim Hagans, Animation-Imagination, Blue Note 7243 4
95198-2
CD 1999. Denise Jannah, The Madness of Our Love, Blue Note 7243 5
22642-2
CD 2000. Mamadou Diabate, Tunga, Alula 1019
CD 2000. Uli Lenz, Rainmaker's Dance, Arkadia Jazz 71031
CD 2000. Byron Stripling, Byron, Get One Free…, Nagel Heyer 2016
CD 2001. Klaus Doldinger, Works & Passion, 1955-2000, Warner 8573-88087-2 (4 CDs)
CD 2001. Barbara Hendricks, Tribute to George Gershwin, EMI
Classics 7243 5 57049-2
CD 2001. David Klein, My Marilyn, Enja Records 9422-2
CD 2001. Bob Belden, Black Dahlia, Blue Note 7243 5 23883-2
CD 2002. Dee Dee Bridgewater, This Is New, Verve 314 016 884-2
CD 2002. Grady Tate, All Love, Village Records 7002
CD 2003. Louise Taylor, Velvet Town, Signature Sounds 1276
CD 2003. Pharoah Sanders, The Creator Has a Master Plan, Venus 35321
CD 2003. John Esposito, Down Blue Marlin Road, Sunjump 0001
CD 2004. Nicolas Folmer, I comme Icare, Cristal 0409
CD 2004. Dee Dee Bridgewater, J’ai deux amours, DDB 0602498697771
CD 2004. John di Martino’s Romantic Jazz Trio, So In Love, Venus 2039
CD 2005. Joe Beck, Brazilian Dreamin’, Venus 4046
CD/DVD 2006. Dee Dee Bridgewater, Red
Earth, DDB B0009091-02
CD 2009. Jessye Norman, Honor! A
Celebration of the African American Cultural Legacy, London Decca
001266002
CD 2009. Mitch Kessler, Erratica,
Sunjump 0007
CD 2009. Line Kruse, Dream, Stunt 09072
CD 2009. Jessye Norman, Roots: My Life,
My Song, Sony Classical 88697 64263-2
CD 2011. Dee Dee Bridgewater, Midnight
Sun, DDB B0015511-02
CD 2012. Robbie
Dupree, Arc of a Romance, Spectra 2159938
CD 2013. Roswell Rudd, Trombone for Lovers,
Sunnyside 1369
CD 2014. Plácido Domingo, Encanto del
Mar: Mediterranean Songs, Sony Classical 8887500685-2
CD 2014. Ray Spiegel Ensemble, Moksha, Simla House 111
CD 2016. Cyro Baptista, Bluefly, Tzadik 4014
CD 2016. Chris Pasin, Baby It's Cold Outside, Planet
Arts 301714
DVD
DVD 2001. Herbie Hancock, The Jazz Channel Presents Herbie
Hancock, Image Entertainment 0927415622
DVD 2005. Dee Dee
Bridgewater, Live in Antibes & Juan-les-Pins, DDB 87522, Emarcy/Universal
9875228
VIDEOS
Chaîne YouTube Ira Coleman
https://www.youtube.com/channel/UCzHVl_MFRTkde0rg32cTrLA
1985. Ira Coleman, Freddie Hubbard (flh,tp), Kenny Garrett (as), Mark Templeton (p), Carl Allen (dm), Ancona Jazz, Italie, 25 octobre
https://www.youtube.com/watch?v=S0_Yyo71mng
https://www.youtube.com/watch?v=s4QPcGHS2vI
https://www.youtube.com/watch?v=_w-3lY-9c9o
https://www.youtube.com/watch?v=ES6DAI6QRl4
https://www.youtube.com/watch?v=a3HZlW7fyWY
https://www.youtube.com/watch?v=lAfGMW0vbPk
https://www.youtube.com/watch?v=nMuoYoKaY-c
1985. Ira Coleman, Woody Shaw/Dizzy Gillespie (tp), Freddie Hubbard (flh,tp), Kenny Garrett (as), Mark Templeton (p), Carl Allen (dm), Berlin Jazz Festival, 2 novembre
https://www.youtube.com/watch?v=f_ThhFOVUcU
https://www.youtube.com/watch?v=p6hV4XaoMUU
https://www.youtube.com/watch?v=Keu3FH8SXqo
https://www.youtube.com/watch?v=UZ0hjgqZOZo
1989. Ira Coleman, Tony Williams (dm), Billy Pierce (ts,ss), Wallace Roney (tp),
Mulgrew Miller (p), «City Of Lights», «Geo Rose», «Warrior», «Sister Cheryl»,
https://www.youtube.com/watch?v=nkJoTY0GE8M
https://www.youtube.com/watch?v=a5FwurVBEeE
1990. Ira Coleman, Tony Williams (dm), Billy Pierce (ts), Wallace Roney (tp),
Mulgrew Miller (p), Festival de Jazz d’Antibes-Juan-Les-Pins, 27 juillet
https://www.youtube.com/watch?v=q1s3JnSnXJw
https://www.youtube.com/watch?v=uteWqWXPHzM
1990. Ira Coleman, Milt Jackson (vib), Mike LeDonne (p), Mickey Roker (dm), «Round Midnight», «Used to Be», «Speedball», Live in Japan
https://www.youtube.com/watch?v=-5u7TZhL22U
https://www.youtube.com/watch?v=Fvmv7MCsCP0
https://www.youtube.com/watch?v=YtnY49I1dD0
https://www.youtube.com/watch?v=05l-CRkESi8
https://www.youtube.com/watch?v=9VdpOiZwfg8
https://www.youtube.com/watch?v=pfxPA0U9hb4
1991. Ira Coleman, Tony Williams (dm), Billy Pierce (ts), Wallace Roney (tp),
James Williams (p), Blue Note Mount Fuji Jazz Festival, Japon, 23 août
(Sources: https://www.loc.gov/item/jots.200022067 et https://sites.google.com/site/happyjazzlife/mt-fuji-jazz-festival)
https://www.youtube.com/watch?v=Fb_1qPgWmd4
https://www.youtube.com/watch?v=PC0xKCXuzOc
1992. Ira Coleman, interview/musique Herbie Hancock (p), Tony Williams (dm), BBC-TV série Birdland, «Just One Of Those Things», «Maiden Voyage», «Sister Cheryl», 11 septembre (Source: https://www.loc.gov/item/jots.200013858)
https://www.youtube.com/watch?v=qSU0se4b4sI
https://www.youtube.com/watch?v=Aw4h61nija4
https://www.dailymotion.com/video/x5km8x
1994. Ira Coleman, Barbara Hendricks (voc), chante Duke Ellington, Monty Alexander (p), Ed Thigpen (dm), Montreux Jazz Festival
https://www.youtube.com/watch?v=LOZ0mOoXD-c
1996. Ira Coleman, Franco Ambrosetti (tp), Dado Moroni (p), Billy Drummond (dm), «My Foolish Heart», Bern Jazz Festival , Suisse
https://www.youtube.com/watch?v=flGCv4Jsc1o
2000. Ira Coleman, Herbie Hancock (p), Eddie Henderson (tp,flh), Eli Degibri (ts), Terri Lyne Carrington (dm), Cyro Baptista (perc,voc), «Fascinating Rhythm», «St. Louis Blues», «Cotton Tail», «Blueberry Rhyme», «The Man I Love», «Here Come De Honey Man», «Cantaloupe Island», «One Finger Snap», «Maiden Voyage», Jazz Central, Jazz Channel, Bet on Jazz/Image Entertainment Prod.
https://www.youtube.com/watch?v=pzsj2RioIq4
2003. Ira Coleman, Dee Dee Bridgewater (voc), Minino Garay (perc), Thierry Eliez (p,org), Patrick Manouguian (g), Hans Van Ousterhout (dm), «September Song», Festival de Jazz d’Antibes-Juan-les-Pins
https://www.youtube.com/watch?v=0bFK59JnOWY
2005. Ira Coleman, Dee Dee Bridgewater (voc), Minino Garay (perc), Marc Berthoumieux (acc), Patrick Manouguian (g), «Ne me quitte pas», Festival AVO Session, Bâle, Suisse, 6 novembre
https://www.youtube.com/watch?v=UpJWOZ6ESzo
2007. Ira Coleman, Dee Dee Bridgewater (voc), Edsel Gomez (p,org), Patrick Manouguian (g), Hans Van Ousterhout (dm), «Speak Low», North Sea Jazz Cruise, juillet
https://www.youtube.com/watch?v=TnLbT2WNSVk
2007. Ira Coleman, Dee Dee Bridgewater, Kabine Kouyate/Assitan Kita (voc), Edsel Gomez (p,org), Minino Garay (perc,dm), Lansine Kouyate (balafon), Baba Sissoko (n’goni), Adama Diarra (djembe), Mamadou Cherif Soumano (g, kora), «Afro Blue», «Bani (Bad Spirits)», «Footprints», «Demissйnw (Children Go Round)», «Sakhodougou (The Griots)», «Massane Cissи (Red Earth)», «Compared To What», JazzOpen, Stuttgart, Allemagne
https://www.youtube.com/watch?v=2VwYMwSstDc
2014. Ira Coleman, Berklee College of Music
https://www.youtube.com/watch?v=vNOuokw5NTg
2016. Ira Coleman, Biréli Lagrène (g), Antonio Faraò (p), Lenny White (dm), Montreux Jazz Festival
https://www.youtube.com/watch?v=eAUt4H4mZVg
2019. Ira Coleman, Antonio Faraò (p), Mike Baker (dm), «Brother Kenny», Jazz in Marciac, août
https://www.youtube.com/watch?v=VmwDw7LjAt0
2019. Ira Coleman, Jonah Kreitner (vln), Tony Purrone (g), Lenny White (dm), «On the Sunny Side of the Street», «Automn Leaves», CD Fiddlin’, 9 septembre
https://www.youtube.com/watch?v=FJOuPjZrZOE
|

