
George Avakian
Hot Memories
Retracer
la carrière du producteur George Avakian, c’est revenir à
l’époque des pionniers de l’industrie du disque et de la
discographie, celle où tout était à inventer. Sa contribution est
considérable : il a systématisé le livret dans les disques de
jazz, lancé la première collection de réédition de disques de
jazz à Columbia, produit le premier 33 tours de jazz, signé Miles
Davis chez Columbia et produit des albums comme 'Round
About Midnight
(1956), Miles Ahead
(1957), qui s’est écoulé à un million d’exemplaires, Sketches
of Spain (1960). Il
a aussi donné un nouveau souffle à la carrière de Louis Armstrong
en lançant les albums-concepts Louis
Armstrong Plays W.C. Handy
(1954) et Satch Plays
Fats (1955) et celle
de Duke Ellington avec le succès commercial de
Ellington
at Newport
(1956).
Il
est important de revenir, même sommairement, à la biographie de ce
personnage qui nous a accordé une interview sur ses années de
jeunesse à la fin des années 1930. Il y évoque sa passion pour le
swing de Benny Goodman et Count Basie, le besoin de reconnaître le
jazz comme un véritable art et ses liens avec Charles Delaunay.
Né
le 15 mars 1919 à Armavir, en Russie, George Avakian immigre avec
ses parents aux Etats-Unis en 1923. Son frère, le cinéaste et
monteur Aram Avakian (1926–1987) – qui a notamment coréalisé
Jazz on a Summer’s
Day (1960), avec
Bert Stern, le premier film documentaire tourné sur les lieux d’un
festival de jazz, le Newport Jazz Festival – est né sur le sol
américain. Epris de la langue anglaise et de jazz dès plus jeune
âge, George Avakian poursuit ses études à Yale où il rencontre
Marshall Stearns, jeune doctorant en langue anglaise et grand érudit
du jazz, un aîné de l’équipe de Jazz Hot dont il fit partie dans
les années trente. Ces années à Yale sont celles de la recherche
discographique et de l’information jazzique, celles où les seules
ressources sur l'histoire du jazz et la discographie sont Le
Jazz Hot (1934)
d’Hugues Panassié et Hot
Discography (1936)
de Charles Delaunay, seuls disponibles en langue française.
Dans
ces années de recherches et sous les conseils de Marshall Stearns,
George Avakian écrit aux trois grandes maisons de disques – RCA,
Columbia et Decca – pour les convaincre de la nécessité de
rééditer les catalogues épuisés des années 1920 et 1930, et de
fournir un livret, comme c’était le cas pour les 78 tours de
musique classique qui comprenaient un livret très complet (textes,
photos).
En
1940, George Avakian produit son premier disque de jazz. Il propose à
Decca une série d’albums de jazz en hommage aux trois grandes
villes qui l’ont rendu célèbre, New Orleans, Kansas City et
Chicago. Decca accepte : le premier disque de jazz est Chicago
Jazz, composé de
six 78 tours de 10 pouces, et un livret de 12 pages. On y entend
Eddie Condon and his Chicagoans, Jimmy McPartland and his Orchestra
et George Wettling’s Chicago Rhythm Kings. Peu après, Columbia
propose à Avakian de se charger de rééditions et de créer la
collection « Hot Jazz Classics ». Interrompu par la
guerre, le jeune producteur reprend ses activités à Columbia et
devient responsable de la division internationale de la musique
populaire, le département de jazz n’existant pas. Parmi les
premiers disques qu’il réédite, il y a ceux de Louis Armstrong
Hot Five et Hot Seven, Bix Beiderbecke, Fletcher Henderson, Duke
Ellington. Autre nouveauté, il introduit les prises alternatives.
En
1948, Columbia introduit le 33 tours. Créé au départ pour la
musique classique (le premier est Violin
Concerto de
Beethoven, dirigé par Bruno Walter et le Philharmonic-Symphony of
New York), George Avakian produit le premier 33 tours en 10"
(25cm) de musique populaire en 1948 (The
Voice of Frank Sinatra
de Frank Sinatra) et le premier 33 tours en 12" (30cm) de jazz
en 1950 (Benny
Goodman at Carnegie Hall,
enregistré en 1938).
Avec
l’avènement du 33 tours en 12" et le succès commercial de
Miles Ahead
en 1957, qui s’écoule à un million d’exemplaires, l’album
devient un voyage, une expérience, il raconte une histoire. Après
onze ans, George Avakian quitte Columbia en 1957 pour Bock's Pacific
Jazz Records (futur World Pacific Records), puis participe à la
création de Warner Bros. Records (1959-1962) et part pour RCA Victor
(1962-1963) où il signe Paul Desmond et Sonny Rollins (The
Bridge, 1962, Our
Man in Jazz,
1962). Dans les
années 1960, il quitte l’industrie du disque pour devenir le
manager de Charles Lloyd puis Keith Jarrett. Il a depuis reçu de
nombreux prix, dont le NEA Jazz
Master Fellowship Award en 2010.
Propos recueillis par Mathieu Perez
Photos Jos Knaepen, Fred Palumbo et William Gottlieb
by courtesy of Library of Congress
© Jazz Hot n°671, printemps 2015

Jazz Hot : Quand
avez-vous entendu du jazz pour la première fois ?
George
Avakian : J’écoutais
la radio, et je me suis rendu compte que toute la musique populaire
américaine ne se limitait pas à « Yes ! We have no
bananas ». J’entendais ces sons étranges, comme Louis
Armstrong. J’ai décidé d’en savoir plus sur cette musique, et
je me suis familiarisé avec Metronome
et Down Beat.
Et j’ai commencé à acheter des disques. J’accompagnais ma mère
à Macy’s. Elle ne parlait pas très bien anglais, alors je
l’aidais pour traduire. Elle me laissait acheter un disque
Brunswick ou Victor pour 89 cents ou trois Decca pour 88 cents. J’ai
commencé à collectionner ces sons étranges et à lire sur cette
histoire. J’étais fasciné. Le tournant a été une émission
radiophonique sur NBC
qui s’appelait « Let’s Dance », qui passait le samedi
soir. Trois types de danse étaient présentés, une par heure. Il y
avait trois orchestres, un de musique latine dirigé par Xavier
Cugat, un de musique populaire par Kel Murray et le troisième était
dirigé par Benny Goodman. C’était le début de l’orchestre de
Benny Goodman. Cet orchestre m’intéressait beaucoup. A la fin des
trois heures, l’émission recommençait. J’ai donc entendu
beaucoup de swing sans savoir ce que c’était. L’émission était
diffusée dans tout le pays, mais les lignes de téléphone utilisées
pour la transmission n’étaient pas conformes pour une bonne
transmission dans tout le pays. Alors des disques microsillons de 16
pouces ont été gravés pour chaque orchestre. On les passait
partout de l’ouest de Chicago à Los Angeles au moment de
l’émission. MCA, qui s’occupait de l’orchestre de Goodman, a
voulu profiter du succès de l’émission et a organisé une tournée
dans le pays durant l’été 1935. La tournée avait bien commencé,
jusqu’à ce que l’orchestre arrive à Denver, dans le Colorado.
Il jouait dans la plus grande salle de l’ouest. Très rapidement,
la direction a dit à Goodman : « Arrêtez ce bruit !
Vous devez jouer des polkas et des valses, une musique calme. »
L’orchestre n’avait pas les bons arrangements alors les musiciens
se sont mis en petites formations et ont improvisé quelque chose.
Par exemple, le trompettiste Ziggy Elman s’est mis au trombone et
Harry James à la batterie, parce qu’il a toujours rêvé d’être
batteur. C’était un personnage haut en couleur. La chanteuse Helen
Ward s’est mise au piano et ils ont joué une musique calme et
plaisante. (Rires)
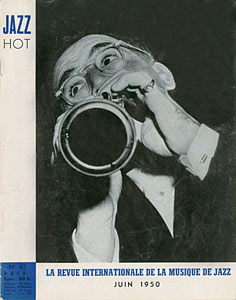
Quel
était le succès de Benny Goodman à ce moment-là ?
A
partir de cette émission radiophonique, on l’entendait partout. Il
avait beaucoup de publicité. Son disque a fini numéro un des ventes
aux Etats-Unis. C’était King
Porter Stomp, composé par
Jelly Roll Morton en 1903 ou 1905. C’est incroyable quand on pense
que c’est ce disque qui a été numéro un. Les jeunes en étaient
dingues ! Tout le monde apprenait à danser le jitterbug, moi
aussi.
Comment
avez-vous rencontré Benny Goodman ?
J’étais
le rédacteur en chef du journal de l’école, Horace
Mann Record, au lycée
Horace Mann, à New York. J’ai décidé d’interviewer Benny
Goodman quand il reviendrait à New York après son triomphe en
Californie. Mais je ne savais pas comment le joindre. J’avais un
copain, Charlie Miller, qui comme moi achetait des disques de swing.
Sa mère faisait partie du parti démocrate de New York, dont le
président était le propriétaire de l’Hôtel Pennsylvania où
Benny Goodman devait se produire la semaine suivante. Elle a pu
arranger une interview. J’ai donc interviewé Benny Goodman et il a
été très courtois. Quand l’interview a été publiée, je lui ai
apporté un exemplaire du journal. Il l’a tellement appréciée
qu’il a dit à son assistant, Dwight Chapin – qui était d’abord
un pianiste, qui avait rencontré Benny à son arrivée à New York
et qui avait pris des cours avec Teddy Wilson – que chaque fois que
je viendrais avec mon copain je devrais avoir une bonne table et être
bien traité. C’était très gentil de sa part. L’interview est
parue en novembre 1936. Quelque temps plus tard, en janvier, Chapin
nous a demandé à Charlie et moi si on pouvait rester après le
concert parce que le Benny Goodman Quartet – Benny Goodman, Teddy
Wilson, Lionel Hampton, Gene Krupa – était invité à un gala de
charité à Columbus Circle pour des républicains espagnols en
pleine guerre d’Espagne, et ils avaient besoin d’aide pour
transporter les instruments. Ce soir-là, je me souviens qu’il y
avait une tempête de neige. On a chargé le taxi avec le vibraphone
d’Hampton et la batterie de Gene Krupa, et on est parti à trois.
Le taxi était plein à craquer. Quand on est arrivés, j’ai
commencé à défaire le vibraphone et je me suis coupé la main.
Chapin m’a donné son mouchoir et la clarinette de Benny que je
devais lui porter immédiatement pendant que Charlie et lui
s’occupaient de la batterie. J’ai monté les escaliers et j’ai
entendu beaucoup de bruit. J’ai frappé à la porte et tout à coup
j’ai vu 80 ou 100 Espagnols complètement ivres en train de faire
la fête. Ils fêtaient la défaite de Franco. A cette époque, je
portais des lunettes et je ressemblais à Benny comme un frère. Je
ne parlais pas un mot d’espagnol. Tout le monde était très gentil
avec moi. De très jolies filles se sont approchées. On m’a offert
une grande bouteille de vin rouge. Je me demandais si on n’était
pas en train de me confondre avec Benny Goodman. J’ai pris une
gorgée de ce vin et j’ai failli tomber raide mort ! (Rires)
Puis, Chapin est arrivé, qui parlait espagnol. Il m’a dit que tout
le monde me prenait pour Benny et m’a demandé de jouer son rôle
jusqu’à ce qu’il arrive. Puis, un grand type est monté sur une
table et a fait une sorte de discours. Chapin m’a dit que je devais
en prononcer un aussi parce que j’étais – moi, Benny Goodman –
l’invité d’honneur. J’ai alors crié le plus fortement
possible quelque chose comme « Muerte de Franco ! ».
Je n’avais aucune idée de ce que je disais. Et tout le monde a
applaudi. Et puis Benny est arrivé et tout le monde a rigolé !
(Rires)
Plus
tard, vous avez aussi produit Benny Goodman. Comment se sont passées
ces sessions d’enregistrement ?
Quand
je le produisais, on a fait trois sessions, qui se déroulaient les
après-midis. Goodman était un peu caractériel, mais je le
comprenais, et on s’entendait très bien. A la fin de chaque heure,
on faisait une pause de dix minutes pour écouter ce qu’on avait
enregistré. Le premier jour, à la fin de la première heure, Benny
entre dans la salle de contrôle, s’assoit entre l’ingénieur du
son et moi. Il écoute une prise, ne dit pas un mot. Je pensais
qu’elle était bonne et lui ai proposé de la garder pour passer à
une autre. Il dit d’accord très sèchement et sort. Quelque chose
n’allait pas. Il revient à la fin de la deuxième heure. La même
chose se passe. Je sors de la salle de contrôle avec lui, et lui
demande si tout va bien. Il me dit qu’il a encore fait une
interview dans laquelle on lui demande toujours les mêmes conneries,
à propos de ses chemises, de ses nœuds de papillon, de sa couleur
préférée, etc., et pas un mot sur la musique. Il se souvenait que
des années auparavant, il avait été interviewé par un jeune
lycéen, et c’était la seule fois où il n’avait parlé que de
musique. Ce soir-là, je suis allé chez ma mère qui avait gardé
toutes mes affaires de l’école et j’ai trouvé le journal de
Horace Mann. J’ai l’ai pris pour la deuxième journée de studio.
A la fin de la première heure, Benny entre dans la salle de
contrôle, s’assoit entre l’ingénieur du son et moi. J’avais
mis le journal devant moi. Il écoute une prise et tout à coup j’ai
vu ses yeux se fixer sur le journal. Après avoir écouté la prise,
il n’a pas prononcé un mot. Il s’est levé et a juste dit :
« Alors, c’était toi ! », puis il est sorti.
(Rires)
Après la mort de Benny, sa fille, qui faisait du rangement dans ses
affaires, a trouvé le journal dans le tiroir du haut de son bureau.
N’est-ce pas gentil ? Il avait gardé le journal toutes ces
années.
Quand
avez-vous commencé à collectionner des disques ?
J’ai
collectionné spécifiquement du jazz. Quand Count Basie est sorti
chez Decca, j’achetais ses disques. J’ai rencontré Freddie
Green, grâce à Chapin, avant qu’il ne fasse partie de l’orchestre
de Count Basie. Un soir, Chapin m’a proposé de l’accompagner
avec sa petite amie à Greenwich Village pour écouter Amanda
Randolph. Elle jouait avec un trio. Il y avait Cliff Jackson au piano
et Freddie Green à la guitare. Je ne savais pas qui ils étaient
bien sûr. Je parlais à Freddie durant les pauses et on s’est très
bien entendu. Quand il a rejoint Count Basie, il m’a présenté au
reste du groupe. Je ne connaissais d’eux que ce que j’en avais lu
dans les magazines. J’ai beaucoup entendu l’orchestre dès leurs
premières semaines à New York. Il ne voyageait pas encore. C’est
la meilleure musique que j’ai entendue de ma vie !
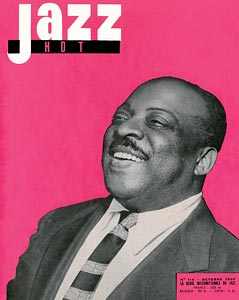
Quels
les liens les orchestres avaient-ils entre eux ?
A
cette époque, la plupart des groupes jouaient du softball et
s’affrontaient à Central Park. Un jour, Freddie Green, que j’ai
connu le mieux de tous les musiciens de Basie, m’a invité à un
match. Le groupe de Basie jouait contre celui de Jimmie Lunceford. A
un moment, Buck Clayton, le voltigeur de droite, est venu vers moi et
m’a donné son gant. Il savait que je jouais et lui n’aimait pas
vraiment ce jeu. Je l’ai donc remplacé et suis devenu le voltigeur
de droite de l’équipe de Count Basie. Une fois, Basie m’a dit
qu’il aimerait jouer contre Harry James et son orchestre la
prochaine fois qu’il serait en ville et m’a demandé d’organiser
ça. L’équipe de Harry James était la meilleure équipe dans les
big bands. Quand il est arrivé à New York, je suis allé voir Harry
James, et il m’a dit : « Dis à Basie qu’on ne joue
pas contre des équipes qui ont des ringers. »
Un ringer
est quelqu’un qui n’est pas un membre régulier de l’équipe et
qui est recruté de l’extérieur. J’étais donc le ringer
de l’équipe de Basie. (Rires)
On n’a jamais joués contre Harry James parce que les deux
orchestres n’étaient jamais en ville au même moment.
Où
trouviez-vous des informations sur le jazz ?
Il
n’y avait rien à part Metronome,
qui était un magazine de musique populaire bien que son rédacteur
en chef George Simon soit un amateur de jazz, et Down
Beat.
Quelle
a été l’importance de la rencontre de Marshall Stearns,
collectionneur, érudit, critique de jazz, qui tenait notamment la
rubrique « Collector's Corner » dans Tempo
Magazine ?
Un
des grands tournants de ma vie a été mon arrivée à l’université.
Mon père ne savait où m’envoyer mais, selon ses amis, les
meilleures étaient Princeton, Yale, Harvard et Columbia. Il voulait
que je quitte New York pour mieux connaître l’Amérique. Il a
décidé que j’irais à Yale et je suis allé à Yale. Le lendemain
de mon arrivée à Yale, je suis allé chez le disquaire pour voir à
quoi ça ressemblait. Il y avait des cabines d’écoute et
j’entendais la musique d’Ellington qui sortait de l’une
d’elles. Je me suis dit que ça devait être un étudiant comme moi
qui venait d’arriver. Il passait le dernier disque d’Ellington,
et moi j’avais le dernier de Benny Goodman. Il s’appelait Jerry
King. On s’est tout de suite très bien entendu. Quand il a vu que
j’aimais le swing – à cette époque, on ne disait pas « jazz »
–, il m’a dit que tous les vendredis soirs, ceux qui voulaient
écouter et parler de musique étaient les bienvenus chez Marshall
Stearns. Il habitait à New Haven et étudiait l’anglais médiéval.
Jerry et moi sommes devenus les meilleurs amis, et nous allions tous
les vendredis chez Stearn. Il avait une énorme collection de
disques. J’ai appris l’histoire du jazz à travers sa collection.
Puis, il nous a pris comme assistants pour cataloguer les nouveaux
disques qu’il recevait pour des chroniques, et nous écoutions
toutes les nouveautés. C’était très agréable.
Quels
étaient vos groupes préférés à cette époque ?
J’adorais
Basie et j’aimais toujours Goodman. Il m’a fallu du temps pour me
familiariser avec Ellington parce que je ne comprenais pas certains
de ces sons étranges. Mais Jerry était déjà un fan d’Ellington.
Il m’a joué ses premiers disques, et je suis très vite devenu un
grand fan d’Ellington. J’aimais beaucoup Bechet aussi. Mais
Marshall ne forçait rien. Il était très érudit et connaissait
certains des musiciens. Il pouvait expliquer beaucoup de choses. La
première fois que j’ai entendu One
Hour de Red Mckenzie et ses
Mound City Blue Blowers, j’étais abasourdi ! Coleman Hawkins est
devenu un de mes héros.

Quand
vous êtes-vous intéressé à la discographie ?
Je
portais un grand intérêt à la discographie. Pendant ma première
année à Yale, j’ai commencé une correspondance avec Charles
Delaunay et Hugues Panassié. Marshall et Delaunay étaient déjà en
lien. A cette époque, les collectionneurs européens n’avaient pas
accès aux nouveaux disques et, nous, nous n’avions pas accès aux
disques plus anciens, qui étaient épuisés ici mais toujours en
circulation en Europe. On faisait des échanges. J’envoyais des
disques de Basie, Ellington, Lunceford et de petits groupes et, eux,
m’envoyaient des disques qu’on ne trouvait plus ici. Delaunay m’a
envoyé les premiers disques Swing. J’ai eu un coup de foudre pour
celui de Rex Stewart. Des années plus tard, Delaunay est venu aux
Etats-Unis avec Walter Schapp. Ce devait être en 1946, 1947. Il
avait rencontré Walter à Paris, qui arrivait de Hollande avant de
partir vers l’Amérique. Delaunay a voulu faire une nouvelle
édition de Hot Discography
et nous a invités, Walter et moi, à y participer. Quand nous nous
sommes partagés le travail, je devais m’occuper des disques
Columbia parce que je travaillais à Columbia depuis la fin 1946. Le
livre est sorti en 1948. Mais j’avais d’abord rencontré Panassié
à New York quand il faisait les enregistrements pour Blue Bird avec
Mezzrow, etc. Il ne parlait pas anglais, quelques mots, alors que
Delaunay se débrouillait bien. Nous sommes devenus amis.
A
cette époque, les disques eux-mêmes contenaient peu de
renseignements.
Quand
j’étais à l’université, j’ai écrit aux maisons de disques à
propos des disques de jazz. Ces disques sont bien plus que quelques
titres sur une face sans autre information que le nom des artistes et
des compositeurs. Le jazz devrait être traité comme l’est la
musique classique chez RCA avec des notices sur l’histoire et la
vie des musiciens. On dit souvent que c’est moi qui ai sorti les
premières rééditions à Columbia alors que la première réédition
était en fait Bix
Beiderbecke Memorial Album.

En
1948, vous avez épousé la violoniste Anahid Ajemian, qui exécuta
avec sa sœur, la pianiste Maro Ajemian, de nombreuses pièces de
John Cage et d’autres compositeurs de cette génération comme
Ernst Krenek, Wallingford Riegger, etc., que vous avez fréquentés.
Y avait-il des correspondances entre ces compositeurs avant-gardistes
et le jazz ?
John
Cage et Merce Cunningham vivaient ensemble à cette époque, et ils
travaillaient dans un petit appartement situé 326 Monroe Street,
près du Brooklyn Bridge. L’immeuble n’existe plus aujourd’hui.
Un peu comme Marshall, Merce et John recevaient une fois par semaine.
Je pense que c’était le samedi soir. C’est là que j’ai
rencontré des compositeurs comme Edgar Varèse, Henry Cowell, et
d’autres, et des peintres comme Jasper Johns, Robert Rauschenberg,
Willem De Kooning, etc. Au lycée, j’achetais des disques de
Stravinsky, Prokofiev, etc., donc je me sentais à l’aise avec eux,
même si je ne savais pas qui étaient ces peintres. Des compositeurs
comme Cage et Varèse m’intéressaient beaucoup. J’avais invité
Cage et Cunningham à un concert de Bunk Johnson. Cage était
fasciné. Il ne comprenait pourquoi il y avait une section rythmique,
basse, batterie, piano. Il aurait préféré n’entendre improviser
que les trois souffleurs. Merce était intrigué par Baby Dodds. Il
allait présenter un récital dans quelques semaines à Hunter
College, à New York, et se demandait si Baby Dodds accepterait de
faire un duo improvisé avec lui. La veille du récital, ils se sont
vus et ont fait une sorte de répétition. C’était extraordinaire.
Le récital a eu beaucoup de succès, mais ce n’était pas aussi
bon que la veille. Ce n’était plus totalement neuf. Cage avait une
certaine connaissance du jazz. Il s’intéressait en particulier à
l’improvisation collective polyphonique new orleans, mais je ne
sais pas s’il a jamais fait quelque chose là-dessus. John et Merce
cherchaient toujours à explorer des voies qu’ils ne connaissaient
pas.
*
|



