|
Sur la route des festivals en 2017
Dans
cette rubrique «festivals», tout au long de
l'année 2017, vous pouvez accompagner nos correspondants lors de leurs déplacements sur
l'ensemble des festivals, où Jazz Hot est
présent. Les comptes rendus sont édités dans un ordre chronologique inversé (les plus récents
en tête). Certains des comptes rendus sont en version bilingue, quand
cela est possible; vous pouvez les repérer par la présence en tête de texte d'un drapeau
correspondant à la langue que vous choisissez en cliquant dessus.
Le jazz en live reste une expérience irremplaçable, autant pour vous que pour les artistes et les organisateurs… Il suffit de cliquer sur le nom du festival.
Nous remercions l'ensemble des Festivals de jazz pour l'accueil de nos correspondants sachant que c'est la condition pour tous de conserver la mémoire d'une des scènes importantes du jazz. Les budgets étant de nos jours soumis aux contraintes de l'austérité, et parfois aux affres de l'ignorance sur ce qu'est le jazz, il importe que les acteurs du jazz conservent à l'esprit cet enjeu essentiel qu'est l'information pour la préservation du jazz. Pouvoir faire des photos et des commentaires, librement, pour la presse spécialisée, et en avoir les moyens par un accueil respectueux de la part des festivals et des autres scènes, est une des facettes de la liberté et de la richesse du jazz, et plus largement de la liberté de la presse et donc de la démocratie dont nous sentons le manque dans le quotidien…
Nous conservons dans cette rubrique une antériorité d'une année pour donner à notre lectorat une meilleure idée de l'activité festivalière et de son évolution. Les années précédentes restent disponibles dans notre boutique.
|
Au programme des Comptes Rendus
|
2017 > |
• Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Jazz sur la Ville • Toulouse, Haute-Garonne, Jazz sur son 31 • Cousance, Jura, Jazz en Revermont • Verviers, Belgique, Jazz à Verviers • Monterey, Etats-Unis, Monterey Jazz Festival • Eben-Emael, Belgique, Jazz au Broukay • Buis-les-Baronnies, Drôme, Parfum de Jazz • Pertuis, Vaucluse, Jazz à Pertuis/Festival de Big Band • Langourla, Côtes d'Armor, Jazz in Langourla • Ospedaletti, Italie, Jazz Sotto Le Stelle • Ystad, Suède, Ystad Sweden Jazz Festival • Marciac, Gers, Jazz in Marciac • Gandía, Espagne, Festival Polisònic • Fano, Italie, Fano Jazz by the Sea • San Sebastiàn, Espagne, Jazzaldia San Sebastiàn • Nice, Alpes-Maritimes, Nice Jazz Festival • Marseille, Bouches-du-Rhône, Marseille Jazz des Cinq Continents • Toulon, Var, Jazz à Toulon • Antibes/Juan-les-Pins, Alpes-Maritimes, Jazz à Juan • Iseo, Italie, Iseo Jazz • Toucy, Yonne, Toucy Jazz Festival • Vitoria-Gasteiz, Espagne, Festival de Jazz de Vitoria • St-Cannat, Bouches-du-Rhône, Jazz à Beaupré • Pléneuf-Val André, Côtes-d'Armor, Jazz à l'Amirauté • Montréal, Québec, Canada, Festival International de Jazz de Montréal • Getxo, Espagne, Getxo Jazz • Corbeil-Essonnes, Essonne, Corbeil-Essonnes Jazz Festival • St-Gaudens, Haute-Garonne, Jazz en Comminges • Bergame, Italie, Bergamo Jazz
|
2016 > |
• Marseille, Provence, Jazz sur la Ville • Cormòns, Italie, Jazz&Wine • Toulouse, Haute-Garonne, Jazz sur son 31 • Verviers, Belgique, Jazz à Verviers • Bar-sur-Aube, Aube, Jazzabar • Bucarest, Roumanie, Bucharest Jazz Festival • Monterey, Californie, USA, Monterey Jazz Festival • Buis-les-Baronnies/Tricastin, Drôme, Parfum de Jazz • Gaume, Belgique, Gaume Jazz Festival • Javea, Espagne, Xàbia Jazz • Langourla, Côte-d'Armor, Jazz in Langourla • Ystad, Suède, Ystad Sweden Jazz Festival • Ospedaletti, Italie, Jazz sotto le Stelle • Royan, Charente-Maritime, Jazz Transat • Pertuis, Vaucluse, Festival de Big Band de Pertuis • Marciac, Gers, Jazz in Marciac • Fano, Italie, Fano Jazz in a Summertime • Marseille, Bouches-du-Rhône, Marseille Jazz des Cinq Continents • San Sebastian, Espagne, Jazzaldia San Sebastian • Toulon, Var, Jazz à Toulon • Toucy, Yonne, Toucy Jazz Festival •
|
• Vitoria, Espagne, Vitoria Jazz Festival • Iseo, Italie, Iseo Jazz • Pescara, Italie, Pescara Jazz • St-Cannat, Bouches-du-Rhône, Jazz à Beaupré • Gent-Gand, Belgique, Gent Jazz • Pléneuf-Val-André, Côte d'Armor, Jazz à l'Amirauté • Vienne, Isère, Jazz à Vienne • Getxo, Espagne, Getxo Jazz • Montréal, Québec, Canada, Festival International de Jazz de Montréal • Ascona, Suisse, JazzAscona • Bruxelles, Belgique, Jazz Marathon • St-Gaudens, Haute-Garonne, Jazz en Comminges • St-Leu-La Forêt, Val d'Oise, Arts & Swing • Bergame, Italie, Bergamo Jazz •
|
Pour
accéder directement au festival de votre choix, cliquez sur le nom des festivals en
bleu. Les recherches restent toujours possibles par nom de musicien, de ville, de festival, de région ou de pays en utilisant la
fonction «recherche» de votre navigateur (la recherche
s'ouvre dans la barre du bas de votre fenêtre).
Comme
pour tout le site, nous vous rappelons qu'il vous faut survoler les
photos avec le curseur, activé par votre souris ou votre touchpad, pour
voir apparaître la légende et le crédit des photos.
|

Provence-Alpes-Côte-d’Azur
Jazz sur la Ville,
6 novembre au 3
décembre 2017
Pour cette 11e édition en 12 ans, Jazz sur la Ville a
connu son plus grand succès. L’association hésite à emprunter le mot de
festival car la programmation est choisie par 35 structures adhérentes; même si le
programme est concerté au sein du bureau, il donne une vision des
différentes formes du jazz sans renier sa tradition ou son évolution; plus
de 75 concerts et une dizaine de rencontres: expositions (expo-photos
de Dizzy Gillespie en Corse par Louis Schiavo, Les Incontournables:
pochettes
rares de disques), films, master-class (Lalo Zanelli) et plusieurs
conférences
(A la Découverte de Monk, Hommage à Dizzy, La Tradition Jazz Musette, Jazz Hot:
La revue internationale du jazz).
A sa naissance, il y a 12 ans, la
manifestation réunissait 6 associations marseillaises et une dizaine de
lieux de
la ville. Désormais, les structures (organisateurs, lieux d’accueil,
partenaires…) sont réparties sur 4 département de la Région Paca qui
coordonnent leurs efforts et
moyens pour présenter un jazz très varié. L’association, petitement
soutenue par la Ville de
Marseille et le Conseil Départemental 13, pas du tout par la région Paca,
accomplit un travail remarquable de mise en commun des énergies, de
partage des
valeurs et une communication de haut niveau malgré un budget restreint.
Chaque
producteur est responsable de la gestion
de ses concerts.
Le programme était très riche, et si on ne peut en donner
un compte rendu exhaustif, on suivra les deux fils rouges de cette édition: la
guitare et les belles voix féminines, instrumentales aussi…

Côté guitare, une véritable armada
était présente, de talents régionaux à quelques maîtres actuels de la six
cordes. La première salve a été envoyée par Jonny Lang dans un blues tonitruant
lorgnant vers le rock. Ben Monder, toujours aussi énigmatique mais dans un
style inédit, soutenait le quintet des sœurs Jensen pour leur première vraie
tournée européenne. Nelson Veras, brésilien établit à Paris, conjuguait son
talent à celui de l’accordéoniste Frédéric Vialle pour un spectacle intitulé Les racines du ciel à l’Hôtel C2, à Marseille. Quant à Sylvain Luc, à
Nice, il offrait un heureux mariage avec les percussions persannes des frères
Chemirani.
Les régionaux n’ont pas
démérité: Philippe Petrucciani rendait un bel hommage à son frère Michel avec Remember Petrucciani; le Toulonnais Claude Basso retrouvait son vieux complice Jo Labita (acc) à la Seyne-sur-Mer, ancienne cité
de chantiers navals, pour un duo très musette; quant à Paul Pioli, il venait à La
Ciotat, autre cité navale, défendre le répertoire original de son nouvel opus Lignes.
Le blues fut encore à l’honneur avec
la 48e édition du Chicago Blues Festival représentée cette année par
le vétéran Carl Weathersby épaulé de Rico McFarland. Les deux sont au sommet de
leur art avec une spéciale dédicace au vieux Carl, époustouflant! Le blues en conférence par François
Billard (journaliste, critique, producteur) qui accueillait dans son Le Non Lieu (la plus petite salle, moins
de 50 places) deux guitaristes en solo, Joël Antona puis Karim Tobbi.
Retour à l’internationale de la
guitare avec deux aventuriers: le Berlinois Kalie Kalima au sein du groupe Finn
Noir et l’étonnante américaine Mary
Halvorson au sein de l’Illegal Crowns, tous
deux en Avignon. Dans un style aussi innovant, Pascal Charrier proposait sa
nouvelle formule du groupe Kami, cette fois en octet, sans oublier Guillaume
Magne du Joce Miennel Tilt. Dans la galaxie Brésil, le magnifique Yamandu Costa
s’imposait en digne successeur de Baden Powell, Raphaël Rabello, Guinga ou
encore Egberto Gismonti, comme un nouveau génie de la guitare, cette fois à sept
cordes.
Autre côté marqué de ce programme,
la voix fut à l’honneur: hommages à des divas disparues, jeune pousses de la
scène régionale et vedettes internationales. Mariannick St-Céran, l’une des
belles voies du Sud, a livré lors de deux concerts sa passion pour Nina Simone.
La jeune Eyma, à la tête de son solide quartet évoqua l’âme d’autres divas
comme Abbey Lincoln; un début de parcours à suivre. Anna Farrow, en quartet,
elle offrait l’intégrale de son premier album Day’s & Moods, et on n’oubliera pas Cathy Heiting. En pleine
ascension internationale, Sarah Lancman en duo avec Giovanni Mirabassi venait défendre
sur la scène d’un Petit Duc bien
plein (nouveau lieu aixois qui accueille une saison jazz) son dernier album A Contretemps. Même succès pour
l’anglaise Lucy Dixon, aussi à l’aise dans ses vocalises que dans ses
claquettes. L’Australienne Sarah McKenzie (voc,p) toujours en quartet avec
notamment Pierre Boussaguet (b) a ravi l’auditoire du Théâtre du Sémaphore à
Port de Bouc, l’un des rares théâtres à intégrer régulièrement du jazz à son
programme annuel.
Stacey Kent, en diva, accompagnée
par l’Orchestre Symphonique Confluence, se produisait dans la plus grande salle
de cette édition, Le Silo, à
Marseille, et attira la foule à l’écoute de son nouveau projet musical I Know I Dream. La chanteuse et
compositrice belge, Melanie De Basio, se présentait au Théâtre du Merlan dans un jazz sombre inspiré de
sa ville natale, Charleroi. La surprise vint sans aucun doute du groupe The
Como Mamas, trois grandes voix féminines originaires de Como, petite ville du
Mississippi qui, pour cette première virée européenne, faisaient étape à
l’Auditorium de Cabriès, autre bourgade des Bouches-du-Rhône, dans un concert
revisitant la tradition du gospel.

Cet important programme d'un mois intense, certainement
plus original que bien des festivals, a attiré une audience de plus de 10000 spectateurs;
une belle réussite compte tenu de la petite jauge de la majorité des salles. Nous
devons encore saluer les performances originales dont celles de Lalo Zanelli
& Ombu, Christian Scott, Ingrid
& Christine Jensen’s –coup de cœur de cette édition–, One Foot, Yom et le
Quatuor IXI Illuminations.
On se souviendra de la projection en
exclusivité nationale du film Chasing
Trane de John Scheinfeld, documentaire essentiel sur Coltrane avec des images inédites et des témoignages
de ses compagnons de route et de sa famille. Saluons la persévérance d'Armel
Bour (Directrice du Cri du Port) qui a fait réaliser en exclusivité les sous-titres,
et a pu ainsi assurer pour la première fois sa projection publique en France,
en V.O. Une nouvelle fois la qualité de projection et du son du Cinéma l’Alhambra
fut remarquable, et la salle était comble. Le
duo italien, Francesco Bearzatti (ts) et Oscar Marchioni (org) dévoila en lever de rideau, une
création inspirée des thèmes et improvisations du Maître Coltrane.
Cette chaleureuse manifestation, qui a accueilli plus de 320 musiciens, se terminait le dimanche 3 décembre 2017 sous
une neige exceptionnelle pour la cité phocéenne avec un beau succès pour le
Trio Barolo, ovationné dans le Musée Borely (Musée des Arts Décoratifs
de la Faïence et de la Mode) et avec les Quatres Vents1 sur la scène
exigüe de La Meson. Le groupe sera à New York début janvier supporté par le French
Quarter et le Winter Jazz Festival.
On attend que ce travail collectif
exemplaire soit vraiment soutenu par les pouvoirs publics car Jazz sur la ville
va à la rencontre de tous les publics, d’habitants qui résident toute l’année
en Provence2 et qui aspirent à une vie culturelle mieux répartie dans l’année.
1. Cf. Jazz Hot n°680,
été 2017
2. Marseille, Aix-en Provence, Avignon, Berre-l’Etang,
Cabriès, Hyères, La Ciotat, La Seyne-sur–Mer, Martigues, Miramas, Nice,
Port-de-Bouc, Port-St-Louis-du-Rhône, Salon-de-Provence, Vitrolles. jazzsurlaville.fr
Ellen
Bertet
Photos Ellen Bertet et Guillaume Peyre by courtesy of Le Cri du Port
© Jazz Hot n° 682, hiver 2017-2018
|
Toulouse, Haute-Garonne
Jazz sur son 31, 6-22 octobre 2017
31e édition du Festival Jazz sur son 31, organisé par le Conseil départemental de la Haute-Garonne, un chiffre porte-bonheur pour cette édition qui a, cette année encore, largement dépassé son objectif des 21000 spectateurs en misant (comme la plupart des festivals d’importance) sur «l’ouverture» aux musiques «tangentielles», sur une politique tarifaire favorable aux petits budgets (avec l'Automne Club) et en proposant quelques concerts gratuits.
Dans sa dimension locale, Jazz sur son 31 s’est caractérisé par la présentation du Big Band Garonne et du 6tet Jazz dirigés par le pianiste et programmateur du festival, Philippe Léogé, ou encore la soirée des 30 ans de l'UDEMD 31, mettant ainsi en lumière le réseau pédagogique du département, sans oublier la fameuse carte blanche à un musicien local qui était, cette année, le jeune pianiste Thibaud Dufoy formé au CNR de Toulouse. Sur le plan international, un coup de projecteur a été donné sur le jazz à La Havane avec quatre soirées autour des formations des pianistes de la nouvelle génération cubaine que sont Rolando Luna et Harold Lopes. Les ateliers et les rencontres avec le public prorogèrent les concerts des formations cubaines, de Claudia Solal (voc) et Benjamin Moussay (p), Frédéric Monino (b) et sa passion pour Jaco Pastorius, mais aussi le travail de Jérôme Débédat autour de la photographie en portant un autre regard sur Cuba.
Nous passons ici en revue les concerts les plus proches du jazz de culture. Et bien que le festival couvre l'ensemble du département, nous nous sommes surtout attardés à l'Automne Club, sorte de club éphémère de 500 places installé au cœur de Toulouse au bord du Canal du Midi.
Ainsi le 10 octobre, à l’Automne Club, le trio Laurent Coq jouait devant un nombreux public curieux de découvrir cette figure contemporaine du piano jazz hexagonal qui cultive une approche assez complexe basée sur des compositions singulières issues pour la plupart de son nouvel album Kinship. Une thématique qui s'inspire de ses diverses rencontres avec des musiciens tels Jérôme Sabbagh ou Bruce Barth. C'est d'ailleurs la première fois que cette musique est jouée «live» depuis son enregistrement à New York l'année dernière. Jonathan Blake, l'ancien partenaire de Kenny Barron, Tom Harrell ou du Mingus Big Band, assure une superbe assise rythmique en variant les climats aux cymbales. Un premier thème est très ellingtonien dans son approche, suivi d'une bonne dizaine d'autres faisant référence à sa famille musicale dont on retiendra «Honest» dédié au pianiste Bruce Barth son professeur à New York en 1994 ou «Flow» en hommage à Laurence Allison. Bien que s'inscrivant dans la tradition du piano jazz, il s'en éloigne à travers son travail de compositeur de thèmes. Plus tôt, dans l’après-midi, il donnait à l’hôpital Purpan de Toulouse, un concert pour les patients et leurs proches. Une occasion de s'essayer avec brio à l'exercice du piano solo, toujours dans une thématique originale.
Le lendemain, le club accueillait à guichets fermés la chanteuse et guitariste de Brooklyn Natalia M. King. Son blues entre shuffle et New Orleans est servi par une voix peu expressive et quelques maniérismes issus de la pop, un univers dont elle vient. Dans un français parfait, elle évoque le sens de chaque thème, donnant une impression de maîtrise de la scène et du public. Autour d'elle, le groupe fonctionne sans plus, malgré la présence de l'excellent Fred Nardin (p).
Changement de climat avec le quintet du trompettiste Julien Alour, le 15 octobre. Une formation ayant pris le parti d'un répertoire original autour d'un leader compositeur faisant la part belle aux thèmes de son album Cosmic Dance. L'ensemble acoustique donne dans un jazz post-bop, quelquefois funky, amené par une excellente rythmique d'où émerge le vétéran Jean-Pierre Arnaud (dm) et Gabriel Midon (b). Le jeu de Julien Alour se caractérise par de longues phrases sinueuses doublées d'une articulation claire, alternant entre le bugle et la trompette. On retiendra la superbe ballade «Song for Julia» issu de son précédent album Williwaw où s'illustre François Théberge (ts) avec un léger vibrato à la Lester Young. D'un thème modal à un autre monkien, comme «Big Bang», le ténor de François Téberge cultive son espace de liberté démontrant qu'il est toujours un enfant de Warne Marsh notamment sur «Cold Duke». 
Le 17 octobre, c'est au compagnon de route de Christian McBride de s'installer sur la scène de l'Automne Club: le pianiste Christian Sands a des qualités que l'on a déjà remarquées lors de ses superbes sessions en sideman. Un sens du swing presque naturel allié à une forte appartenance à la culture du piano jazz, que ce soit par ses block chords à la Phineas Newborn ou une main gauche virtuose toujours au service d'une musicalité sans failles. Son jeu peut être également plus percussif et modal suivant les thèmes démontrant une parfaite connaissance de l'héritage de la tradition avec un côté virtuose qui évite l’écueil du remplissage. Eric Wheeler (b), originaire de Washington, a une solide expérience de sideman auprès de Cyrus Chestnut ou Dee Dee Bridgewater, tandis que le batteur du trio, Jérôme Jennings, a collaboré entres autres avec Chick Corea. On peut juste regretter une certaine facilité sur le plan de l'esthétique et du répertoire. Là où il sublime le trio de Christian McBride, le pianiste manque peut-être de personnalité en leader. On retiendra une déclinaison du blues, comme le fait souvent Ron Carter, avant un clin d’œil à Ray Brown sur «FSR» ainsi qu'une superbe version de «I Got a Rhythm» où Christian Sands utilise des effets à la Erroll Garner. Le rappel sur une version gospellisante binaire de «Body and Soul» termine ce qui aura été l’une des plus passionnantes soirées du festival.

Le 18 octobre, on retrouve Fred Nardin, avec son propre trio. D'emblée, il revisite un standard, «You'd Be so Nice to Come Home To » de Cole Porter, avant d’enchaîner sur une composition originale «Don't Forget the Blues» issu de son excellent nouvel album Opening. Le pianiste s’est entouré d’une rythmique de haut vol: Leon Parker (dm), avec lequel il partage depuis quelques années une entente musicale, est remplacé lors de cette tournée par Rodney Green; Or Bareket contrebassiste originaire de Jérusalem, ayant fait ses classes entre Tel Aviv, Buenos Aires et New York, complète ce trio in the tradition. Le pianiste s'illustre dans un jeu au swing léger, aéré et délicat doublé d'un toucher presque cristallin. On est dans un style néo-bop tout en restant contemporain dans son travail de composition. Il y a d'ailleurs une sorte de fraîcheur dans son approche du trio qui rappelle celle de Jacky Terrasson, dû certainement à la présence sur l'album du batteur Léon Parker alors que sur scène Rodney Green se veut tout aussi coloriste aux cymbales mais plus classique dans son accompagnement. Le trio se sublime sur une version dynamique de «I Mean You» avant de poursuivre un peu plus tard sur «Green Chimneys», démontrant une totale maîtrise de la culture jazz. Mais c'est par sa maturité d’écriture que Fred Nardin impressionne notamment avec «The Giant» en hommage à Mulgrew Miller, l'un de ses modèles, et dont Rodney Green fut le batteur. Le final sur «Turnaround» (Ornette Coleman) est un retour aux sources, à ce blues qui reste la matrice du jazz.
Le lendemain l'Automne Club affiche de nouveau complet pour l'éclectique Gaël Horellou en quartet. L'altiste poursuit une carrière à géométrie variable, un peu à l'image d'un Laurent de Wilde entre son ouverture vers les nouvelles technologies avec les formations NHX, Cosmik, Connection, Explorations, mais aussi les musiques ethniques (album Identité) et bien sûr le jazz post-bop, que ce soit avec Abraham Burton (as) ou dernièrement Jeremy Pelt (tp). Ce concert est en fait le l'aboutissement de son excellent album new-yorkais, Brooklyn, où l'on retrouve Ari Hoenig (dm). Le concert débutant sur une ballade, on est frappé par l'expressivité de Gaël Horellou, sorte de Sonny Stitt contemporain ayant intégré les apports d'un Jackie McLean dans l'approche de l'instrument, voire de David Sanborn pour le léger vibrato. Ari Hoenig dynamise avec ferveur le quartet par une polyrythmie extrême relançant le soliste en permanence. Pour ce dernier concert de leur tournée, le leader présente ses musiciens: son batteur, un phénomène, sorte «d'objet musical non identifié», son ancien élève, Etienne Déconfin, devenu aujourd'hui son pianiste et Victor Nyberg son contrebassiste suédois, fidèle compagnon de route de ses trois derniers albums. Un thème tel que «Mangrove special» se finit tels un hymne coltranien démontrant la cohésion du quartet et le jeu rythmique du pianiste évoquant McCoy Tyner, surtout sur le superbe «Dutch blues» au swing implacable. Il y a une forme d'urgence dans la musique de Gaël Horellou, à l'image de ses modèles.
En seconde partie, on a pu apprécier le quintet de Wallace Roney. Le trompettiste revient à ses premières amours avec son nouveau combo acoustique, dans la lignée du Miles Davis du second quintet, avec Eric Allen dans le rôle de Tony Williams et l'excellent Curtis Lundy dans celui de Ron Carter. Le leader sculpte une sonorité grave le rapprochant de Miles surtout dans l'utilisation de la sourdine. Le jeune Emilio Modeste (ts) qui, à seulement 17 ans, a déjà partagé la scène ou étudié avec Rene McLean, Bobby Watson, Gary Bartz, Winton Marsalis, Larry Willis ou Antoine Roney, posède un jeu caractérisé par un léger vibrato au service d'un lyrisme discret, dans la lignée du Wayne Shorter des années 60. Wallace Roney laisse respirer la note, la suspend pour mieux la faire rebondir. On n'est plus dans le simple hommage à Miles Davis, mais dans une sorte de renouvellement, dans une musique toujours aussi belle et contemporaine.
Au même moment comble de l'ironie, le trio du pianiste Danilo Perez avec John Pattitucci (b) et Brian Blade (dm) –soit la rythmique de Wayne Shorter– jouait avec brio le répertoire de ce dernier sur la scène du Bascala de Bruguières.

Le final du festival eut lieu au cœur de la Ville Rose, sur la scène de la Halle aux Grains, autour de la chanteuse Dianne Reeves. Aux frontières d’un jazz aux couleurs binaires, parfois funk teinté d'une world latine au sens large, la chanteuse de Détroit charme un public de plus en plus large. Douée d'une voix digne des grandes héritières de la tradition, elle promène son timbre, ses inflexions et son sens du phrasé au service d'une thématique plurielle. On est un peu dans la lignée des productions policées de son oncle George Duke qui lui avait produit quelques albums. La frappe sèche et puissante de Terreon Gully (dm) que l'on a souvent entendu derrière Nicholas Payton participe à cette impression de musique pop. Le jazz est présent notamment sur ce superbe duo avec Peter Martin, pianiste de la Nouvelle-Orléans sur «You Go to My Head», mais aussi cet hommage à Ella Fitzgerald (centenaire oblige) avec «I Can't Give Anything but Love» suivi de «That's All». La présence de Reginald Veal (b) donne une dimension plus jazz au quartet avec Peter Martin (p) en maintenant un certain équilibre avec un batteur plus à l'aise en binaire et un guitariste Romero Lumbano qui excelle dans les rythmes brésiliens. Le rappel sur «Suzanne» de Leonard Cohen conforta un très nombreux public acquis à la cause universelle d'une musique populaire au sens noble du terme.
David Bouzaclou
© Jazz Hot n°682, hiver 2017
|
Cousance, Jura
Jazz en Revermont, 5-8 octobre 2017
Cousance, un bourg du Revermont d’environ 1200 habitants,
situé dans ce magnifique département du Jura, dans les paysages somptueux de
l’automne, entre Lons-le-Saunier et Saint Amour, se pare d’un festival de jazz
qui en est à sa seizième édition. Nous reviendrons sur sa genèse avec
l’interview de son président-fondateur, Michel Guillot, à la suite de ce
compte-rendu. Jazz en Revermont, qui fait une large part aux musiciens de la
région, repose sur l’engagement de plusieurs dizaines de bénévoles assurant son
bon fonctionnement. Si, pendant les quinze années précédentes, le festival a
sillonné les communes du Sud Revermont, il s’est fixé, cette année, à Cousance,
par facilité logistique.
La première journée fut dédiée plus spécialement aux enfants
avec une matinée qui, dès 9h30, accueillait 600 enfants, très attentifs, de
quatre groupes scolaires du secteur de Beaufort pour le spectacle «Jazzoo» (qui
a fait l’objet d’un disque éponyme, ayant obtenu le prix de l’Académie Charles
Cros, en 2015, et un Grammy Awards en Suède, en 2014). Il s’agissait d’un
dessin animé et concert interactif mis en action par le groupe suédois ODDJOB
(qui devait donner un grand concert le lendemain), dans le but de faire découvrir
la musique et le jazz aux enfants par le truchement «d’aventures et
mésaventures animalière». Spectacle repris à 19h pour tout public.
A 21h, une création de François Thuillier (tu) avec les élèves
des classes de musique actuelle de l’école de musique «Haut Jura
Arcade» de Morez. Puis, François Thuillier s’est produisit en trio avec Geoffroy
Tamisier (tp) et Jean-Louis Pommier (tb).
 Le 6 octobre, un enfant du pays, le trompettiste-bugliste
Aurélien Joly, parrain et fil rouge du festival, avait reçu une carte blanche
avec son groupe «De la Mancha» pour ouvrir la soirée «Trompettistes». Pourquoi
«De la Mancha»? Par passion pour le Don
Quichotte de Cervantès, et surtout pour son amour de Rossinante et Sancho
Pança, qui lui inspirent sa musique, me confia-t-il après le concert. Il était
entouré de Romain Cuoq (ts), Romain Nassini (p, son habituel compagnon de duo),
Michel Malines (b) et Kevin Luchetti (dm). Aurélien Joly est un trompettiste de
l’école Wynton Marsalis, un son déclamatoire, chaud et cuivré typique
new-orleans, une technique impressionnante avec une maîtrise parfaite des
aigus, dont il n’abuse pas, privilégiant la mélodie et le feeling; avec les
mêmes qualités au bugle. Le contrebassiste, parfait de mise en place, lui aussi
mélodique dans les solos, a dû écouter Charlie Haden, d’ailleurs le seul
morceau qui n’était pas de la plume d’Aurélien Joly, «La Pasonaria», de Charlie
Haden justement, fut enlevé avec passion par le quintet boosté par la
contrebasse. Le saxophoniste ténor est parfaitement en osmose avec le
trompettiste, dans un jeu assez véhément, dans la descendance quelque peu
ténors texans. Quant au pianiste, il assure comme on dit, par un jeu riche des
deux mains qui dynamise le groupe. Le batteur est bien dans la ligne des batteurs
d’aujourd’hui (tous les batteurs des différents groupes entendus à ce festival
adoptent à peu près la même technique, venue en gros de Paul Motian, ils
ponctuent, enrichissent les morceaux de différentes figures rythmiques; ils
sont plus du côté des coloristes que de celui des producteurs de swing; par
exemple le chabada a quasiment disparu, ce qui ne les empêche pas de vitaliser
le groupe, et même de swinguer pour certains. Un morceau en référence au «No
Pasaràn», le slogan de Dolores Ibàrruri Gomez qui devint le cri de ralliement
des républicains espagnols en 1936, fut enlevé avec émotion et tension. En plus
d’être un excellent trompettiste, Aurélien Joly est aussi un bon compositeur,
voilà donc un jeune musicien avec lequel il faudra compter. Il faut lui
souhaiter de pouvoir tourner avec son groupe; avis aux programmateurs.
En deuxième partie le groupe suédois ODDJOB du trompettiste Goran Kajfeš
(voir Jazz Hot n° 675, printemps
2016) avec Per Johansson (as, fl, bcl), Daniel Karlsson (clav), Peter Forss (b) et Moussa
Fodera (dm). On est là dans une autre dimension avec un groupe qui a plus de
vingt ans d’âge. Le quintet se présente dans une mise en espace très scénique,
jouant des poses avec les instruments et des effets de lumière simples et beaux
qui créent des atmosphères mystérieuses, bleutées ou rougeoyantes, dans
lesquelles la musique prend corps. Une mise en place au cordeau, des musiciens
chevronnés mais jouant toujours avec passion, sincérité et engagement. Pas de
poudre aux yeux, d’impros toutes prêtes: ils y vont à fond. Ce groupe s’éloigne
parfois quelque peu du jazz, mais ce soir-là ils étaient tout à fait jazz. Les
arrangements enlacent les solistes, ça tourne impeccablement, avec une
rythmique genre Rolls Royce. Le grand concert du festival devant un public
ravi.
 Le 7 octobre, le Anne Quillier
Sextet, fondé en 2011, dans lequel on retrouvait Aurélien Joly à la trompette,
avec Pierre Horckmans (cl, bcl), Michel Molines (b), Grégory Sallet (s), et Guillaume
Bertrand (dm). Anne Quillier dirige sa formation de derrière ses claviers sur
des arrangements et des compositions d’elle-même en un fonctionnement qui fait penser
à Carla Bley, avec parfois quelque chose des Jazz Messengers. Au piano elle
joue souvent à pleines mains sur tout le clavier faisant monter la chauffe par
des motifs répétitifs. La rythmique est bien huilée avec parfois un tapis
basse-batterie très efficace. Le deuxième morceau fut une sorte de concerto
pour piano sur tenues des soufflants et ce fameux tapis basse-batterie. Le clarinettiste
basse sur, je crois, «Ex nihilo» s’arracha complètement, magnifiquement!
Aurélien Joly fit à nouveau preuve de ses immenses qualités, et semblait comme
un poisson dans l’eau dans cet ensemble. Un groupe solide avec de jeunes
musiciens déjà bien ancré dans le jazz.
En deuxième partie, le chanteur
Loïs Le Van avec le Big Band Jazz en Revermont, réunissant pour la circonstance
dix-huit musiciens de divers coins de France, sur des compositions du chanteur
et des arrangements de Thomas Mayade et Sandrine Marchetti. Ces musiciens (dont
certains étaient déjà présents dans les groupes locaux) sont des amis et il
fallait voir leur joie et leur plaisir de se trouver à jouer ensemble, aussi
bien aux répétitions que pendant le concert. Loïs Le Van en est à son deuxième
album, So Much More, après The Other Side et a remporté le concours
de Jazz Vocal Voicingers à Zory en Pologne. C’est un vocaliste à part parmi les
chanteurs masculins, un peu entre Mark Murphy et David Linx (il a d’ailleurs
étudié avec lui) pour les modulations et la technique, et Kurt Kobin pour la
puissance de la voix. Il sait se placer, mener le big band. Il chante en force
avec de longues tenues, du moins tel que je l’ai entendu à la tête du Big Band,
sur également de longues tenues modulées en différents voicings par toutes les
sections. C’est un bain sonore qui emplit l’air. L’orchestre s’en est bien sorti
malgré le peu de répétitions: bravo aux musiciens. Certains morceaux étaient
enluminés par des solos dans la bonne tradition des big bands. Interventions
salvatrices car ce bain sonore risquerait de provoquer de l’ennui, ce qui fut
le cas chez quelques spectateurs. Loïs Le Van est parfaitement maître de son
art, et nul doute qu’on va entendre parler de lui. Ce fut une belle découverte
à ce festival, qui a su prendre des risques pour inviter des musiciens hors des
sentiers battus, comme avec ODDJOB, devant un public dans l’ensemble peu habitué
à ce genre de musique.
 Dernière journée le dimanche 8
octobre avec deux concerts l’après midi. A 14h30, le quintet de Fayçal Salhi,
Bisontin d’origine algérienne, qui est un joueur de oud dans la tradition,
toutes proportions gardées, de Rabih Abou Khalil, auquel il a rendu hommage
dans son premier disque Timgad (Jamra
Productions 2016). Il confie s’être inspiré, en plus du jazz, des musiques
égyptiennes ainsi que des chants de Oum Khalsoum. Au oud, c’est un rentre
dedans, il joue en force, en accords plutôt façon guitare, ce qui fait son
originalité. Il était entouré de Thomas Nicol, figure étrange dans ce contexte avec son look de baroqueux, extraordinaire
violoncelliste, auteur de solos époustouflants lanceurs de chauffe à l’archet. Il
sait faire prendre la mayonnaise. Il est majeur pour le son, le feeling et la
particularité du groupe; Christophe Panzani à la flûte et au soprano s’exprime
avec un beau lyrisme: il évite les phrases charmeur de serpent, restant à fond
dans l’expression jazz –il a joué dans le big Band de Carla Bley; Arnaud
Dolmen à la batterie, fait un beau travail de soutien et relance avec cependant
un jeu léger qui s’accorde avec l’inspiration orientale du groupe; Vladimir
Torres à la contrebasse est très bien dans son rôle d’assise du groupe. Ce sont
de jeunes musiciens qui ne sont pas totalement dans la sphère jazz, louchant
aussi vers les musiques latines. Ils réussissent assez bien la synthèse
jazz-orient. A noter qu’au morceau de rappel ils entrèrent dans une véritable
transe musicale qui nous emporta tous.
En deuxième partie, le trio d’Olivier
Raffin (le régional de l’étape) s’adjoignit
un guitariste invité. Il était aux différents claviers en compagnie de Victor
Pierrel à la basse et Antoine Passard à la batterie. Sur une commande du festival
l’intension du leader était de traduire en jazz quelques thèmes du groupe
Police de Sting. Bonne idée en soi.
Hélas on fut loin d’une réussite. On avait affaire avec un groupe amateur au
sens péjoratif du terme. Ils sont jeunes, il leur reste à travailler avec
humilité et en profondeur.
Jazz en Revermont est un festival
sans prétention, qui met en avant les musiciens de la région tout en étant
ouvert sur l’extérieur. Il s’est ainsi ouvert cette année à des formes de jazz
contemporain et à quelques groupes de haut vol. Souhaitons qu’il persévère dans
cette philosophie avec le nouveau président, ou présidente, qui prendra le
relai en 2018.
Texte et photos: Serge Baudot
***

Michel Guillot, président de Jazz en Revermont
Jazz Hot: Comment est née l’idée de ce festival?
Michel Guillot: Nous
étions trois couples: ma femme et moi, mon frère et son épouse et un
couple d’amis. Nous écoutions du jazz ensemble, surtout du new orleans au
début, puis nous avons découvert les autres esthétiques du jazz. Nous avons eu
l’idée d’un festival sur une soirée, avec un repas, et dont les bénéfices
iraient à des associations de bienfaisance. On m’a demandé d’en être le président
et on est parti comme ça. De fil en aiguille le festival a pris corps: les
gens, les édiles, se sont impliqués. Et voilà seize ans que ça dure.
Vous vous souvenez du premier groupe invité?
Il y avait entre autres le
saxophoniste Michel Pastre, et des petits groupes du coin.
Comment fonctionnez-vous maintenant?
Avec les subventions de la
commune, de la région et de quelques mécènes locaux. Les entrées représentent
un tiers du budget. Grâce aux bénévoles on s’en tire bien.
Comment se fait le choix des groupes?
Jusqu’à maintenant on le faisait entre
nous, par les connaissances de chacun. Cette année, nous avons confié la
programmation à Vincent Vandelle et à Martine Croce qui ont amené les deux
groupes phares. On essaie le plus possible de faire venir des jeunes, et aussi
de faire travailler des musiciens locaux tout au long de l’année avec les
élèves des écoles de musique par exemple. Et aussi d’impliquer les écoles, de
la maternelle au CM2; ainsi, 600 élèves ont
travaillé toute l’année, en dessinant à propos de «Jazzoo». Vous avez pu voir
les dessins exposés sur les murs de la grande salle.
Quel genre de public avez-vous?
La plupart ne sont pas des
amateurs de jazz, ils viennent par curiosité. Nous faisons donc œuvre de
pédagogie.
Vous avez annoncé que vous passiez la main…
Oui pour différentes raisons
personnelles et puis il faut un renouvellement générationnel. Je n’ai pas
encore trouvé mon successeur, mais je resterai dans les parages pour aider.
Texte et photo: Serge Baudot
© Jazz Hot n° 682, hiver 2017
|
Verviers, Belgique
Jazz à Verviers, 30 septembre-27 octobre 2017
Le 11e festival initié et dirigé par Béatrice
Pottier s’est déroulé en huit soirées, du 30 septembre au 27 octobre, dans cinq
villes qui bordent la frontière est de la Wallonie: à Verviers, bien
évidemment, mais aussi à Saint-Vith, Eupen, Waimes et Dison. Pour la deuxième
fois, une collaboration intéressante s’est établie entre l’ancienne cité
lainière et le festival de Rimouski (Québec). Après Jef Neve (p) en 2015, c’est
Philip Catherine (g) qui est parti découvrir la Gaspésie à l’été 2016. Cet
automne, ce sont quatre canadiens qui ont atterri en Belgique pour participer
au festival verviétois et mettre au point un projet commun avec des jazzmen
belges à l’issue de quatre journées en résidence à Malmédy.

Nous n’étions pas présents le 30 septembre pour
assister au grand retour de l’organiste André Brasseur (77 ans), mais le 5
octobre, nous avons fait le déplacement au très beau Centre Culturel de
Saint-Vith pour découvrir ce quintet mixte entre les québécois Hichem Khalfa
(tp), Jérôme Beaulieu (p) et les Belges Sam Gerstmans (b) et Mimi Verderame
(dm) et Fabrice Alleman (ts, ss). La soirée débuta avec une petite heure de
retard justifiée par un méchant virus grippal attrapé par Fabrice Alleman lors
des répétitions. Jusqu’au bout, Fabrice avait espéré pouvoir développer le
programme et les arrangements créés pour la soirée. Peine perdue, il fut
incapable de quitter sa loge. Le concert s’est donc déroulé sans lui, avec
quelques compositions originales d’Hichem Khalfa (tp) et Jérôme Beaulieu (p),
agrémentées de standards connus de tous comme «Along Came Betty» et
«Airegin». Avec «E.S.T.» une composition d’Hichem Khalfa en ouverture, on comprend
vite qu’on a, face à nous, un trompettiste lumineux. Le timbre n’est ni trop
clair ni trop aigu; la sonorité est ample avec juste ce qu’il faut de
vibrations. Classique, somme toute! On pense à Art Farmer, à Chet Baker
parfois, au Miles de «Kind of Blue». Le discours est assuré et l’addition des choruses: sans excès. Hichem Khalfa
laisse place aux sidemen. Jérôme Beaulieu (p, kb), timide au début, s’exprime
crescendo pour finir sur un «Airegin» volontaire, inspiré. Pour notre plaisir
et celui des musiciens invités, Sam Gerstmans et Mimi Verderame démontrèrent
tout le talent et le professionnalisme qui les distinguent.
Le lendemain, vendredi 6, en ouverture, à la Salle
Duesberg de Verviers, on a retrouvé le trompettiste franco-algérien (il réside
au Québec depuis six ans) à la tête de son groupe: Jérôme Beaulieu (kb),
Jonathan Arseneau (b) et Dave Croteau (dm). Le quartet est nettement plus "rockisant" avec le clavier et la
basse électrique. Néanmoins, si le choix
stylistique est différent, on retrouve avec plaisir le son bien rond du
trompettiste. Les influences culturelles des compositions se mélangent
harmonieusement comme avec le premier thème: «Momo» qui glisse sur des
arabesques. Les climats varient au long du concert. A «Reminiscence» succède
«Yanco»: un peu plus lourd, comme une marche funèbre africano-néorléanaise,
puis «J.B»: une très belle ballade
avec un bon solo de basse. «Romain-Rouge» met en évidence le talent du
claviériste Jérôme Beaulieu; «Coquine» a des accents d’Aranjuez, «Here
Later» est joué shuffle. Du batteur,
Dave Croteau, on aurait aimé un peu plus d’inventivité mais son jeu
métronomique, sert l’assurance des solistes. «Tea Time», bien enlevé, bien mis
en place, conclut une prestation excellente et swingante, riche par ses
arrangements et ses climats. On peut, sans risquer de se tromper, prédire une
belle carrière à Hichem Khalfa(tp)! En deuxième partie, samedi, Ivan
Paduart (p) et Quentin Dujardin (g) présentèrent «Catharsis»: un projet
éthéré où les belles harmonies sont soulignées par Bert Joris (tp, flh).
«Delivrance» et «Far Ahead» sont d’Ivan Paduart. Suivent «Paco» puis «Marc et
Farouk» qui illustrent l’amour de Quentin Dujardin pour la guitare sèche, Paco
De Lucia et Ralph Towner. Théo De Jong, à la basse électrique, sonne un peu
trop sourd. Pourquoi ne joue-t-il pas ici de cette belle basse acoustique qui
lui sied le mieux? Je ne suis pas un fan de Manu Katché (dm), qui vient
de la pop music mais, ce soir-là, il
a fait dans la mesure, créatif, moins bruyant. Bert Joris (tp, flh) est,
incontestablement, mieux dans ses baskets avec un programme néobop. «Isabelle», «Retrouvaille»,
«Catharsis»…: de belles mélodies. Vous avez dit «planantes»? Comme c’est
étrange!
Anne Paceo (dm) et son quartet «Circles» –seuls au
programme du samedi 7 octobre– se produisaient pour la première fois en
Belgique. Une affiche qui n’a guère suscité la curiosité des Verviétois puisque
c’est devant une vingtaine de spectateurs seulement qu’ils jouèrent leur
répertoire électronique (le festival a eu par ailleurs à subir la concurrence
du football ce soir-là…). Les musiciens, vivement applaudis, eurent le bon goût
d’offrir une musique très originale où les effets synthétisés, bien maîtrisés,
constituent la base de toutes les compositions. Les œuvres charpentées avec
goût osent des contrastes saisissants, particulièrement avec les chants de Leila
Martial (voc). Dans «Sunshine», elle colle sa voix aérienne, instrumentale, sur
le soprano et le clavier. «Fidèle» fait usage du vocoder; «Hope is Swan», avec
des unissons soprano/voix résonne comme un poème irlandais. Ailleurs, ce sont
des cris violents, punks, qui nous heurtent avant de revenir à des mélodies
plus douces –on se prend à évoquer Enya et même Barbara! Entre les parties
écrites ou convenues portées par les effets électroniques, on apprécia les
solos totalement jazz de Tony Paeleman (kb) et Christophe Panzani (ss). Anne
Paceo est une excellente batteuse et une leader-compositrice intéressante. Elle
termina son concert par une introduction au likembé. Public clairsemé, public
conquis, musiciens étonnés mais étonnants!
Que faut-il faire pour attirer plus de monde à
Verviers? Que doit-on faire pour que les amateurs aiguisent leur curiosité et
fassent confiance à une organisatrice généreuse? A mi-parcours du festival
Béatrice Pottier continuait à espérer une meilleure audience pour le groupe
Sonico (le 13, à Dison), la création Udiverse de Fabrice Alleman (ss) avec l’Orchestre
de Chambre de Wallonie (le 14, à Eupen), le repas blues animé par les
guitaristes Jacques Pirotton et Jean-Pierre Froidebise (le 20, à Waimes) et,
cerise sur la tarte au riz (spécialité locale): un «Concert la Paix» qui
devrait réunir autour du guitariste marocain El Hassan: Steve Houben (as,fl),
Stéphane Martini (g), Mimi Verderame (g, dm), Yves Teicher (vln), André Klénès (b),
Stephan Pougin (perc), Marine Herbaczewski (cello), entre-autres (le 27 au Triangle
de Saint-Vith).
Texte: Jean-Marie Hacquier
Photo: Fred Verheyden
© Jazz Hot n° 682, hiver 2017
|

Monterey, Californie, Etats-Unis
Monterey Jazz Festival , 15-17 septembre 2017
Les
festivals de jazz d’un certain âge, disons 50 ans et plus, ont une certaine
légitimité et le droit de célébrer leur propre histoire avec ses
anecdotes. Le Monterey Jazz Festival, qui a atteint l’âge canonique de 60 ans
en 2017, peut se vanter de son patrimoine, fier à juste titre de son statut de
«plus vieux festival de jazz du monde, et ce sans interruption». Car si le
Newport Jazz Festival, sur la côte opposée des Etats-Unis, fut le premier
et a servi de modèle pour la façon d’opérer, il a connu une histoire plus
mouvementée avec un changement de lieu; il n’en a pas moins tenu le choc tout
au long des années. Il
était tout à fait logique alors, que pour son grandiose programme du 60e anniversaire, Monterey, parfaitement au fait de son histoire, choisisse
de faire le point sur ce qu'il a été, et sur ce qu’il est venu à représenter dans
le monde du jazz. Tim Jackson, directeur artistique de longue date, qui prit
les rênes des mains du fondateur Jimmy Lyons, réactiva la vision artistique qui prisait les nouveaux sons contemporains. Pendant les années Jackson,
le festival de Monterey a été un modèle et un admirable carrefour des musiques traditionnelles, jusqu’aux plus aventureuses.
D’une
certaine façon, le cru 2017 fut une leçon dans l’art de l’hommage. Revenons au
début avec le set d’ouverture de Regina Carter dédié à Ella
Fitzgerald; le programme de la scène principale rendait lui hommage
alternativement à Dizzy Gillespie (longtemps visiteur privilégié et membre
d’une association d’admirateurs de ce festival), et un autre à Sonny Rollins
(encore avec nous, mais ne se produisant plus beaucoup). L’idée d’hommage tient
aussi une grande place dans le projet actuel de Dee Dee Bridgewater –autour de
son album Memphis...Yes, I’m Ready,
du R&B de la vieille école, qui s’éloigne du jazz proprement dit, et met au service de la musique de sa jeunesse son puissant savoir-faire de soul singer.
 Pour
l’hommage à Gillespie, l’excellent pianiste Kenny Barron mena la charge comme
directeur musical, accueillant en invités les trompettistes Sean Jones, Roy
Hargrove, Nicholas Payton; mais l’un des moments les plus mémorables fut le grand
solo de Kenny Barron sur «Con Alma», donquichottesque, virtuose, dans un
traitement musical totalement fluide. L'ombre de Rollins, lequel a illuminé de nombreuses représentations sur la scène principale au fil des
ans, planait sur la soirée du samedi avec des ténors clairement marqués par
Rollins (ce qui recouvre bien-sûr un large éventail de saxophonistes ténor
après 1960). Branford Marsalis, Joe Lovano, et Joshua Redman avaient tous une
conception claire et personnelle de la musique de Sonny, et convergèrent vers le final sur «Saint Thomas». Mais le point culminant du set eut
lieu grâce à Jimmy Heath, un copain de la même génération que Sonny, qui donna
un éclatant, profond, personnel et sublime «Round Midnight».
Même
si ce programme regardait plus vers le passé que d’habitude, il y avait beaucoup
de choses à glaner sur les cinq différentes scènes du festival. Du point de vue d'une esthétique plus contemporaine, la soirée du dimanche fut certainement le point
culminant avec l’apparition du sextet dynamique, cérébral et cependant viscéral de
Vijay Iyer, (avec le batteur Marcus Gilmore tenant une pulse plus droite que le
tonitruant et surdoué Tyshawn Sorey), dont le dernier album, Far From Over, fut la sortie la plus marquante de 2017. Puis ce fut au tour du quintet, étonnamment fluide, de
la fascinante bassiste-leader Linda May Oh, avec le guitariste Matt Stevens et
le saxophoniste Ben Wendel, brillamment à la manœuvre. Le set était à la fois accessible et audacieux.
 Le
Pacific Jazz Café (ré-agencé, et connu dans l'ancien temps comme la Coffee House Venue) était
réservé au piano et aux petits groupes. Le menu allait de l’hommage à Stan Getz
de Joel Frahm (oui, encore un hommage, sincère) jusqu’à la pianiste JoAnne
Brackeen, vétérante sous-estimée, et son trio, ou encore la sensationnelle
chanteuse «Ella-esque», Roberta Gambarini. On
entendit un autre courant du jazz, d’une approche plus jeune mais qui a intégré
les générations précédentes, avec le pianiste chef d’orchestre Gerald Clayton –également
artiste en résidence du festival. Son trio a joué le vendredi au Night Club, se
dépensant dans un répertoire à la fois musclé et musicalement cohérent; le pianiste
et ses amis du trio sont revenus sur la grande scène le samedi soir pour un
très spécial Big Show. Le
père de Gérald, bien sûr, est le célèbre contrebassiste et chef d’orchestre
John Clayton, qui était l’artiste choisi cette année pour l’œuvre de commande annuelle
de Monterey. S’emparant des ressources élégantes et swinguantes de son Clayton-Hamilton
Jazz Orchestra –le meilleur big band de la West Coast– et de celles de la nouvelle génération de talents de son fils au piano, l’aîné des Clayton
conçut une suite ambitieuse intitulée «Stories of a Groove». Les grooves en
question glissèrent du Blues au Swing et à des tours plus tendus, plus
syncopés. A
l’introduction de la suite, après avoir rassurer la commission, John Clayton
déclara: «Tim Jackon m’a invité à des réflexions sur le climat politique
actuel»; il fit une pause, pour souligner son effet, et conclut: «peut-être n’aurait-il pas dû faire cela».
On peut lire des déclarations sur le mood-groove-swing, les turbulences, et
l’importance de garder sa foi en la musique au milieu des horreurs dues la Maison
Blanche. «Stories of a Groove» a parlé par le cœur et la tête
d’un musicien…
Sur
la grande scène de Monterey, il y a aussi des dialogues plus intimes. Pour
preuve cette année, les empathiques duos de Brad Mehldau avec le mandoliniste
Chris Thile –une nouvelle paire de musiciens d'un genre différent, lié par un album
sans pareil (paru chez Nonesuch)– et la rencontre de deux vieux amis pianistes, Herbie
Hancock et Chick Corea, pour un set audacieux, sensible, inventif et
rafraîchissant. La
prestation Hancock-Corea qui a clôt ce festival sur une note forte, peut aussi,
d’une certaine façon, être vue comme un hommage à un festival célébrant sa propre mémoire. Tous deux on joué un rôle important dans la culture du Monterey
Jazz Festival tout au long des années, et le charme ludique, facilement
virtuose de ces deux-là ensemble, les a fait apparaître comme un autre moment historique de Monterey,
en temps réel.
Josef Woodard
Traduction-Adaptation Serge Baudot
© Jazz Hot n°682, hiver 2017
|
Eben-Emael, Belgique
Jazz au Broukay, 18-20 août 2017
C’est quoi «le Broukay»? C’est où? Réponse:
un moulin sis au bord de la rivière «le Geer», en Belgique, commune de
Bassenge, bourg d’Eben-Emael; aux confins de la Wallonie, de la Flandre
(province de Limbourg) et de la
Provincie Limburg (Hollande); au sud de Maastricht (lire «Mâstrikt» et pas «Mâstrichte»); à l’est de la ville de Bilzen
et à l’ouest de Visé, du Pays de Herve et des anciens Fourons
devenus«Voeren»! Cet irrésistible territoire rassemble les
carrières de tufeau et les champignonnières de Kanne, les immenses écluses de
Lanaye entre la Meuse et le canal Albert, la Montagne Saint-Pierre, le Fort
d’Eben-Emael (première incursion des parachutistes de l’Allemagne nazie en
Belgique à l’aube du 10 mai 1940); la belle Commanderie d’Alden-Biesen (Bilzen)
fondée par les Chevaliers Teutoniques; le restaurant 5 étoiles du Château de
Neerkanne et la non moins intéressante Tour d’Eben-Ezer construite entièrement
avec des pierres de silex par un initié – une sorte de cousin du Facteur Cheval!
 Et le jazz dans tout ça? Nous étions présents pour la deuxième
soirée de la 21e édition de Jazz au Broukay, organisée par les
pouvoirs locaux et Jean-Pol Schroeder, le directeur de la Maison du Jazz de
Liège. La première soirée était un hommage à Chet Baker qui a débuté par un document
vidéo réalisé par la Maison du Jazz, retraçant la carrière du trompettiste et
les relations privilégiées qu’il entretenait avec Jacques Pelzer ou Philip
Catherine. Deux trios de trompettistes vinrent en apothéose de cette première
soirée. Le premier comptait Grégory Houben (tp, flh, voc), Quentin Liégeois (g)
et Cédric Raymond (b). Le truculent Grégory osa –dixit Schroeder– transcender
les œuvres de Dalida et Johnny Hallyday. Pourquoi pas? Le second trio
réunissait l’éminent Bert Joris (tp, flh), le sémillant Nicola Andrioli (p) et
Jos Machtel (b). Ben, oui, nous avons raté ça!
Le samedi soir, traditionnellement, les organisateurs
se consacrent au jazz Django. Nous y étions! Une vidéo assemblée par les
mêmes que la veille faisait la part belle aux affres des communautés Rom et, au
milieu de celles-ci: à l’héritage de Django Reinhardt et ses suiveurs: Bireli
Lagrène, Patrick Saussois, les Rosenberg… Ce sont les fils de Stochelo–Johnny
(g/rhythm, voc) et Mozes (g solo)– qui assurèrent la première partie avec le
contrebassiste hollandais Arnould Van den Berg. Bon sang ne peut mentir. L’adage
est facile, mais il est approprié pour ce qui est du talent et de la virtuosité
de Mozes («BlueMoon», «Caravan»). Avec «Cry Me A River» –le seul morceau
divinement chanté par Johnny– on se prit immanquablement à rêver à la gueule
d’amour d’une jeune dame en canoé rose!
Pour conclure cette deuxième journée,
l’apothéose avait été confiée aux Cavaliere Père et Fils en formation Jazzy
Strings Sextet qui comptait: René Desmaele (tp, flh, cornet), Fred Guédon (g/rythm)
et, en invité, Dorado Schmitt (g). Mario Cavalière (g) reste
incontournable et bien en place pour défendre l’héritage manouche qui va de
Liberchies à Samois. L’autre vedette de la journée, Dorado Schmitt (g), nous a
particulièrement accroché par le velouté de sa sonorité, la justesse de son
touché, sa très belle sensibilité et sa modestie. Loin de répondre aux appels,
aux débordements et aux accumulations de chorus d’Alexandre Cavaliere (vln),
Dorado s’exprime joliment, discret, attachant, passant les relais et rejetant une
couverture qu’il mérite amplement. C’est aussi une manière de garder l’esprit;
elle va à l’encontre de la virtuosité à tout cran de la plupart des familles.
«It Must To Be You», «Nuages», «Bossa Dorado»… Dans l’après-midi du dimanche, nous aurions pu
écouter le Gumbo Jazz Band: du swing venu de Maastricht, puis The Viper’s
Rhythm Band, cinq musiciens et danseurs des environs de Liège. Mais où
étions-nous donc encore partis?
Jean-Marie Hacquier
photo Pierre Hembise
© Jazz Hot n° 681, automne 2017
|
Buis-les-Baronnies, Mollans-sur-Ouvèze, Drôme
Parfum de Jazz, 13-26 août 2017
Le Pour sa 19e édition, le festival Parfum de Jazz continue de faire honneur au cadre
somptueux de la Drôme provençale avec trente-deux concerts, tant en journée
qu’en soirée pour les «apéros-jazz» sur les places des quatorze villages
participants et, bien entendu, les grands concerts offrant un jazz abordé dans
ses différentes dimensions, mais sans jamais en sortir. Une programmation
cohérente, ce qui n’est plus si évident aujourd’hui, agrémentée de deux
conférences de qualité. Grâce en soit rendue au président et fondateur de ce
bel événement, le trompettiste Alain Brunet, qui l’anime avec enthousiasme et,
à l’occasion, «paie de sa personne» aux côtés des musiciens.

Dimanche 13 août,
le concert d’ouverture se tient dans le superbe décor montagneux de
Saint-Ferréol-Trente-Pas; tradition oblige et pour une bonne cause, au profit
de la lutte contre la mucoviscidose. Le Super Swing Project composé de Jean-Marc
Monnez (p, voc), Daniel Barda (tb), Charles Prévost (washboard), le pilier du
groupe, et de Gilles Berthenet (tp), entraîne un public venu en nombre sur les
traces de Sidney Bechet avec «Blues My Naughty Sweety Gives to Me», mais aussi
de Nat King Cole avec«When I Grow to Old to Dream» et une belle version de «Sweet Lorraine» alternant des
chorus enlevés de Daniel Barda et Gilles Berthenet. Marc Monnez reprend «Lady
Be Good» dans une prestation spectaculaire, puis seul au piano-voix, «Lisa» de George Gershwin. Le voyage musical
se termine sur un bel arrangement de «Them There Eyes»de Billie Holiday
et, pour le rappel, sur «Please Don't Talk About Me». On retrouvera avec plaisir cette formation le
lendemain, pour la présentation du festival, dans les jardins de l’hôtel de
ville de Buis-les-Baronnies.

Lundi 14
août, pour
la première fois, le centre
de vacances Léo Lagrange de Montbrun accueille la programmation de
Parfum de
Jazz avec le quintet d’Aurore Voilqué (vln, voc): Jerry Edwards (tb),
Thomas
Ohresser (g), Basile Mouton (b) et Julie Saury(dm). «Rose Room», sur un
arrangement d’Olivier Defays, ouvre le «bal swing» suivi de «Mabel» de
Django,
introduit par Julie Saury et interprété dans le style new orleans;
tandis que Basile Mouton ouvre longuement le «Black Trombone» de Serge Gainsbourg, où se distingue, bien évidemment, Jerry
Edwards. Le public est conquis par l’énergie de la violoniste, très à son aise
sur le répertoire de Django («Place de Brouckère») ou sur la chanson française
(«Le Rififi», associé à la gouaille de Magali Noël), particulièrement
lorsqu’elle déambule au milieu du parterre. «Une Blonde en or» d’Henri Salvador
conclut le concert sous les acclamations.

Mardi 15 août, la place du village au cœur du village de
Mollans-sur-Ouvèze est comble pour Les Doigts de l'Homme –Olivier Kikteff
(g), Yannick Alcocer (g), Benoît Convert (g) et Tanguy Blum (b)– qui présentent
leurs nouvelles compositions et de plus
anciennes, adaptées à la nouvelle formation, avec des percussions (Nazim
Aliouche) au lieu de l’accordéon. Dès «Là-haut», le premier morceau joué, on
retrouve la place prépondérante des trois guitares qui se répondent. Olivier
Kikteff aime expliquer l’origine des compositions, ainsi, pour «Le Cœur
des vivants» (également titre du dernier album, paru en 2017); il rappelle Tacite:
«Le vrai tombeau des morts, c’est le cœur des vivants». Quant à «Amir Across
the Sea», il s’agit d’un hommage à Amir Mehtr, ce nageur qui a fui la Syrie à
la nage pour rejoindre l’Europe. «Love Song», une reprise de Tigran Hamasyan, qui
permet à Nazim Aliouche de démontrer tout son talent, est suivie de «4BC», une
composition d’Olivier Kikteff. Benoît Convertreste seul sur scène pour l’intro de «Indifférence», standard de Tony
Murena, vite rejoint par l’ensemble du groupe pour un éclatant final. Le
concert s’achève avec les anciens titres du groupe –«Mixture»,«Féerie» et«Da Vibe»–, avant un rappel réclamé
avec insistance.

Mercredi 16 août,
Laurent Courthaliac (p) présentait, à Buis-les-Baronnies, son hommage à la
musique des films de Woody Allen, objet de son dernier album, All My Life (Jazz & People). Un
concert donné en plein air, avec son octet, et qui précédait la projection de Manhattan, (finalement annulée pour
cause d’orage), l’un des chefs-d’œuvre du cinéaste new-yorkais. Les
orchestrations de Jon Boutellier (bar) sont interprétées par Bastien Ballaz
(tb), Fabien Mary (tp), Dmitry Baevsky (as), David Sauzay (ts), Clovis Nicolas
(b) et Romain Sarron (dm). Un parcours jazzique et cinéphilique à travers des
titres dont plusieurs sont issus de la comédie musicale sortie sur les écrans
en 1996, Tout le monde dit I love you:
«Everyone Says I Love You», «All My Life» ou encore «Just You, Just Me».
Jeudi 17 août, la
soirée se tenait au Théâtre de Verdure de la Palun (Buis-les-Baronnies), lequel
jouit d’une superbe vue sur le Mont Ventoux. Elle est ouverte par le quartet franco-luxembourgeois
de Maxime Bender(ts, ss) –Manu Codjia (g), Jean-Yves Jung(org) et
Jérôme Klein (dm)– avec leur projet Universal Sky aux ambiances oniriques.
Un répertoire de compositions qui va de jolies ballades («Sorrow») jusqu’au
jazz-rock («Song of Fire and Ice», clin d’œil à la série télévisée Game of Thrones).
En deuxième
partie, le trio d’Olivier Hutman (p), formé des excellents Darryl Hall (b) et
Steve Williams (dm) débute sous les meilleurs auspices avec «Driftin» d’Herbue
Hancock. Il est rejoint, par Eric Le Lann (tp) et Olivier Temime (ts) dès le
deuxième titre, «Ayam», une composition du trompettiste. Suivent un
bon blues avec «Max’s Axe» et un non moins délicieux «Milestone». Une plaisante
ballade également, avec un original du leader, «I Am to Talk About You», avant
de reprendre «Zingaro», un bossa d’Antonio Carlos Jobim. Fin du concert et retour
au pur bebop avec «Hortense»et «Fast Changes». La soirée se conclut
sur un rappel enthousiasmant: «If I Should Lose You», immortalisé
par Nina Simone, et «Well You Needn't» de Telonious Monk. 
Vendredi 18 août,
retour au Théâtre de Verdure de la Palun avec les Swing Ambassadors: Max-Alipe
Michel (as, ss), Philippe Dieudonné (ts), Dominique Rieux (tp), Rémi Vidal
(tb), Cédric Chauveau (p) Jean-Pierre Barreda (b) et André Neufert (dm). Le
concert s’ouvre avec un «Cute» basien qui met d’emblée le public au diapason.
Suivent «Moten Swing» de Bennie Moten; «Perdido», sur lequel le septet invite
Tony Russo (tp); «Shiny Stocking», bien arrangé par ClaudeGousset (tb),
l’un des orfèvres retravaillant ce répertoire swing pour le compte des
Ambassadors, avec François Biensan (tp); ou encore «Flight of the Foo Bird» mis
en valeur par un beau solo de Cédric Chauveau. Pour le final, Nicolas Folmer
(tp, programmé le lendemain) est convié sur «Take the ’A’ Train» et «Lullaby of Birdland»,
tandis que le président du festival, Alain Brunet, entame un scat endiablé avec
la joyeuse équipe.

Samedi 19 août
–notre dernier soir de présence–, toujours au Théâtre de Verdure, Daniel Humair
(dm) se produisait en invité d’honneur de Parfum de Jazz 2017, avec Nicolas
Folmer en invité. La batteur, qui est également peintre, exposait d’ailleurs à
la Galerie Lithos de Saint-Restitut durant toute le
festival. Le quartet, complété par Hervé Sellin (p) et Stéphane Kerecki(b), débute avec «What Is This
Thing Called Love?» de Cole Porter, suivi de «Gravenstein», une composition du leader.
Autre original, de Nicolas Folmer cette fois, «I comme Icare» permet
d’introduire «Brunette» (qui semble dédié à Alain Brunet!), après quoi
intervient un hommage à Paul Chambers, avec le magnifique «Mr.P.C.»de
John Coltrane, bien entendu orné d’un bon solo de Stéphane Kerecki. Un concert
tout en délicatesse.
Un festival qui
se déguste comme un Côtes du Rhône aux riches arômes. Rendez-vous en 2018 pour un bel anniversaire, la 20e édition!
Texte et photos: Patrick Martineau
© Jazz Hot n° 681, automne 2017
|
Pertuis, Vaucluse
Jazz à Pertuis/Festival de Big Band, 7-12 août 2017
Par
le caractère original de sa programmation, la défense des grands
orchestres de jazz français et européens, un tarif de billetterie entre
la gratuité et de 6 à 16 euros pour les concerts payants, ce festival
revêt un véritable caractère populaire. Il est soutenu essentiellement
par la Mairie de Pertuis et reçoit quelques autres petits soutiens
institutionnels et privés.
Léandre
Grau est toujours le capitaine souriant de ce navire parrainé par
Gérard Badini. On y vient de toute la région, sans tenue de soirée, dans
la simplicité d’une atmosphère
aussi familiale que sincère, et la présence de nombreux bénévoles, dont
les élèves du Conservatoire de musique n’est pas pour rien dans la
bonne humeur de ce festival enraciné dans un terroir. Nous étions
absents comme de coutume pour la soirée Salsa réservée à la danse et
pour la soirée du mardi ou se produisaient The Shoeshiners et l’Aubagne
Jazz Band… Nobody’s perfect.

Lundi 7 août
Pour
l’ouverture du Festival, le public a répondu en nombre, la file
s’allonge à l’entrée et, après un contrôle dans les normes mais
sympathique, nous pouvons assister au lever de rideau sur la scène de la
première cour de l’Enclos de la Charité. Depuis plusieurs années les
musiciens de Tartôprunes, dont un grand nombre a fréquenté les classes
du Conservatoire de Pertuis, lancent le festival. Certains sont devenus
professionnels d’autres sont là simplement par passion, par amitié et
pour la «déconnade». La bande, une sorte de Blues Brothers and Sisters
sont déguisé(e)s en clone d’américains. Un peu comme dans les Village
People, on retrouve la statue de la liberté, le cow-boy, le bandit… La
présentation se fait en simili anglais et précise qu’il s’agit d’un
«Trump Tribute» où les blagues potaches alternent avec des arrangements
de titres venus de tous les horizons. L’animateur remercie Léandre Grau
de les avoir invités à venir depuis Memphis dans le Tennessee. Au
passage, on entend quelques bons solistes, notamment le tromboniste
Romain Morello et le trompettiste Valentin Halain. Le répertoire passera
par le rhythm & blues, le reggae (de Bob Marley), la soul, une
manière d’hommage à George Benson version Broadway et Dalida sera
ressuscitée. Après une bonne heure de concert, acclamés par la foule
qui compte un grand nombre de copains, le public a juste le temps de
gagner la grande scène pour écouter le Big Band de Pertuis.
Tartôprunes: Caroline
Suche (p), Maeva Morello, Valentin Halain (tp), Romain Morello (tb)
Philippe Ruffin, Clément Serre, Alex Chagvardieff (g), Maxime Briard
(dm) Bastien Roblot (g, perc, voc)
Cette prestation, présentée dans la programmation officielle, reste pour le Big Band de Pertuis son
concert majeur de l’année. D’une édition à l’autre, le Big Band a
renouvelé son répertoire offrant ainsi une diversité de compositions et
d’arrangements au service de l’ensemble et des solistes. Cette grande
formation qui existe depuis 1984 a donné sa chance à de nombreux jeunes
musiciens; on retrouve dans ses rangs des anciens et leur relève. La
chanteuse Alice Martinez, qui vient de terminer une longue tournée en
Chine, s’affirme désormais au niveau national; elle apporte à cette
formation un complément de charme et de swing. Léandre Grau, directeur
artistique du Festival et chef de troupe du Big Band de Pertuis,
toujours aussi classe, présente la soirée et lance «l’artillerie». En
première partie on pourra entendre
«Flight
of the Foo Bird» de Neal Hefti, enflammé par le solo du saxophone ténor
Christophe Allemand, puis «Critic’s Choice» d’Oliver Nelson illustrés
par de beaux solos du jeune sax alto Clément Baudier très inventif, du
pianiste Yves Ravoux, discret mais ici très efficace, et de Romain
Morello (tb), l’un des piliers de l’orchestre. Vont suivre «Don’t be
That Way», «Between the Devil and the Deep Blue Sea» servis par une
belle intervention d’Alice Martinez, «Bluesette» de Toots Thielemans
avec un formidable arrangement de Mike Tomato et une mise en valeur
d’échanges trombone/trompette. Toujours en pleine découverte, on
retrouve un thème de Lennie Niehaus, musicien favori et collaborateur de
Clint Eastwood, «Cream of the Crop». Pour les deux titres avant la
pause, Alice Martinez, drapée de sa belle robe noire, rejoint la machine
pour «Teach Me Tonight» et qui va exploser sur «Jumpin’East of Java».
La
seconde partie toujours aussi enthousiaste présente des thèmes plus
traditionnels, que de nombreux amateurs dans le public reconnaitront. On
va ainsi voyager sur les traces de Count Basie avec «Basie Straight
Ahead» à Duke Ellington avec «In the Sentimental Mood» en passant par
«Spencer Is Here», «Satin Doll», «The Very Thought of You», «Blues in
the Closet», «I Loves You Porgy», «I Thought About Uou», «Just a Minor
Thing». Chacun y apportant sa juste contribution et son savoir-faire,
notamment les parties chantées. Après un long concert très applaudi, le
rappel sera «Get Happy» qui porte bien son titre vu l’acclamation du
public et la joie qui semblait pétillait sur les visages de ces
noctambules. Une belle soirée sous les étoiles du Vaucluse.
Big Band de Pertuis: Yves
Ravoux (p), Gérard Grelet (g), Bruno Roumestan (eb), Stéphane Richard
(dm), Christophe Allemand, Clément Baudier, Laurence Allemand (ts), Yvan
Combeau (as) Jérémie Laurès (bs), Jean-Pierre Ingoglia, Romain Morello,
Lonny Martin (tb), Bernard Jaubert (btb, tu), Yves Martin (btb), Yves
Douste, Lionel Aymes, Roger Arnaldi, Valentin Halin, Nicholas Sanchez
(tp), Alice Martinez (voc), Léandre Grau (lead)
Mercredi 9 août
Voici
un quart de siècle que le Caroline Jazz Band anime avec passion un
répertoire consacré au swing au blues et au style new-orleans.
Originaire de Montpellier, le groupe a traversé pour des centaines de
concerts maintes fois la France. Toujours chaleureux les musiciens avec
entrain ont réchauffé le fond de l’air un peu trop frais ce soir-là.
Caroline Jazz Band: Henry
Donadieu (ts, cl), Gilbert Berthenet (tp, flh), Francis Guero (tb),
Bruno Grau (g, bjo), Yves Butrefille (b), Michel Mozet (dm)

David Hitchen Big Band: David
Hitchen (tp, lead), Rémi Pichot, Sylvain Avazeri, Manu Penlaver (tp),
Bruno Hervat, Keith Hutton, Jean-Michel Stueber, Andy McKay, Vincent
Bertin (tb), Philippe Castaldi, Cristina Santini, (as), Jérome
Chalendard, Boleslaw «Bolo» Mielniczuk (ts), Hugo Beudez (bs), Gilles
Marthan (p) Léo Chazalet (eb) Laurent Maurell (dm)
Vendredi 11 août
Le
groupe Snap Fingirls nous propulse dans le jazz des années 1940 et 50,
orchestré par 6 musiciens: Pascal Aignan (sax), Phillipe Anicaux (tp),
Matthieu Maigre (tb), Sébastien Germain (p), Lilian Bencini (b),
Thierry Larosa (dm), et 3 chanteuses: Suzy Deschamps, à l’origine du
projet avec son court-métrage «Snap Fingirls» qui est aussi prof’ de
chant et pianiste; Sophie Teissier qui se produit régulièrement dans la
région avec son quartet ou d’autres formations; et Claire Leyat,
chanteuse-guitariste et membre du duo Ohlala. Les trois
chanteuses ont mis en paroles les compositions de Pascal Aignan et
Sébastien Germain. Costumes d’époque aidant, le trio nous emmène avec
humour dans un petit voyage dans le temps à la suite des Andrew Sisters,
et donne à entendre un joli ensemble de voix claires, souples et
dynamiques. Ça pétille, ça swingue, ça dépayse…

François Laudet
Big Band: Thomas Savy (ts), Xavier Quérou (sax), Esaie Cid (s), Matthieu
Vernhes (ts), Tullia Morrand (bs), Martin Berlugue (tb), Marc Roger
(tb), Martine Degioanni (tb), Judith Weckstein (tp), Sophie Keledjian
(tp), Michel Feugere (tp), Julien Ecrepont (tp), Malo Mazurié (tp),
Carine Bonnefoy (p), Nicolas Peslier (g), Cédric Caillaud (b), François
Laudet (dm).
Samedi 12 août
Le
lendemain, rencontre expérimentale, sous le regard de Tonton Georges
–grand moyenâgeux devant l’éternel, dont le portrait et l’œuvre
illustrent le fond de scène–, entre musiques du XVIe siècle et jazz. Gageure pas si risquée qu’on pouvait le penser, puisque
ces deux musiques possèdent en commun une base rythmique forte et
l’improvisation (qui a disparu ensuite). On pourrait ajouter leur même
capacité à recréer à partir de matériaux populaires, les Ensaladas de Mateo Flecha pouvant se comparer aux medleys du jazz. On a donc pu voir un quatuor extrait de l’Ensemble de cuivres
anciens de Toulouse, avec Daniel Lassalle (sacqueboute), Jean-Pierre
Canihac (cornet à bouquin), Brice Sailly (orgue et clavecin), et Florent
Tisseyre (perc) s’acoquiner avec un quintet de jazz: Denis Leloup (tb),
Philippe Léogé (p), Jean-Pierre Barreda (cb) et Fabien Tournier (dm)
pour jouer les œuvres de Diego Ortiz et Juan Vasquez. La rencontre des
chacones, pavanes et thèmes de jazz fait dresser l’oreille, et même si
le swing ne retrouve pas tous ses petits, une dynamique s’installe, qui
nous fait oublier les 400 ans qui les séparent!

La
clôture du festival est confiée au Big One Jazz Big Band drivé par Stan
Laferrière, grand arrangeur, chanteur, batteur, guitariste… et pianiste
ce soir-là, qui nous propose aussi un retour aux sources avec sa «Big
band jazz saga», épopée du jazz et des big bands depuis leur apparition
au début du XXe siècle. Sous la forme d’un récit
pédagogique alternant avec ses illustrations musicales se déroulent donc
presque 100 ans de jazz: Stan le conteur invite son big band à se
couler dans le rôle des grands orchestres qui se sont succédé depuis
Fletcher Henderson et James Reese Europe jusqu’à Art Blakey et Wayne
Shorter, en passant par les Basie, Ellington, Miller, Thad Jones, Lalo
Schifrin… Stan l’arrangeur a adapté des standards de chaque formation,
les détournant et les renommant avec humour: on a ainsi droit à «Conte
basique», «l’Oreille est Hard», «Fly Me to the Case», etc.
Initiative
intéressante, bien servie par des musiciens très professionnels et
porteurs d’une grande culture musicale, qui réaffirme que le jazz n’est
pas un genre musical, mais une culture qui a ses origines dans
l’histoire sociale des Etats-Unis et de la communauté afro-américaine.
Parfaite clôture d'un festival de big bands ayant pris racine(s) dans la
volonté pédagogique d'une école de musique et dans une terre de
culture.
Big One Jazz Big Band:
Stan Laferrière (dir, arr, p), Antony Caillet, Julien Rousseau,
Benjamin Belloir, Mathieu Haage (tp), Cyril Dubile, Nicolas Grymonprez,
Jérome Laborde (tb), Jean Crozat (btb), Christophe Allemand, David
Fettman (ts), Olivier Bernard, Pierre Desassis (as), Thierry Grimonprez (bar), Sébastien Maire (b), Xavier Sauze (dm)
Jazz
à Pertuis présente depuis 19 ans des big bands, mais il existe un grand orchestre invisible –et c'est toute sa force– sans lequel ce festival ne
pourrait pas exister, qui revient chaque année sans perdre son
enthousiasme, sans se lasser, pour notre confort, celui des musiciens,
notre accueil et notre plaisir: le big band des bénévoles avec à sa tête
le plus jeune d’entre eux, Léandre Grau! On attend impatiemment ce que nous réserve l’anniversaire des 20 ans…
Michel Antonelli et Ellen Bertet
texte et photos
© Jazz Hot n° 681, automne 2017
|
Langourla, Côtes d'Armor
Jazz in Langourla, 4-6 août 2017
Cette année encore, le Théâtre de
Verdure, cette ancienne carrière réaménagée en salle de concert en plein air,
accueillait une programmation 100% jazz. Et c’est une 22eédition mémorable que Marie-Hélène Buron, la directrice artistique du festival
Jazz in Langourla, assistée de Gildas Le Floch, nous ont concoctée.

L’année dernière, c’était le
guitariste Sylvain Luc qui lançait les festivités. Cette année, l’excellent Daniel
Givone a eu cet honneur. Voilà plusieurs éditions qu’il nous touche par sa
générosité et sa présence infatigable au festival, aussi bien sur scène qu’aux
côtés des bénévoles. On se souvient notamment du très émouvant hommage qu’il
avait rendu avec Alma Sinti à Patrick Saussois. Et des nuits passionnées où il faisait
le bœuf avec les musiciens de passage et les têtes d’affiche lors des jams au
bar Le Narguilé, sans jamais tirer la couverture à lui. Cette discrétion, cette
sensibilité, cette poésie, ce répertoire, ce jeu où tout est supérieur rendent
ce guitariste exceptionnel. Il est seul en scène. Au départ, il ne voulait s’accompagner
que d’une seule guitare, classique, mais, emporté par la passion, il en a
rapporté d’autres et, durant une heure, il ne cesse de passer d’un instrument à
l’autre et change de registre en un clin d’œil. De Jean Ferrat à Sting, du
flamenco aux standards de jazz, avec une pensée pour son héros Joe Pass, il donne
tout, joue avec mille nuances. Chaque instant est un moment de poésie, de jazz,
de beauté. L’esprit de Patrick Saussois est très présent. On sent Daniel Givone
très ému lorsqu’il évoque la mémoire de son ami. Saussois, Givone, la nuit, le
jazz, la musique, des moments d’amitié indissociables du festival de jazz de
Langourla. Entre Saussois et Givone, les points communs sont très nombreux.
Comme lui, c’est un guitariste curieux de tout, un amoureux de la guitare qui
joue tous les styles. Chaque année, Givone passe du temps au Népal. Il s’est
nourri de cette culture, a étudié la façon qu’ont les Indiens de jouer de cet instrument.
A la fin du set, il interprète deux compositions originales, «L’éléphant» et «Sur la route du Népal», moments parmi les plus beaux de la soirée. La transition avec
le prochain groupe semble toute faite, le guitariste rappelant que le dernier
album de Patrick Saussois, The Look of
Love (Djaz, 2010), a été enregistré avec Rhoda Scott. Place donc à la grande organiste.
Accompagnée de son Lady Quartet, composé de Sophie Alour (ts), Géraldine Laurent (as) et Julie Saury
(dm), Rhoda Scott enflamme le Théâtre de Verdure avec son groove. Entre
compositions («We Free Queens», «You’ve Changed», «I Wanna Move») et reprises («Que reste-t-il de nos amours?», «Moanin’»), les
titres qu’elles jouent sont tirés essentiellement de leur nouvel album, We Free Queens (Sunset Records), sorti
en début d’année. Cette seconde partie de soirée est gorgée de swing, de blues,
avec des accents très funky. Les musiciennes sont pleines de fougue et d’enthousiasme.
Le public est conquis.

Samedi soir, le 5 août, les
festivaliers découvraient le duo formé par Emile Parisien (ss) et Vincent
Peirani (acc). Et n’a pas été déçu! Les trentenaires s’intéressent aussi
à l’histoire du jazz et revisitent de façon très personnelle le répertoire de
Sidney Bechet. Ils débutent avec «Egyptian Fantasy» et «Temptation Rag», qu’ils
ont enregistrés dans leur album Belle
Epoque (ACT, 2014). On comprend vite qu’ils ont longuement écouté la
musique du maestro avant de s’y attaquer, tant ils en ont capté l’essence dans des
arrangements subtils, laquelle dérive parfois vers la musique de chambre et la
musique contemporaine. Entre le feu de Parisien et le jeu très dramatique de
Peirani, la fusion est totale. Ils jouent peu de titres. Chaque morceau qu’ils
interprètent est une rêverie. Chacune de leurs notes est une aventure. Suivent
un hommage à Schubert («Schubertauster») et un clin d’œil à Michel Portal («3
temps pour Michel P.») avant de revenir à Bechet avec un magnifique «Song of
the Medina». Somptueux.
Puis revoilà Julie Saury. Après avoir
accompagné Rhoda Scott la veille, elle nous présente ici son album For Maxim (nous renvoyons les lecteurs à
son interview, dans ce numéro, et à la chronique de son disque dans Jazz Hot n°679) en hommage à son père Maxim
Saury (1928-2012), l’un des grands représentants du jazz new orleans en France.
Pour un tel projet, elle a fait appel à des musiciens qu’elle connaît bien:Aurélie
Tropez (cl),Frédéric Couderc (ts, fl), Shannon Barnett (tb), Philippe
Milanta (p) et Bruno Rousselet (b). Sans jamais tomber dans le piège de la nostalgie
larmoyante, elle a repris des standards que jouait et aimait son père, les a
réarrangés, plutôt dérangés. On reconnaît bien les thèmes «Sweet Georgia
Brown», «Moppin and Boppin», «Avalon», «Do You Know What It Means to Miss New
Orleans?», «Back Home Again in Indiana», «Together», et ce ne sont pas
tout à fait les mêmes. C’est très astucieux, très
réussi, très rafraîchissant. Au final, bien que glaciale (les musiciens claquaient des dents!), la soirée fut très réussie.
Nous n’avons pu assister à la dernière soirée du
festival, qui s’achevait le dimanche avec Selmer n°607et les Glossy
Sisters, mais nous ne doutons pas que cette édition 2017 a fini en beauté.
Cette année encore, entre les concerts au Théâtre de Verdure, les
apéros-concerts en début de soirée (notamment le très intense Nebia Trio,
lauréat du Tremplin blues jazz2016) et les jams au Narguilé, Jazz in Langourla est l’un des
rares festivals de jazz à défendre à ce point un état d’esprit jazz de partage
et de convivialité entre les musiciens et les festivaliers, les passionnés et
les bénévoles, et une programmation artistique exemplaire. A l’année
prochaine!
Texte et photos: Mathieu Perez
© Jazz Hot n° 681, automne 2017
|
Ospedaletti, Italie
Jazz Sotto Le Stelle, 2-4 août 2017
Les
fidèles lecteurs de Jazz Hot
connaissent bien notre attachement à ce festival proche de San-Remo et à une heure de voiture de Nice. Cadre de rêve:
l'Auditorium Communale est un
amphithéâtre à l'antique de moins de 400 places au milieu des palmiers. Proximité
avec les artistes, sonorisation irréprochable, et présence, à deux pas, d'une
terrasse qui propose spaghettis al
vongole et salade de poulpe irrésistibles. Le photographe Umberto Germinale, qui assure la programmation et la présentation avait
prudemment, pour cette 14e édition,
choisi le thème «crossing», lui laissant
les coudées franches pour une sélection d'artistes évoluant dans des
univers bien différents. Un portrait au-dessus de la scène rappelle la récente
disparition du contrebassiste Dodo Goya, parrain du festival et grande figure du
jazz italien, à qui les trois soirées
sont dédiées. Cigare éteint en bouche, il était présent chaque année depuis la
création du festival, dans le public, les coulisses, et plus souvent encore,
sur scène.

Mercredi 2 août
Emanuelle Cisi (ts), Dino Rubino
(p, flh), Rosario Bonaccorso (b), Peter Van Nostrand (dm) forment le quartet No
Eyes, dont le nom fait référence à un titre de Lester Young, et, en
introduction à cet hommage au saxophoniste légendaire, «September in the Rain »
est exécuté de façon très classique avec la souplesse de swing qui convient.
Pour un «Jumping at the Woodside» très enlevé, le très jeune pianiste délaisse
le clavier pour le bugle dont il joue avec brio à la mode des boppers et, le
sax au très beau son se révèle être aussi un émule de Rollins. Puis, c'est un
émouvant «Goodbye Pork Pie Hat», le thème de Mingus qui fait allusion à
l'emblématique couvre-chef de Lester.
Longue introduction du contrebassiste qui joue aussi parfois en
chantonnant sa phrase à l'unisson pour la ballade «These Foolish Things»,
développée ensuite sous forme de samba. Suivront, en duo sax/bugle: «Jumping With
Symphony Sid», un blues basique de Lester, dédié à cet homme de radio qui œuvra
à diffuser le bebop, puis «Polka Dots
and Moonbeans» truffé de références à Rollins, enfin, «Tickle Toe» (thème de
Lester immortalisé par le Count Basie Orchestra), joué sur un tempo d'enfer par les deux
soufflants qui échangent habilement chorus et «quatre-quatre» dans un joyeux
feu d'artifice ponctué par les «bombes» du batteur new-yorkais aussi discret
qu'efficace tout au long de ce remarquable concert que parachève, en rappel,
un «Lester Leaps In» tout aussi torride.
Jeudi 3 août
Riccardo
Zegna (p) Original Standard Nonet –Pietro
Tonolo (ts, fl), Claudio Chiara (as), Davide Nari (bs), Giampolo Casati (tp),
Davide Garola (tb), Federico Zaltron (tp), Simone Monanni (b), Roberto Pagliri
(dm)– présente une musique «de répertoire» où les interventions un peu
convenues des solistes importent moins que l'exécution (parfaite au demeurant)
des arrangements. Le pianiste, le contrebassiste, le batteur, le sax alto et le ténor sur qui repose
l'essentiel, se distinguent toutefois très nettement par des improvisations très convaincantes.
Les thèmes sont tirés pour la plupart des répertoires de Monk, Mingus,
Ellington, Gillespie. La prestation est de qualité et s'écoute avec plaisir.
Pas de quoi révolutionner l'histoire du jazz, certes, car ce n'est pas le
propos. Mais une bonne occasion de montrer que «la musique du diable» peut
aussi se décliner sous la forme d'une musique de chambre (dont la dynamique,
s'accroit tout au long de la soirée), appréciée des initiés tout en étant
accessible aux profanes.

Vendredi 4 août
Membre actif de Weather Report et
de Steps Ahead, le batteur Peter Erskine est une star. De Gary Burton à Mike
Stern, il a joué avec les plus grands. Le voir ici, si proche, et l'entendre en «son direct», sans
amplification ou presque, avec des musiciens talentueux (dont le fabuleux
saxophoniste Bob Sheppard) est une véritable aubaine. Il se produisait à Ospedaletti
avec son Dr. Um Band: Bob Sheppard (s), John Beasley (p, ep) et Benjamin
Shepherd (b). les thèmes s’enchapinent tous aussi gorgés d'énergie les uns que
les autres. Car, selon un mode jazz-rock radical, le quartet les enfile, comme
autant de perles dignes des plus actuels «dance floors», tout en laissant à
chacun de ses membres le loisir de les enrichir de sa touche personnelle. Le jazz
redeviendrait-il une musique de danse...voire, d'hypnothérapie ? Rêvons...
Le concert est magnifique. Les moments de pure folie, tempérés par des plages
de quiétude apaisantes, laissent l'auditeur un peu étourdi, mais conscient
d'avoir assisté à un grand moment musical.
Succès total. L'auditorium est bondé chaque soir,
et les spectateurs, ravis. Malgré des moyens financiers modestes, Jazz Sotto Le
Stelle prouve, s'il en est encore besoin, la vitalité et, surtout, l'importance des «petits» festivals pour la
défense et l'illustration de cette musique qui nous tient tant à cœur. Et, on
peut se réjouir quand ils sont, comme ici, tenus à bout de bras par des amateurs enthousiastes et éclairés.
Texte: Daniel Chauvet
Photos: Umberto Germinale
© Jazz Hot n° 681, automne 2017
|
Ystad, Suède
Ystad Sweden Jazz Festival, 1-6 août 2017
On
revient au festival d’Ystad retrouver des amis. Le caractère convivial de ce festival –dont le fonctionnement repose
essentiellement sur de nombreux et dévoués bénévoles qui répondent présents
chaque année– est son atout maître. Ainsi
a-t-on plaisir de côtoyer à la cafétéria
du Ystads Teater (le centre de presse) les membres de l’équipe,
musiciens, agents et correspondants venus du Danemark, d’Allemagne, du Royaume-Uni,
des Etats-Unis ou du reste de la Suède; l’occasion d’échanger des points de vue,
de rencontres et de découvertes qui font d’Ystad une cité internationale qui gravite autour du
jazz en communion avec un public nombreux et sympathique. Dans la quarantaine de concerts proposés, quelques moments forts: la programmation, toujours assurée par le pianiste
Jan Lundgren, est apparue cette année moins ouverte sur le monde, privilégiant les musiciens scandinaves, notamment
ceux du label ACT… Elle n’en a pas moins permis de découvrir en
scène de grands artistes…
La
traditionnelle soirée inaugurale du festival, s’est déroulée, le 1er août, dans un nouvel espace: l’Ystad Arena, un complexe sportif flambant
neuf.
Fort d’une capacité d’accueil nettement supérieure à celle du théâtre
municipal, ce bâtiment ouvre aux organisateurs la possibilité de jauges
plus
importantes. Mais le lieu possède moins de charme que les
traditionnelles scènes d’Ystad. Ce
premier concert –qui avait fait le plein de spectateurs– évoquait la
mémoire de Monica Zetterlund (1937-2005), actrice et chanteuse de jazz
suédoise, notamment connue pour avoir enregistré «Walz for Debby» avec
Bill
Evans en 1964. Cette célébration, ponctuée de longues interventions dans
la
langue d’Ingmar Bergman, ne nous était pas accessible de ce fait… Et la
musique n’a pas non plus compensé notre frustration: le Ekdahl
& Bagge Big Band, plutôt bon, a été lesté par les interventions de
deux gloires locales, Svante Thuresson et Tommy Köberg –crooners ayant
collaboré avec Monica Zetterlund–; moment à retenir, un
pétillant «What a Little Moonlight Can Do» interprété par Hannah
Svensson (voc)
suivi par un duo avec Filip Jers («Con alma»), dont l’harmonica
rappelait celui
du grand Toots.
 Heureusement,
le lendemain offrit un réveil en fanfare au concert de 11h, avec le retour
gagnant (ils étaient déjà là en 2015) des Rad Trads dont la musique oscille
entre blues, rock, country. Les cinq jeunes gens–les frères Michael (tp,
voc) et John (dm, voc) Fatum, Patrick Sergent (ts, kb, voc), Alden Harris-McCoy
(g, voc), Michael Harlen (b, voc)– s’amusent beaucoup sur scène et partagent
généreusement leur plaisir d’être ensemble. On est plutôt dans un esprit
rock’n’roll, et c’est extrêmement plaisant. Le groupe –qui
par ailleurs maîtrise l’art du brass band– a ensuite enchaîné sur une parade new
orleans dans les rues d’Ystad (Alden Harris-McCoy troquant sa guitare contre un
soubassophone) avec le renfort d’un tromboniste resté anonyme et d’un altiste
japonais, Yosuke Sato. Ouverte par un antique camion de pompiers et l’ensemble
des bénévoles du festival, le défilé a remporté un franc succès et s’est achevé
sur «When the Saints Go Marching In» et «Down by the Riverside». Epatants, ces
Rad Trads!
A
19h30, au théâtre, un autre musicien déjà présent en 2015, Bobby Medina (tp,
flh, Jazz Hot n°676), proposait un
projet spécial avec l’excellent XL Big Band. Pour autant qu’il soit
sympathique, le trompettiste n’a pas la carrure d’un grand soliste pouvant se
mesurer à un big band. Certains des arrangements originaux qu’il a présentés
(«Autumn Leaves», «Grazing in the Grass» en hommage à Hugh Masekela) ne
manquaient cependant pas d’intérêt. Mais le vrai raté de cette prestation fut
l’invitation du finaliste suédois du concours de l’Eurovision, originaire
d’Ystad (la belle affaire!), le jeune Frans, dont la posture hip-hop et les
maigres talents vocaux paraissaient incongrus. Cette journée s’est joliment
conclue à l’église du monastère par un délicat duo entre un habitué du
festival, le Danois Jabob Fisher (g) et Hans Backenroth (b).
 Le 3
août, la pluie nous a privés de la cour de Per Helsas Gård et il a fallu se
replier au théâtre pour entendre Viktoria Tolstoy (voc). Au milieu des massifs
de fleurs et avec un bon café, le récital de la Suédoise d’origine russe,
serait sans doute mieux passé. Présentant son dernier album en date, Meet Me at the Movies (ACT), elle a
donné en quartet (Krister Jonsson, g, Mattias Svensson, b, Rasmus Kihberg, dm)
sa version de chansons de cinéma, généralement éloignées de l’univers du jazz,
en dehors de «Smile» de Charlie Chaplin. Un concert pas inoubliable.
A
16h45, au Konstmuseum, le groupe David’s Angels (Sofie Norling, voc,
Maggi
Olin, p, David Carlsson, b, Michala Østergaard-Nielsen, dm) a servi une
musique éthérée avec le renfort d’Ingrid Jensen (tp) qui fut la seule
source de jazz
et d’intérêt de cette prestation. A 18h15, au cloître, le Norvégien
Bugge
Wesseltoft donna un aimable concert de piano solo, à partir de ses
compositions
rappelant l’esthétique jarrettienne. Le silence religieux qui
l’accompagnait
prêtait volontiers à la comparaison; loin du jazz spirit.
Enfin,
à 20h, au théâtre, le festival nous offrit le premier bon (et vrai) concert de
jazz avec le quintet d’Al Foster (dm, Jazz
Hot n°670): Freddie Hendrix (tp, flh), Mike DiRubbo (as), Adam Birbaum (p)
et Doug Weiss (b). Les deux soufflants ont été pour beaucoup dans le plaisir procuré
par cette prestation évoquant respectivement Dizzy Gillespie et Charlie Parker,
puisque ce nouveau projet d’Al Foster est un hommage au mythique altiste. D’un
côté le son mat d’Hendrix, pétaradant de swing (gillespien en diable sur
«Night in Tunisa»), de l’autre le lyrisme de DiRubbo (magnifique solo sur
«Lover Man»), qui prend certainement racine dans la botte italienne (c’est un
Italo-Américain de la deuxième génération). Al Foster –très en confiance avec
sa rythmique, qui le suit depuis de longues années–, toujours caché derrière
ses cymbales, reste un maître de la batterie, tout en finesse.
Le concert de
23h réunissait Al Di Meola et Peo Alfonsi pour un duo de guitares autour du
thème «Piazzolla & Lennon-McCarney» (sic). Au final, on a eu droit à une
suite de compositions dans l’esprit flamenco, agrémentées de quelques (légers)
effets électroniques. Un intermède avant
d’aller à la jam-session.
 Le 4
août, nous avons retrouvé avec joie la cour de Per Helsas Gård et Jacob Fisher,
dont le quartet –Zier Romme Larsen (p), Mathias Petri (b), Andreas Svendsen
(dm)– invitait Yosuke Sato (lequel avait eu l’honneur, la veille, de faire
retentir son saxophone en haut de l’église Sainte-Marie, tradition instituée
par le festival). Au menu, du bon bebop («I Fall in Love too Easely», «Ornithology»…)
joué avec cœur. On passera très vite sur la prestation du Danois Carsten Dahl
(p) au musée, qui relevait du bruitisme, pour arriver au
concert du soir, au théâtre (et pas n’importe quel concert, sans doute le plus
marquant de cette édition 2017: la grande Deborah Brown (voc) présentait un hommage
à Ella Fitzgerald, entourée d’une rythmique américaine (Rob Bargad, p, Essiet
Okon Esdiet, b, Newman Taylor Baker, dm), du ténor polonais Sylwester Ostrowski
et de ses compatriotes du NFM Leopoldium Strings, un orchestre à cordes de
vingt pièces (la chanteuse qui est retournée vivre à Kansas City, a conservé
des liens étroits avec l’Europe et notamment la Pologne). L’utilisation des
cordes dans le jazz a donné quelques belles réussites (Charlie Parker, Billie
Holiday, Ray Charles et évidemment Ella Fitzgerald…) mais reste un exercice
délicat. Deborah Brown débuta le concert simplement avec son trio («Lullaby of
Birdland») et le sax (qui prodigua un accompagnement discret tout au long du
concert) avant d’être rejointe par l’orchestre. D’emblée l’alchimie fut
parfaite: l’expression très enracinée de la vocaliste se trouvant mise en
valeur par les cordes. Un résultat magnifique, qui fit honneur au répertoire
d’Ella («Cry Me a River», «Summertime»…) et atteint un sommet avec «How Deep Is
the Ocean» qui propagea une émotion telle que le public suédois réserva à
Deborah Brown une longue ovation à l’issue du morceau. On n’en avait pourtant
pas fini: «Kansas City Here I Come» rappela les fondements blues de la culture
musicale de cette grande dame.
En
seconde partie de soirée, Jan Lundgren se livrait à un duo inédit avec Nils
Landgren (tb, voc). On n’a certes pas retrouvé les sommets d’intensité du
précédent concert, mais cette rencontre fut plaisante, teintée d’humour (le
tromboniste, directeur du festival Jazz Baltica, entretient une forme de
rivalité amicale avec Lundgren, directeur du festival d’Ystad). Outre
l’inévitable relecture jazzy du folklore suédois, les deux musiciens ont donné
à entendre plusieurs standards, dont un «The Nearness of You» joliment repris
par Nils Landgren, au chant, à la façon de Chet Baker.
 Le 5
août, le concert du 11h était consacré à Wayne Shorter. Le sextet de Gilbert
Holmström (ts) donna une prestation intéressante bien qu’hétéroclite, passant
du swing au free, et du free aux ballades. A 13h, à l’hôtel Ystad Saltsjöbad,
c’est une autre musicienne déjà programmée en 2015 –et pour le même projet– qui
effectuait son retour à Ystad: Nicole Johänngten (ts, ss). Il s’agissait d’une
nouvelle version de son groupe international et exclusivement féminin, Sofia
(avec la Belge Anne Niepold, acc, la Suissesse Julie Campiche, harp, la Suédoise
Charlotta Andersson, g, la Népalaise Sanskriti Shrestha, tabla, l’Allemande
Lisa Wulff, b, et la Britannique Sophie Alloway, dm): un assemblage d’identités
musicales diverses qui se retrouvent autour du jazz et souvent aussi à côté. On
peut en tous les cas saluer la performance de ce collectif qui ne s’était
rencontré que la veille et a travaillé sur les compositions de chacune. Les
plus intéressantes furent «Ystad Tree» de Nicole Johänngten et «Nœud
explicatif» d’Anne Niepold.
A
16h45, au théâtre, se produisait le Scottish National Jazz Orchestra, dirigé
par Tommy Smith et avec Eddi Reader (voc) en invitée. Le big band a proposé un
passage en revue des chansons du patrimoine écossais avec des arrangements
jazzy. Mais comme souvent en ce cas, la fusion est restée artificielle bien
qu’écoutable. A 20h, toujours au théâtre, Jan Lundgren revenait en quartet avec
Jukka Perko (as, ss), Dan Berglund (b) et Morten Lund (dm) à l’occasion de la
sortie de leur CD Potsdamer Platz(ACT). Basé sur des compositions originales du pianiste, le concert a aligné
quelques jolies ballades, en particulier «Potsdamer Platz» et «On the Banks
of the Seine».
A 23h, le duo Hiromi (p)/Edmar Castañeda a donné lieu à
un numéro de virtuosité, parfois un peu gratuit.
 Le
6
août, c’est un bon trio qui a inauguré, à 11h, cette dernière journée:
celui de Lars Danielsson (b) avec Marius Neset (ts) et Morten Lund (dm).
La musique était servie par des compositions de qualités, dont «Off to
Munich».
Bien plus séduisant fut le concert de 16h45, au théâtre, de Jerry
Bergonzi (ts), Tim Hagans (tp) et leur rythmique scandinave: Carl Winther
(p), Johnny Åman (b) et Anders Mogensen (dm). Le son de Bergonzi est toujours empreint
de poésie et de swing, tandis que Tim Hagans arbore un jeu très coloré.
Globalement, le quintet fonctionne bien. On a notamment relevé les qualités du
pianiste, fils du trompettiste Jens Winther (1960-2011) dont l’une des
compositions fut jouée. Tim Hagans en profita pour rappeler qu’il avait
travaillé avec lui et a souligné son lien particulier avec l’Europe. Une prestation
solide dont on a notamment retenu une belle version de «Laura».
Pour
les deux concerts de clôture, au théâtre, les impressions furent contrastées. A
20h, le Ann-Sofi Söderqvist Jazz Orchestra, déroula des pièces toutes de la
main du leader. Si le big band permet d’éviter l’ennui, la musique
était trop aseptisée pour être véritablement captivante. Les interventions
ponctuelles de Lena Swanberg (honnête chanteuse de comédie musicale) l’on fait
dériver vers la variété sans créer un intérêt supplémentaire.
Heureusement,
nous avons quitté Ystad avec du jazz et du vrai: le nouveau projet de
Joshua Redman (ts) en hommage à son père, le saxophoniste Dewey Redman
(1935-2011) et, à travers lui, à l’aventure du free jazz. Très bien entouré par
Ron Miles (tp), Scott Coley (b) et Brian Blade (dm), Joshua a redonné vie au
répertoire du Old and New Dreams d’Ornette Coleman (dans lequel son père a
côtoyé Don Cherry, Charlie Haden et Ed Blackwell), groupe qui fut actif de 1976
à 1987. Un héritage que le quartet a porté avec conviction et intensité,
livrant un free aussi incandescent que saisissant.
Un mot
enfin des jam sessions qui se sont tenues les 3, 4 et 5 août au restaurant
Marinan, sur le port, et toujours animées par le trio du jeune Sven Erik
Lundeqvist. C’est la soirée du 4 août qui restera dans les mémoires avec la constitution
d’une formation détonante composée de Deborah Brown, Bobby Medina et Jan
Lundgren qui ont partagé un plaisir du jazz communicatif. Tandis que la nuit
du 5 août fut essentiellement animée par Nicole Johänngten et les membres de
son collectif.
Texte: Jérôme Partage
Photos: Philippe Dugast by courtesy, Markus Fägersten by courtesy, Jérôme Partage
© Jazz Hot n° 681, automne 2017
|
Marciac, Gers
Jazz in Marciac, 28 juillet-15 août 2017
Le Festival de Marciac fêtait cette année son 40e anniversaire, et dans un programme toujours plus copieux qui en fait la
plus grande manifestation française, l'une des plus grandes du monde en
matière de jazz, on a isolé un temps exceptionnel, celui du concert
donné par Cécile McLorin Salvant entourée du Quintet du parrain du
festival, présent depuis 26 ans, Wynton Marsalis (tp), avec Walter
Blanding (ts, cl), Dan Nimmer (p), Carlos Henriquez (b) et Ali Jackson
(dm).
Ce moment a été exceptionnel parce que pour l'occasion
Wynton Marsalis a écrit un fort beau texte pour célébrer cet
anniversaire et ce festival, mais plus largement pour célébrer le rôle
de la France, de son peuple, dans la reconnaissance du jazz en tant
qu'Art et expression originale du peuple Afro-Américain. Wynton Marsalis
a plus particulièrement mis l'accent, ce qui nous a énormément touchés,
sur le rôle de notre revue, Jazz Hot, de ses fondateurs, Charles Delaunay et Hugues Panassié et sur l'équipe qui en prolonge aujourd'hui l'histoire ("This publication, started in 1935, is still going strong”).
Wynton
Marsalis a mis en valeur le rôle essentiel de Charles Delaunay en
évoquant en particulier le Quintette du Hot Club de France, le premier
label de jazz –Swing–, la discographie de Charles Delaunay et les
Festivals du jazz (Paris, les Salons du jazz) d'après la Seconde Guerre, rejoignant ainsi le thème de l'exposition des 80 ans de Jazz Hot, fêtés il y a peu en 2015 à la Fond'Action Boris Vian, qui réévaluait l'apport de Charles Delaunay et bien sûr de Jazz Hot.
Il
a aussi bien entendu évoqué sa longue amitié avec le Festival Jazz in
Marciac, ceux qui en furent à l'origine et qui l'ont développé, Bill
Coleman et Jean-Louis Guilhaumon. Et si Wynton Marsalis versa une larme à
la fin de ce moment, c'est que le contenu de son texte, qu'il avait
demandé de traduire et de lire à Cécile McLorin Salvant, parfaitement
bilingue, avait une portée non seulement historique mais sans doute
aussi très actuelle dans une Amérique du XXIe siècle où les traces de l’œuvre de Martin Luther King pour l'accession à l'égalité s'effacent dangereusement.
Dans
le droit fil de son texte, d'une soirée d'anniversaire émouvante, le
concert qui a réuni une Diva du jazz comme on n’en espérait plus,
franco-américaine, et le virtuose Néo-Orléanais, a été un monument
musical, non seulement par la qualité de l'expression jazzique, le jeu
si intense de la formation de Wynton, la voix exceptionnelle de Cécile,
mais encore par la dimension pédagogique et illustrative d'un concert
d'une construction aussi savante qu'adaptée au discours d'anniversaire
et à l'histoire que Wynton Marsalis venait de raconter par la voix de Cécile McLorin Salvant.
Wynton
Marsalis et Cécile McLorin Salvant nous ont habitués à une intelligence
hors normes dans la construction de leurs concerts, ce qui en fait
toujours un moment privilégié. Ils ont atteint cette fois encore une
dimension dont les amateurs de jazz ne peuvent que rêver, car
l'imagination, la culture comme le talent et l'expression de ces
musiciens sont stratosphériques. Les présents ont eu raison comme on a
coutume de le dire.
Je n'étais pas à Marciac, je le regrette, mais par la magie de YouTube,
ce concert est disponible en intégralité, et nous l'avons relayé en
ouverture de ce compte rendu (il vous suffit de cliquer sur l'image
ci-dessous), car il peut se passer de tout commentaire par sa cohérence,
la qualité de sa construction comme par le talent des artistes, y
compris Dan Nimmer, Walter Blanding, Carlos Henriquez et Ali Jackson.
C'est un magnifique voyage dans le XXe siècle,
l'histoire de la musique et du jazz, une musique véritablement incarnée:
la France, les Caraïbes, la Nouvelle-Orléans, avec pour ce faire la
participation d'un Néo-Orléanais de naissance, de cœur, et d'une Cécile
McLorin Salvant, toujours essentielle, et idéalement placée pour ce
cheminement transatlantique par sa mémoire familiale et son vécu qui
mêlent les Etats-Unis, la France et les Caraïbes.
Un beau moment de culture universelle, de jazz, de générosité. Un grand moment de pédagogie.
Car ce qui a réuni Paris, la France de l'entre-deux-guerres et le jazz hot, c'est-à-dire l'expression inventée et libérée par les Afro-Américains, c'est un socle de valeurs humaines, acquises ou recherchées;
les Sidney Bechet, Louis Armstrong, Duke Ellington, Coleman Hawkins,
Benny Carter, etc., vinrent en France dans les années 1930 pour faire
reconnaître leur art, collectivement, bien au-delà de leur seul talent;
puis après guerre, les Don Byas, Bud Powell, Dexter Gordon, Dizzy
Gillespie, Charlie Parker, Thelonious Monk, et les centaines d'autres
sont venus de leur jazz illuminer nos nuits, nos festivals; cette
reconnaissance qu'ils trouvèrent chez Charles Delaunay, en même temps
qu'un soutien et des outils pour l'indépendance de leur art, repose sur
ce concept d'égalité universelle qui fait la grandeur de la France, même
si elle l'a oublié en 2017. Ce même concept d'égalité s'est transposé
dans la lutte des Droits civils aux Etats-Unis, il n'y a qu'à écouter
les discours de Martin Luther King (cf. l'éditorial de ce mois). Le
jazz, ce n'est pas qu'une musique, c'est un art au cœur d'un peuple, un
art de vivre, une manière de penser le monde, une philosophie, une
civilisation, même si les musiciens n'en sont pas tous et tout le temps
conscients car l’art, cet art, n'est pas la propriété des seuls
musiciens, même si les amateurs de jazz l'ont oublié dans ce XXIe siècle où la mémoire humaine fait place à la mémoire machine.
C'est
tout ce qui rend cette soirée anniversaire de Marciac exceptionnelle. C'est pourquoi, nous tenions à en conserver une trace
musicale au-delà de l'habituel compte rendu, dans un compte rendu off shore en
quelque sorte, et à souligner cette soirée: 1h 58’ de bonheur! Merci à
Marciac, à Wynton Marsalis et ses compagnons, à Cécile McLorin Salvant.
Nous avons tenu également à transcrire ce qui a été dit ce jour d'anniversaire, un verbatim pour
mémoire, et à donner la version originale en anglais, plus complète, du
texte écrit de Wynton Marsalis (textes transcrits après la vidéo).
Yves Sportis

Jazz in Marciac, Happy 40th Anniversary
Texte de Wynton Marsalis, traduit, adapté et récité par Cécile McLorin Salvant
En
tant qu’originaire de la Nouvelle-Orléans, je suis un non francophone
d’origine française. En tant que trompettiste, je suis un disciple de
Jean-Baptiste Arban et je m’honore d’être l’un des nombreux descendants
du grand virtuose Maurice André.
En tant que musicien de jazz, je
rends hommage à la marque profonde et durable que la France donne à
l’identité du jazz. Les Français ont accueilli à bras ouvert la musique
de l’Afro-Américain James Reese Europe et son orchestre, les "Hell
Fighters", pendant la Première guerre mondiale, et la musique de Sidney
Bechet.
Hugues Panassié et Charles Delaunay ont créé le Hot Club de
France pour valoriser le jazz en France. Le Quintette du Hot Club de
France avec Stéphane Grappelli et Django Reinhardt a démontré, par sa
virtuosité et son swing, que le jazz était un langage musical
international. Charles Delaunay, auteur de la première discographie du
jazz, et Hugues Panassié ont fondé Jazz Hot en 1935.
Swing Records,
le premier label de jazz du monde est né en France. Après la Seconde
guerre mondiale, le Festival International de Jazz de Paris a accueilli
différentes générations de musiciens et a élevé le jazz au rang d’art.
Au cours du XXe siècle, les compositeurs classiques français ont rejeté le snobisme et
les préjugés qui étaient de mise envers le jazz et ont montré leur
respect. Maurice Ravel avait un grand respect pour Ellington. Darius
Milhaud a contribué à faire de Dave Brubeck le grand musicien,
compositeur, ambassadeur et champion des Droits de l’Homme qu’il est
devenu.
Pendant la période des Droits Civiques américains, tout
musicien de jazz sérieux a noué des liens avec la culture et le public
français. Un grand nombre d’albums ont été enregistré ici : Dizzy on the
French Riviera en 1962, Miles in Antibes en 1963, les enregistrements
live de Duke Ellington et d’Ella Fitzgerald à Juan-les-Pins en 1967. Les
musiciens de jazz savaient que la France appréciait notre musique et
nous a accordé certaines libertés qui nous étaient refusées dans notre
pays, à cette époque.
L’histoire du festival de Marciac, qui a
commencé en 1977, fait également partie de cette histoire. Né il y a
quarante ans avec Bill Coleman et Jean-Louis Guilhaumon dans le magasin
de meubles de Marcel Labarrière, c’était l’occasion de se rassembler
pour partager ce qu’ils avaient en commun.
J’ai eu la chance de
jouer ici pendant vingt-six ans. Dès ma première année, j’ai senti une
familiarité particulière avec cet endroit. Ici, nous avons joué avec des
maîtres de la Nouvelle-Orléans, un big band de jeunes musiciens
français, des orchestres symphoniques, des musiciens brésiliens,
pakistanais, irakiens, Pierre Boussaget, Hervé Sellin, Guy Lafitte, mon
septet, le Jazz at Lincoln Center Orchestra et les musiciens
fantastiques qui sont ici avec moi. Ici, nous avons vu le chapiteau
passer du silence total à la ferveur d’une église. Nous avons joué ici
jusqu’à point d’heure, sur la place, dans des restaurants, dans des
clubs, des maisons, des vignobles. Nous avons joué dans la rue et pour
des événements officiels. Il y a deux jours, j’ai joué avec un de nos
élèves, Emile Parisien, qu’on connaît depuis vingt ans.
Pour moi,
tout ici a été glorieux. Tout le monde connaît le charme de cette
région : l’armagnac, le tournesol, la lune, les route sinueuses,
l’architecture, le cassoulet, le foie gras, le vin de Saint-Mont, mais
surtout les gens d’ici.
Il y a vingt ans, j’ai écrit une suite
dédiée à ce festival. Mes sentiments étaient très profonds à ce moment ;
le temps qui passe ne fait que confirmer cela. Il est difficile d’être
intègre et encore plus de le rester. Nous avons créé ici quelque chose
de très spécial pendant quarante ans. Parce qu’il est beaucoup plus
facile de laisser tomber quelque chose que de le ramasser, nous devons
fêter chaque anniversaire en réaffirmant l’intégrité que ce festival
représente. Merci.
Wynton Marsalis
(adaptation : Cécile McLorin-Slavant & Family)
Jazz in Marciac, Happy 40th Anniversary
Texte de Wynton Marsalis paru sur son blog
As
a New Orleanian, I am a non-French speaking extended family member of
France. As a trumpeter, I began studying from the book of Frenchman Jean
Baptiste Arban at 6 years old, and still today, strive to play his
exercises correctly. I am also honored to be one of the many descendants
of the great virtuoso Maurice André whose sparkling playing inspired a
world of trumpet players to pursue excellence.
As a jazz musician, I
am profoundly grateful for the deep and lasting imprint of French
culture and scholarship on the identity of our music. During Word War 1,
the French embraced the music of Afro-American musician James Reese
Europe, and members of the 369th Infantry "Hellfighters” band from
Harlem. This fascination and acceptance of ragtime, the blues, and jazz
continued after the war and would eventually culminate in the elevation
of New Orleanian jazzman Sidney Bechet to the status of French cultural
hero.
Hugh Panassie’, Charles Delaunay and a few other students
created the "Hot Clubs of France” which established and promoted the
value of jazz all over this country. The Quintet of the Hot Club of
France, featured geniuses Stéphane Grappelli and Django Reinhardt, whose
virtuosity and deep swing demonstrated that jazz was an international
musical language. Charles Delaunay, authored the first jazz discography,
and along with Mr. Panassie founded Jazz Hot Magazine. This
publication, started in 1935, is still going strong.
The very first
Jazz Record Company in the world, Swing Records was established in
France and, after the Second World War, the International Festival of
Jazz in Paris welcomed the styles of different generations of musicians
showcasing jazz as serious art with a meaningful tradition. This was
meaningful because jazz was still struggling with the perception that it
was a popular fad requiring new tricks like a circus act.
Throughout
the 20th century, French classical composers rejected the snobbery and
prejudice that was commonplace at that time to express an affinity and
deep respect for jazz. The great Maurice Ravel immediately comes to mind
with his respect for Ellington, as does Darius Milhaud, who was the
greatest influence in the life and work of Dave Brubeck. Milhaud was
instrumental in helping shape the young Brubeck into the great musician,
composer, ambassador, and champion of human rights that he became.
As
we moved into the 1960’s, the American Civil Rights Era, every serious
jazz musician pursued a meaningful relationship with French culture and
audiences. Many many great albums were made here, from "Dizzy on the
French Riviera” in 1962, to "Miles in Antibes” in 1963, to Duke
Ellington and Ella Fitzgerald’s live recordings in Juan-les-Pins in
1967. Jazzmen and women knew that France appreciated and embraced our
music, and she also afforded some of the freedoms denied us in our own
country at that time.
The story of Marciac which began in 1977, is
also part of this continuum. Born 40 years ago with American trumpeter
Bill Coleman and Jean Louis Guilhaumon and in the furniture shop of
Marcel Labarriere, it was a way for people to get together and express
their communality and their commonality.
I have been blessed to play
here for 26 of those years. From my first year, I always felt an
uncommon integrity in this place. Here, we have played with New Orleans
masters, a big band of young French Musicians, young musicians from New
York, symphonic orchestras, with musicians from Brazil, Pakistan and
Iraq, with Pierre Boussaget, Hervé Sellin, the legendary Guy Lafitte,
the great tap dancer Jared Grimes and with my soulful septet, the Jazz
at Lincoln Center Orchestra and the fantastic musicians up here tonight.
Here, we have seen the Chapiteau absolutely silent in mass
concentration and have also heard it rock with the intensity of an old
time church revival. We have played until all hours of the morning to
rapturous applause and stomping and cheering, played in the square while
families socialized and shopped, in restaurants, clubs, homes and
vineyards. Here, we have played parades down the street at official
functions and at parties. Two nights ago, I played with one of our
students who attended the college in the 90’s, Emile Parisien. It was a
profound experience that took 20 years to enjoy.
For me, it has all
been glorious and fortunate. Everyone knows about the romance of this
region: the Armangac, the sunflowers, the bright night moon, the winding
roads lined with stoic trees and the rustic architecture. Yes,
cassoulet, foie gras and Saint Mont wine is wonderful, but the soul of
everything is always the people. It is something very powerful and at
the same time very delicate. It must be nurtured at all times because
this spirit is all that we can truly pass on to the future. Materials
decay but the spirit prevails.
20 years ago I wrote a suite dedicated
to the festival and this spirit. My feeling was very strong at that
time. The passage of years have only deepened that feeling. Integrity is
hard to come by, it’s even harder to maintain. We have created
something very special here for 40 years. Because it’s a lot easier to
let something fall than to pick it up, we must celebrate each
anniversary by reaffirming the integrity that this festival represented
at birth. Thank you for your kindness through all these years and thank
you.
Wynton Marsalis
© Jazz Hot n° 681, automne 2017
|

Gandia, Espagne
Festival Polisònic, 28 juillet-19 août 2017
C’est toujours un
plaisir d’assister à un concert dans les jardins arborés de la Casa de Cultura
de Gandía. Le Polisònic s’y installe en plein été faisant
profiter le public d’une fraîcheur plutôt recherchée et pour des tarifs plus
que modérés (6 euros). 28e édition d’un programme qui, s’il fait
toujours appel à du jazz, englobe aussi divers genres avec des formations ou
des musiciens qui sont souvent une découverte pour les festivaliers. Parmi les
neuf soirées nous avons fait des choix.
Le 5 août, les festivaliers ont pu écouter Jorge Pardo déclinant son projet «Djinn».
Ce projet correspond bien à la personnalité de Pardo qui, bien que lauréat il y
a quelques temps du Prix du Jazz, navigue au gré de sa fantaisie, toujours à
partir des racines du flamenco. Même pour ceux qui ont écouté son précédent
disque Historias de Radha y Krishna (Jazz Hot n°676), Djinn, qui peut -être
considéré comme un développement de celui-ci-, est assez déroutant. Jorge Pardo
(ts, fl), bien qu’entouré de quatre partenaires (clavier, basse, guitare
flamenca, cajón et percussions)
s’appuie sur l’ordinateur tout au long de thèmes très complexes à décrypter car
les différents genres du flamenco s’imbriquent les uns dans les autres, soléas, tanguillos, bulerias… Et tout
cela contient aussi des références au phrasé du jazz, au blues, à de très
vieilles réminiscences flamencas. Pardo s’aventure dans le monde des DJ’s, du
langage hip-hop, additionnant ces sons que l’on entend dans les lieux nocturnes
du monde entier à son flamenco pour créer selon lui une «musique urbaine
contemporaine». Le talent de Pardo est toujours incontestable mais parfois le
son enregistré semble interminable et on apprécierait de pouvoir profiter davantage
des musiciens en chair et en os. Il arrive aussi qu’il faille même s’aider des
yeux pour différencier ce qui émerge des instruments de ce qui sort de
l’ordinateur! Mais globalement le projet est plaisant et la soirée fut un
régal.
Le 14 août, la chanteuse Mariola Membrives commémorait levingtième anniversaire de la sortie de Omega, le disque historique de Enrique
Morente, une petite révolution dans le flamenco qui s’acoquine dès cette époque
avec d’autres rythmes. Membrives n’a pas un jeu de scène convaincant mais elle
est là pour chanter! Et la voix sort des tripes pour une réinterprétation très
personnelle des thèmes originaux, issus entre-autres de textes du Poète à New York de Federico García Lorca et de compositions de Leonard Cohen –partie
prenante du disque de Morente– telle que «Manhattan». La prestation sur
«Aleluya», toujours de Cohen, est magnifique, dramatique: un qualificatif permanent
de l’ensemble d’un concert d’une grande dureté. Nous avons aussi trouvé un
grand intérêt à l’écoute de l’accompagnement choisi par Mariola et offert par
d’excellents jazzmen qui enrichissent davantage encore le concert. Jazz, flamenco,
les thèmes oscillent de l’un à l’autre. David Pastor et sa trompette ravissent
les jazzophiles et Oliver Haldón, guitare flamenca, enchante les amateurs de
flamenco. Le contrebassiste Masa Kamaguchi s’illustre dans un duo avec Mariola
Membrives sur une valse lorquienne, tandis que le batteur peut briller tant
avec son cajón que pour des soli de jazz à la batterie.
 Quatre jours plus tard on retrouvait David Pastor, un
habitué du Polisònic, à la tête de son trio Nu
Roots. Le trompettiste présente son dernier travail, Motion. Une
nouvelle fois nous regrettons l’utilisation
d’ordinateurs qui à notre sens n’apportent rien ni au jazz ni à
l’excellente
prestation de Pastor, mais l’heure est à la fusion, au gadget pour se
démarquer jusqu’à ce que trop de monde l’adopte. Cela dit, David est un
excellent trompettiste,
avec des airs d'Arturo Sandoval lorsqu’il s’envole dans les aigus. On
assiste
à de superbes improvisations et de beaux dialogues avec le très
énergique
batteur Pere Foved. Au clavier, José Luis
Guart est autant acteur que pianiste mais domine son travail. Le trio est
parfaitement rodé. Coltrane est à l’honneur dans «Coltrane Roots». On écoute
aussi «Salvat Street», un thème du pianiste: «Dr Guart». Pastor
manipule totalement «Water Melon Man» pour en faire l’ironique «The Orange
Buyer». Autre belle manipulation, «Suite Bar Roca», d’un thème de musique baroque.
Le batteur propose un travail original et agréable à l’oreille en grattant sa
caisse claire avec les ongles pour une version également truquée de «Green en
Blue». Une nouvelle fois, le Polisònic a montré
que, bien que n’étant pas un festival de jazz, la part que ce dernier occupe
est de qualité. Un exemple à suivre pour les festivals existant dans un
environnement proche: Javea, Dénia…
Patrick Dalmace
texte et photos
© Jazz Hot n° 681, automne 2017
|
 Fano, Italie Fano, Italie
Fano by the Sea, 27-29 juillet 2017
Parvenue à sa 25e année, la manifestation dirigée par Adriano Pedini a été
consolidée grâce à une répartition thématique précise et l’acquisition d’un
espace prestigieux: l’imposante Rocca Malatestiana. C’est là que s’est
déroulée la majeure partie des concerts, que ce soit ceux en ouverture de
soirée avec les acteurs et les musiciens de renom, ou ceux qui suivaient, sous
l’appellation Young Stage, réservé
aux musiciens émergents.
En outre, dans
le décor évocateur de la Pinacoteca di San Domenico se sont tenus des concerts dans
le cadre du cycle Echi della migrazione
(Echos de la migration), créé l’an
dernier pour fournir des points de réflexion sur le drame des exodes de masse.
Les trois dernières journées ont offert une grande variété de
propositions et de contenus.
 Piano alla Rocca. Les concerts du soir étaient axés sur
les divers aspects du piano d’aujourd’hui. Tigran Hamasyan semble nettement
orienté vers le dépassement des barrières stylistiques, mais en même temps sa
poétique semble cacher quelque problème d’identité. Quand le pianiste met sa
formidable technique au service de structures qui mêlent son background arménien
avec l’empreinte jazz, à travers la modalité et l’improvisation, il exploite au
mieux son toucher net, sa capacité de synthèse et le contrôle des dynamiques. A
la fin, des longueurs évidentes émergent, ainsi que d’exténuantes séquences de
vocalises en des clés pseudo-ethniques, accompagnées ou suivies par un jeu de
piano tantôt minimaliste, tantôt classifiant, dans le sillage du Keith Jarrett
le plus dissocié.
L’évolution
artistique de Giovanni Guidi se reflète aussi bien dans l’approche de
l’instrument que dans la vision du compositeur. En piano solo se condensent la
valeur mélodique, les progressions harmoniques tonales et un souffle choral qui
peut rappeler Chris McGregor et Dollar Brand. Ces équilibres sont d’ailleurs brisés
à dessein par des configurations sombres, dans le registre grave, et des
montées et descentes sur le clavier qui rappellent la poétique de Cecil Taylor.
Guidi exprime
d’ailleurs au mieux ce potentiel avec le quartet Ida Lupino (du titre du CD
éponyme pour ECM) dans lequel il est accompagné par Gianluca Petrella (tb),
Louis Sclavis (bcl) et João Lobo (dm). Non seulement le quartet base sa propre
force sur les remarquables individualités mais aussi sur les ensembles mesurés
et sur les combinaisons de timbres équilibrées et sur des collectifs puissants,
et aussi quand il empiète sur des terrains informels. Lobo peut se promener
avec désinvolture dans des jeux raffinés de nuances timbriques jusqu’à des up
tempos fluides, des figures désarticulées vers de solides images. L’interaction
entre Petrella et Sclavis se révèle déterminante pour les contrastes timbriques,
la compétence dans les contrepoints (par exemple dans «Ida Lupino»
de Carla Bley), et la maîtrise des registres et des dynamiques dans les
crescendos et les fortissimos.
Chano
Dominguez est partisan d’une synthèse entre le jazz, le flamenco et d’autres
cultures latines. Toutefois, sa prestation à Fano a mis nettement au second
plan la composante latine en faveur de l’afro-américaine, par des installations
modales et des arrangements efficaces de pages historiques. Ce n’est pas par
hasard que Dominguez a puisé à pleines mains dans le Kind of Blue de Miles Davis. D’abord en appliquant une figure dans
le registre grave, doublée par la contrebasse de Martin Leiton, aux cellules de
«Freddie Freeloader». Puis en fragmentant le thème de «Blue
in Green» et en insérant des ornementations. Pour finir, en diminuant la
structure de «All Blues» en un cadre rythmique soul jazz avec des
nuances funky, grâce à la contribution de David Xigu (dm). Que Dominguez soit
un habile réinventeur son interprétation d’«Evidence» de
Thelonious Monk, pourvue de couleurs mélodiques inédites, le démontre.
 De jeunes talents s’affirment. Depuis quelques années Young Stage a pour objectif de mettre en
lumière de nouveaux talents, avec une attention particulière aux Italiens. Le
tromboniste Filippo Vignato qui s’est rapidement affirmé sur la scène
nationale, fait preuve d’un style à maturité quant à l’articulation du phrasé,
la puissance sonore et le spectre dynamique, permettant de justifier l’affiliation
avec Julian Priester, Roswell Rudd et Albert Mangelsdorff. Dans son trio, une
formation paritaire à part entière, figurent le pianiste français Yannick
Lestra –qui traite le Fender Rhodes dans le sillage de Zawinul et de Hancock–
et le batteur hongrois Attila Gyárfás, qui dans le flux rythmique continuel
introduit des couleurs, des décompositions et des fractures. Le niveau élevé d’interplay favorise de longues séquences
avec des sections sur tempo libre dans lesquelles apparaît l’esprit d’Ornette
mais aussi, et surtout, en plus, des allusions au tournant électrique du Davis
de Bitches Brew.
Le Trio
Pericopes insère des éléments post-rock dans une installation
rythmico-harmonique qui –toutes proportions gardées– se place dans une aire proche
de celle fréquentée par des formations Bad plus, E.S.T. ou Tingvali Trio, comme
du reste le montre l’approche du batteur Nick Wight. L’improvisation qui en
découle est confiée à l’approche d’Alessandro Sgobbio (p) et surtout aux
progressions cinglantes –avec des excursions souveraines– d’Emiliano Vernizzi
(tq), avec souvent de petits noyaux
thématiques ou de simples cellules mélodiques.
L’hybridation
stylistique caractérise le quintet guidé par la pianiste Maria Chiara Argirò,
résidant à Londres depuis quelques années. Les ensembles provenant d’itérations
(de figures mélodiques ou de noyaux rythmiques) de saveur vaguement
minimaliste, l’emportent. De lents et obsessifs crescendos alternent avec
d’opportuns changements métriques. Totalement dirigé vers la finalité
expressive, le quintette comprend Tal Janes (g), Alex Hitchcock (ts), Andrea Di
Biase (b) et Gaspar Sena (dm).
 Musique migrante. La Pinacoteca di San Domenico est une église déconsacrée du centre
historique. Echi della migrazione (Echos
de la migration) propose la confrontation du musicien seul –comparable à
un long voyage à la recherche d’un objectif avec les espaces et les volumes
architecturaux, avec le silence, avec son propre instrument et, en définitive,
avec soi même.
Paolo Angeli
est un spécialiste de la guitare sarde préparée, instrument composé d’une
grande caisse harmonique et de 18 cordes. En plus des 6 conventionnelles, 8
sont fixées sur un cordier transversal. Les 4 autres sont des cordes de
violoncelle (jouées en fait avec l’archet) soutenues par un pont posé au fond
de la caisse harmonique. Un embout similaire à celui d’une contrebasse est
place sur l’instrument. Angeli utilise deux pédaliers: un, installé sur
la droite, lui permet d’actionner des petits marteaux qui activent les
basses; l’autre, à gauche, pour exécuter la partie mélodique doublant le
son acoustique et l’électrifié. Enfin, Angeli peut modifier le son et créer des
bourdons à l’aide d’hélices insérée sur le bord de la caisse. Le spectre des
sources et des inspirations est très large: depuis une expérimentation
qui se rapproche de celle de Fred Frith, Elliot Sharp et David Torn il a développé
une pureté timbrique absolue, digne de Ralph Towner; depuis la tradition
vocale de la Sardaigne jusqu’à la musique arabe de l’Afrique du Nord. Une
synthèse accomplie et une approche totalement ouverte à l’improvisation.
Le
trompettiste Giovanni Falzone a présenté son travail le plus récent, Migrante. Falzone réalise une mosaïque
sonore basée sur la stratification d’échantillonnages (effectués en temps réel)
de petites percussions, de petits objets, de clochettes, de flûte à bec et de
voix. Avec la trompette il y superpose graduellement des cellules dilatées par
le delay, des extraits de mélodies, des phrases aux amples courbes, et des
emballements soudains avec un traitement méticuleux, quasi maniaque, du son. Le
plus important est qu’il évite le risque de tomber dans le pseudo ethnique
d’une certaine World Music.
Batteur
prédisposé à la décomposition, à la désarticulation et à la recherche de
timbres et de Couleurs, Roberto Dani s’est présenté en tant que percussionniste
dans une prestation qui privilégiait autant le rapport à l’espace, aux
réverbérations et au silence, qu’à la gestuelle. Dani opère par une lente accumulation
de cellules conçues comme une véritable unité timbrique, alternant des phases
statiques, suspendues à des explosions sonores improvisées. D’un côté il évoque
des maîtres comme Pierre Favre et Paul Lytton; de l’autre des procédés de
marque contemporaine qu’on retrouve dans les œuvres de Iannis Xenakis. Se
plaçant au centre de la scène, entouré par le public, et se déplaçant vers différents angles, Dani
modifie –et dans certains cas, inverse– le rapport entre exécutant et auditeur. Dans une certaine mesure, Fano Jazz by the Sea s’efforce de modifier les
critères d’utilisation de la musique à travers cette démarche. On espère que
c’est ce qu’il continuera à faire dans le proche avenir.
Enzo Boddi
Traduction-Adaptation Serge Baudot
Photos Michele
Alberto Sereni, by courtesy of Fano Jazz by the Sea
© Jazz Hot n° 681, automne 2017
|
San Sebastiàn, Espagne
San Sebastiàn Jazzaldia, 21-25 juillet 2017
Une centaine de concerts,
dix-sept scènes, plus de 150 000 spectateurs… Le bilan numérique du 52e San Sebastiàn Jazzaldia est pour le moins flatteur. Le contenu n’est pas non
plus en reste avec des têtes d’affiche comme Wayne Shorter, Herbie Hancock, Hiromi
& Edmar Castañeda, Saxophone Summit, Houston Person, Abdullah Ibrahim,
Uri Caine, Gregory Porter ou encore Charles Lloyd. Par ailleurs, face à l’éparpillement
du festival en divers lieux, nous rendons compte de cette édition 2017 par
scène.

Jazz Band Ball
21 juillet. Ray Gelato (ts, voc) et son groupe The Enforcers (Gunther Kurmayr, p, Ivan
Kovacevic, b, Martí Elías, dm) ont attiré un public nombreux avec leur jazz
plein de swing, dans la tradition des grands showmen des années quarante et cinquante. Aux morceaux popularisés par
Louis Prima et Louis Armstrong, s’est ajouté une amusante version de «Tu Vuo Fá
l'Americano» de Renato Carosone.
Le concert du vétéran Houston Person (ts, 83
ans), entouré de Dena DeRose (p, voc), Ignasi Gonzalez (b) et de Jo Krause (dm)
a été une véritable leçon de jazz. La première partie était centrée sur le
ténor et sur son répertoire, alors que la deuxième l’était sur la pianiste qui
a aligné standards («Sunny») et autres titres populaires («Imagine»).
Uri Caine
(p, ep) était lui en trio avec Mark Helias (b) et Clarence Penn (dm), pratiquant
un style diablement rythmique et ouvert, où se mêlent jazz, classique, pop,
rock de façon débridée.
Mais la surprise de la soirée a été Kevin Mahogany
(voc), soutenu par Hervé Sellin (p), Pierrick Pedron
(as), Bruno Rousselet (b) et Philippe Soirat (dm), dont l’humour, la voix de
baryton et les talents de scatteur ont fait mouche. Le chanteur s’est promené
au gré de ses amours musicales : «Caravan», «Route 66», «The Girl From Ipanema»…
Terrasse Heineken
23 juillet. Ernie Watts (ts), accompagné de
Christof Saenger (p), Rudi Engel (b) et Heinrich Koebberling (dm), a offert un concert de jazz
sérieux et vigoureux, où il a témoigné de sa maîtrise du meilleur hard bop. Au
cours d’une heure et demi, Watts a présenté des morceaux de son dernier album Wheel of Time, comme l'élégant «Letter From Home». Il a navigué par des terrains aériens avec «Song spirituel», qu’il
a commencé et a fini à la flûte. Et, bien sûr, il a eu le temps de se rappeler
de son ami Charlie Haden avec la belle ballade «Real of Time».
25 juillet. Comme il y a deux ans, le trio du pianiste Didier Datcharry (Jean-Xavier Herman, b, et Marie-Hélène
Gastinel, dm) a passé en revue de grandes compositions signées d’Oscar
Peterson, Erroll Garner, Phineas Newborn Jr., Ahmad Jamal ou encore Monty
Alexander.
Kursaal
21 juillet. La musique de Wayne Shorter (ts, ss) est avant tout une œuvre
collective où ses musiciens ont un rôle décisif. Auprès de lui, Danilo Pérez
(p), John Patitucci (b) et Brian Blade (dm) génèrent une énergie irrépressible
qui se nourrit de l'interaction étonnante et du dialogue entre les quatre
musiciens. Avec Danilo Pérez, qui propose de nouveaux rythmes et variations,
Blade, tout en précision, et Patitucci, qui constitue la base de cet
assemblage, Shorter se sent libre pour jouer avec ses deux saxophones et de démontrer son talent
inépuisable. Le répertoire comptait des morceaux bien structurés Lost»,«Zero Gravity»,« Adventures
Aboard the Golden Mean»), pleins de tournures
surprenantes et soumis aux modulations élastiques de chacun des interprètes, qui
entraient et sortaient du flux musical avec une liberté totale, mais toujours en harmonie.

22 juillet. Le duo entre la Japonaise Hiromi Uehara (p)
et le Colombien Edmar Castañeda (harp) faisait craindre un excès de virtuosité
qui a été heureusement écarté par leur bonne entente. La musique
était certes grandiloquente mais, s’agissant de musiciens si dépendants de leur
capacités techniques, un certain contrôle de leur part a permis de donner un
concert agréable plutôt qu’une interminable suite d’explosions musicales un peu
vaines. Pour autant, la version de «Spain», à
la façon de Chick Corea, livrée en rappel, ne nous a pas évité les clichés.
23 juillet. Le concert de Robert Glasper (ep) a connu quelques soucis
techniques. Dès le premier morceau –«Tell Me a Bedtime Story», que Herbie
Hancock avait enregistré dans son Fat
Albert Rotunda il y a presque cinquante ans– le pianiste a eu des soucis
avec ses claviers. Pendant que les techniciens essayaient de régler le
problème, Casey Benjamin, avec son vocoder et son clavier Roland pendu autour
du cou, a sauvé la situation. Après cela, son long solo au saxophone soprano,
enveloppé par le jeu rythmique de Glasper, la basse de Burniss Travis II et la
batterie Justin Tyson, a confirmé le caractère d'un groupe qui cherche à aller
bien au-delà du jazz. Apparemment un peu trop au goût du public qui a en partie
déserté la salle. Depuis ses débuts, Robert Glasper caresse l’ambitieux projet
de réunir jazz et hip-hop, avec des fortunes diverses. Quand le groupe prend de
l'intensité, en particulier grâce aux solos de Casey Benjamin et du guitariste
Mike Severson, la formule fonctionne. Précédé
par «Roxanne» du groupe Police, l’intervention de Casey Benjamin sur «Day to Day» a révélé une dimension plus sophistiquée du
projet, qui a débouché sur «Gonna Be Alright» en rappel.
24 juillet. Herbie Hancock est revenu à Jazzaldia en faisant l’objet d’une
double attente : d’une part, l’envie de voir une nouvelle fois cette
figure mythique du jazz, de l’autre, découvrir les nouvelles tendances qu’il
dessine. Dans le second cas, la principale attraction de ce concert fut Terrace
Martin, un des saxophonistes actuels les plus en vue, par ailleurs producteur
(notamment du dernier album de Herbie Hancock). Pour autant, peu d’espace fut
réservé à ses solos, et il se concentra essentiellement sur les claviers et levocoder. Son dialogue avec Herbie n’en fut pas moins fluide. A la tête d’une
formation qui comprenait également Lionel Loueke (g), James Genius (b) et Vinnie Colaiutta (dm), le pianiste a présenté un répertoire dominé
par l'électronique et des effets qui ont modifié la texture de chaque
instrument. Il y eut des moments assez brillants –en particulier une version risquée du populaire «Cantaloupe Island»-, mais d'autres («Come
Running») où le groupe semblait déséquilibré, avec une batterie trop forte et des
effets prenant trop d’ampleur. Une performance qu'Herbie Hancock a conclue avec
son Roland pendu autour du cou pour jouer «Chameleon». Un départ funk-rock.

Théâtre Victoria Eugenia
22 juillet. Les pianistes Chano Domínguez et Stefano Bollani, lors
d'une rencontre à quatre mains, ont entremêlé leurs styles dans une expérience
inédite. Ils ont commencé par un morceau de Chano Domínguez («Míster CP»), puis de Stefano Bollani («Relaxing with
Hamilton») pour enchaîner avec «Luisa» de Jobim. Beaucoup de complicité dans
ces échanges autour des musiques de la Méditerranée, du Brésil, des airs flamencos
mélangés à des chansons napolitaines et au swing; deux fortes personnalités
parfaitement accordées et tout en maîtrise.
Musée San Telmo
La petite scène du Musée San Telmo a accueilli quatre concerts matinaux
dédiés à quatre figures historiques du jazz dont on célébrait l’anniversaire: Ella Fitzgerald, Thelonious Monk, Dizzy Gillespie et John
Coltrane. Les musiciens qui ont participé à ces hommages sont des enseignants
du Centre Supérieur de Musique du Pays Basque, Musikene, qui fêtait ses 15 ans.
21 juillet. C’est Deborah Carter (voc) qui a inauguré la sérié –accompagnée
d’Iñaki Askunze (ts), Javier Juanco (g), Gonzalo Tejada (b) et Jo Krause (dm)-
pour évoquer les 100 ans d’Ella Fitzgerald. La chanteuse a tenu son rôle avec
naturel, démarrant sur «How High the Moon» et enchaînant nombre des succès qui
ont jalonné la carrière d’Ella: «Satin Doll», «Comes
Love», «Next Voyage», «It Don’t Mean a Thing», «One Note Samba», «Take Love
Easy» et «A Tisket a Tasket» en rappel. Seule exception, «Bonito Tema», une
pièce composée par le guitariste espagnol José Luis Gámez.
22
juillet. Le quartet d’Iñaki
Salvador (p) –Andrzej
Olejniczak (ts, bcl), GonzaloTejada (b), Borja Barrueta (dm)– marquait le
centenaire de Thelonious Monk en interprétant les grandes compositions du
pianiste : «Epistrophy», «Trinkle Trinkle» ou «I'm Confessin»,
lesquelles ont bénéficié d'arrangements ingénieux. Les temps forts furent le
medley «Well You Needn't» / «Blue Monk» exécuté par Iñaki Salvador en solo en piano soloainsi que l'introduction
suggestive de Gonzalo Tejada à «Round Midnight»
débouchant sur «Misterioso».
24 juillet. Pour les 100 ans de Dizzy Gillespie, le sextet de Chris Kase
(tp) –Carlos Martín (tb,
cga), Joaquín Chacón (g), Mariano Díaz (p), José Agustín Guereñu (b), Guillermo
McGill (dm)– ne semblait pas à son affaire. On aurait en effet mieux vu Chris
Kase rendre hommage à Chet Baker. D’ailleurs, le groupe n’a fait que survoler
le répertoire de Diz, préférant exposer le sien, en dehors de l’inévitable «Manteca».
25 juillet. Enfin, c’est au septet de Mikel
Andueza (as) –Bob Sands (ts), Miguel Ángel López (bar), José Luis Gámez (g), Francesc Capella (p), Víctor Merlo (b), Jo Krause (dm)– de commémorer les 50
ans de la disparition de John Coltrane. Ce fut une belle réappropriation, les
trois saxes étant particulièrement en verve ainsi que le bassiste, avec un solo
remarqué sur («Do You Hear the Voices You Left Behind», un morceau de John
McLaughlin inspiré de «Giant Steps».
Place de la
Trinidad
22
juillet. Charles Lloyd a reçu, à 79 ans, le prix Donostiako
Jazzaldia 2017 sur la scène de la Place de la
Trinidad, par le directeur du festival, Miguel Martín. Le saxophoniste a
déclaré ne pas être un adepte des discours mais a remercié l’organisation du
festival ainsi que le public présent. Puis, avec son groupe (Gerald Clayton, p, Reuben Rogers, b, et Eric Harland, dm) ila donné un concert qui a diminué
en intensité et a augmenté en lyrisme au fil du temps. Il a commencé fort avec une évocation de Coltrane («Dream Weaver», 1966).Puis, accompagné de Clayton, il s’est
enfoncé dans le folklore sud-américain via le blues. Sa musique
dégageait une atmosphère de beauté et de sentiments difficiles à trouver chez
d’autres. En fin de concert, il a repris deux compositions essentielles dans
son répertoire: «Rabo de Nube» de Silvio Rodríguez et «Passin' Thru». Et à la demande du public, le quartet a effectué son
rappel sur «La Llorona».
En deuxième partie, le concert du Saxophone Summit dévoilait l’absence de Dave Liebman, malade, compensée parGreg Osby (as) et Joe Lovano (ts), accompagnés de Phil Markowitz (p), Cecil
McBee (b) et Billy Hart (dm). Les morceaux
initiaux, basés sur des compositions de Lovano, ont semblé un peu lointains par
rapport à la musique de Coltrane. La mayonnaise a cependant finit par prendre
avec «Compassion» et «India».

23 juillet. Donny McCaslin n'est pas un
débutant. Il avait enregistré son
premier album en tant que leader il y a 20 ans, et,
depuis lors, a eu une trajectoire impeccable et s'est révélé être l'un des saxophones ténor les plus créatifs et intéressants du moment. Ce n'est
pas par hasard si’il a été la clé de voûte à l'orchestre de Maria Schneider et
du quintet de Dave Douglas des années durant. Avec Jason
Lindner (kb), Jonathan Maron (b) et Nate Wood (dm), la formation de McCaslin a ouvert son catalogue de
jazz progressif avec «Shake Loose». Il y a eu aussi des morceaux comme
«Beyond Now» de son dernier album, et «Fast Future» en fin de concert. Il
convient de mentionner en particulier la version instrumentale
de «Lazarus» de David Bowie (appartenant au disque Blackstar), absolument mémorable sur laquelle le leader a construit
un long solo d'une expressivité extrême.
En deuxième partie, se produisait Kamasi Washington (ts), très attendu. Un
musicien plus intéressant comme compositeur et arrangeur que comme soliste. Il
était déjà venu à Jazzaldia avec une petite formation il y a deux ans. Il
semble classique sans être artificiel, invoquant des sons qui appartiennent à
la mémoire du jazz bien que la majorité du public l’ignore et les associe à
d’autres styles comme le funk ou la soul. Ni Washington, ni le tromboniste Ryan
Porter, ne sont véritablement brillants, mais ils gèrent leurs ressources de façon
intelligente et livrent des solos bien structurés. Il en va du même du reste de
cette formation: Brandon Coleman (kb), Joshua Crumbly
(b), Robert Miller (dm), Jonathan Pinson (dm), Patrice Quinn (voc) et même le
père de Kamasi Washington, le saxophoniste Rickey Washington, qui a
effectué une bonne intervention au soprano.
24 juillet. Deux
performances sans intérêt se sont succédées: premièrement, le brass band Lucky Chops, dont la musique tenait tout au mieux de
l’esprit de carnaval, puis, Macy Gray (voc), en petite forme et
trop bavarde pour nous tenir en haleine sur le terrain de la pop et du R’n’B.
La réunion de la chanteuse et du brass band en fin de soirée n’a réjoui que les
inconditionnels.
25 juillet. Le concert d'Abdullah Ibrahim était, très probablement,
le plus attendu de cette édition. Le pianiste effectuant une tournée dédiée auxJazz Epistles, l'un des groupes les plus importants de l'histoire du jazz sud-africain.
Comme à son habitude, il a ouvert son concert par une longue pièce en piano
solo. Cette introduction et deux longs passages en solo ont été les plus
bouleversants de cette soirée, en passant du
ténébreux au crépusculaire, en modelant délicatement l'harmonie. Peu à
peu, le reste des musiciens s’est joint à lui.
D'abord, Noah Jackson (cello) et CleaveGuyton Jr. (fl), Will Terrill
(dm), Lance Bryant (ts), Andrae Murchison (tb) et Marshall McDonald (bar). L'invité spécial
aurait dû être Hugh Masekela mais, suite à un accident, il a été remplacé par Terence
Blanchard (tp). Ce dernier a su s’adapter à l’univers musical d'Abdullah Ibrahim et s’est intégré au groupe sans
chercher à se mettre en avant. Un beau concert avec un final au sommet,
introduit en trio piano, flûte, violoncelle.
Pour le deuxième set, Gregory
Porter se présentait devant le public de San Sebastian pour la troisième fois. Sa
voix et son répertoire continuent de croître même si on vérifie que sa
ligne musicale a plus à voir avec la soul, le R’n’B ou même encore le gospel
qu'avec le jazz. En tous cas, sa présence a dégagé des
ondes positives, de «Take Me to the Alley» (qui
donne son titre à son dernier album), à «Holding On» en passant par «On My Way
to Harlem», exécutés sans artifice. Puis, profitant d’une petite
averse, le chanteur, comme un pasteur s’adressant à sa paroisse, a entonné «Liquid Spirit» et enflammé le public. Il a poursuivi avec «Consequence of Love», une
version de «Papa Was a Rollin' Stone», «Genocide Musicale», «Wade in the
Water», un «Don't Be a Fool» tout en intimité et un hommage à Nat King Cole avec«I Love You for Sentimental Reasons», moment où il s'est approché du
jazz. Gregory Porter a achevé sa prestation
sans faille sur «When Love Was King».
 En conclusion, ce Jazzaldia 2017 fut un bon cru, même s’il reste encore
une marge de progrès concernant, notamment, la mise en valeur du jazz, la présence
invasive du sponsoring ou la facilitation du travail des photographes…
Lauri Fernández
photos José Horna
© Jazz Hot n° 681, automne 2017
|
Marseille, Bouches-du-Rhône
Marseille Jazz des Cinq Continents, 19-29 juillet 2017
Marseille Jazz des Cinq Continents a donné sa 18eédition, la première –en tant que directeur artistique– pour Hugues Kieffer
(historiquement directeur technique du festival) qui en prenant les rênes de la
programmation a redonné stabilité et sérénité à l’équipe (voir notre article
paru en amont du festival). Celle-ci peut d’ailleurs se satisfaire de la
fréquentation de ces dix soirées de concerts (en hausse par rapport à 2016),
dont trois ont affiché complet. On s’interroge parfois sur les limites du jazz
qui semble aujourd’hui englober la variété internationale et de fait le public
marseillais a été à ce titre exemplaire puisqu’il s’est massivement déplacé
pour Norah Jones et George Benson. Heureusement, les amateurs étaient également
servis et ils ont pu applaudir Taj Mahal, Tony Allen et Branford Marsalis. Lesgrands festivals de jazz sont devenus des événements de grande consommation
(c’est ce qu’attendent collectivités et sponsors) et si le jazz y est encore
possible, il n’est plus toujours indispensable à ces grandes animations.

Après la soirée inaugurale du 19 juillet –un concert
gratuit, à la Friche de la Belle de Mai, du groupe anglais Sons of Kemet
(au
son entre hip-hop et world, avec une touche jazzy pour prétexte)–, le
festival
opérait son réel démarrage, le lendemain, avec la très belle affiche
réunissant
le quartet de Branford Marsalis (ss, ts, inédit à Marseille) et Kurt
Elling
(voc). Un mot sur le cadre, d’abord: le Théâtre Silvain, splendide
théâtre de verdure, aménagé en 1923 sur le modèle du théâtre d’Epidaure,
encaissé dans une calanque des quartiers sud de Marseille. On y accède
en
longeant la somptueuse Corniche qui offre le tableau, sur fond
bleu-azur, des îles
du Frioul et du Château d’If. Tous les ingrédients pour une soirée de
jazz
absolument parfaite étaient réunis. Et le plaisir fut au rendez-vous.
Devant
des gradins bien remplis, Branford a débuté le concert avec sa
rythmique: Joey Calderazzo (p), Eric Revis (b) et Justin Faulkner (dm);
une
véritable Rolls du swing qu’il a conduite avec doigté, prenant au
soprano des
solos d’une grande finesse. Dès le deuxième morceau, Kurt Elling entre
en
scène. Dans ce contexte, le chanteur a donné le meilleur, rappelant ses
qualités de jazzman (c’est un excellent scatteur), alors qu’on l’avait
trouvé
plus fade, dans le registre du crooner, lors de son dernier passage à
Paris, en
novembre 2016 (voir notre compte-rendu). Mais avec la présence
stimulante de
Branford Marsalis, Kurt Elling a mis un tigre dans son moteur et a
dialogué
très à son aise avec le quartet, qui marquait-là une première
collaboration
(suite à la sortie de Upward Spirale,
Okeh, 2016). Etincelant sur les morceaux rapides, il est poignant sur les
ballades: «Practical Arrangement» (chanson de Sting –grand
ami du saxophoniste–, bien arrangée) a soulevé l’émotion du public
marseillais; aidé en cela par les interventions de Branford qui joue
juste ce qu’il faut. Quel régal également d’entendre le trio seul: le
lyrisme de Calderazzo, la puissance de Revis, le drive de Faulkner. Largement
acclamés, le saxophoniste et le chanteur ont repris en duo, pour le rappel
«I’m a Fool to Want You». Puis Eric Revis est revenu seul en scène
pour un long solo absolument épatant avant que le concert ne s’achève sur une
évocation collégiale de New Orleans.
Le 21 juillet, pour la seconde soirée au Théâtre Silvain, le
jazz de haute volée avait cédéla place à plus de facilité avec les très
festifs rythmes cubains de Roberto Fonseca (p, ep) et –assez logiquement– attiré
un public encore plus nombreux que la veille. Il faut dire que le spectacle
avait de l’allure: une grande formation avec une belle section de cuivres
pour donner de l’ampleur à la musique. Cette dernière, si elle est
authentiquement cubaine, n’entre pas vraiment dans la sphère du jazz. Roberto
Fonseca, malgré le patronage de Jazz in Marciac, ne s’inscrit pas la belle
synthèse du jazz afro-cubain (les n°496 et 497 de Jazz Hot restent d’ailleurs utiles à (re)lire sur le sujet) mais dans
une musique grand public qui permet à chacun de se lever de sa place pour
bouger, taper dans les mains et danser. Effet recherché et obtenu.
La première série de concerts se terminait le 22 juillet
avec quatre formations que l’on pouvait apprécier sur les terrasses du Mucem et
du Fort Saint-Jean, autre cadre merveilleusement flatteur. Le premier groupe à
s’offrir aux festivaliers fut le bon quintet de Yonathan Avishaï (p), composé
de César Poirier (as, cl), Yoni Zelnik (b), Donald Kontomanou (dm) et Inor
Sotolongo (perc). Au menu, de solides compositions, exécutées avec allant et
une approche moderne qui n’oublie pas le swing. A noter également une belle
reprise du «Django» de John Lewis. On avait ensuite le choix entre
le trio de Piers Faccini (g, voc) –dans la veine pop-folk américain– ou le
délicat duo réunissant Cyril Achard (g) et Géraldine Laurent (as). La décision
fut aisée et ce fut effectivement un joli moment que ce dialogue intimiste
entre le guitariste et l’altiste. On connaît les qualités de Géraldine Laurent
dont le son mélodieux fut joliment mis en valeur par les cordes. Le dernier
temps de la soirée –la «création» de Guillaume Perret (ts), façon rave party– a paru en revanche hors
sujet.
 Après une pause dominicale, le festival a pris, le 24
juillet, ses quartiers dans les jardins du Palais Longchamp dont les pelouses
débordaient pour la venue de Norah Jones. Lors d’une courte première partie,
Nguyên Lê (g) a proposé une rencontre avec le violoniste vietnamien Ngô Hông
Quang pour une évocation planante de l’Asie. Un beau voyage mais très éloigné
du continent du jazz. Autre problématique avec Norah Jones (voc, p, g) qui
n’est pas véritablement une artiste de jazz (elle se situerait plutôt dans le
créneau pop-folk) mais sait s’exprimer à l’occasion dans l’idiome blues ou jazz
dont elle maîtrise la grammaire (outre un ou deux passages blues au piano lors
du concert, on peut rappeler qu’elle avait enregistré un joli duo avec Ray
Charles et participé, après sa disparition, à un hommage à Jazz at Lincon
Center). En promo pour son nouvel album, Day
Breaks, la fille de Ravi Shankar a présenté de nouvelles chansons et
également fait plaisir à ses fans en reprenant quelques-uns de ses succès
(«Don’t Know Why»). Un show millimétré (avec un bon
orchestre: Dan Iead, g, Peter Remm, synth, Joshua Lattanzi, Jason
Roberts, b, Gregory Wieczorek, dm, perc) qui a bénéficié du charme indéniable
de son interprète.
Le 25 juillet, c’est un public un peu plus jeune et branché qu’à
l’accoutumé qui s’était déplacé pour Robert Glasper et Kamasi Washington. On
apprécie l’abord original de Glasper (kb) et son humour. Mais ce soir, le
pianiste avait délaissé la formule trio –où il excelle– pour un projet entre
jazz, rock et hip-hop réunissant Mike Severson (g), Burniss Earl Traviss II
(b), Justin Tyson (dm) et Benjamin Casez à la guitare synthé seulement (le fort
mistral ayant endommagé son saxophone durant les balances). Au menu, du gros
son de guitare électrique (avec une reprise du groupe de rock Nirvana) et des
effets électroniques à gogo. Dans un esprit plus fusion, plus free et plus
débridé, Kamasi Washington (ts) entouré par Patrice Quinn (voc), Ryan Porter
(tb), Brandon Coleman (p), Joshua Crumby (b) et deux batteurs juchés sur de
hautes estrades (Robert Miller et Jonathan Pinson), est un ténor sérieux. Le
groupe, ensuite rejoint par Rickey Washington (ss), rappelle quelque peu la
fantaisie du Sun Ra Arkestra, mais dont la musique était davantage enracinée. Il
n’en reste pas moins que Kamasi Washington incarne une dimension de la scène
jazz actuelle tout à fait intéressante quand elle ne se dilue pas dans les
musiques commerciales du moment. Saluons au passage le travail de l’équipe
technique du festival, confronté à un mistral qui lui a passablement compliqué
la tâche.
Le 26 juillet, Ana Popovic (g, voc) assurait le lever de rideau d’une des dernières légendes vivantes du blues,
Taj Mahal. Avec son groupe
franco-italien (Cédric Ricard, ts, Davide Ghidoni,
tp, Michele Papadia, kb, org, voc, Philippe Gonnand, b, voc, Stéphane
Avellanda, dm), elle a attaqué son répertoire habituel, essentiellement
constituéd’originaux, et malgré la qualité de ses musiciens (souvent
issus du jazz) n’a pas fait dans la dentelle. Misant beaucoup sur son
apparence, la Serbe enchaîne des titres tous semblables (à part une reprise de
Tom Waits) et suscite une lassitude qui nous fait regretter de n’avoir plus
souvent en France l’occasion d’entendre les grands noms du blues de Chicago,
New York ou New Orleans. Vint enfin Taj Mahal (g, voc, hca, bjo…) dont c’était
le premier passage par Marseille; les amateurs les plus anciens ont
toutefois le souvenir d’un concert au théâtre municipal d’Aix-en-Provence, en
octobre 1980. Sa collaboration avec Keb’ Mo’
(g, voc, hca…) a donné naissance à un groupe majeur du blues actuel, Tajmo (Danna
Robins, ts, Quentin Ware, tp, David Rodgers, kb, org, Stan Sargeant, b, Marcus Fannie, dm, Deva et Zoe Mahal, voc). Le duo Taj
Mahal / Keb’ Mo’, ainsi bien renforcé, proposait des compositions tirées de
leur dernier album, Tajmo (Concord)
mais aussi des titres
emblématiques de leur carrière. Taj Mahal est entré en scène, précédé par le
groupe, sur «Senor Blue» suivi de «Don’t Leave Me Here». Au cours de la
soirée, les deux compères ont varié les plaisirs, passant, pour Taj Mahal, de
la guitare électrique au dobro, de la guitare acoustique au banjo, de la mini-guitare
dix cordes à l’harmonica, alors que Keb’ Mo’ alternait guitare électrique et
harmonica. Nouveautés et morceaux plus anciens se sont enchaînés sans temps
mort: «Queen Bee», «She Knows How to Rock Me», «Done Changed My Way
of Living». Comme une
boucle dans le temps, ils reprennent de façon acoustique «Diving Duck Blues»et
«Leaving Trunk» présents sur l’album Taj
Mahal. Keb’ Mo’ joue un
rôle essentiel assurant visiblement la direction musicale. Ses interventions en
soliste, à la guitare et au chant sont une composante essentielle. Dans un
final festif et devant un public debout et chantant, le groupe aussi soudé
qu’excellent a quitté le plateau avec «All Around The
World». A 75 ans, Taj Mahal prouve encore que le blues peut être populaire et
de grande qualité.
Le 27 juillet ne fut assurément pas la meilleure soirée du
festival (même si l’affluence y fut la plus forte: signe des temps). On
passera rapidement sur la première partie avec la chanteuse Imany qui, ni par
son expression, ni par son répertoire (notamment «Bohemian
Rhapsody» de Queen) n’a le moindre lien avec le jazz. Restait
l’indéboulonnable George Benson dont la collaboration avec Miles Davis n’est
plus qu’un lointain souvenir, le guitariste ayant fait le choix d’une carrière
commerciale depuis son tube de 1980: «Give Me the Night»
(évidemment dans la setlist du soir).
Après un démarrage funk et instrumental prometteur, Benson nous a servi une
soupe indigeste de sa voix doucereuse et fatiguée, accompagné d’arrangements vintage sortis de ce que la variété des
années 80 a produit de pire. Exemplaire, sa bluette «Nothing’s Gonna
Change My Love for You» (popularisée en France par le chanteur pour
adolescentes Glenn Medeiros). On préférerait entendre George Benson revenir au
jazz et au blues dont il fut un brillant interprète. Ce n’est pas pour cette
vie apparemment.
Le 28 juillet ne fut pas non plus fameux, célébrant un
métissage musical confus où le jazz n’est plus que résiduel. Rien d’étonnant de
la part d’Emile Parisien (ss) et Vincent Peirani (ass) –qu’on a encore jamais
pris en flagrant délit de swing– qui présentaient un hommage à Joe Zawinul
avec Aziz Samahoui (voc, perc), Manu Codja (g), Tony Paeleman (ep), Linley
Marthe (b), Paco Séry (dm) et Mino Cinelu (dm). Un assemblage de musiques du
monde façon bouillabaisse (pour le côté couleur locale). En seconde partie, le
protéiforme Herbie Hancock (p, kb) a emprunté une nouvelle fois la voie des
courants en vogue, jouant une musique saturée d’effets et finalement
artificielle. A la tête d’un groupe correspondant à sa vision musicale (Terrace
Martin, kb, voc, Lionel Loueke, g, James Genus, b, Vinnie Colaiuta, dm), le
leader nous a quand même offert de brefs instants de grâce avec quelques solos
émergeant de l’ensemble, qui nous ont rappelé qu’Herbie Hancock est un grand
musicien de jazz (quand il le veut).
Heureusement, la dernière soirée du festival, découpée en
trois concerts, apporta de bons moments de jazz (pour ce qui est des deux
premiers concerts) placés sous le signe de l’«afrobeat». En
ouverture, c’est son "inventeur", Tony Allen (dm) qui présentait un
hommage à Art Blakey, accompagné d’Irving Acao (ts), Jean-Philippe Dary (p) et
Matthias Allamane (b). Très modestement, le batteur a déclaré au public:
«I just try to entertain you». Il est allé bien au-delà, revisitant
le répertoire du leader des Jazz Messengers avec originalité, suspendant le
swing par moments, comme en apnée, marquant le rythme d’une frappe lourde
(particulièrement sensible sur «Night in Tunisia»). Malgré un
pianiste manquant de relief, c’est un bon groupe qui a occupé la scène, servi
par les excellentes prestations d’Irving Acao et Matthias Allamane. Le tout
avec un final envoûtant sur «Secret Agent». On en aurait bien
dégusté davantage! Même réflexion à propos du quartet de Roy Ayers (vib,
voc). Plein d’énergie et de joie de vivre, le leader a généreusement distribué
ses good vibes. Enchaînant des
compositions efficaces («Searching», «Grey, Black and
Green»…), secondé par de solides sidemen (malheureusement non crédités),
il a donné à entendre un jazz festif qui avait tout pour plaire au plus grand
nombre. En troisième partie, c’est le large ensemble de Seun Kuti (voc, fils de
Fela Kuti) qui a investi les lieux. Les couleurs et les rythmes africains ont
ainsi conclu le festival sur un air de fête. Il s’agissait de poursuivre le fil
rouge de la soirée: Fela Kuti (voc, 1938-1997) dont Tony Allen a été le
batteur attitré et avec lequel Roy Ayers a enregistré Many Colours of Music en 1980. Une conclusion sympathique mais
encore une fois assez éloignée du jazz.
Un mot enfin de la programmation parallèle au festival,
«Marseille Heure Jazz», nettement moins ambigüe (Rhoda Scott au
Parc de la Moline, Eric Legnini à Salon-de-Provence, Stéphane Belmondo, Jacky
Terrasson à Aubagne, des projections de film, comme le documentaire inédit I Called Him Morgan, et une exposition consacrée
à Miles Davis à L’Alcazar…). Preuve que le problème pour le jazz est bien le
gigantisme des festivals et leur besoin d’atteindre le grand public pour être
rentables. On rêverait ainsi que Marseille Jazz des Cinq Continents exerce son
éclectisme au sein du jazz plutôt qu’au-delà (car il y a tant à faire) en
privilégiant les belles scènes du Théâtre Silvain et du Mucem.
Jérôme Partage
Photos Ellen Bertet
© Jazz Hot n° 681, automne 2017
|
Nice, Alpes-Maritimes
Nice Jazz Festival, 17-21 juillet 2017
Ayant vu son édition 2016 annulée quelques
heures après l'épouvantable attentat sur la Promenade des
Anglais le soir du 14 juillet 2016, le Nice Jazz Festival revêtait cette année
un caractère bien sûr très particulier. Le jazz «symbole de liberté», selon
les mots d'Herbie Hancock («ambassadeur de bonne volonté» à l'Unesco et parrain
de l'édition 2017 du festival), se devait de surmonter l'adversité et de
relever le défi en appliquant le slogan: «Peace, Unity, Love and... Having
Fun».
Double
programmation: d’un côté, la grande scène Masséna (souvent plus de 6000
spectateurs debout devant un mur de son phénoménal) dédiée aux têtes
d’affiche à peu près toutes étrangères au jazz; de l’autre, la scène du Théâtre de
Verdure (3000 places assises et une sonorisation plus mesurée),
davantage tournée vers les amateurs de jazz, proposait des vedettes
confirmées
comme des révélations prometteuses (ce sont essentiellement ces
concerts-là que
nous avons suivis). Politique payante, en tous cas, du point de vue
comptable
puisque le festival a battu son record de fréquentation.
Lundi 17 juillet
Trombone Shorty (tb) ouvre le bal avec son
«funk» à la sauce new orleans très appréciée du public de Massena pour sa fougue
et son engagement dynamique et spectaculaire. Herbie Hancock conclut la soirée
par un concert très fortement estampillé jazz-rock: Herbie Hancock (key, p),
Lionel Loueke (g, key), Terrace Martin (as), James Genus (b) et Vinnie Colaïuta
(dm), ne déclenchent pas franchement l'enthousiasme malgré (ou à cause d')un
volume sonore démesuré excluant toute forme de nuances.
Au Théâtre de Verdure, le même soir, Renée
Rosnes (p, arr) et son «Woman to Woman» –Cécile Mc Lorin Salvant (voc),
Anat Cohen (cl), Melissa Aldana (ts), Ingrid Jensen (tp), Noriko Ueda (b),
Allison Miller (dm)– créent l'événement. Sur des standards («Shadows» de
Charlie Mingus, «Yesterdays» de Jerome Kern) ou des compositions personnelles («Barbudos»),
les arrangements d'une grande modernité et le jeu splendide d'invention de ces
jazzwomen d'exception (intervenant ensemble ou, tour à tour) font merveille,
tandis que Cécile Mc Lorin Salvant reste simplement égale à elle-même:
magnifique!
En seconde partie, Roberto Fonseca (p, voc)
–entouré de Javier Zalba (fl, ts, cl), Jimmy Jenks (sax), Matthew Simon (tp),
Yandy Martinez (b), Ramses Rodriguez (dm), Adel Gonzalez (perc) et Ucha (voc)–,
élargit sa palette habituelle de couleurs africaines, tout en gardant les bases purement cubaines qui
assurent son succès, pour une solide prestation en accord avec les canons du
genre.
Mardi 18 juillet, Théâtre de Verdure
En début de soirée, Samy Thiébault (ts,
fl), accompagné d’Adrien Chicot (p), Sylvain Romano (b), Philippe Soirat (dm),
et Meta (perc, voc), obtient un succès
mérité en reprenant quelques compositions issues de Rebirth, son dernier album (dont «Abidjan», «Nesfé
Jahân»...) et quelques thèmes inédits (dont une composition du Vénézuélien
Enrique Hidalgo). Avec fougue, élégance et originalité, ce citoyen revendiqué
du «village planétaire» transporte ses auditeurs d'un continent à l'autre sans
jamais s'éloigner du langage du jazz. Une prouesse.
Puis, vient Christian McBride (b) en quartet
avec Josh Evans (tp), Marcus Strickland (ts, cl) et Nasheet Waits (dm). C'est
un concert très attendu, car si le contrebassiste publie abondamment, ses apparitions
sur les scènes de nos contrées ne sont pas des plus fréquentes. Sa prestation
est à la hauteur des attentes. Dans un langage post-bop (avec des touches de
free assumées), la maîtrise technique s'efface, toute au service d'une
créativité enthousiaste et juvénile dont le dynamisme et la véhémence
promettent encore au jazz quelques belles années. Standards ou compositions originales,
ballades ou thèmes «up-tempo» tout est de la même qualité: exceptionnelle. Un
concert magistral!
Pour conclure la soirée, après ce moment
d'intensité maximale, la tâche consistait, pour Youn Sun Nah (voc) à ramener le
calme et la douceur au Théâtre de Verdure. Soutenue par Jamie Saft (p, org, ep),
Clifton Hyde (g), Grad Jones (b) et Dan Rieser (dm), sa frêle silhouette, sa
voix fragile (lorsqu'elle parle, car lorsqu'elle chante, c'est tout à fait
autre chose), et son attitude empreinte d'une hyper timidité ont conquis la
foule des spectateurs encore scotchés à leur siège (et qui l'avaient déjà
encensée lors de son dernier passage ici même il y a deux ans, dans un genre
très différent). Avec une science du suspense «light» et un charme
irrésistible,Youn Sun Nahprésente un répertoire composé de ballades
soft et de thèmes musclés, en dominant parfaitement son sujet.
Mercredi 19 juillet, Théâtre de Verdure
Johnny O'Neal (p, voc) était soutenu par Ben
Rubens (b) et Itay Morchi (dm). Interprète du rôle d'Art Tatum dans le film Ray, et membre des Jazz Messengers au
début des années quatre-vingt, dont il cite d'ailleurs quelques thèmes, et au
jeu très apprécié par le regretté Mulgrew Miller, le
pianiste-chanteur est un inconnu à Nice. Il y livre une solide prestation dans le genre «trio
piano/vocal post-bebop», où l'on relève l'influence d'Ahmad Jamal pour la
qualité des ruptures de climats et de tempos et le toucher de piano, et une
très belle maîtrise du chant et du scat. Surprise bienvenue pour une majorité
de jeunes spectateurs peu habitués à entendre un jazz d'une facture aussi classique.
Tony Allen (dm) présente ensuite son hommage à
Art Blakey avec Irving Acao (ts), Remi Sciuto (bs), Daniel Zimmerman (tb,
tuba),Jean-Phi Diary (p, key), Indy
Dibongue (g) et Mathias Allemane (b). Tout auréolé de son compagnonnage avec
Fela Kuti, la star historique de la pop africaine, et à ce titre considéré
comme l'un des créateurs de «l'afro-beat», Tony Allen se livre à un hommage très
personnel tant par son jeu que par ses choix de rythmiques, radicalement
décalées, évoquant plus l'Afrique que le
jazz. Les thèmes «patrimoniaux» des Jazz Messengers deviennent ainsi difficiles
à reconnaître, car quelque peu vidés de leur substance. La déception est
toutefois tempérée grâce aux pointures qui composent l'orchestre, toutes
capables d'improvisations fulgurantes.
Cory Henry (org, key), moins de trente ans,
est déjà une star comme membre des «Snarky Puppy» un groupe «soul fusion»…Bref,
il joue de l'orgue Hammond, a été baptisé au son du gospel et de la soul. De
sacrés atouts. Mais les solides racines qui irriguent son jeu sont mises au
second plan, pour une musique à la mode et sans profondeur. Il était accompagné
de Adam Agati, Andrew Bailey (g), Darius Woodley (dm), Sharay Reed (b),
Cassondra James et Matia Celeste (voc).
Jeudi 20 juillet, Théâtre de Verdure
Elève de Max Roach et Billy Higgins, le
jeune batteur new-yorkais Daniel Freedman
s'est déjà fait remarquer aux
côtés de personnalités aussi différentes queSting, Angélique Kidjo, Anat
Cohen, Lionel Loueke ou Dianne Reeves. A la tête de son quartet –Yonathan Avishai
(p), Gilad Hekselman (g), Felipe Cabrera (b)–, il reprend les titres de Imagine That, son dernier album. Nourrie
d'influences africaines (en particulier des Gnawas) orientales, sud américaines
ou... gospel, c'est une musique limpide,
sans aspérités inutiles, qui s'écoute avec beaucoup de plaisir.
Révélé par Avishai Cohen, le pianiste israélien
Shai Maestro mène désormais sa propre carrière dans la mouvance «jazz
contemporain». Un terme fourre-tout où il est de bon ton de revendiquer les
mannes d'Erik Satie, Art Tatum, Claude Debussy, Jimi Hendrix, ou, qui
sait...les tambours du Bronx... Si ce «mesclun» (comme on dit à Nice) a ses
adeptes, le trio (complété par Jorge Roeder, b et Ziv Ravitz, dm) a livré un
set grandiloquent.
Mais le concert attendu était celui réunissant
Abdullah Ibrahim (p) et Terence Blanchard (tp), soutenus par Cleave
Guiton Jr. (as, cl, fl, piccolo), Lance Bryant (ts), Andrae Murchison
(tb), Marshall McDonald (bar), Noah Jackson (b, cello) et Will Terrill
(dm). Né en 1934, le
pianiste sud-africain Abdullah Ibrahim (soutenu autrefois par Duke
Ellington, et
à qui Paul Bley et Keith Jarrett doivent stylistiquement beaucoup)
entame le
concert en solo. En moins d'une vingtaine de minutes, c'est
un medley magique. Sans les développer,
il esquisse en quelques mesures les thèmes magnifiques qui ont construit
son œuvre.
On les reconnaît avec bonheur tout en pestant d'avoir oublié leurs
titres… Quand il est ensuite, et très discrètement, rejoint par la flûte
et le
violoncelle, le public subjugué et ravi, est tellement respectueux et
conscient d'être à l'écoute d'une des légendes vivantes de l'histoire du jazz qu'il ose à peine applaudir. Puis
c'est l'orchestre tout entier, emmené par le trompettiste Terence Blanchard
(dans le rôle réservé initialement à Hugh Masekela, l'autre icône du jazz
sud-africain), qui reprend et développe les pièces précédemment évoquées. Le
pianiste se fait moins présent, se contentant de ponctuer les prises de solos
(tous superbes) des soufflants et d'introduire ou de conclure les thèmes, mais
la musique garde la même intensité et la même qualité: sublimes. Ovation debout
de plusieurs minutes légitime pour Abdullah Ibrahim, dans un Théâtre de Verdure
bondé; incontestablement la plus grande personnalité de ce festival.
Vendredi 21 juillet, Théâtre de Verdure
Depuis quelques années, un concours national,
ouvert gratuitement au public, se déroule sur plusieurs jours, organisé par la
Ville de Nice et Imago prod, la petite mais valeureuse structure de David Benaroche,
dévoué défenseur du jazz sur la Côte d'Azur. Ce Tremplin du NJF permet aux
lauréats de se produire sur la scène du
festival. Spirale Trio (Laurent Rossi, p, Philippe Brassoud, b,
Jérôme
Achat, dm, victorieux en 2016) et Pierre Marcus (b) Quartet (Baptiste
Herbin,
as, ss, Fred Perreard, p, Thomas Delor, dm, victorieux en 2017) étaient
programmés pour un trop court set en ouverture de rideau sur la scène du
Théâtre de Verdure. Sur des compositions personnelles, ces deux
formations azuréennes pratiquent un jazz post-bop dynamique de très haut
niveau. Ils
obtiennent un beau succès devant des amateurs très exigeants. Evoquant
Charlie
Parker autant que Cannonball Adderley, le saxophoniste Baptiste Herbin
fait
très forte impression, mais ce n'est pas nouveau. Il suit un chemin qui
va très
bientôt le mener au tout premier rang. Idem pour Pierre Marcus, le jeune
prodige de la contrebasse, issu du Conservatoire de Nice, qui surprend
et
enthousiasme chaque fois davantage en affirmant sa personnalité au fil
des concerts.
Retour aux musiciens confirmés avec Henri
Texier qui précise qu’il ne dirige en rien les membres de son «Sky Dancers»: Sébastien
Texier (ts), François Corneloup (bs), Manu Codjia (g), Armel Dupas (p) et Louis
Moutin (dm). Il présente des compositions
personnelles, toutes dédiées à des minorités ethniques maltraitées, dont la plupart
d'Amérique du Nord. Set superbe. Les thèmes sont splendides de musicalité et
d'invention tant harmonique que rythmique, les arrangements tirés au cordeau et
la section rythmique redoutable d'efficacité. Les solistes, s'emparant de ce
matériau d'une solidité à toute épreuve, n'ont plus (facile à dire…) qu'à se
laisser porter et laisser libre cours à leur imagination. Ce dont ils ne se
privent pas. Le public, conquis, salue la performance par une ovation debout
largement méritée.
Annoncé comme le fils spirituel de Pharoah
Sanders voire d'Albert Ayler ou de John Coltrane (rien de moins!),
Kamazi Washington (ts) avait, pour sa première venue à Nice, un sacré défi à
relever. Entouré par son propre père, Rickey Washington (fl, ss), Brandon
Coleman (p, keys), Ryan Porter (tb), Joshua Crumbly (b), Robert Miller (dm),
Jonathan Pinson (dm) et Patrice Quinn (voc), le saxophoniste a donné un concert
décevant. Hymnes pathétiques, déluges d'incantations des cuivres à l'unisson
façon free jazz, feux roulants de batterie, stops chorus de saxo ténor (au très
gros son) enflammés, mélodies reprises par une chanteuse hiératique, costumes
africains… Un folklore qu'on croyait oublié. Harmonies le plus souvent
minimales et rythmes simplistes mais véhéments, énergie débordante dans les
tempos rapides, discours universalistes naïfs et lyrisme exacerbé dans les
ballades. La recette est connue… Rien ne manque pour conquérir un auditoire
prêt à se laisser emporter par ce tsunami. Le succès est sans précédent pour cette édition 2017 qui a totalisé 43000 spectateurs, sans compter le «off»
qui se déroulait dans une soixantaine de lieux
publics, cafés, restaurants et hôtels à travers la ville, dont une scène
dans les jardins de la Promenade du Paillon où on a pu notamment découvrirle trompettiste et chanteur néo-orléanais James
Andrews, émérite professeur –encore injustement méconnu– de Trombone Shorty, sa
starde frère cadet. Un rebond aussi surprenant qu’heureux pour un
festival qui, après avoir connu le pire, envisage l’avenir avec confiance,
ayant déjà lancé les ventes du «pass» pour l’édition 2018.
Daniel Chauvet
© Jazz Hot n° 681, automne 2017
|
Toulon, Var
Jazz à Toulon, 15-23 juillet 2017
28e édition
de Jazz à Toulon qui a pour ambition de porter le jazz à travers la ville, du
centre à la périphérie. L’occasion de rappeler la genèse de ce festival, issu
de la volonté du maire de l’époque, François Trucy, qui avait confié à son chef
de Cabinetn Jean-Pierre Colin, le soin de proposer un festival d’été. Ce
dernier, passionné de jazz et ayant effectué son service militaire à Boston (où
il avait rencontré la nouvelle génération de jazzmen à la Berklee), initia donc
un festival de jazz dont la réalisation en fut confiée à Daniel Michel, directeur
du COFS. La formule étant de donner un concert gratuit chaque soir sur une place
différente. Daniel Michel (Nanou pour les intimes), a pris sa retraite l’an
dernier, mais il garde un œil sur son enfant. La présidente du COFS, Bernadette
Guelfucci, a pris la suite avec courage car les difficultés budgétaires sont de
plus en plus contraignantes. Malgré tout, Jazz à Toulon poursuit sa belle
histoire

Les grands concerts du soir
En ce 15
juillet de canicule et pour le coup d’envoi, Richard Bonaet le groupe Mandekan
Cubano –Ludwig Afonso (dm), Osmany Paredes (p), Luisito Quintero (perc),
Roberto Quintero (perc), Rey Alejandre (tb), Dennis Hernandez (tp)– ont mis le
feu à la place de la Liberté, cœur de la ville, avec une
musique qui mêle l’héritage du jazz et des musiques traditionnelles
afro-cubaines. Creuset d’une fusion brûlante et torrentueuse. Mandekan Cubano repose sur trois
percussionnistes: un conguero maître de ses quatre congas, incroyable de
vitesse, de précision et de clarté dans ses roulements; avec lui, c’est la
transe assurée; un joueur de tambours cubains, bongos, cymbales et
percussions diverses dont un cajon, remarquable de vélocité sur tous ses
instruments; un batteur solide pour assurer le tempo et les différentes
assises rythmiques. L’écueil avec tant de percussionnistes serait qu’ils
fassent tous la même chose; écueil évité car le trio fonctionne en
contrepoints rythmiques, les figures s’enchevêtrant les unes dans les autres
pour produire un tapis foisonnant qui vous transporte dans les rues chaudes de
La Havane. Côté soufflants, un bon trompettiste du genre, qui assure, comme on
dit. Le point faible est le tromboniste, assez brouillon dans ses solos, et
très souvent en dehors du temps, ce qui brise le groove de cette musique;
mais la rythmique faisait oublier ce défaut. La révélation fut le pianiste,
dans la droite ligne des pianistes cubains, plutôt côté Danilo Perez, très jazz
dans ses solos; longs solos que lui accordait avec raison Richard Bona. A noter un instant de calme vers le milieu du concert, la
seule mais somptueuse ballade façon slow qui fit se pâmer bien des cœurs. Quant
au leader à la basse électrique à cinq cordes, sa facilité, son agilité, la
perfection des attaques, à la mitrailleuse parfois, la richesse de ses lignes
de basse, son imagination dans les solos, son lyrisme, sont des qualités
rarement réunies chez le même musicien. Et chapeau pour les arrangements, joués
en place, au cordeau, menés d’une main de fer par le bassiste. Que dire de sa
voix suave, caressante et envoutante, montant en douceur dans les aigus. La
plupart des chansons sont en langue Mandekan, originaire de l’Afrique de l’Ouest.
A noter que Richad Bona est également un grand showman, sachant communiquer
avec le public avec bonhomie, sincérité, humour et un plaisir évident, créant
une atmosphère de fête qui réjouit le public remplissant l’immense place. Naturellement,
il invita la foule à chanter en l’imitant, puis, pour les assis, à se mettre
debout et danser, et les assis de se lever et de se trémousser. Concert ad hoc pour lancer ce festival
populaire.
Le 17 juillet, la place Bouzigue (une place excentrée dans les
quartiers nord de la ville, presque un village, bercé par le chant des cigales)
prenait la route du blues avec Natalia M. King (voc, g), accompagnée de Fred
Nardin (p, org), César Poirier (s, cl), Anders Ulrich (b) et Donald Kontomanou
(dm). Natalia M.King, du haut de ses 48 ans et après une longue absence, a repris la route des concerts avec de jeunes
musiciens tout à fait à son écoute. Elle s’exprime sur une faible tessiture,
plutôt dans le médium, avec une voix puissante bien carrée, assez blues, mais
sans grand charisme, se servant de sa guitare avec parcimonie; mais le
groupe est là, solide. Elle fait preuve d’une belle sincérité et d’un grand
engagement physique. C’est un programme blues, teinté de rhythm & blues avec
parfois des parfums new orleans, surtout quand César Poirier prend la
clarinette. La chanteuse parle beaucoup, se racontant, axant la soirée autour
de l’amour avec tous ses tourments, la chose la plus importante au monde,
dit-elle. D’ailleurs son second morceau sera «You Don’t Know What Love
Is?» sur un autre tempo, et dans un autre univers que ceux de Billie
Holiday. Un autre thème de Billie, dont elle avait écrit les paroles
«Don’t Explain»; chez Billie c’était la plainte de la femme
amoureuse trompée, blessée, mais généreuse; avec Natalia, pris sur up-tempo,
c’est la femme en colère, «Pas d’explication mais ça va
barder!». Un autre thème cher à Billie «Stormy Weather»
fut très bien enlevé. Le meilleur morceau de la soirée fut «I Put A Spell
on You» plus dynamique et lui convenant mieux. Bien que se disant non-féministe,
elle dédicaça un morceau à Simonne Veil et… Edith Cresson! Le batteur se
régalait visiblement à glisser quelques figures de son cru dans son drumming
blues. Contrebassiste et pianiste-organiste prirent des solos d’une belle
expressivité. Et bien sûr, figure désormais obligée, Natalia M. King appela le
public à se lever et à danser (sans grand succès) sur «Clap Your
Hands». Un concert agréable, bien mené, mais sans grand relief.
Le 18
juillet, place Saint Jean, en plein cœur d’un quartier populaire à l’est de la
ville, Olivier Ker Ourio (hca) était en quintet avec Jerry Léonide
(p, ep), Linley Marthe (b), Arnaud Dolmen (dm) et Inor Sotolongo (perc); un ensemble formé avec des musiciens
des «îles chaudes»: La Réunion, Maurice, La Guadeloupe, Cuba,
avec lesquels il reprend et développe son expérience L’Orkès Pei. Le concert débute avec l’hymne de la Réunion, «P’tit’
fleur fanée», de Jules Fossy, suivi par «La Rose tombée»,
autre air réunionnais, dans lesquels se mêlent le maloya (hommage rendu à
Danyel Waro, l’un des grands spécialistes) et le jazz. On est tout de suite dans un bain
rythmique, ça tourne et ça chauffe. Le conguero (qui a joué avec tout le gotha
cubain et moult grandes pointures du jazz) est le diable derrière ses quatre
congas; il ira jusqu’à l’épuisement dans des solos torrides, comme par
exemple sur «Sirocco» qui nous vaudra un duel de haute technicité
entre la basse et la batterie. Le batteur pratique un drumming africain tout à
fait dans la descendance de Dennis Charles; il est pour beaucoup dans la
chauffe. Quant au bassiste, dans ses solos il fera un festival de tout ce qu’on
peut faire avec une basse électrique, solide comme un roc dans l’assise du
groupe. Le pianiste fait preuve d’un sens mélodique admirable et très prenant,
que ce soit au piano ou au Fender Rhodes. Quant à l’harmoniciste, on le sent
heureux d’être là, avec ces musiciens, qu’il regarde, on peut dire, avec amour.
Il est au sommet et se donne à fond avec le lyrisme qu’on lui connaît, et qu’on
retrouve dans ses compositions, et surtout avec un phrasé jazz. Cette musique
qui repose souvent sur le ternaire est d’un grand plaisir d’écoute, tant les
mélodies sont belles, les rythmes envoûtants, et les musiciens, haut de
gamme, d’une générosité infinie, dans
une mise en place exemplaire. Ce n’est pas du jazz pur et dur, mais c’est
cousin germain. Un grand concert qui comble l’esprit et le corps.
Le 19
juillet, place Martin Bidouré (dans un quartier populaire à l’ouest de la
ville) se produisait Yilian Cañizares(vln, voc). Née à La Havane où elle étudie
le violon,
elle poursuit ensuite ses études au Venezuelaet en Suisse au Conservatoire de Fribourg. Elle découvre
Stéphane Grappelli et s’intéresse au jazz. Elle fonde alors le groupe Ochumare,
puis tourne sous son propre nom. Ylian
Cañivarez fut donc une découverte pour les Toulonnais avec son groupe composé de Daniel Stawinski
(p), David Brito (b), Cyril Regamey (dm) Inor Sotolongo (perc) qui jouait la
veille avec Olivier Ker Ourio. Ce fut le troisième concert basé sur de la
musique cubaine, et ce soir plus particulièrement Yoruba, peuple en particulier
du Nigeria et du Bénin, pris en esclavage et vendu dans les pays d’Amérique
Latine, dont Cuba, où son influence sur la musique est grande; on connaît
les tambours yorubas. Yilian Cañizares est de cette origine, elle jouera
un morceau de sa composition dédié à son grand-père Yoruba, et un autre à sa
mère de la même ethnie. Elle chante en yoruba, en espagnol et en français, et
de plus elle chante en s’accompagnant au violon, avec parfois des unissons à la
Slam Stewart. Une belle voix, chaude, souple, prenante, qui peut exprimer aussi
bien la douceur, dans une berceuse, le célèbre «Duerme Negrito», ou
sur une ancienne prière du Nigeria «Ochumo» (orthographe non
garantie), que la passion et la colère. Un hommage au compositeur Simon Diaz,
vénézuélien comme le contrebassiste, et un salut à ce peuple. Yilian Cañizares
est une très bonne violoniste classique, elle est très expressive, avec parfois
un emportement à la tzigane, mais elle n’a absolument pas le phrasé jazz, sauf
sur quelques mesures par-ci par-là de facture quelque peu grappellienne. Son pianiste, berlinois, sonne
parfaitement cubain, le contrebassiste est solide mais le batteur à la frappe
lourde; heureusement le conguero (avec seulement trois congas ce soir)
s’est chargé de booster brillamment le contexte rythmique.Belle présentation de
Yilian Cañizares, fragile et pourtant dominante, touchante dans un ensemble où
le rouge domine, auréolée par une énorme coiffure afro rousse, virevoltant et
dansant comme un lutin avec un sourire à dérider les plus coincés. Un beau et
bon concert de chansons cubaines. Pour le jazz on verra demain.
Le 20 juillet, Jean-Luc Ponty (vln), Biréli Lagrène
(g), Kyle Eastwood (b) étaient réunisen bas du Marché Lafayette, près du port. Un excellent concert. Voyant et écoutant Jean-Luc Ponty
je me remémorais le concert mythique à Châteauvallon en 1972, je crois, avec le
jeune Stanley Clarke (19 ans) à la contrebasse, et le grand batteur de Miles,
Tony Williams. Ponty n’a rien perdu de son jeu, olympien de facilité, de
lyrisme dans des solos cinq étoiles. Kyle Eastwood se révèle un contrebassiste
étonnant, d’une dextérité et d’une vélocité incroyables, avec des attaques
nettes, au service d’un phrasé quasiment guitaristique. D’ailleurs dans la
complémentarité contrebasse/guitare, on ne distinguait plus de qui étaient les
phrases, l’un en lançant une, l’autre la reprenant et la développant, ou
partant à l’unisson. Quant à Biréli, je ne sais comment il se débrouille, j’ai
beau regarder sa main droite, mais tout en assurant une rythmique d’enfer
(piano-batterie à lui tout seul), il arrive à phraser; des phrases qui
tournoient comme des chansons. Quand je lui ai demandé comment il faisait, il
m’a répondu: C’est facile! Quelques standards au répertoire et des
compositions des trois musiciens: Une «Samba de Paris» dynamitée,
une «Andalucia» d’Eastwood avec une intro basse pharamineuse;
«Renaissance» de Ponty, véritable hymne à la vie;
«Stretch» de Biréli, qui s’envole littéralement. Le moment le plus
chargé d’émotion et de lyrisme contenu fut sur «Mercy, Mercy» de
Zawinul; c’est beau quand soudain on entend que le public retient son
souffle. Le premier vrai concert pleinement jazz du
festival, et quel concert! Cela valait la peine d’attendre!
Le 21 juillet,
place de l’Equerre, dans la vieille ville, la jeune chanteuse britannique, Jo
Harman, est apparue vêtu d’une longue robe bleue, portant couronne sur ses
cheveux, avec aux pieds des baskets blanches, pur tableau du temps du Flower
Power; sa musique vient de cette époque également. Elle est entourée,
accompagnée, par quatre musiciens (Terry Lewis, g, Steve Watts, cl, Andy Tolman, b, Martin Johnson, dm, qui
font bien le job, comme on dit, avec tous les effets et les facilités du genre,
c’est à dire du pop-rock britannique. A noter que le piano électrique sonnait
comme une casserole. La demoiselle possède une voix qu’on entend beaucoup dans
la pop anglo-saxonne. Elle a une grande maîtrise sur une belle tessiture,
capable d’aller de la douceur à l’impétuosité. Elle chante avec un engagement
total du corps, bougeant d’une façon à la fois touchante et affriolante, avec
une belle présence, occupant toute la scène. En revanche, le comportement du
guitariste et du bassiste est intolérable: quand ils ne jouent pas, et
que la chanteuse se donne à fond, ils sont là qui discutent et se marrent comme
des pingouins sur la banquise; bien sûr dès que leur tour arrive, ils sont
impeccables; ils font leur boulot, y nada mas! Un concert qui
réjouit un vaste public, mais de jazz pas une ombre.
Le 22
juillet, plages du Mourillon, on s’attendait au grand concert du festival et,
amère déception, Roy Hargrove était bien présent physiquement mais absent
musicalement, ou presque. Quand le trompettiste se risque à quelques figures de
break dance, qu’il chante, le résultat n’est pas à la hauteur, malgré un
formidable quintet hard bop: Justin Robinson (s), Sullivan Fortner (p),
Ameen Saleem (b), Quincy Phillips (dm).Globalement le phrasé de Roy est absent,
sauf sur deux belles ballades qu’il interprète au bugle où l’on retrouve le
musicien à son niveau. A noter là un splendide solo de batterie: sur une
ballade, il faut le faire. Pour le reste ce sont des riffs, des bouts de phrase,
parfois une courte envolée, et des imperfections qui nous font penser que Roy
Hargrove avait visiblement un problème ce soir-là. Heureusement, la rythmique
était d’enfer et le leader lui a judicieusement laissé une large place.

Les concerts d’après-midi:
Place Camille Ledeau, le 18 juillet, un bon groupe de fusion,
Groovology (Thomas Turunen, cl, Gabriel Charrier, tp, Julian Boudrin, s, Philippe
Mege, b, Jérémie Eloire dm) dans le style des Brecker Brothers. Les
arrangements sont simples et efficaces, qui permettent aux musiciens de
s’exprimer en longs solos. Bonne mise en place et bon choix de répertoire. A
noter que le contrebassiste remplaçait le titulaire au pied levé, et qu’il s’en
est sorti avec les honneurs.
Place Puget, le 19 juillet, Shoeshiners Band (Alice Martinez, voc, ukulélé, Ezequiel Celada, s, cl, Sylvain
Frou Avazeri, tp, tb, Gabriel Manzanèque g, bjo, Olivier Lalauze, b, Stéphane Zef
Richard, dm, washboard), reprend, tant dans la présentation que dans la
musique, le jazz swing/new orleans revival des années quarante, sur de bons
arrangements originaux et une mise en place parfaite. Alice Martinez chante les
mots, scate très swing, avec une voix charmeuse, un bon feeling, et une
décontraction admirable. Du beau travail.
Le 20 juillet, le guitariste Claude Basso présentait son travail
de compositeur et arrangeur exécuté par son groupe constitué de Pascal Aignan (ts,) Olivier Chaussade (ts), Adrien Coulomb (b),
Thierry Larosa (dm), tous excellents jazzmen vivant dans la région. Un groupe
homogène, à l’écoute, parfaitement en place. Claude Basso a concocté des
morceaux très nettement sous l’influence du Monk des années cinquanbte, avec
ses ruptures, ses changements de rythme, et tout ce qu’il faut pour lancer les
solistes. Les arrangements pour les deux ténors sont remarquables avec quelque
chose d’Ellington dans l’harmonisation. Deux ténors semblant venir de la lignée
Lester Young-Sonny Rollins, pour faire vite. Aignan étant plus rentre dedans,
plus bouillant, tandis que Chaussade tourne autour du thème, l’effleure avant de
lancer la machine; tous deux sont parfaitement complémentaires, et font
le travail d’une section de cuivre complète. Basso, le guitariste tranquille,
dans la grande tradition de la guitare jazz sait faire monter la pression dans
ses solos; avec la contrebasse et la batterie on a une rythmique solide
et tournante, pour du jazz pur fruit.
Toujours place Puget, le 21 juillet, le Sardana
Jazz Quartet, composé de Jean-Luc Savalli (p, lead), Denis Fouriot (tp),
Pierre Navarro (b) et Gilles David (dm), dans un jeu
mainstream-bop parfaitement intégré, était tout à fait à l’aise sur les grands
standards auxquels ils apportent une touche personnelle, comme par exemple sur
«Take The A train» de Strayhorn ou «In a Sentimental
Mood» du Duke, avec une belle et longue intervention du bugliste et du
bassiste. Un beau et nostalgique «Softly as a Morning Sunrise». Le
bassiste électrique est remarquable de vélocité sur les tempos rapides, et de
lyrisme sur les tempos lents. Un Quartet de bon aloi.
Autres
manifestations:
Le 18 juillet, une parade circulait de 10h à 12h30 dans les
quartiers du centre ville avec Freaks Band et d’autres musiciens, amateurs et
professionnels, pour faire la fête.
Du 18 au 21juillet, 13h à 16h, étaient proposées des
scènes ouvertes de avec le trio Jazz in the City -Marc Tosello (b), Lucien Chassin (dm)
et Michel Gagliolo (p)– qui accueillaient
sur une place du centre ville les musiciens qui voulaient s’exprimer en groupe
ou recevoir des conseils. On eut quelques déconvenues mais aussi de belles
surprises. La formule a rencontré un grand succès.
Cette année une grande place a été donnée aux musiciennes,
mais hélas pas une seule vraie jazzwoman, alors qu’on n’en manque pas,
notamment en France. A l’image de bien d’autres festivals, Jazz à Toulon
affiche le mot jazz mais le met en minorité dans sa programmation,
particulièrement sur les grandes scènes. On sait néanmoins gré au festival de
permettre encore d’écouter du jazz dans le cadre d’une opération dont le but
premier est l’animation de quartier.
Serge Baudot
Texte et photos
© Jazz Hot n° 681, automne 2017
|
Antibes/Juan-les-Pins, Alpes-Maritimes
Jazz à Juan, 14-23 juillet 2017
Il
est toujours agréable de retrouver la Pinède Gould qui depuis 1960
accueille l’un des plus célèbres festivals de jazz de France et du
monde, créé, entre autres, par un ancien de Jazz Hot, Jacques
Souplet. La première édition rendit hommage à Sidney Bechet qui venait
de disparaître, avec l’inauguration du célèbre buste. De Rosetta Tharpe,
Charles Mingus, Bud Powell, Ted Curson, Eric Dolphy, Stéphane
Grappelli, Martial Solal, René Urtreger, Claude Luter, etc., présents
lors de la première édition, à l’actuelle édition, l’histoire et
beaucoup des gloires du jazz ont fait étape avec régularité sur cette
scène prestigieuse: on se souvient en particulier d’Ella Fitzgerald et
de la cigale, de Duke Ellington, avec Ella aussi, Louis Armstrong,
Erroll Garner, Dizzy Gillespie, Oscar Peterson, B. B. King, Aretha
Franklin, Miles Davis, John Coltrane, pour n'en citer que
quelques-un(e)s qui ont écrit les pages de la légende. Le premier compte
rendu dans les colonnes de Jazz Hot (n°157, septembre 1960) est
de Charles Delaunay en personne, et de toutes les scènes alors proposées
(le Fort en particulier), il recommande de privilégier la Pinède Gould.
L’histoire lui a encore donné raison pour cette 57e édition…

Mardi 18 juillet
Wayne Shorter Quartet: Wayne Shorter (ts, ss), Danilo Perez (p), John Patitucci(b), Brian Blade (dm)
A
presque 84 ans (il est né le 25 août 1933), Wayne Shorter est devenu à
l’instar de Sonny Rollins, son aîné de seulement trois ans, l’autre
légende encore vivante du saxophone de l’histoire du jazz contemporain.
Sa longue et glorieuse traversée est marquée par de grandes étapes. La
belle époque auprès d’Art Blakey (1959-1964) qui le révèle au grand
public et l’amène en Europe pour la première fois; sa consécration au
sein du quartet de Miles Davis (1964-1969), son ascension au rang de
véritable vedette en cofondateur de Weather Report (1970/1985); enfin,
avec son quartet actuel qu’il dirige depuis l’an 2000 et qui l’a
intronisé au rang d’icone. Seule la période de 1985 à 2000 apparaît
moins fondamentale, même s’il participe aux côtés d’Herbie Hancock à des
tournées de V.S.O.P ou joue avec Carlos Santana… Le Festival d’Antibes
l’accueille pour la 11e fois, un hommage à sa longue carrière et à la
célébration d’un des plus prolixes compositeurs que ses différents
groupes au fil du temps ont largement sollicités. Le répertoire actuel
correspond à une profonde introspection, et ses thèmes s’enchaînent sans
nul besoin de présentation, comme une longue suite alternant saxophone
ténor ou soprano. Cette approche longuement pensée a commencé au contact
de John Coltrane pour aboutir aujourd’hui à une marque de fabrique qui
va au-delà de sa contribution aux rythmes d’Art Blakey, de la recherche
de renouveau de Miles Davis ou de la machine foudroyante du jazz-rock
de Weather Report. Wayne Shorter est désormais un sage, une figure
emblématique qui arrive avec une musique, difficile à priori, à capter
un vaste auditoire subjugué. Antibes à ce mérite d’avoir présenté des
artistes tels John Coltrane, Cecil Taylor, Anthony Braxton, ou encore
Ornette Coleman au grand public. Ce quartet fonctionne au regard, au
sourire: une entente parfaite laisse à chacun l’espace de s’exprimer et
si, aujourd’hui, ses sidemen sont aussi les leaders de leur propre
formation, ils redeviennent ici les disciples du maître qu’ils suivent
fidèlement et qu’ils honorent par un niveau technique et une inspiration
sans faille. S’installant tranquillement, le groupe délivre une potion
magique qui s’infiltre dans l’inconscient pour laisser place à un
ravissement étrange qui durant 80 minutes envoute. L’heure du rappel
vient et dans un boléro original l’artiste resalue l’audience. A
signaler que Wayne Shorter apparaît comme le conteur principal dans le
film consacré à Lee Morgan, I Call Him Morgan, qui vient d’être présenté
à Marseille et dont on peut espérer la diffusion prochaine en France.
Wayne Shorter précise que c’est grâce à Lee Morgan qu’il a été recruté
par Art Blakey. Quel chemin parcouru depuis dans cette carrière hors
norme!
Branford Marsalis Quartet With special guest Kurt
Elling: Branford Marsalis (ts, ss), Joey Calderazzo (p), Eric Revis (b),
Justin Faulkner (dm), Kurt Elling (voc)
En 2001, Branford
Marsalis devait jouer pour la première fois à Antibes et aléas de la
météorologie, le concert face aux trombes d’eau, fut annulé. Seul un
petit cercle, dans un lieu à l’abri, avait assisté à un bœuf, paraît-il
mémorable. Le revoici donc avec ses mousquetaires invitant le crooner
Kurt Elling pour une tournée estivale de haut-vol. Pour avoir écouté le
quartet à plusieurs reprises, dont un magnifique concert à Perugia, on
ne pouvait que s’attendre à une parfaite entente qui prouve que les
groupes réguliers apportent à leur répertoire une dimension inégalée. Le
groupe ouvre cette seconde partie par un titre enthousiaste, Branford
Marsalis, lui aussi, valsera du soprano au ténor au fil des
compositions. Kurt Elling, en digne invité, fait son apparition, moins
bavard que dans son propre groupe, mais chantant tout aussi bien. Il se
lance sur les traces de Porgy and Bess de Gershwin en interprétant
«There's a Boat Dats Leavin' Soon for New York». Kurt Elling est l’un
des excellents talents vocaux du monde du jazz ; Sa carrière aux
Etats-Unis et en club est très riche, mais il manque encore en Europe de
la véritable reconnaissance qu’il mérite. A son habitude, le
saxophoniste laisse une grande liberté à ses musiciens, surtout à Joey
Calderazzo, un grand du clavier, même si sa carrière de leader reste en
retrait. Le répertoire alterne compositions de Branford Marsalis et
répertoire de standards de Kurt Elling, qu’ils ont enregistré sur
l’album Upward Spiral, «Blue Gardenia», « I’m fool to Want You»,
«Pratical Arrangement», « Doxy». Kurt Elling rappelle sa passion pour la
bossa nova avec «So Tinha De Ser com Voce» ou encore un final en clin
d’œil à Antonio Carlos Jobim avec l’évocation d’«Aguas de Março». Le
concert est justement réparti entre titre en quartet où la rythmique
fait merveille, laissant à chacun son espace d’expression et une juste
place au chanteur qui scatte parfaitement avec sobriété. Lors du rappel,
un cérémonial néo-orléanais enthousiasme le public debout, rappelant
une parade avec un Kurt Elling, verre plastique à la bouche,
reproduisant le son de la trompette bouchée.
Mercredi 19 juillet
Macy Gray: Macy Gray (voc), William Wesson (kb,ts,fl), Jonathan Jackson (kb), Caleb Speir (eb), Tamir Barzilay (dm)
On
attendait avec impatience cette nouvelle tournée de Macy Gray,
allait-elle reprendre les thèmes et le groupe, très blues et jazz, de
son magnifique album Stripped* enregistré en 2016 ou proposer un groupe
dans une lignée moderne rhythm & blues? Ce fut la seconde solution
qui doit mieux convenir à une tournée de grands festivals d’été. Avec un
groupe resserré, la chanteuse à la voix si particulière a défendu son
projet avec une force, une rage et une ténacité dignes des plus
grandes. Un seul regret l’absence d’une section de cuivres, mais William
Wesson, instrumentiste polyvalent passe allégrement des claviers, au
saxophone ténor, de la flûte au mélodica sans oublier d’assurer les
chœurs. Drôlement costumé en complet à carreaux, l’orchestre a assuré
comme la chanteuse. Tour à tour féline et romantique, susurrante ou
coléreuse, l’authentique Macy Gray s’inscrit dans la droite ligne de
Tina Turner pour défendre ses grands titres qui recueillent tant de vues
sur internet et soulève le public de son siège. Elle nous livre des
versions dynamiques de «Do Something», «Beauty With World», «Finally
Made Me Happy », «She Ain’t Right For You», sans oublier son tube «I
Try» et, pour le final, un version vitaminée de « My Way». Notons
l’excellence de la rythmique où Tamir Barzilay et Caleb Speir ont donné
le bon tempo.
Gregory Porter: Gregory Porter (voc), Tyvon
Pennicot (ts), Chip Crawford (p), Jahmal Nichols (b), Ondrej Pivec (org
Hammond), Emmanuel Harrold (dm)
Pour avoir écouté de nombreux
concerts de Gregory Porter, qui se ressemblaient forts, à l’exception de
ses participations remarquables, à ses débuts, auprès de Robin McKelle
puis son invitation au sein du Lincoln Jazz Orchestra dirigé par Wynton
Marsalis (avec Cécile McLorin Salvant), allait-on assister à une énième
version de son tour de chant?
Mais Gregory Porter, tout en restant
fidèle à ses accompagnateurs présents sur ses albums, a fait bouger les
lignes et mis sur le devant de la scène l’excellent Tyvon Pennicott
(ts), remarqué notamment dans le quartet d’Al Foster, et l’organiste
tchèque Ondrej Pivec. Ces changements l’inscrivent encore plus dans une
démarche reliant le gospel à la scène jazz de Harlem. Chacun des
musiciens a eu droit à son moment de bravoure mais c’est surtout le
discret mais plus qu’efficace Tyvon Pennicott qui cisèle le répertoire
du grand chanteur tant par la taille que par la voix, le saxophoniste
apparaît minuscule devant la masse du colosse à la casquette. Tour à
tour charmeur et crooner, dans ses chansons d’amour «Hey Laura »,
«Consequence of Love» ou « Brown Eye Girl», il s’inscrit dans la pure
tradition avec la superbe évocation de ses aînés et de ses références
(John Coltrane, Marvin Gaye, Abbey Lincoln…) dans «On My Way to Harlem».
Variant les combinaisons d’accompagnement, du duo piano-voix,
orgue-voix, il sait utiliser la palette de ses musiciens et des climats,
souvent tendres, pour délivrer un tour de chant qui fait de lui avec
Kurt Elling l’un des chanteurs actuels intéressants dont l’univers
dépasse largement le jazz. Clin d’œil aux anciens avec un «Nature Boy»
que Nat King Cole n’aurait pas renier et une introduction de «Shaft»
suivi de «Papa Was a Rolling Stone», puisés chez Isaac Hayes et the
Temptations qui sont autant de grands titres qui s’inscrivent dans la
Great Black Music. Le grand Gregory Porter aura donné à Antibes un de
ses plus beaux concerts. La classe !
Jeudi 20 juillet
Sting
with special guest Joe Sumner: Sting (eb, voc), Dominic Miller, Rufus
(g), Josh Freese (dm), Joe Sumner (chœur, g, voc), Percy Gardona (acc)
C’est
une tournée familiale qui réunit père et fils, celui de Sting et celui
de son fidèle guitariste Dominic Miller. L’ouverture de la soirée
propose en effet Joe Sumner, le fils de Gordon Sumner alias Sting. Le
fils est aussi le chanteur et bassiste du groupe de rock anglais Fiction
Plane. Le père introduit le fils, et ils entament un duo vocal
acoustique rappelant la tradition folk anglaise. Resté seul en scène,
Joe Sumner prouve sa maîtrise vocale pour un court passage qui met en
valeur ses compositions. Il fait désormais parti du groupe actuel de son
père et ils se retrouvent en fin de soirée, après l’intermède Hiromi.
Sting reprend alors des titres de son dernier album (le 12e en solo)
57th & 9th, et il enchaîne les tubes de sa déjà longue carrière. Sa
musique a côtoyé le jazz avec ses premiers albums personnels, The Dream
of the Blue Turtles (1985) ou Bring of the Night (1986) qui réunissaient
entre autres Branford Marsalis, Darryl Jones (eb) Kenny Kirkland… Mais,
petite faute de goût pour cette scène mythique du jazz, c’est son
répertoire rock depuis Police qui assure ce soir-là son succès, avec un
record d’assistance pour le festival…
Hiromi duo featuring Edmar Castañeda: Hiromi (p), Edmar Castañeda (harp)
On
se référera au n°680 de Jazz Hot, été 2017 (Festival de St-Gaudens)
pour rappeler le parcours de la pianiste Hiromi et de sa rencontre avec
le harpiste colombien Edmar Castaneda. Leur tournée a démarré en mai
2017 et, en 2 mois, le duo a pu peaufiner un répertoire original où les
deux protagonistes brillent de leur talent d’improvisateurs. Nullement
impressionnée de jouer en première partie de Sting, qu’elle évoque comme
l’un des stars de sa jeunesse, la Japonaise, toujours la crinière
électrique, va interpréter et défendre une partie de son répertoire, ici
écourté, devant une immense audience (le record du festival). Le duo
démarre sur deux compositions d’Edmar Castañeda, «Entrecuerdos», puis
un hommage à Jaco Pastorius, «Para Jaco», où le son des cordes basses de
la harpe évoque le jeu du bassiste. Le dialogue est permanent et le jeu
très scénographié de la pianiste ajoute à la qualité de sa prestation.
On a écrit que le duo ressemblait à un big band. Hiromi rappelle qu’elle
est aussi compositrice et propose sa longue suite «Elements» qui se
divise en quatre tableaux, «Air, Earth, Water et Fire». Un duo encore
magnifique qui a réussi une nouvelle fois son pari de rallier un vaste
public sur un répertoire difficile, encore plus risqué ce soir devant un
public venu pour Sting.
Vendredi 21 juillet
Shabaka
& the Ancestors: Shabaka Hutchings (ts), Mthuni Mvubu (as), Ariel
Zomonsky (b), Tumi Mogorosi (dm), Gontse Makheme (perc), chanteur non
ptécisé (voc)
Cette soirée, comme l’a précisé, le présentateur,
était dédié à la célébration d’un jazz authentique, traversant les
époques et se voulant représentatif de l’ancienne génération et de la
relève par la jeune garde. Hélas il semble que le public semble avoir
répondu moins nombreux.
La soirée débuta avec le saxophoniste
britannique Shabaka Hutchings qui vient de signer avec un de ses
groupes, The Ancestors, son premier album Wisdom of Elders. Enregistré
en Afrique-du-Sud, le groupe défend l’héritage du jazz mais aussi de
l’Afrique. Selon Shabaka «les choix de vos ancêtres, leur histoire, ont
un impact sur vous, libre ensuite à chacun d'en tirer les leçons qui lui
sont utiles… C’est aussi bien l’histoire de son arrière-grand-père qui
servit dans l’armée britannique au moment de la Première Guerre mondiale
et qui échoua quelque temps à Cape Town, qui sert son énergie, autant
que le souvenir de John Coltrane et Pharoah Sanders en 1965» Il s’est
entouré avec ses Ancestors de musiciens aguerris de Cape Town et de
Londres et dans une sorte de longue suite, entrecoupée de chants, il
évoque la voix de ses ancêtres. Normalement le chant est porté par la
voix de Siyabonga Mthembu qui pour cette soirée fut remplacé. Le
concert, plus bref que d’habitude, laisse présumer ce que peut être
l’incantation qu’il désire atteindre et offrir à l’auditoire, comme lors
de ses longues performances.
Robert Glasper Experiment:
Robert Glasper (kb, fender Rhodes), Casey Benjamin (voc, kb, ts, ss),
Burniss Earl Traviss II (eb), Justin Tyson (dm), Mike Severson (g)
Robert
Glasper est-il le caméléon du jazz actuel, toujours où on ne l’attend
pas et dans de nombreux et différents projets. En trio acoustique, à la
commande de bandes sonores comme Miles Ahead, le film sur Miles Davis,
ou dans ses formules «expérimentales» où le jazz se marie à l’électro,
le funk, le rap ou encore le hip hop. Décoré de multiples Grammies
Awards pour ses collaborations avec Kanye West, Jay-Z ou Mos Def, il
semble plus apprécié des scènes de musiques actuelles que des clubs de
jazz, du moins en Europe. Pour sa première participation au Festival de
Juan-les-Pins, il propose son quartet habituel renforcé d’un guitariste
de rock. Tel une machine, il ne laisse aucun répit tant par le volume
sonore que par la diversité de ses interventions. Il démarre sur un
hommage à Herbie Hancock «Once Upon the Time» où s’exprime son toucher
dans un long solo au fender Rhodes, puis alternera compositions
originales et clins d’œil tels, «Show Me the Way», «The Sweetest Taboo»
et même un «Roxanne» dévastateur. Le muti-instrumentiste Casey Benjamin,
assure dans tous les cas de figure et sa présence sur le devant de la
scène peut laisser penser un court moment que s’est lui qui dirige
l’orchestre. En fait, il est le double du pianiste qui grâce à sa
versatilité peut servir du fond du court. Sur les parties les plus
calmes Robert Glasper nous rappelle Lonnie Liston Smith, lui aussi grand
maître des claviers, qui puisait son inspiration avec son Cosmic Echoes
dans l’univers de la planète soul et funk sur fond de jazz. Une
première qui a pu surprendre un public plus âgé qui s’était réfugié en
haut des gradins en attendant Archie Shepp. Loin d’une réputation de
grande gueule, le pianiste après son concert n’a pas hésité à aller à
l’encontre des spectateurs.
Archie Shepp: Archie Shepp (ts, voc), Marion Rampal (voc), Carl-Henri Morisset (p), Mathias (b), Steve McCraven (dm)
Depuis
plusieurs années, Archie Shepp ne s’appuie pas sur un groupe régulier, à
part son dernier épisode de la saga Attica Blues Big Band. Au fil des
concerts, on retrouve d’excellents musiciens, vétérans comme ce soir
Steve McCraven ou des plus jeunes comme le brillant Carl-Henri Morisset
qui s’est illustré auprès de Riccardo Del Fra, Eddie Henderson ou encore
Ricky Ford. SI Cette conception du partage est louable, elle laisse
néanmoins le souvenir nostalgique de ses groupes de haut niveau du passé
de part et d’autre de l’Atlantique.
Archie Shepp symbolisait ce
soir la mémoire, la tradition qui au cours de sa carrière l’a vu passer
du free jazz le plus radical (John Coltrane, John Tchicaï…) à la
relecture de la grande musique classique afro-américaine, Duke Ellington
en tête. Sa très longue carrière ne peut se résumer à quelques lignes,
mais l’écoute de ses magnifiques albums chez Impulse!, Denon, Marge,
SteepleChase ou Enja, pour ne citer que certains labels, résume un pan
de l’histoire du jazz des cinquante dernières années. Avec cette
formation, il a décidé de traverser son histoire avec des standards et
certains de ses titres emblématiques. Le son est moins puissant mais
toujours émouvant, et Archie Shepp joue, malgré son âge, sans
discontinuer en premier plan. Il attaque par un hommage au pianiste très
oublié, Elmo Hope, suivi du désormais traditionnel « Don’t Get Around
Much Anymore» d’Ellington, laissant après sa partie vocale la part belle
au pianiste qui prouvera toute sa compétence. Sur le morceau suivant «I
Know About the Life» enregistré en 1981, avec l’un de ses meilleurs
quartet (Ken Werner, Santi De Briano, John Bestch) il invite la
chanteuse Marion Rampal qui depuis la reprise de l’Attica Blues Big Band
le rejoint régulièrement sur scène. La chanteuse d’origine
marseillaise, relève très dignement le défi et elle a su, sur chacun des
titres qu’elle interpréta, sans aucun cabotinage, s’intégrer à
l’univers du saxophoniste. Archie Shepp en vieux combattant, toujours
attentif aux défis enchaîne «Burning Bright» composé par Tom Mc Clung,
son ami et pianiste depuis 1996 (disparu en mai dernier, cf. notre
rubrique nécrologique) et «Blues For Brother George Jackson» signé de
sa plume. Il rend ici un vibrant hommage au militant des Blacks Panthers
et défenseur des droits de l’homme, assassiné à la prison de Saint
Quentin lors d’une révolte (21/08/1971). Au final, un concert plein
d’émotion pour ce géant du jazz qui, à tout juste 80 ans, reste encore
actif.
Pour sa 57e édition, le Festival Jazz à Juan annonce une fréquentation de près de 30000 spectateurs. Rendez-vous est donné pour la 58e édition de Jazz à Juan qui aura lieu du 14 au 22 juillet 2018. A l’année prochaine!
Michel Antonelli
Texte et photo
© Jazz Hot n° 681, automne 2017
|

Iseo, Italie
Iseo Jazz, 14-16 juillet 2017
Exemple unique dans la multitude des festivals disséminés sur la
péninsule, et qui en est à sa 25e année de vie, Iseo Jazz a
fermement maintenu l’engagement de mettre en avant la scène du jazz italien, en
privilégiant et promouvant des projets originaux, avec une attention
particulière portée aux talents émergents: ceci grâce au travail
scrupuleux du directeur artistique, le musicologue Maurizio Franco. Le festival
porte ainsi le slogan mérité de «La casa del jazz italiano» (La maison
du jazz italien). Bénéficiant du cadre magnifique du lac d’Iseo, la
manifestation s’est enracinée dans le territoire, grâce aux multiples
événements qui l’ont précédée dans différentes localités limitrophes de la
province de Brescia. Le noyau principal de la programmation a coïncidé avec les
trois soirées finales, qui se sont tenues comme d’habitude à Iseo, sur le
parvis de la Pive di Sant’Andrea et au Lido de Sassabanek. Cette année 2017
correspondait également au 50e anniversaire de la mort de John
Coltrane et au 100e de la naissance de Thelonious Monk. Deux projets
spéciaux furent ainsi dédiés à ce dernier qui, partant de la vision géniale du compositeur, visaient à
mettre en valeur ses aspects encore inexplorés.
En trio avec Giancarlo Bianchetti (g) et Giovanni Giorgi (dm), le
saxophoniste Pietro Tonolo a traité l’œuvre de Monk comme un flux ininterrompu
de compositions: «Reflections», «Bemsha Swing» et «Misterioso». Cette
démarche s’accompagne de l’utilisation de l’électronique (d’où ElectroMonk, titre du projet et du CD
éponyme). Outre les saxes ténor et soprano, Tonolo utilise la flûte basse et leflutax, une flûte traversière dont le
son est modifié par l’emploi d’un bec de soprano et l’utilisation du delay. Giorgi élargit les possibilités rythmiques à l’aide de live electronics et d’un pédalier de guitare relié à la batterie.
Bianchetti est capable de produire un large éventail de couleurs et de nuances.
La composante rythmique se trouve exaltée par le traitement insolite réservé à «‘Round
Midnight» et par les progressions urgentes de «Epistrophy» et «Bright
Mississippi», qui dans quelques cas rappellent le trio Motian-Lovano-Frisell.
 Vocalese Monk? Cela semble une
contradiction dans les termes. Pour autant, Daniela Spalletta (voc) a osé transposer
les thèmes et les improvisations de Monk au chant. C’est encore plus courageux
(ou risqué!) si l’on considère l’absence d’instruments harmoniques. Dans le
dialogue avec Alberto Fidone (b) et Peppe Tringali (dm), Daniela s’aventure avec
désinvolture sur les lignes asymétriques de «Monk’s Dream» et sur les éclats
impulsifs de «Straight No Chaser», témoignant d’une maîtrise dans
l’articulation du phrasé, en dépit d’un spectre vocal encore limité. Monk se
trouve encadré dans l’optique des autres: Joe Henderson dans le solo de «Ask Me
Now»; Wynton Marsalis en asséchant la respiration orchestrale de «Four in One».
Un chant riche en profondeur caractérise Ada Montellanico, qui, avec son
quintet, proposait le projet Abbey’s Road, une relecture passionnante du
répertoire d’Abbey Lincoln. La chanteuse met son expression au service du
collectif, interagissant avec Filippo Vignato (tb) et Giovanni Falzone (tp), auteurs
d’arrangements efficaces. La capacité narrative et l’identification au texte
ressortent, même dans des morceaux comme «Driva Man» et «Freedom Day», tirés deWe Insist! Freedom Now Suite de Max
Roach, album-manifeste historique qui se plaçait dans le droit fil de la lutte
pour les droits civils. Le phrasé fluide et la richesse des accents s’apprécient
pleinement dans «Wholly Earth» chargé de polyrythmie africaine, et dans un
«First Song» de Charlie Haden, exprimé avec des pauses judicieuses. Une
concision riche en contenu caractérise les arrangements qui font ressortir les
ensembles mais valorisent en même temps les équilibres entre Matteo Bortone (b)
et Ermano Baron (dm), le phrasé incisif de Vignato, la finesse cristalline des
constructions mélodiques de Falzone.

Depuis 1980 Tiziano Tononi (dm) et Daniele Cavallanti (ts) animent
Nexus, avec l’objectif de développer, dans une perspective européenne, les
exigences proposées par l’avant-garde afro-américaine des années 60 à 70, se tenant
à une distance appropriée du free historique. Leur approche privilégie d’amples
installations modales avec d’occasionnels glissements atonaux, de la polyphonie
et des schémas d’appels et de réponses, des constructions polyrythmiques qui
mettent en évidence, par intermittence, une matrice africaine. D’ailleurs
Tononi est en quelque sorte débiteur aussi bien d’Andrew Cyrille que d’Ed
Blackwell, tandis que l’approche au ténor de Cavallanti vient en grande partie
de Dewey Redman. Cela démontre qu’en définitive à la racine de leur musique il
y a aussi l’esprit révolutionnaire d’Ornette Coleman et de Don Cherry. Les contrastes
et les combinaisons entre les autres voix instrumentales s’avèrent plus
dynamiques: Alberto Mandarini (tp), Francesco Chiapperini (as, bcl), Emanuele
Parrini (vln), Pasquale Mirra (vib) et Andrea Grossi (b).
Tandis quel les concerts qui se sont tenus sur le parvis de la Pieve di Sant’Andrea ont proposé cette
remarquable densité de contenu, la soirée au Lido di Sassabanek a mis en
confrontation deux approches totalement différentes du rapport entre le jazz et
la musique populaire.
Shardana est le projet
avec lequel Zoe Pia se confronte à l’héritage de sa Sardaigne natale. La jeune
clarinettiste qui a mené aussi une activité dans le domaine classique, a rassemblé
un quartet singulier formé de musiciens ayant comme elle joué avec le
trompettiste Marco Tamburini, disparu prématurément il y a deux ans: Roberto De
Nittis (p, kb), Glauco Benedetti (tuba basse), Sebastian Mannutza (dm, vln).
L’idée de base est intéressante: partir de la répétitivité de certains motifs
folkloriques, soutenus parfois par les typiques launeddas et l’enregistrement de chants traditionnels, pour
développer des formes d’improvisation.
 Le batteur Tullio De Piscopo, à qui a été remis le Prix Iseo, a derrière
lui une carrière longue et variée. Animateur de la scène italienne depuis les
années 70 De Piscopo peut se prévaloir de nombreuses et prestigieuses
collaborations avec des artistes du calibre de Wayne Shorter, Bob Berg, John
Lewis, Billy Cobham, Gerry Mulligan, Astor Piazzolla (pour n’en citer que
quelques-unes). Comme batteur il est doté d’un swing impeccable, d’un drive
fluide, d’un impressionnant contrôle des dynamiques et d’une fine musicalité.
En outre, il est capable littéralement de faire «chanter» l’instrument, comme
le montrent quelques-unes de ses figures modelées sur des phrases mélodiques:
une caractéristiques qui lui vient sans aucun doute de ses origines
napolitaines. A partir des années 70, De Piscopo s’est consacré aussi à la
musique commerciale, mais toujours avec goût: avec le chanteur-guitariste
Pino Daniele, et aussi à son compte à la fois comme chanteur et batteur. Dans le
plaisant concert d’Iseo, on a pu apprécier les aspects variés d’une forme
intelligente de divertissement: les polyrythmies de «Anticalypso»,
composées du guitariste Roland Prince pour le quintet d’Elvin Jones; le jazz-rock
de «Toledo», du répertoire de Pino Daniele; un solo de batterie très «cantabile»:
les succès commerciaux des années 70 comme les contagieux «Stop Bayon» et
«Andamento lento»: de la soul et du funk à profusion dans les versions
«napolitanisées» de «Sex Machine» de James Brown et «Cantaloupe Island» de
Herbie Hancock. Pour démontrer que dans une interprétation moderne du concept
de «populaire» -ou popular d’un point
de vue anglo-américain- on peut conjuguer la perfection instrumentale, la
musicalité, la créativité, le spectacle, et (pourquoi pas?) le divertissement.
Encore une fois donc, Iseo Jazz a su mettre sur le même plan –toujours
avec une grande attention à la qualités des choix-recherche, innovation et
tradition, le rapport entre l’actualité et l’histoire du jazz, sans jamais en
oublier sa nature de musique populaire.
Enzo Boddi
Traduction-Adaptation Serge Baudot
© Jazz Hot n° 681, automne 2017
|
Toucy, Yonne
Toucy Jazz Festival, 14-15 juillet 2017
Le 9e édition du Toucy Jazz Festival
bénéficie de l’expérience acquise par Ricky Ford au service de la passion, bien
épaulé en la circonstance par son épouse Dominique. La ville de la Puisaye a
une nouvelle fois célébré l’esprit du jazz et du blues durant le troisième
week-end de juillet, et le Toucy Jazz Festival a été cette année marqué par deux concerts
phares dans le parc de la Glaudonnerie, celui de Mighty Mo Rogers, figure
éminente du blues contemporain, et celui de China Moses, bien connue du public français pour sa
personnalité de femme de médias et, bien sûr, comme chanteuse de jazz et de
soul. Dédié à Michka Saal, la réalisatrice de A Great Day in Paris, récemment décédée, le festival présente cette
année la particularité que Ricky Ford s’efface davantage au profit des artistes
invités, retenu qu’il est, dans un premier temps, à Paris pour le défilé du 14
juillet auquel il participe pour commémorer l’esprit de James Reese Europe et
de tous ceux qui importèrent le jazz en France (il est l’auteur de l’arrangement
utilisé pour interpréter l’hymne national sur les Champs-Élysées). Dans le
prolongement de la précédente édition, le choix des artistes invités témoigne
d’une authentique réflexion sur la constitution d’une affiche attractive et
développe une formule qui se réfère davantage à l’esprit qu’à la lettre des
valeurs fondatrices du jazz.
 Mighty Mo Rodgers (voc, ep) est l’une des grandes voix du blues contemporain,
une figure particulière en ce qu’elle recèle d’influences composites à même d’alimenter les nombreux
courants du jazz contemporain. Bien secondé par Luca Giordano (g), Walter
Monini (eb) et Alessandro Svampa (dm), il va par ce concert au Toucy Jazz
Festival, qui s’inscrit dans son Mud’n
Blood Tour, littéralement bouleverser toutes les personnes présentes en
dynamitant les clivages qui obscurcissent souvent notre vision du monde. Le
chanteur claviériste est dépositaire d’un héritage immémorial, cette filiation
spirituelle qui noue le destin des esclaves du sud américain au jazz des
grandes villes d’Amérique du Nord. La vision très concrète qu’il a de ce qui
constitue une vie d’homme digne de ce nom lui a de surcroit fait mettre ses
connaissances universitaires au service des populations démunies en enseignant
dans les quartiers difficiles. Avant de monter sur scène, Mo nous parle avec
passion de l’histoire de l’esclavage, de la façon dont «un peuple captif
a engendré la musique la plus libre qu’on puisse imaginer». Il évoque le
lien qui va du blues rural au blues urbain, avec cette électrification des
instruments qui le laisse longtemps dubitatif, bien qu’elle ait préparé le terrain
au rock et à une large partie de la musique populaire. Pour lui, le blues est
avant tout une voix, un chant, au-delà de ces guitares électriques qu’il a
appris à apprécier chez T-Bone Walker et Albert Collins, et qui sont devenues
le fétiche d’une musique par trop bruitiste menaçant toujours de couvrir les
vocalises du chanteur. Bien qu’il reconnaisse le génie de Jimi Hendrix, qu’il
considère comme un véritable bluesman, ses goûts personnels très étendus l’inclinent
à apprécier des musiciens tels B.B. King sur son Live at the Regal, James Brown et son Live at the Appolo, ou Lightnin’ Hopkins, dont la période
acoustique nourrit encore aujourd’hui toute son œuvre, ce legs universel à
l’origine de sa vocation de «blues soldier». Sa voix hantée et lebeat marqué de sa musique viennent aussi de figures comme John Lee Hooker,
capsule de bouteille de bière collée sous la semelle, qui scandent symboliquement
le tempo des sourdes mélopées susurrées par leur voix de basse. C’est avec ce
qu’il considère comme une authentique vocation spirituelle qu’il aborde ce
concert conçu comme un prolongement de son identité et de sa culture, au
service d’une vision résiliente de la vie et de l’union entre les peuples. Tout
de noir vêtu, il s’installe derrière son clavier et tente de conjurer par sa
musique «The Evil that Men Do». «Truth, Justice and the
Blues» résonne comme un programme de vie. Au passage, sur le shuffle
«No Regrets», qui résonne comme le «Respect» d’Aretha
Franklin, on remarque l’excellent son d’ensemble qui soutient le message de
l’artiste, tandis que «Shame!» est animé d’un feeling quasi-funk;
qui établit le lien avec la soul et le rhythm ’n’ blues de Jimmy Reed et d’Otis
Redding, comme attesté par l’usage du piano électrique Wurlizer et de la Gibson
demi-caisse, présents dans la musique de Mighty Mo, à l’instar de l’inspiration
plus gospel de gens comme Bobby Blue Bland et Wilson Pickett. Après un couplet
technosceptique de l’artiste sur le téléphone portable et les réseaux sociaux, censés
rapprocher les hommes alors qu’ils confèrent un caractère évanescent aux
relations humaines nouées par leur entremise, la veine libertaire et
émancipatrice de l’artiste donne un caractère triomphateur au quasi-reggae «Prisoners
of War» et à «Bastille Blues», qui relient les différentes
formes d’expression artistiques de la communauté afro-américaine, au premier
rang desquelles on trouve la musique des grandes métropoles, et en particulier Muddy
Waters et le Chicago Blues (superbe chorus basse-batterie). Un hommage à Charlie
Mingus qui se mue en évocation d’Albert King pour ceux qui sont nés
«Under a Bad Sign», et le slow blues de «Juke Joint
Jumpin’» nous dit que «si la terre est bleue, c’est en raison même
de l’existence du blues», «Kennedy Dies» puis «Tangle
Blues» et «Black Coffee and cigarettes» finissent de
convaincre un public conquis au point de danser sur les pelouses du parc de la
Glaudonnerie, avant qu’un dernier rappel en forme de manifeste «Soldier
of the Blues» n’emporte définitivement la mise en poussant l’osmose entre
artistes et public à un niveau rarement atteint pour un concert en extérieur. Avant
de nous quitter, Mo Rodgers nous annonce avec malice que Ricky Ford a promis de
venir jouer sur son prochain album, et nous songeons alors à ce nouvel opus
dont il nous a parlé, un duo avec le chanteur malien Baba Sissoko, destiné à
revitaliser le chant blues en lui restituant ses racines africaines (Griot Blues). Définitivement l’un des
grands moments de l’histoire du festival de Toucy.

Après cette épiphanie, la
Vandoren Jam Session accueille Clément (kb) et Rémy Prioul (dm) à l’orgue et à
la batterie. Toujours dans le lignage de Jimmy Smith et Larry Young, leur sens
du swing et le son de l’orgue Hammond nous accompagnent tout au long de ces
deux journées en dehors du temps. Leur set bien rôdé peut sembler par trop
respectueux des grands musiciens qu’ils reprennent et adaptent, mais les frères
Prioul convainquent par la qualité de leur interprétation et n’oublient pas de
jouer de nouveaux titres comme «Cry Me a River» ou le plus
surprenant «Purple Rain» de Prince. Clément Prioul utilise toujours
son Cabin Leslie pour recréer le son tournoyant caractéristique de l’orgue
Hammond B3, et le fait d’être issu d’une famille de musiciens au sein de
laquelle les deux instrumentistes sont seuls passés professionnels permet aux
deux frères une symbiose formidable, toute en cohésion et faite de prises de
risques complètement maîtrisées. A la fin du dernier set, Fred Burgazzi (tb) un
fidèle de Ricky Ford, s’adjoindra une nouvelle fois au duo lors de la clôture
du festival.

En marge du marché de Toucy, la poésie
de Christian Sauvage (p), pianiste qui vit dans l’Yonne et dont le disque
figure en bonne place dans la vitrine de la librairie de Toucy, apporte une
touche d’exotisme bienvenue à un patrimoine musical empreint par ailleurs d’un
fort classicisme. Au sein même de la Galerie14, lieu où se déroule
traditionnellement une partie du festival off, Christian Sauvage déploie une
verve essentiellement romantique au service d’une sorte de littérature musicale
du voyage. La mélancolie de «Oiseau Bleu», le métissage du
«Crystal Silence» de Chick Corea et Gary Burton, la musique
brésilienne de Chico Buarque, le maniérisme élégant de Debussy, la modernité de
Ravel, tout ceci compose une émulsion riche de saveurs qui inclut jusqu’à une
touche de folklore issu des pays de l’Est. Sa technique très propre lui permet
des harmonies impressionnistes intégrant le meilleur de la délicatesse
pianistique de Bill Evans, ainsi que des emprunts judicieux à la musique arabe,
à laquelle l’ont confronté ses années d’enfance en Algérie. Un authentique bain
de jouvence, plein de fraicheur, d’intelligence et de charme distingué et
érudit.
Au soir du 15 juillet, c’est
au tour du China Moses (voc) trio d’investir la scène du Parc de la
Glaudonnerie, aux termes d’une tournée qui suit la sortie de l’album
studio Nightintales, premier
album tissé de compositions personnelles qui lui tiennent visiblement très à
cœur. Partageant la scène avec Luigi Grasso (as, kb) et Mike Gorman (p) soit
une partie seulement de la formation à l’origine de l’enregistrement, la
chanteuse va nous interpréter ses «légendes nocturnes» dans une
veine plus intimiste que celle des concerts donnés précédemment par le groupe. Il
y a évidemment l’équivalent d’une mise à nu symbolique derrière ce parti pris
de dépouillement. La chanteuse est coutumière de jeux de masques dignes de la
République de Venise. Son saut de l’ange à elle est suggéré par le caractère
répétitif des voyages nécessités par les tournées, qui rend les différentes
villes traversées interchangeables, comme elle nous l’explique avec une grande franchise.
Dans ces conditions, seule la réponse du public, l’osmose avec les personnes
venues assister au concert parvient à faire la différence et à rendre unique tel
ou tel instant privilégié. Ce qui constitue une sorte d’encouragement à se
manifester bruyamment en même temps qu’un rappel des difficultés rencontrées
par la communauté des musiciens, avec pour toile de fond une initiation aux
histoires vespérales qui constituent la matière même de son nouvel album. Si
les références aux séries télévisées populaires, de même que l’assimilation de
la voix masculine au saxophone (dialogue amusant entre la chanteuse et Luigi
Grasso lors d’un intermède à caractère burlesque) peuvent sembler un peu faciles,
même si elles sont présentées comme des clins d’œil, elles établissent de l’aveu
même de la chanteuse un écran sur lequel défilent les histoires d’hommes et de femmes qui lui sont
chères. La formule shakespearienne «Nous sommes de l’étoffe dont sont
faits nos rêves» convient ici pour qualifier ce voyage au cœur d’un multivers très féminin, sorte de «girl power» après la
lettre qui achève sa mue au contact des hommes, devenus entretemps objets de
désir et de poésie. Sur les premiers titres, la chanteuse apparaît bien plus
émotive que son assurance coutumière ne le laisserait supposer de prime abord, et
Ricky Ford n’y est peut-être pas étranger, lui qui, au début du concert,
présentait la fille de Dee Dee Bridgewater comme la plus belle et la plus
intéressante voix depuis Billie Holiday.

Le son d’ensemble plus acoustique que
lors des concerts donnés avec la formation au complet permet en tout cas de
matérialiser le legs du blues et du rhythm ’n’ blues
à l’univers de la chanteuse. Il y a chez China Moses comme une défiance
vis-à-vis de ce qui constitue ses plus beaux atouts, ses plus belles qualités, un
peu comme si elle avait en permanence l’intuition que toute facilité, et
partant toute autorité, s’expient dans les brumes vaporeuses de quelque ivresse
artificiellement entretenue, aux confins du talent, de la sensibilité
esthétique, et de la conscience féminine. Les grandes figures de la pop culture
lui sont manifestement familières, elle qui dût en son temps ajouter un certain
nombre de références au panthéon de son illustre génitrice. La dimension
symbolique du legs de Janis Joplin est ainsi célébrée au travers de «Move
Over» (tiré de l’album Crazy Bluesde 2012) tandis que la vie brève et intense de Dinah Washington (à qui elle a
consacré l’intégralité d’un album hommage en 2009, This One’s For Dinah) constitue une sorte de modèle pour la
chanteuse, qui rappelle les diverses expériences qui s’offrirent à elle telles
des tentations, et le prix de cette liberté qui brûle les ailes dans une
consomption permanente. Dans cette acception, China Moses exprime un scepticisme
technologique comme démenti par le génie relationnel de l’artiste, qui
communique et utilise à merveille les médias comme les réseaux sociaux. Elle nous dit le processus d’écriture
fiévreuse de l’album avec son producteur, Anthony Marshall, cinq jours de
fièvre créatrice au terme desquels le hip hop n’était plus l’ennemi du swing,
rompant tous les clivages qui pouvaient encore, parfois, la retenir prisonnière
d’un passé, d’un héritage trop lourds à porter. Ces «midnight love
affairs», parfois tristes et mélancoliques, constituent en tout cas un
véritable voyage au pays des couleurs et
des parfums, défiant l’uniformité de goûts revendiquée par les puristes, et hantées
par un timbre de voix versatile qui évolue du contralto aux accents lyriques de
voix opératiques vraisemblablement empruntés à l’univers des cantatrices. Les
aventures d’une nuit défilent, en forme d’exhortation («Watch Out»)
ou d’avertissement, de communication ultime ou de rupture majeure («Disconnected»),
quand elles ne prennent pas la forme d’une dépendance et d’une addiction. Mais
parce qu’il faut bien vivre, toujours aller de l’avant, ce dérèglement de tous
les sens peut aussi prendre la forme d’une overdose, d’une intoxication
(«Nicotine»), d’une obligation d’affronter son propre fatum
(«Hangover»), et d’un flirt avec le nervous breakdown, afin que
d’éviter le «Breaking Point», pour avoir enfin une chance de se
retrouver en se réconciliant avec son propre destin. Grâce doit être rendue à
Luigi Grasso, dont le talent et l’intelligence au saxophone font penser aux partitions
et aux traités d’harmonie qu’il recouvre de son écriture fine et déliée (quel
plaisir de l’entendre jouer avec la polyphonie de son clavier électronique,
émulant le temps d’un titre les harmonies vocales de grands orchestres de jazz)
tandis que les atmosphères lunaires générées par le piano de Mike Gorman
bénéficient de toute la science des arrangements développée de concert par les
deux complices musicaux, qui se fendent de passages instrumentaux de haute
volée sur lesquels China Moses peut évoluer en toute liberté. Le concert se
termine sur une ultime jam en compagnie de Ricky Ford, dont les admirateurs
scandent le nom lors du rappel tout en refluant vers la scène, spectacle
émouvant qui symbolise sans doute mieux qu’un long discours toute la réussite de
cette édition 2017 du festival de Toucy.
Jean-Pierre Alenda
photos Patrick Martineau
© Jazz Hot n° 681, automne 2017
|

Vitoria-Gasteiz, Espagne
Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz,
11-15 juillet 2017
Le Festival de Jazz de
Vitoria-Gasteiz affiche un bilan contrasté, sur le plan de la fréquentation,
pour cette édition 2017, la 41e. Contempler le complexe omnisports de
Mendizorroza avec presque la moitié des sièges vides trois jours durant, avec
les conséquences qu’on imagine sur le plan financier, voilà qui a soulevé des
inquiétudes et, de la part du public et des médias présents, quelques
interrogations. A contrario, les
concerts du Théâtre Principal ont connu une bonne
fréquentation. Pour autant, en ces deux lieux, la programmation proposée ne
manquait pas d’intérêt.
Le 11 juillet, au Théâtre Principal, parmi les concerts
du jour, se jouait une nouvelle version du projet «Konexioa»
(Connexion) du batteur de Vitoria, Hasier Oleaga, en quartet avec Jorge
Abadía (g), Julen Izarra (ts) et Jorge Rossy (vib, qu’on a longtemps
connu comme batteur de Brad Mehldau, Wayne Shorter ou encore Joshua
Redman),
mêlant des compositions de chacun des musiciens avec d’autres de Chris
Cheek, Lee
Konitz, Lee Morgan ou même Kurt Weill. A Mendizorroza,
les Brown Sisters ont remporté un franc succès lors de la traditionnelle
nuit du gospel –le palais omnisports étant, pour cette occasion, plein à
craquer!–, avec un répertoire de spirituals classiques et des originaux,
dépassant même en qualité les groupes des années précédentes
 La
soirée du 12 juillet, à Mendizorroza,
évoca le jazz fusion des années soixante-dix et quatre-vingt avec, en
première
partie Larry Carlton (g), suivi de Stanley Clarke (b). Le guitariste a
débuté
en solo, avec une ballade de nuances douces et tapping. Rejoint ensuite
par Wolfgang Dahlheimer (kb), Claus Fischer (b) et Hardy Fischotter
(dm), il s’est
orienté vers le blues et le funk, échangeant notamment des phrases avec
le
clavier. Un concert qu’il a achevé avec ses morceaux les plus connus:
«Josie», «Sleepwalk» ou «Room 335».
Quant à Stanley Clarke, il était entouré de
Beka Gochiashvilli (p), Cameron Graves (kb) et Mike Mitchell (dm), soit les
membres du «Up World Tour» qu’on avait pu entendre deux ans
auparavant au festival de Getxo. On a ainsi retrouvé des titres déjà présents
à ce précédent concert («Brazilian Love Affair», «Song to John», etc.) ainsi qu’une
construction similaire: un démarrage très électrique à la basse, des
rythmes funky et beaucoup de slap, des solos partagés avec chacun des musiciens, puis un changement à la
contrebasse, histoire d’en remontrer en virtuosité. Un ensemble bien fait, mais
sans surprise.
 Le 13 juillet, à Mendizorroza,
était consacré à Thelonious Monk à l'occasion du centenaire de sa naissance.
Dans la première partie du programme, quatre pianistes se sont relayés pour jouer
diverses de ses compositions, en solo comme en duo. Et pas n’importe lesquels:
Kenny Barron, Cyrus Chestnut, Benny Green et Eric Reed! Ce dernier, après
avoir dédié le concert au regretté Mulgrew Miller, s’est assis devant l’un des
deux Steinway pour jouer «Thelonius». Duos et solos se sont enchaînés sur «Monk's
Dream», «Bye-Ya»,«Ruby, My Dear», «I Mean You» ou encore «Blue Monk». Cette
évocation a permis de donner différents points de vue sur Monk, avec des choix
évidents («In Walked Bud» par le duo Green/Chestnut)
ou d’autres beaucoup moins («Teo» par Green), en passant par des standards qui
lui sont associés («Smoke Gets in Your Eyes» par Chestnut, «I'm Getting
Sentimental Over You» par Barron). On retiendra tout particulièrement de cette
performance le «Reflections» d’Eric Reed et le «Light Blue» de Kenny Barron.
 En
seconde partie, TS Monk (dm) a poursuivi l’hommage à son père avec force et
swing. «Rhythm-A-Ning», «Sierra» ou «In Walked Bud» ont permis au public de
profiter d'un jazz vivant et fluide, surtout concentré sur le bebop. Randall
Haywood (tp), Patience Higgins (as), Willie Williams (ts), Theo Hill (p) et Beldon
Bullock (b) ont formé avec le batteur une formation brillante, avec une mention
spéciale au saxophoniste, auteur des meilleurs solos. Invitée du sextet, Nnenna
Freelon (voc) a captivé le public avec l'intense «Skylark», accompagnée par Beldon
Bullock, ou avec ses scats. Le final a offert un «Round Midnight» joué d’abord
en instrumental, puis avec le concours de la chanteuse. Un succès très net!
Il faut rappeler que TS Monk et Nnenna Freelon s’étaient déjà produits ensemble
à Vitoria en 1997 pour un hommage à Thelonious Monk
 Le 14 juillet, c’est une formation à cordes originale que
proposait Mendizorroza avec la réunion entre Jean-Luc
Ponty (vln), Biréli Lagrène (g) et Kyle Eastwood (b). Les deux premiers,
en compagnie de Stanley Clarke, avaient déjà enregistré un disque (D-Stringz) sous ce format en 2015. De
même, Ponty et Clarke, en 1994, était en trio à Vitoria avec Al Di Meola sous le
titre «The Rite of Strings». Avec une telle antériorité, on se demandait si
Kyle Eastwood serait à sa place… et ce fut le cas! Le «walking»
d'Eastwood s’est bien combiné avec les accords de Biréli, tandis que Ponty développait
des mélodies avec le ton si particulier qui le caractérise. De «Blue Train» de
Coltrane ou «Oleo» de Sonny Rollins, jusqu’à «Andalucía» ou «Samba de Paris»
d'Eastwood, en passant par «To and Fro» et «Childhood Memories» de Ponty, sans oublier
«One Take» ou «Saint-Jean» de Lagrène, le répertoire fut à la hauteur du talent
des musiciens.
La journée s’est finie par Patti Austin
(voc), soutenue par un trio de musiciens allemands, efficaces mais
froids. Evoquant Ella Fitzgerald, elle a également démontré ses talents d’actrice
en racontant sa vie, ses débuts dans la pauvreté, ses amours et différents
moments de sa carrière. Basé sur son album, For
Ella, le tour de chant de Patti Austin comprenait «Honeysuckle
Rose», «Mr. Paganini», «The Man I Love», «Satin Doll», ou le taquin
«A-Tisket-A-Tasket». La chanteuse les a interprétés avec goût et
élégance. Elle a terminé
avec un thème qui est une sorte d’hymne, «Hearing Ella Sing». Un bel
hommage!
Notons que l’animation des rues de Vitoria avait été
confiée cette année au tromboniste de New Orleans Lucien Barbarin et son Street
Band. Dans une configuration complètement acoustique, sans amplification, excepté
un micro dont Barbarin s’est servi pour chanter, il a su créer une ambiance
particulièrement festive.
 Le dernier soir, à Mendizorroza,
le premier concert, intitulé «Woman to Woman» rassemblait la crème du
jazz féminin autour de Renee Rosnes (p): Cécile McLorin Salvant (voc), Anat
Cohen (cl), Melissa Aldana (ts), Ingrid Jensen (tp), Noriko Ueda (b) et Allison
Miller (dm). Les instrumentistes et la chanteuse se sont relayées, et seul le
dernier morceau a été joué par le groupe au complet. Melissa Aldana a parcouru
tous les registres de son ténor en un phrasé riche. Ingrid Jensen a joué avec
une grande diversité de tons, la sourdine y compris, avec beaucoup de style,
tout comme Anat Cohen. La puissance et le dynamisme d'Allison Miller ont
bénéficié des appuis graves de Noriko Ueda, constituant une excellente base
rythmique. Quant à Renee Rosnes, elle a assuré avec brio la direction musicale.
Enfin Cécile McLorin Salvant a su porter, jusque dans le cœur
du public, les histoires qu’elle a chantées, notamment «Gracias a la Vida» ou
«Alfonsina y el Mar», chantés en espagnol parfaitement vocalisé. «Yesterdays»
ou «Flamenco Sketches» sont des exemples de standards menés magistralement,
tandis que «Galapagos» de Rosnes a donné idée des qualités de compositrice de
la pianiste.
En seconde partie de soirée, le Panaméen Rubén Blades (voc), appuyé
sur les treize membres de l’orchestre de Roberto Delgado (b) a parcouru son
répertoire (Las Calles», «Pedro Navaja», «Ojos de Perro Azul», «El Cantante» ou
«Todos Vuelven»). Il est à noter qu’il a également interprété «Mack the Knife»
dans la version swing de Bobby Darin et a fait danser tout le palais omnisport.
Pendant ce temps, le grand pianiste George Cables entamait
le dernier de ses concerts dans les salons de l'hôtel Canciller Ayala qu’il
enveloppé d’un jazz authentique durant le festival. Accompagné par Essiet
Essiet (b) et Victor Lewis (dm), George Cables a été sans doute ce que le
festival de Vitoria a donné de meilleur et nul autre que lui ne pouvait mieux
le conclure.
Lauri Fernández
photos José Horna
© Jazz Hot n° 681, automne 2017
|
Saint-Cannat, Bouches-du-Rhône
Jazz à Beaupré, 7-8 juillet 2017
Treize
ans après sa création, Jazz à Beaupré persiste et signe une nouvelle
édition, nous invitant à la découverte ou aux retrouvailles dans le très
beau cadre du parc du Château de Beaupré. La priorité donnée aux
petites formations autour du piano, et le choix de faire connaître des
musiciens régionaux restent les lignes directrices de la programmation
de Chris Brégoli et Roger Mennillo.
Le programme annonçait le 7/07 :
Quartet Ligne Sud, avec Christian Gaubert (p) André Ceccarelli (dm)
Diégo Imbert (el b) (en remplacement de Jannick Top) et Christophe
Leloil (tp). A la suite, le duo de Jacky Terrasson (p) et Stéphane
Belmondo (tp). Nous étions absents ce jour-là, mais pour nous faire
pardonner, voicile lien pour retrouver les vidéos sur le site du
festival (cliquer sur l'écran YouTube)
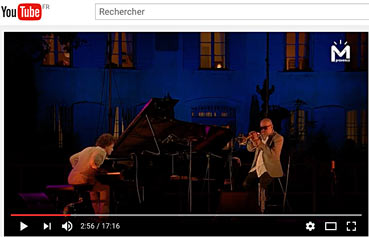
La
soirée du 8, qui n’était d’ailleurs pas un lundi, débute avec Monday 8
Trio, avec Laure Donnat (voc), Ugo Lemarchand (ts) et Roger Mennillo
(p). Une rencontre sur un stage, un an plus tôt, a donné naissance à ce
projet musical en trio, deux voix et un piano ; pas de section rythmique
donc. Mais Laure Donnat chante depuis 1997, Ugo Lemarchand a commencé
le saxophone à 12 ans… quant à Roger Mennillo, pianiste et compositeur
self-made in Provence, le jazz est sa seconde patrie. C’est dire que ces
trois-là ont le sens de l’équilibre, du dialogue (trialogue ?), de la
passation de témoin. Laure est une chanteuse expressive et énergique,
qui sait donner ou retenir sa voix, passant du registre intimiste de
« Girl From Ipanema » au shout puissant des blueswomen sur « Fine and
Mellow » immortalisé par Billie Holiday et Ella Fitzgerald. Le ténor
d’Ugo Lemarchand a un son chaud et feutré dans la lignée des pères du
saxophone depuis Coleman Hawkins, Lester Young et Ben Webster. Il se
glisse à la suite des vocaux de Laure, les prolonge ou les souligne
comme une deuxième voix. Roger Mennillo est la force tranquille du trio,
tout en sobriété, délicatesse et swing, dans le registre tynerien qu’il
affectionne. Un CD devrait être la prochaine étape du trio.

Le
déroulement des soirées, en deux parties, permet à la mi-temps de
profiter de l’accueil de la famille Double, qui ouvre son parc et ses
millésimes aux amateurs de bons vins. Avant et entre deux, Jean Pelle,
en MC consciencieux, présente, accueille, explique, fait patienter…
Après
la découverte, le temps des retrouvailles : Monty Alexander est presque
un abonné de Jazz à Beaupré, avec pas moins de cinq participations. On
connaît, mais on revient, on sait qu’on ne s’ennuiera pas. Monty garde
la même énergie et la même capacité de renouvellement. Son dernier trio
est bâti sur le format classique piano-basse-batterie, avec un plan de
scène resserré à la Jamal, batteur et bassiste très proches du leader.
On
attendait Herlin Riley à la batterie, c’est Obed Calvaire qui le
remplace, batteur de Miami d’origine haïtienne qui, depuis son passage à
la Manhattan School of Music, accompagne depuis une dizaine d’année
(entre autres, la liste est trop longue !) Wynton Marsalis, Joshua
Redman, Dave Holland, le SF jazz Collective ou le big band de Roy
Hargrove. Pas de problème d’adaptation donc, Obed Calvaire sait se
couler dans tous les styles et tous les formats, et le jeu dansant des
batteurs de New Orleans n’a pas de secrets pour lui.
 
A
la basse, Hassan Shakur, accompagnateur régulier de Monty Alexander, et
qu’on a pu entendre avec Ahmad Jamal. Fils du pianiste Gerry Wiggins
Sr, il commence sa carrière à 12 ans et intègre le Duke Ellington
Orchestra version Mercer à 18. Il fait lui aussi le tour de la planète
avec Dizzy Gillespie, Milt Jackson, Sarah Vaughan, plus récemment avec
Bill Easley… bref, du solide, du jeu rond, profond et énergique.
Monty
Alexander a commencé sa carrière musicale à 14 ans dans les clubs de
Kingston, Jamaica, et le jazz est entré très tôt dans sa vie avec les
tournées nord-américaines. Son arrivée aux USA en 1961 le plonge dans un
jazz en pleine expansion, et ce glouton de musique réussit un cross
over magistral entre les rythmes caraïbes et le swing. Il n’a donc aucun
scrupule à glisser de Nat King Cole à Bob Marley (« Nature Boy »), à
invoquer Sonny Rollins avec le très latin « St Thomas »… Ils font partie
de sa culture et de sa vie : chassez la Caraïbe… On navigue donc de ses
propres compositions « Grub », « Skamento », à l’indispensable « Besame
Mucho » ou à un long et expressif « Autum Leaves » qu’il dissèque à
plaisir.
Pianiste volubile et enthousiaste, il sait accorder sa
place au silence et laisser parler ses accompagnateurs. Toujours en
mouvement, et pas avare de communication, Monty Alexander donne chaque
fois le meilleur, avec humour et gentillesse, et renchérit sur les
rappels !
N’oublions pas la qualité du son (et de la boisson!),
la disponibilité des bénévoles, qui font de ce festival «sympa-chic»,
une heureuse étape sur la route des festivals.
Ellen Bertet
texte et photos
© Jazz Hot n° 681, automne 2017
|

Pléneuf-Val-André, Côtes-d’Armor
Jazz à l’Amirauté, 4 juillet-22 août 2017
Pour la 22e édition, l’Association Jazz à l’Amirauté, toujours en étroite
collaboration avec la municipalité, a poursuivi son bonhomme de chemin,
fidèle à ses fondamentaux d'une manifestation conviviale, à ses mardis
du jazz et au swing, pour le plus grand bonheur de cette ravissante
station balnéaire sur la côte nord de la Bretagne.
Signalons pour les amateurs de découvertes que Pléneuf-Val André réunit les attraits d'une station balnéaire du début XXe siècle, Val-André, d’un ancien port de pêcheurs qui allaient gagner leur pain jusqu'en Islande, Dahouët, et d'une belle et ancienne petite ville de l'intérieur, Pléneuf, où le génie de la pierre est à la base de l'architecture.
La fête gratuite du
rendez-vous hebdomadaire de juillet et d’août, toujours très bien
organisée par la trentaine de bénévoles de l’association, sous la férule
d’Elie Guilmoto, a permis à un public toujours aussi nombreux de taper
du pied et des mains chez l’Amiral Charner.
Parrainée
par Philippe Duchemin, cette édition proposait Julien Bruneteaud Trio
(4/7), William Chabbey Trio (11/7), Philippe Duchemin Trio et Leslie
Lewis (18/7), Soul Sérénade d’Emilie Hédou (25/7), La Canne à Swing de
Kevin Goubern (1/8), La Swingbox de Didier Desbois (8/8), Louis Prima
Forever de Patrick Bacqueville, Michel Bonnet, Claude Braud et compagnie
(15/8), et pour finir ces deux mois, le Boogie System de Jean-Pierre
Bertrand (22/8).
On le voit un programme dévolu au swing, comme
chaque année, où les très bons musiciens de jazz de l’hexagone ont la
part belle pour le plus grand plaisir d’un public très fidèle et
nombreux qui en redemande.
L’étalement dans le temps nous empêchant
d’être présents pendant deux mois dans cette belle partie de la
Bretagne, nous avons centré notre compte rendu sur le trio de William
Chabbey (g) avec Guillaume Naud (org) et Mourad Benhammou (dm) et sur
celui de Philippe Duchemin (p), avec Patricia Lebeugle (b) et Jean-Pierre
Derouard (dm), qui accompagnait une découverte, l’excellente Leslie
Lewis au chant.
Deux visions du swing, plus bop chez Chabbey, plus
mainstream chez Duchemin-Lewis, mais une vision du jazz, un jazz ouvert,
généreux, qui fait référence au blues et au swing, et qui reste
toujours expressif, tout entier tourné vers l’échange avec le public.
Le
11 juillet, William Chabbey a largement repris son répertoire («A New
Day», «Kenny’s Song», «La Valse des frangins», «New Swing», etc.) dans
la veine de ces trios de la grande tradition du jazz où l’orgue se marie
à la guitare, avec la complicité d’un bon Guillaume Naud et le drive
toujours aussi réjouissant de l’excellent Mourad Benhammou. On a
apprécié la révérence faite à B. B. King, qui montre que les musiciens
dits «de jazz» savent très bien quel grand musicien de jazz était le
bluesman B. B. King, et combien le dit «blues» est la composante
essentielle de cette musique de jazz.

 Le
18 juillet confirma d’ailleurs cette volatilité des étiquettes qui
cloisonnent la grande musique afro-américaine, aujourd’hui universelle.
Car Leslie Lewis est tout à la fois une bonne chanteuse de jazz, de
blues, de gospel, de soul, sa voix trahissant à chaque détour tous les
accents de la grande tradition vocale afro-américaine à travers le
temps. Si le trio de Philippe Duchemin nous a gratifiés en intro’ de son
virtuose hommage à Bach, la chanteuse a repris le répertoire des
standards et du jazz («Cheek to Cheek», «Night and Day», «Misty», «What a
Little Moon Can Do», «Georgia», etc.), s’écartant parfois vers la soul
ou vers le gospel sans qu’au fond on change d’univers. Le
18 juillet confirma d’ailleurs cette volatilité des étiquettes qui
cloisonnent la grande musique afro-américaine, aujourd’hui universelle.
Car Leslie Lewis est tout à la fois une bonne chanteuse de jazz, de
blues, de gospel, de soul, sa voix trahissant à chaque détour tous les
accents de la grande tradition vocale afro-américaine à travers le
temps. Si le trio de Philippe Duchemin nous a gratifiés en intro’ de son
virtuose hommage à Bach, la chanteuse a repris le répertoire des
standards et du jazz («Cheek to Cheek», «Night and Day», «Misty», «What a
Little Moon Can Do», «Georgia», etc.), s’écartant parfois vers la soul
ou vers le gospel sans qu’au fond on change d’univers.
Seul «dérapage
incontrôlé», dirons nous, la version d’une chanson de Leonard Cohen,
sans doute intéressante mais pas dans le registre de la chanteuse, a
paru un peu artificielle et désincarnée. Le public a globalement tout
apprécié et a réservé une belle ovation à cette soirée, prenant plaisir
dans l’après-concert à discuter directement avec des musiciens tous
aussi simples et accueillants.
On
ne doute pas que les autres soirées ont reçu un accueil similaire d’un
public curieux et direct dans son abord de la musique, sans chichis, et
c’est de cet esprit dont le jazz a besoin, loin des atmosphères des
messes médiatiques ou élitistes qui ne sont pas à son échelle ou dans
son esprit.
La
Bretagne swingue toujours, et si l’équipe de Jazz à l’Amirauté
travaille à renouveler son équipe, c’est bien parce que l’accueil du
public le justifie… Rendez-vous avec le swing en 2018 et avec les
nouvelles énergies tant attendues!
Yves Sportis
photos Sandra Miley
© Jazz Hot n° 681, automne 2017
|

Montréal, Québec, Canada
Festival International de Jazz de Montréal, 28 juin-8 juillet 2017
Tout
fut parfait au Festival de jazz de Montréal cet été, lequel, comme d’habitude,
prouva une fois de plus qu’il est un modèle, c’est à dire la façon dont un festival
de jazz devrait travailler. Les rouages de l’organisation sont bien huilés, se
déroulant en divers points de la ville –tout autour de cette Place des Arts,
vibrante de culture– interdite à la circulation et équipées en podiums de plein
air pour nourrir les oreilles affamées du public qui afflue dans cet espace.
Cette année, on pouvait aussi participer à la cuisine mutante, semi-indigène du
«pulled pork poutine», tout en dansant dans les rues.
Avec
sa programmation sage (ce qui veut dire le plus possible de programmes
conséquents en salle), le festival n’est rien moins qu’un merveilleux et fiable
miroir de la scène du jazz du moment. Le Festival de Montréal, même s’il désire
être dans la niche «avant-garde», fait sagement appel aux vieux chouchous et aux
nouvelles coqueluches, ainsi qu’aux nouveaux courants dans le spectre des
styles et des énergies du jazz de cette saison particulière; et cette année ne
fit pas exception.
Parmi les groupes les plus pointus que j’ai rencontrés dans
ces quatre jours, dès l’ouverture forte et typique au week-end de ce festival
de dix jours, fut le nouveau All-Star
Project Hudson (Jack DeJohnette, John Scofield, Larry Grenadier et John
Medeski), et l’étoile qui arrive à maturité, le trompettiste et leader Ambrose
Akinmusire avec son quartet, ainsi qu’un brillant duo du guitariste Bill
Frisell avec son nouveau compagnon d’armes, le bassiste Thomas Morgan.
Cependant, d’une
certaine manière, un puissant air d’aigre-doux millénaire planait sur les trois
premiers soirs du festival, du moins pour ceux d’entre nous qui pensent que le
trio, unique en son genre, The Bad Plus, est l’une des aventures jazz les plus
fascinantes de ce millénaire. The Bad Plus, une variation malléable et mobile
du vénérable contexte trio piano, perd son pianiste, Ethan Iverson, qui sera
remplacé par Orrin Evans à la fin de l’année.
Ce changement majeur
imposait une certaine mélancolie au rendez-vous «Invitation» pour les adieux à
Montréal des trois concerts, tous nettement différents, dans l’église réformée,
The Gesù (où se joue l’essentiel de la musique d’avant-garde). Un concert
d’ouverture avec simplement le trio nous rappelait la proposition créative du
groupe démocratique et cependant subversif en tant qu’unité: le pianiste
Iverson qui n’est jamais dans l’exagération ou le théâtral bon marché,
saupoudrait sa prestation d’ironie et d’invention, ayant formé un pacte avec le
bassiste Reid Anderson (probablement aussi le meilleur compositeur des trois)
et le batteur David King, créant une musique souple, émouvante, iconoclaste et
qui se définit comme Hip: une musique vraie jusque dans ses termes artistiques.
La liste des morceaux comprenait Anderson’s «Dirty Blonde» (le seul air qui fut
répété dans la suite, le «répertoire à répétition», un syndrome dont beaucoup
d’autres artistes ont été coupables), la version fraîche et éclairante par le
trio de «Time After Time» (la chanson de Cyndi Lauper) et la sorte de
vignette d’Iverson «Do Your Sums/Die like a Dog/Play for Home» et King’s Rough 'n' Rangy «Wolf Out».
Mais comme il l’a
montré à Montréal en 2017 aussi bien que dans une invitation précédente à une
résidence ici, le trio peut facilement s’adapter à des situations où il se
transforme en orchestre de «soutien» pour les solistes invités; dans ce cas
l’agile saxophoniste alto, influencé par Bird, Rudresh Mahanthapa et le
guitariste Kurt Rosenwinkel. Avec Mahanthapa, le groupe prit pour un soir des
morceaux de grands saxophonistes alto, principalement Charlie Parker et Ornette
Coleman, avec le spirituel «Subcouinscious-Lee»
de Lee Konitz dans le mélange. Pour le troisième soir ils se sont appuyés sur
le monde du guitariste Kurt Rocsenwinkel, avec des airs de facture plus
contemporaine qui allaient bien à la fluide virtuosité et à la voix musicale au
penchant sérieux du guitariste.
A la Maison
Symphonique de Montréal (qui abrite le Montreal Symphony), à l’architecture
encore relativement nouvelle, avec son hall de concert à l’acoustique
impressionnante, le vétéran Charles Lloyd, qui vieillit en beauté, a ouvert son
set en présentant ses respects révérencieux à la pianiste Geri Allen, récemment
décédée, et qui avait joué dans l’orchestre de Llyod pendant quelques années.
Llyod était là avec son New Quartet: Gerald Clayton remplaçant Jason Moran au
piano, avec la force robuste du bassiste Reuben Rogers dans la section
rythmique, et l’imposant batteur Eric Harland qui maintient les fondations pour
les pérégrinations variées de Lloyd.
Mais la véritable
excitation et le cœur de ce deuxième acte vinrent plus tard, avec Hudson (ainsi
nommé parce que tous les musiciens vivent dans l’idyllique Hudson Valley, au
dessus du remue-ménage de New York). Comme on l’a entendu dans leur premier
album et spécialement en direct, ces quatre-là s’entendent à merveille, amenant
une atmosphère organique post-Miles au déroulement des événements (DeJohnette
et Scofield appartiennent tous deux au club des ancien de Miles). Avec un
matériau incluant des chansons de Jimi Hendrix –heureusement des morceaux moins
courus comme «Wait Until Tomorrow» et «Castles Made of Sand»– le
savoureux et nouvel original de Scofield «El Swing», «Woodstock» et «Dirty
Ground» à la métrique bizarre de Bruce Hornsby (avec DeJohnette chantant,
modestement mais sincèrement), Hudson fit vraiment une grande impression, offrant
des souhaits pour la vie à venir dans le sol instable des groupes de jazz
composé de leaders actifs à part entière.
Comme à l’habitude
différentes factions du jazz étaient représentées à Montréal. Le Tip City Trio
sans batteur de Christian McBride s’est aventuré en douceur sur le terrain Jazz
and Pop, et le facteur jazz-rencontre-le-groove fut traité joliment par le
Robert Glasper Experiment et les intrigantes idées de Donny McCaslin sur le
sujet d’une esthétique du jazz injecté de rock. McCaslin a gagné récemment un
légitime profil très médiatisé, grâce à son rôle dans le brillant album chant
du cygne de David Bowie, «Black Star», et le set de McCaslin atteignit un haut
point à minuit avec la version sur les
nerfs et cathartique du vieux classique de Bowie «Look Back in Anger». La nuit
suivante au Gesù, l’excellent et polyvalent batteur du McCaslin Band, Mark
Giluiana (également important sur Black Star), vint avec son propre quartet
faire preuve d’un parfait talent pour slalomer entre les valeurs du jazz
traditionnel et les énergies contemporaines.
Rosenwinkel lui-même
était en bonne place avec son nouveau projet aux fortes saveurs brésiliennes,
«Caipi», au sous-sol du bâtiment central du festival, l’Astral Night Club. Tout
à fait en contraste la Maison Symphonique offrait son ambiance épique à des artistes
singuliers développant de grandes idées –la star montante de la gauche-du-jazz,
Colin Stetson, pour son captivant solo Saxophonic (incluant la gymnastique du
souffle circulaire sur des «sonics» au saxophone basse), et le solo
aventureux du jeune claviériste et chanteur débordant d’énergie, Tigran Hamasyan, globalement satisfaisant, mais
parfois noyé dans les trucs et les machins.
Tandis que les pianistes passent, la grande nouveauté
à Montréal cette année a été Iverson et la reconnaissance de The Bad
Plus; le «nouvel espoir» du vieillissement du jazz (depuis 17 ans sans
changement de personnel). Sans aucun doute Iverson continuera à travailler de
sa façon unique –comme il l’a fait avec le groupe de Billy Hart et ailleurs– avec
peut-être un travail en solo à venir? Sans aucun doute Les Bad Plus
continueront à travailler pour le bien d’un nouveau jazz provocateur (ou
deviendrons plus mauvais, dans l’une ou l’autre des définitions). Mais pour
l’instant, nous savourons la chance de vivre les derniers jours de ce grand
orchestre en transition, et le Gesù de Montréal a été un temple contemplatif parfait
pour les trois nuits musicales les plus inspirées de cet été.
Josef Woodard
Traduction-Adaptation Serge Baudot
© Jazz Hot n° 681, automne 2017
|
Getxo, Espagne
Getxo Jazz Festival, 28 juin-2 juillet 2017
En avançant d’une semaine ses
dates habituelles, le Festival International de Jazz de Getxo a ouvert la saison estivale
au Pays Basque. Il s’est présenté, comme les années précédentes, en trois
volets: les grands concerts pour les têtes d’affiche, la programmation «Troisième Millénaire» dédiée aux jeunes talents
et le concours de groupes, sans oublier les jam sessions nocturnes.
Lors
de la première journée, le saxophoniste polonais Andrzej Olejniczak
(ts, ss, bcl) a donné la première de son projet «Interpretando a
Chopin», accompagné
par Michal Tokaj (p), Michal Baranski (b) et Lukasz
Zyta (dm). Ce projet, élaboré avec le compositeur polonais-canadien Jan
Jarczyk, récemment décédé, revisite librement divers Préludes, Études et
Mazurkas de l’immortel pianiste. Olejniczak a développé différentes
perspectives
dans une vaste gamme qui mêlait classique, jazz et même certains rythmes
latins ou afro-cubains. Un grand concert mené à bien par
l'un des meilleurs saxophonistes européens et un trio de premier ordre.
Comme
cerise sur le gâteau, il faut souligner l'hommage à John Coltrane au 50eanniversaire de sa mort, «Central Park West».
 Après les changements de programme dus à l’état de santé de
John Abercrombie d’abord, et Pharoah Sanders après, la vedette de la deuxième
journée a été Christian Scott (tp), l'un des meilleurs musiciens
de la nouvelle génération, et dont la critique américaine apprécie la volonté de
fusion entre jazz, hip-hop et rock. Christian Scott a commencé à prendre de
l'importance en 2006 avec l'album Rewind
That tandis que dans son dernier
opus, Stretch Music, il poursuit sa
recherche d’un nouveau style, plein de références et d’effets retentissants. Accompagné
par Elena Pinderhughes (fl), Lawrence Fields (p), Luques Curtis (b) et Mike
Mitchell (dm), le trompettiste a proposé un concert reflétant cette recherche
qui n’est pas sans rappeler Miles Davis: son électrifié, effets
synthétiques à la trompette, appui puissant de la batterie mais également des
morceaux plus mélodiques où le piano et la flûte adoucissent cet ouragan
sonore. Bien que pouvant paraître quelque peu hermétique, le concert a remporté
les suffrages du public.
 Le 30 juin, Bill Evans (ts, ss) retrouvait la
scène avec un nouveau projet, soutenu par Dean Brown (g), Etienne
M'Bappé (b) et Keith Carlock (dm). Tout a commencé avec un Evans mélodique, dans une
ligne de jazz «mainstream» au goût du public le plus traditionnel. Et bien qu’il
ait présenté Dean Brown comme un guitariste fusion, ce dernier a rapidement mis
le cap vers des accentuations funk. Le leader a également joué quelques
morceaux au piano et a chanté; en effet, il prend les solos au saxophone
(en particulier au soprano) avec une difficulté croissante. Enfin, Dean Brown a
orienté la musique jouée vers le blues-rock, l’éloignant du jazz. On retiendra
a minima le savoir-faire d’Etienne M'Bappé, dont les solos étaient de haut
niveau.
Le 1er juillet, Dianne Reeves a joué à guichets
fermés. Les onze morceaux qu'elle a interprétés, d’un
instensité allant crescendo, ont confirmé l’excellence de cette grande dame du
jazz ainsi que la qualité des musiciens qui l’entouraient: Peter Martin
(p, kb), Romero Lubambo (g), Reginald Veal (b), et Terreon Gully (dm). Après
une ouverture instrumentale à la tonalité brésilienne, Dianne Reeves a entamé «Suzanne», de Leonard Cohen, de façon éthérée,
continuant avec «Minuano» de Pat
Metheny. Puis sont venus «Infant Eyes», de Wayne Shorter, «All Blues»,
de Miles Davis, et «Tango», un original de Dianne Reeves, tiré de son dernier
album, Beautiful Life (2015). Devant
un public complètement conquis, elle a interprété «Once I Loved» d'Antonio Carlos Jobim, en duo
acoustique avec le vétéran de la guitare brésilienne, Romero Lubambo. Elle a
profité de son morceau «Nine» pour utiliser à nouveau le scat, et avec «One for
My Baby (and One More for the Road)», elle a demandé au public de se joindre à
elle en claquant des doigts. Le concert s’est achevé sur la ballade soul «Cold»,
sur lequel Dianne Reeves a présenté ses musiciens en chantant. Et, devant l’insistance
du public, a donné en rappel un autre original, «Mista»,
pour lequel elle a invité sur scène Claudio Jr. De La Rosa (ts), leader d’un
des groupes qui concouraient ce jour-là (voir plus loin). L’ovation finale fut
mémorable.

Le 2 juillet, dernier jour du festival, on
affichait aussi complet pour Chucho Valdés en quartet (Yelsy
Heredia, b, El Pico, dm, Yaroldy Abreu,
perc). Ce fut un concert joyeux, exubérant, flirtant également par moments avec
la musique classique. Soit un voyage d’une heure et demi dans les Caraïbes. Les
solistes ont su mêler leurs styles, comme sur «El
tango de Lorena», un hybride du tango et du blues, tel que Valdés
lui-même l’a décrit. Il a enchaîné avec «Son 21», «Le Rumbón», une composition
de musique paysanne qu'il a appelé «Country Cuban
Music», «Con poco coco» (un morceau de
son père, Bebo Valdés), une adaptation -proche du boléro- du «Prélude n° 4»
de Chopin, une fusion de conga, jazz
afro-cubain et contradanse sur «Conga-Danza», ou encore son «Caridad Amaro» et
un medley de jazz «américain». En rappel, Chucho Valdés a offert «Son Andino», un
rencontre entre Cuba et les Andes, en invitant le public à danser les «timbas»
cubaines au son de la contrebasse.
 Au concours de groupes le jury a fait sensation
en attribuant le premier prix au trio norvégien Malstrom (Salim Javaid, as,
Axel Zajac, g, Jo Beyer, dm) dont le projet présentait des éléments de rock
progressif et de free jazz proches de The Thing. Le prix du meilleur soliste est allé à
Alistair Payne, le trompettiste du Quintet Sun-Mi-Hong, groupe qui a reçu le
deuxième prix. Le public s’est une nouvelle fois distingué du jury en donnant
sa voix au quartet de Claudio Jr. De La Rosa, ainsi que le prix du meilleur
soliste à son leader.
Dans la partie «Troisième Millénaire» se sont spécialement démarqués le
quartet de la chanteuse Anne Bejerano, le
quintet de Dahoud Salim (p, gagnant du concours
de l'année passée) et le trio de Giulia
Valle (b), avec Marco Mezquida (p) et David Xirgu (dm).
Il faut enfin signaler
la belle exposition photographique Jazz for Two…and Two for Jazz (40 clichés) proposée par «notre» José
Horna, à la salle d’exposition Torrene, pendant le festival.
Lauri Fernández
photos José Horna
© Jazz Hot n° 681, automne 2017
|
Corbeil-Essonnes, Essonne
Corbeil-Essonnes Jazz Festival, 23 juin-2 juillet 2017

Le Corbeil-Essonnes
Jazz Festival, organisé par l'association Codjace, a proposé une programmation
une nouvelle fois marquée par son partenariat historique avec le Caveau de La
Huchette. C’est en effet la troupe du Caveau, emmenée par Dany Doriz (vib), qui
a ouvert le festival avec un grand concert évoquant le film de Damien Chazelle,La La Land, dans lequel le célèbre
club parisien apparaît. Se sont donc retrouvés sur la grande scène du parc
Chantemerle: Wendy Lee Taylor et Austin O’Brien (voc), Tony Solà et Pascal Thouvenin (ts), Ronald
Baker (tp, voc), Jeff Hoffman (g), Philippe Petit (p), Cédric Caillaud (b),
Didier Dorise (dm) et un très jeune invité, Nirek Mokar (p). En outre, s’ajoutait
à cette 18e édition une dimension féminine importante avec la
présence de Sarah Lenka (voc, le 25 juin), Gunhild Carling (tp, voc, le 1er juillet), Mariannick Saint-Céran (voc, le 2 juillet) ou encore Rhoda Scott
(org, le 24 juin), concert auquel nous étions présents.

Rhoda Scott était ainsi à la
tête d’un groupe presque exclusivement féminin: Aurélie Tropez (cl), Nicolas
Peslier (g), Julie Saury (dm) et Linda Lee Hopkins (voc). La première partie du
concert, instrumentale, a donné l’occasion à Rhoda de mettre en valeur ses
sidewomen, avec une prise de leadership d’Aurélie Tropez sur «In My Solitude» (il est à souligner que si
la clarinettiste était à son aise sur ce morceau ellingtonien, elle a su
adapter son esthétique swing au groove gospel de l’organiste tout au long du
concert) et un revigorant solo de Julie Saury sur «Caravan». L’accompagnement
très fin de Nicolas Peslier étant également à souligner.
Avec
l’arrivée de Linda
Lee Hopkins sur «What a Wonderful World», le concert a pris une nouvelle
dimension, plus festive; la chanteuse étant décidée à faire réagir un
public un
peu sage. Avec de puissants échos d’église dans la voix, elle a
rapidement
déclenché l’enthousiasme avec un prenant «Stand by Me» (où elle a
glissé,
le plus naturellement du monde, quelques mesures de «Fields of Gold» de
Sting),
«Hit the Road Jack» ou encore «Let the Good Time Roll» qui a fait se
lever
l’assistance. En parfaite osmose avec Rhoda Scott, dont elle partage les
racines musicales (sans compter que Julie Saury est excellente pour le
gospel), Linda Lee Hopkins a fini par ensorceler le public de
Corbeil-Essonnes qui a repris avec elle «Glory, Glory, Hallelujah!» en
se tenant
la main. Mais sur le rappel, Rhoda Scott a rappelé que c’était toujours
elle la
patronne, prenant tout le monde de cours avec «Ainsi Parlait
Zarathustra»,
d’abord pris avec toute la solennité de l’orgue (et de la batterie),
avant de
partir dans une improvisation jazz pour laquelle l’a rejointe l’ensemble
de la
troupe.
 Texte: Jérôme Partage
Photos: Patrick Martineau
© Jazz Hot n° 681, automne 2017
|
St-Gaudens, Haute-Garonne
Jazz en Comminges, 24-28 mai 2017
Pour
situer le Festival Jazz en Comminges qui en est à sa 15e édition, on
peut tout simplement citer la présentation de l’association CLAP qui
organise cette belle manifestation sur les bords de la Garonne.
«Depuis
des années, le Comminges est une terre de jazz. Terre de naissance de
Guy Lafitte, saxophoniste de renommée internationale, né à St-Gaudens.
Terre de clubs et de caves comme La Rotonde à Bagnères-de-Luchon où l’on
recevait les plus grands musiciens de jazz à l’époque du Hot Club.
C’est pour continuer cette histoire que Pierre Jammes et Bernard Cadène
créent en 2003 les Rencontres du saxophone, devenues le festival Jazz en
Comminges». Pour cette 15e édition le programme plus que riche
présentait au Parc des Expositions quatre grandes soirées avec sept
groupes de stature internationale et un grand nombre d’événements dans
toute la ville; des concerts gratuits avec le Festival Off, des
films, master-classes, expositions et conférences. L’association
regroupe un grand nombre de bénévoles de tous âges qui donnent une forte
vitalité et un entrain réjouissant à tous les participants, des
musiciens au public. L’époque du long week-end de l’Ascension permet de
découvrir en même temps une magnifique région aux pieds des Pyrénées,
riche d’un patrimoine culturel et d’une gastronomie incontournables.

Le
Big Band Garonne: Philippe Léogé (dir, clav) Frédérika (voc), Tony
Amouroux, Alain Cazcarra, Cyril Latour (tp) Rémi Vidal, Christophe
Allaux, Olivier Lachurie (tb), Christophe Mouly, Samuel Dumont, Jean
Michel Cabrol, David Cayrou (sax), Cyril Amourette (g), Pascal Selma
(eb) Florent «Peppino»Tysseyre (perc), Fabien Tournier (dm)



Retour
à la simplicité avec l’installation d’un authentique groupe de jazz, le
Roy Hargrove Quintet. Roy Hargrove (tp, flh,voc) se présente avec son
groupe quasi habituel car seul le pianiste Sullivan Fortner a été
remplacé par Takata Ono, pour cette pré-tournée de printemps. Costume de
rigueur, basket rouge aux pieds et sourire au visage, tel un lutin à la
houppe rigolote, il emmène son groupe sur les traces actuelles du jazz
américain. On entre immédiatement dans le jeu pour un jazz qui baigne
dans la tradition mais servi par une fougue moderniste. Le groupe joue
essentiellement des nouvelles compositions telles «Stuff», «Seven
Avenue» ou encore «Madness of the Earth». Nul besoin de superlatif pour
une formation solide ou chacun a l’occasion de s’exprimer: si Roy
Hargrove est bien le leader il laisse une large autonomie à des
musiciens de valeur. Tour à tour à la trompette et au bugle, il chante
aussi, assez discrètement, et scate en véritable héritier de Dizzy
Gillespie. D’humeur joyeuse, le groupe partage des moments de rythmes
accélérés ainsi que des ballades bien inspirées. Le pianiste Takata Ono,
au jeu complet, tisse tel une araignée, un accompagnement sans faille
et assure des solos de haut vol. Il signe une composition quasiment joué
en solo très émouvante. Justin Robinson (as), tel un autre lutin, mais
un peu enrobé, sa silhouette rappelle celle d’Arthur Blythe, prouve
qu’il peut rivaliser avec les grands noms de l’alto. Tour de force
d’Ameen Saleem (b) qui, sous sa casquette vite enlevée vu la température
de la salle, nous entraîne dans la moiteur de la jungle avec un solo
éblouissant. On n’oublie pas Quincy Philips (dm) qui lui aussi a fait
son petit tour de piste. Un seul regret: la longue première partie priva
une partie du public, parti avant la fin, du grand maître de la soirée:
Roy Hargrove!

Annoncé
en quintet le 26 mai, le groupe de Kyle Eastwood est en fait un
quartet avec un invité de marque. Très à l’aise sur cette scène qui l’a
déjà accueilli, il fait l’effort de s’adresser au public en français et
présente ses musiciens pour introduire la soirée à la contrebasse qui
démarre sur un de ses anciens titres, «Prosecco Smile», suivi de «Big
Noise», composition du répertoire de jazz écrite en 1940. Mariant
tradition et apport personnel, son répertoire et son interprétation sont
parfaitement équilibrés, rendant hommage à ses aînés, proposant des
nouveaux titres et évoquant sa passion pour la musique de film. Le
groupe évolue du trio au quartet, lui-même passant de la contrebasse à
la basse électrique, donnant à chacun l’occasion de se distinguer,
notamment Quentin Collins à la trompette et au bugle. Il poursuit avec
des titres de l’album Time Pieces qui vient de paraître, dont «Bullet
Train» puis un hommage à Herbie Hancock avec sa ballade «Dolphin Dance»,
dans un tempo très lent surligné par un solo du bugle. Sur le cinquième
thème, «Marrakech», qu’il avait composé dans sa jeunesse, suite à son
premier voyage au Maroc, apparaît il maestro Stefano Di Battista
(as, ss), resplendissant et modeste. Dans une évocation orientale, le
soprano survole le climat dessiné à l’archet rythmé de percussions
chatoyantes. Une véritable initiation aux mystères du désert qui envoute
sur un crescendo au son hypnotique. En hommage à l’Italie et au cinéma,
le groupe devient trio, basse électrique, piano et soprano pour
interpréter le thème principal du film Cinema Paradiso,
composition d’Ennio Morricone, qui nous fait revivre le film sans les
images, une version touchante. Rappelant son statut de compositeur de
musique de cinéma, Kyle nous livre avec Andrew McCormack (p) une version
épurée de la bande sonore de Letters From ’Iwo Jiwa, réalisé par
son père. Le groupe au complet termine sur une version vitaminée de
«Boogie Stop Shuffle», aussi sulfureuse que l’original de Charlie
Mingus. Depuis des années, Kyle Eastwood, en toute discrétion, a gravi
les marches qui le mène de la notoriété héritée d’un père célèbre à un
véritable statut de musicien respecté. Aujourd’hui, son talent de leader
se double de celui d’un excellent compositeur entourée d’une équipe
fidèle et d’invités de marque qu’on peut retrouver sur son dernier
album:
Kyle Eastwood (b, eb), Andrew McCormack (p), Quentin Collins (tp, flg), Chris Higginbotton (dm) et Stefano Di Battista (as, ss)

A
l’aube de ses 73 ans, le pianiste jamaïcain Monty Alexander apparaît
toujours aussi élégant, un vrai gentleman du clavier. Il a choisi depuis
quelques années de jouer soit en trio acoustique dans un répertoire
très jazz ou dans ce groupe, Junkanoo Swing, qui mélange la musique de
Harlem aux racines de son île natale, voyageant du calypso au reggae
avec des escales jazz. En fait, il y sur scène un trio et un groupe de
reggae qui repose magnifiquement sur la rythmique du batteur Karl
Wright. N’ayant plus rien à prouver depuis longtemps, vu sa formidable
carrière, il semble se faire plaisir en amusant le public qui revisite
ainsi ses compositions et de grands standards dans un pot-pourri soigné
et joué de façon magistrale. Clin d’œil à ses rencontres avec Harry
Belafonte pour le calypso «Banana Boat Song», tube interplanétaire, une
brève évocation du thème de James Bond 007 contre Dr. No, qui se passait
à la Jamaïque, une citation de la Panthère Rose d’Henri Mancini, le
tout en passant du trio acoustique au quartet électrique très carré.
Adoubé par Duke Ellington, il introduit en sa mémoire une version très
personnelle de «Duke’s Place» qui devient «Hello» de Lionel Ritchie et
poursuit avec «Hurricane Come and Gone», belle composition signée de sa
plume, enchaînée à «Could Be You Love», un reggae de Bob Marley. Pour
terminer le concert, il rappelle la mémoire de Bob Marley dans une
version gospel de «No Woman No Cry», autre tube international qui
rassemble toujours la foule. Le contrat est rempli, mais le public très
nombreux réclame un rappel qui sera un blues déviant vers un calypso
signé encore par Harry Belafonte, mais sacralisé en jazz par Sonny
Rollins (un de ses anciens employeurs) «Don’t Stop the Carnival», thème
dansant qui mettra en valeur les batteurs dans un échange type battle
drums: Un concert au millimètre servi par un grand professionnel!
Monty Alexander (p,melodica), Hassan Shakur (b), Jason Brown (dm), Leon Dunkan (eb),Andy Bassford (g), Karl Wright (dm, perc)
Parmi
les nombreux concerts qui animèrent la ville dans plusieurs lieux, nous
pouvons entre autres citer, le duo trompette et guitare Religio, le
groupe de la chanteuse Manel Cheniti, dans un répertoire consacré à
Dinah Washington et le groupe So Groovy, dont les cuivres et la
chanteuse, Valéria Vitrano, ont fait trembler les piliers de La Halle
aux Grains. Il ne faut surtout pas oublier l’Atelier Adultes du
Conservatoire Guy Lafitte qui a mis particulièrement en valeur les plus
jeunes en quintet dans leur composition intitulée «Detroit» et une
version fort sympathique de «Litlle Sunflower». Quant au deuxième
Tremplin Jeune Talent, qui se déroulait tôt le matin, on a pu découvrir
trois excellents jeunes groupes, dont deux gagnants exæquo qui seront
programmés en sélection du Off lors du prochain festival. Les deux
vainqueurs sont le Guillaume Ramaye Reunion Project et le quartet Minor
League, emmené par le guitariste Jérémy Bonneau. Le troisième groupe,
non retenu, La Cave, n’a pas démérité mais ce groupe au style de rock
progressif dirigé par le guitariste Cyril Bernhard est plus adapté à un
circuit rock.
L’édition 2017 se poursuivait le samedi 27 mai, en
notre absence, avec un concert à guichets fermés pour la venue de Jamie
Cullum, artiste toujours aussi populaire.
Elle se terminait le
dimanche 28 mai par une très longue journée qui accueillait le futur du
jazz régional. Le public devait ainsi découvrir à La Halle aux Grains
les ateliers des cycles longs de l’Ecole de Musique Music’Halle, suivi
dans l’après-midi des classes à horaire aménagé du Collège Didier
Daurat, de l’orchestre du Conservatoire Guy Lafitte dirigé par Wilfrid
Arexis et pour terminer le formidable Big Band 65, qui depuis 1978
honore par son swing le département des Hautes Pyrénées. Sans oublier,
pour les stakhanovistes, le concert du septet Offground donné à
l’auditorium de la Médiathèque du Saint-Gaudinois.
Pour découvrir la
totalité des manifestations et des superbes équipements culturels de la
Ville de St-Gaudens et de la Communauté des Communes du
Saint-Gaudinois, il faudra revenir l’année prochaine. En attendant, vous
pouvez découvrir le détail des actions de l’Association CLAP dans le
cadre du festival sur le site www.jazzencomminges.com et si vous êtes à
proximité rejoindre les rangs des bénévoles nécessaires à la réalisation
de ce festival incontournable en Occitanie.
Michel Antonelli
© Jazz Hot n° 680, été 2017
|

Bergame, Italie
Bergamo Jazz, 23-26 mars 2017
La 39e édition de Bergamo Jazz –la seconde sous la direction de Dave Douglas– a
proposé un programme dense et de qualité élevée, avec quelques
nouveautés: un espace appréciable était réservé aux jeunes groupes
italiens émergents dans la session Scintille di Jazz dirigée par
le saxophoniste bergamasque Tino Tracanna; la fascinante cité lombarde
offrait une vaste distribution des nombreux événements en de multiples
lieux (dont quelques-uns n’ont jamais été ouverts à la musique). Outre
le Teatro Donizetti, destiné aux concerts du soir, le Teatro Sociale et
l’Auditorium della Libertà, le public a pu jouir de cadres inédits tels
que la Biblioteca Angelo Mai, l’Accademia Carrara et l’ex-Monastero del
Carmine. A l’intérieur de ce riche programme –entre le confirmé, le
surprenant et quelques désillusions– on peut trouver quelques pistes qui
contribuent à faire réfléchir sur la fonction culturelle et, pourquoi
pas?, sociale d’un festival de jazz aujourd’hui.
L’art difficile du trio
La
musique de l’OriOn Trio de Rudy Royston (dm) se développe sur des
pédales modales et des tempos libres, mais aussi sur le groove et des
patterns rythmiques élémentaires. Dans les parties modales, et encore
plus quand il se confine dans l’informel, on retrouve des échos de
l’incommensurable leçon du compositeur Paul Motian. Dans ce contexte,
l’attention à la dynamique est maximale et offre à Royston le prétexte
pour jouer sur les timbres et les couleurs. Ailleurs, l’approche
rythmique est en revanche plus plate et conventionnelle, révélant les
limites d’un leadership encore simpliste et d’un projet inachevé. La
propulsion de Yasushi Nakamura (b) est puissante et pourvue de son et de
sorties vibrantes. Fréquemment au-dessus des lignes et aux marges de
l’intonation, Jon Irabagon élabore un crescendo inspiré du phrasé
corrosif rappelant David Murray, David Ware au ténor et Sam Rivers au
soprano.
Pleinement
consciente de l’histoire du ténor, la chilienne Melissa Aldana, âgée de
28 ans, fait preuve d’une personnalité prometteuse et d’une volonté de
définir son propre langage, surtout par des compositions originales
desquelles émerge une matrice latine sans traces de lieux communs. Son
style est caractérisé par un son rond, un phrasé clair et jamais
interminable, dans lesquels on trouve des traces évidentes de Warne
Marsh, Sonny Rollins et de son maître George Garzone. Une telle attitude
se reflète aussi dans le traitement des standards: un «Spring Can
Really Hang You up the Most» raisonné et précédé par une introduction où
viennent s’élaborer des variations autour du fragment initial du thème
de «Saint Thomas». Polyvalente, sèche et empathique, la rythmique –son
compatriote Pablo Menares (b) et Craig Weinrib (dm)– intègre chaque
sollicitation qu’elle souligne avec discrétion, et relance.

Le solo comme défi
Dans
la poétique d’Evan Parker –engagée ici exclusivement au soprano– la
respiration circulaire est le moyen employé pour construire des spirales
concentriques alimentées par une logique stricte. Les cellules se
multiplient, jusqu’à créer une sorte de loop hypnotique et
induire un état de transe, héritage de cultures anciennes, grâce à des
harmonies, des micros, des sopranos et des registres extrêmes. D’une
masse sonore apparemment informe émergent continuellement des schémas
géométriques et des phrases (ré)générées. Malgré tout, sur le terrain de
l’improvisation aléatoire, on peut identifier une forme et une unité
structurelles. L’itération effleure parfois l’univers de Terry Riley,
non sans raison sopraniste. De brèves phases statiques s’ouvrent
occasionnellement, avec des changements de registre et de timbre, d’où
affleurent aussi des fragments mélodiques. L’importance que Monk et Lacy
(hommage à travers «The Dumps») attachaient aux pauses et au silence,
est mise volontairement au second plan.
Le
violoncelliste Ernst Reijseger est partisan de la conception de
l’improvisation totale, libérée des matrices prédéfinies selon les
canons historiques de l’école hollandaise. Dès lors il se construit un
flux sonore qui peut prendre vie par l’archet hypnotique pour ensuite
s’élever en soudaines visites tournées vers le blues. Ou bien, il crée
des progressions de saveur Bach combinées avec des vocalises, et il
utilise le pizzicato pour élaborer des phrases orientées vers la
formation d’un groove se rapportant à la mémoire des grands
contrebassistes qui s’exprimaient aussi au violoncelle comme Oscar
Pettiford, Ron Carter et Dave Holland, ou des spécialistes de
l’instrument tels Abdul Wadud et Hank Roberts. Puis il utilise tout le
corps de l’instrument à la façon de percussions ou d’une guitare. Il
émerge aussi des africanismes découlant de la collaboration avec le
Sénégalais Mola Sylla. Le rapport avec l’espace prend à travers le
mouvement un rôle prépondérant avec cette pincée de théâtralité et de
clownerie propres à la scène hollandaise.
Qu’est-ce qu’on entend aujourd’hui par «tradition»?
Dans la reprise de This Machine Kills Fascists,
disque dédié à Woody Guthrie, Francesco Bearzatti avec le Quartetto
Tinissima effectue une reconnaissance à l’intérieur des différentes
sources du jazz afro-américain, soulignant les racines folk et blues.
L’héritage de New-Orleans se manifeste dans la scansion rythmique et
dans certains mélanges entre clarinette et trompette, tandis qu’une
empreinte R&B découle du phrasé sanguin du ténor. Les digressions
rythmiques ouvrent le chemin à des solos incisifs. Sous cet aspect, les
enchaînements nets et logiques avec lesquels Giovanni Falzone (tp)
développe ses phrases se révèlent impressionnants. Danilo Gallo (b)
fournit le ciment avec son style sec mais polyvalent, recourant à une
ample gamme de timbres grâce à des pédales et des effets. Une
polyvalence exemplaire complétée par la variété des solutions de Zeno De
Rossi, capable d’exploiter un large éventail de couleurs de chaque
élément de la batterie.

Dans
un duo inédit avec Kenny Wollesen, Bill Frisell a proposé, avec une
inventivité rafraichissante, un panorama stimulant qui pourrait être la
définition d’Americana, ce qui veut dire un répertoire lié à la
tradition populaire en accord avec l’acception la plus grande du terme.
Cela ressort en particulier par l’emploi varié des timbres pendant
l’exécution grâce aux ressources du pédalier. De douces mélodies (comme
l’originale «Steady Girl») avec des réminiscences country et des accents
rock se trouvent réunies –dans une sorte de colonne sonore imaginaire–
par une harmonisation et une articulation du phrasé absolument jazz.
Quand Frisell salit et exacerbe les timbres il semble restaurer les
fastes de Before We Were Born. Le versant plus jazz rappelle la
collaboration avec Motian. On s’en aperçoit clairement dans la façon
dont le thème «Misterioso» est distillé, puis désarticulé, dans la
méticuleuse et réfléchie succession harmonique de «Lush Life», dans les
lignes superbes d’«Oleo». Ces caractéristiques enrichissent les versions
de «A Hard Rain’s A-Gonna Fall» de Dylan, abordées avec une audace
corrosive, et «What the World Needs Now Is Love», de Bacharach, jalonnée
de délicates figures mélodiques. Dans chaque passage, Wollesen suit le
dessin du collègue avec une grande sensibilité dynamique, d’heureuses
intuitions de timbres et une approche contrapuntique par endroits,
utilisant aussi dans un même morceau les baguettes, les mailloches
feutrées et divers types de balais.

Simply Ella de Regina Carter est un non projet, exemple typique de «comment on ne
devrait pas appliquer des critères servilement philologiques à la
tradition». En pêchant dans le répertoire global de Fitzgerald, Carter a
exécuté des versions privées de contenu, d’intuition et d’âme, sans
rien y ajouter de personnel: en gros, elle a confectionné du cover.
Ainsi elle a rendu vain le travail d’arrangement de Marvin Sewell,
réduisant au minimum syndical la contribution de Reggie Washington (b)
et Alvester Garnett (dm). Unique exception, Ellington: «Come Sunday»
exprimé à la fin par un interplay et «Imagine My Frustration» pourvu d’un minimum de blues feeling.
L’idée
d’introduire l’orgue (en réalité un clavier qui en reproduit les
sonorités) en le confiant à Cooper Moore permet à William Parker de se
rattacher non seulement aux œuvres des grands solistes comme Jimmy
Smith, Jack McDuff, Big John Patton, Larry Young, mais aussi à la
tradition du soul jazz et du R&B sans jamais utiliser aucun élément
dérivé ou philologique. C’est plutôt en unissant ses lignes puissantes
et enveloppantes au drumming polyrythmique et dense d’africanismes du
partenaire proverbial Hamid Drake que Parker parvient à une installation
des plus solides et en même temps fluide par les placements d’un orgue
toujours en dehors des schémas et par les progressions brûlantes du
ténor de James Brandon Lewis, qui regarde plus vers Rollins, Ayler,
Shepp et Ware que vers Coltrane, mais semble aussi avoir assimilé la
leçon de Hawkins, Gonsalves et des ténors texans. Evidemment tout en
étant dotée d’une nette matrice afro-américaine, cette musique est à des
années lumière du groove canonique. Elle se transforme plutôt en un
flux de magma bouillonnant.

Le son ECM
Au
prestigieux label allemand ECM s’attache une poétique orientée vers une
recherche abstraite de la pureté sonore. Amateurs et opposants d’une
telle orientation auront tiré des motifs valables de discussions dans
deux événements proposés à Bergame.
Espaces
et silences. Eléments nécessaires en musique, explorés à fond par des
compositeurs contemporains comme Morton Feldman. Le Norvégien Christian
Wallumrød s’inspire de ces critères pour réaliser avec son ensemble un
tissu basé sur la répétition systématique de noyaux harmoniques
essentiels et de micro-cellules mélodiques. Il en résulte de subtils
mélanges de timbres entre le piano et l’harmonium du leader, vibraphone
ou batterie (Per Oddvar Johansen), violoncelle (Katrine Schiøtt),
trompette (Eivind Lønning) et (Espen Reinertsen) ténor. La musique reste
en équilibre entre espace et profondeur mais dénonce aussi des contenus
très fragiles. Certains moments chorals étaient plus appréciables, dans
lesquels au moins le dessin mélodique réussit a circuler, à tel point
que l’improvisation s’efface complètement et se confine en territoire
académique.
Avec le solide quartet Surrounded by Sea, Andy Sheppard semble poursuivre une recherche de la double nature:
d’une part des mélodies limpides, d’une lisibilité simple; d’autre part
des dynamiques diffuses, impalpables, aux limites du silence. Au-delà
des meilleures intentions, il en découle une musique terriblement
statique et privée de feu créatif, qui limite la notable aptitude des
musiciens, à commencer par l’inventivité du leader. Les intuitions
mélodiques et l’inclination dialectique de Michel Benita sont réduites à
l’os, tandis que Sebastian Rochford (dm) apparaît confiné dans un rôle
de modeste (et par intermittence incertain) second rôle. Elvind Aarset
(g) développe avec une efficace économie sa fonction de sonorisateur à
l’aide de la vaste gamme d’effets et le support de l’électronique, mais
il n’est pas mis dans la condition d’exploiter pleinement de telles
ressources pour créer un contraste plus consistant.
Musique pour grands ensembles
Exemple
particulier de la féconde scène scandinave, Shamania est une formation
féminine de onze éléments (plus une danseuse) réunis par Marilyn Mazur.
Malgré son rôle de direction musicale, la percussionniste danoise ne
concentre pas sur elle les exécutions. Au contraire, certains de ses stimuli (comme les configurations et les séquences colorées) donnent le
prétexte et l’occasion de collectifs joyeux, la circulation
«démocratique» de cellules mélodiques, échanges entre les sections ou à
l’intérieur de chacune. Celle des soufflants
(alto/ténor/soprano-trompette-trombone) est particulièrement animée
–enrichie de deux vocalistes Josefine Cronholm et Sissel Vera Pettersen–
en possession d’une vaste gamme expressive et capables d’acrobaties
téméraires. A noter aussi pour son expérience de l’improvisation
radicale, Lotte Anker (ts, ss), qui se distingue par un phrasé anguleux
et par un timbre vif. Le choralité polyphonique des exécutions puise
avec une inspiration libre dans la musique ethnique (en particulier de
l’Afrique), mais le langage et l’esprit sont absolument jazz.

Sur
la base d’une collaboration de 20 ans, Enrico Pieranunzi a présenté
avec le Brussels Jazz Orchestra, formation belge de 16 éléments, une
série de ses compositions finement arrangées par le trompettiste Bert
Joris, desquelles ressortent «Persona», «Fellini’s Waltz», «It Speaks
for Itself» et «With My Heart in a Song». L’écriture harmoniquement
dense et mélodiquement linéaire du pianiste romain se trouve ici mise en
valeur par des échanges et des stratifications entre les sections de
anches et de cuivres, par les superpositions rythmiques sur l’usage
récurrent du ¾, ainsi que les intéressantes solutions timbriques, comme
la combinaison fréquente entre Clarinette et flûte. La choralité et la
précision des arrangements limitent au minimum indispensable les solos
qui atteignent la plus grande efficacité expressive dans les séquences
entre l’alto (Frank Vaganée), la trompette (Pierre Drevet) et le
trombone (Marc Godfroid).

Place aux jeunes!
Pour
la vitalité et le futur d’un festival en Italie, il est fondamental de
mettre en avant la réalité locale, avec une attention particulière aux
talents émergents. Dans le cadre de la section Scintille di Jazz le groupe de la vocaliste de 27 ans Camilla Battaglia s’est signalé en reproposant une bonne partie du récent Tomorrow-2 More Rows of Tomorrows.
Il s’agit d’un projet courageux basé sur un répertoire totalement
original, dans lequel Camilla recherche un mariage peu facile (ou
peut-être mieux: une unité) entre des textes cérébraux, des mélodies au
dessin ardu et une harmonie complexe. Pénalisée en la circonstance par
un mauvais message, la voix participant aux dynamiques collectifs.
Camilla est fille de: sa mère est la chanteuse Tiziana Ghilioni, son
père est Stefano Battaglia. On ne peut qu’apprécier son effort de
chercher sa propre identité, loin des stéréotypes de la chanteuse de
jazz ou d’encombrants modèles. Il serait souhaitable de rechercher une
plus grande finesse et musicalité dans les choix phonétiques et
lexicaux. L’apport du groupe est intéressant, avec en plus de
l’incomparable Roberto Cecchetto (g), Nicolò Ricci (ts), Federico
Pierantoni (tb), Andrea Lombardini (elb) et Bernardo Guerra (dm).
En
conclusion cela vaut la peine de rappeler que dans le petit espace du
Teatro Donizetti était présentée l’exposition photographique Il Jazz di Riccardo Schwamenthal,
photographe bergamasque, passionné historique, disparu en octobre
dernier: des documents des plus précieux, rigoureusement en noir et
blanc, sur les protagonistes d’une époque mémorable. Le Donizetti ne
sera pas disponible, à cause de restaurations urgentes, pour la 40e édition de 2018, pour laquelle on peut s’attendre à une symbiose future avec d’autres lieux évocateurs de la cité.
Enzo Boddi
Traduction Serge Baudot
Photos de Gianfranco Rota by courtesy of Bergamo Jazz
© Jazz Hot n° 679, printemps 2017
|

Marseille, Provence
Jazz sur la Ville, 3 novembre-3 décembre 2016
Jazz sur la Ville fêtait sa 10e édition en onze ans d’existence. Cette manifestation atypique assimilée
à un festival a démarré autour de six associations marseillaises et
compte aujourd’hui 46 partenaires répartis sur l’ensemble de la Région
Provence-Alpes Côte d’Azur 1.
Cette année plus de 300 musiciens (266 professionnels et une
cinquantaine d’amateurs) ont donné 70 concerts, complétés par deux
expositions (Flying Dutchman Records, Jazz à Porquerolles par ses photographes), trois films (Histoires de l’Accordéon, Music Is My Way, The Whole Gritty City), quatre masters classes (Andy Emler, Jazz à la voix, Reggie Washington, Francis Varis-Raoul Barboza), une conférence (Detroit, capitale ignorée de la musique), une lecture musicale (Thelonious Sphere Monk), un ciné concert (Les saisons) et une création théâtrale (La nuit ou Nina a chanté),
soit un total de 81 manifestations qui placent cette nouvelle édition
dans le peloton de tête des événements dédiés au jazz dans le sud-est de
la France. L’ampleur de la manifestation est l’occasion (et la raison)
ici d’un compte rendu collectif… Merci à tou(te)s.
Jeudi 3 novembre
Le
Cri du Port-Lou Tavano (voc) Sextet: Alexey Asantcheeff (p), Arno de
Casanove (tp, flh), Maxime Berton (sax, bcl, fl), Alexandre Perrot (b),
Ariel Tessier (dm)
Le coup d’envoi est donné par le concert de Lou Tavano qui présentait son nouvel album For You composé
en partenariat avec le pianiste Alexey Asantcheeff. Pour son premier
concert marseillais, l’élégante chanteuse, superbement épaulé par une
équipe de jeunes musiciens, donna tout son soul et emporta haut la voix
un auditoire ravit. Le public très enthousiaste lui fit trois rappels,
honorés à chaque fois par une nouvelle composition parfaitement
maîtrisée. La fougue de la jeunesse, un groupe très soudé, un répertoire
original fit de cette soirée une réussite totale malgré une salle à
moitié pleine. Le la de Jazz sur la Ville était donné.
Samedi 5 novembre
Le Non-Lieu-Detroit capitale ignorée de la musique
Cette
conférence musicale donnée par François Billard (journaliste, écrivain,
producteur discographique…) a été suivi de la projection de Resilience,
un documentaire sur la résistance des habitants de Detroit. Dans le
cadre kitch-chaleureux du Non-Lieu, cette conférence nous a promené
depuis les années trente jusqu’à aujourd’hui à travers les genres
musicaux, du jazz de Don Redman au rap d’Eminem. Le style tient autant
du happening verbal, d’une forme d’improvisation que du genre savant. Il
en résulte une promenade séduisante dans la jungle épaisse des musiques
de Detroit, la ville demeurant le héros, avec ses multiples lianes
permettant de passer d’un genre à un autre. C’est une forme inédite de
DJing commenté sur le mode ironique. Le documentaire Resilience a
apporté un beau contrepoint à cette odyssée. Il témoigne admirablement
de l’interaction entre la musique et la vie de ses habitants et de la
résistance d’une population, unie contre la misère et les magouilles des
politiques et des hommes d’affaires. Non, Detroit n’est pas près de
mourir.
Samedi 5 novembre
La Meson-Dèlgres: Baptiste Brondy (dm), Rafgee (tb, sousaphone), Pascal Danaë (voc, g)
Le
nom du groupe vient de celui de Louis Dèlgrès, officier métis qui
combattit le rétablissement de l’esclavage par Napoléon à la Guadeloupe.
Le leader Pascal Danaë se rappelle son ancêtre, Louise Danaë, esclave
affranchie en 1841, et évoque un univers musical entre le blues et ses
racines africaines. Le choix de l’orchestration, dobro électrifié et
sousaphone donne une coloration très particulière à ce blues chanté en
dialecte et créole bien soutenu par un batteur dans la lignée du
«Chicago sound». Un blues tropical qui électrise l’auditoire, la petite
salle de La Meson, bourrée presque comme toujours. Une forme originale
qui sied à un blues revisité par une véritable sincérité.
Dimanche 6 novembre
Musée Cantini-What’s News? Reimagining Benny Goodman: Oran Etkin (cl, bcl), Sullivan Fortner (p)
Dans
la grande salle du Musée Cantini, qui accueillait l’exposition Le Rêve,
Oran Etkin pour sa première venue à Marseille a fait danser l’âme des
peintres et du public. Oran Etkin (élève de Dave Liebman et David
Krakauer) affirme son attachement à un jazz traditionnel, ici puisé dans
l’œuvre de Benny Goodman et la veille dans celle de Duke Ellington,
lors d’un concert (Wake Up Clarinet!) pour le jeune public à La
Criée. Les spectateurs répartis autour du groupe, certains presque
adossés aux toiles, à la stupeur des gardiens, ont apprécié un style
maîtrisé, très chic. Ce concert gratuit, présenté par Marseille
Concerts, a permis à un public non spécialiste de découvrir un excellent
musicien et une exposition.
Dimanche 6 novembre
Le Cri du Port-Ligne Sud: Christian Gaubert (p), Jannick Top (elb), André Ceccarelli (dm) + Christophe Leloil (tp)
Retour
à Marseille et au jazz pour Christian Gaubert. Si Christian a fait ses
armes au Conservatoire de Marseille puis a formé trio et big band au
service du jazz, c’est par ses collaborations avec les grands noms de la
chanson (Aznavour, Bécaud, Shuman…) qu’il est devenu un compositeur,
arrangeur, chef d’orchestre très recherché aussi bien dans les studios
d’enregistrement que dans le cinéma. Avec son trio Ligne Sud, il
retrouve ses amis Jannick Top et André Ceccarelli et replonge dans
l’univers du jazz en signant deux opus dont le second Lendemains
prometteurs vient de paraître. Il signe des thèmes qui empruntent les
chemins de la Bulgarie, de la Turquie et plus loin l’Arménie. Pour ce
concert à l’heure du thé, les amis et le public ont répondu présents et
la petite salle (135 places) du Cri du Port a refusé du monde. Le trio
renforcé par le trompettiste Christophe Leloil (présent sur le dernier
album) a poursuivi son voyage.
Jeudi 10 novembre
Espace Julien-Omer Avital (b) Quintet: Eden Ladin (clav), Asaf Yura (as, ts), Alexander Levin (ts), Ofri Nehemya (dm)
La
jeune génération des musiciens israéliens installés à New York,
présenté par L’Espace Julien et le Cri du Port, est prometteuse. Omer
Avital tel un Charlie Mingus, dont il s’inspire fortement, ne laisse
aucun répit à son combo et à son auditoire. Ce soir, il présente son
nouvel album Abutbul Music qui voyage entre Amérique urbaine et
Moyen-Orient. Les arrangements sont soignés même si par moment ils sont
un peu répétitifs, mais le but est la transe, et ça fonctionne à
merveille.
Vendredi 11 novembre
Atelier des Arts-David Patrois (vib) Trio: Jean-Charles Richard (ss,bs), Luc Insenmann (dm)
La
petite salle du quartier de Sainte-Marguerite accueille depuis quelques
années des concerts de jazz plutôt classique. Ce concert, présenté par
le Cri du Port, le second dans ce lieu, réunit un public très attentif
pour un répertoire bien pointu. L’audience peu habituée à cette formule
lui a fait un chaleureux accueil. David Patrois, l’un des rares
vibraphonistes nationaux, proposa un répertoire original, la plupart sur
son dernier album Flux Tendu. Le groupe avait choisi de jouer
acoustique et leur écoute mutuelle était perceptible. Luc Insenmann,
parfait aux balais et aux baguettes, assura une superbe rythmique et si
ma préférence alla au baryton de Jean-Charles Richard, son jeu soprano
se maria allégrement aux lames du vibraphone.
Samedi 12 novembre
La Maison du Chant-Tribute to the Jungle Queen Abbey Lincoln: Aïda Diene (voc) Edouard Leys (p), Guillaume Alexandre Robert (b)
Après
avoir assuré un stage vocal, la veille à La Maison du Chant, Aïda Diene
nous a entraîné dans une jungle où la reine se nomme Abbey Lincoln. Le
titre interpellait, et la chanteuse rappela, en quelques titres, le
parcours de chanteuse, poétesse, féministe mais aussi militante pour
l’égalité des droits civils. Solidement épaulé par Edouard Leys au piano
et par Guillaume Alexandre Robert, le trio présente une belle cohésion.
Aïda a chanté le gospel et ça s’entend notamment dans les passages en
solo complétement acoustiques où sa voix s’envole vers les anges. Aïda
vient aussi du Sénégal, et elle a voyagé entre Dakar, Paris et a choisi
aujourd’hui la Bretagne pour exprimer son art de chef de chœur. On peut
regretter beaucoup d’explications qui cassent un peu le rythme du
spectacle mais cela a le mérite d’expliquer le contexte. Ce « tribute »
évoque trois périodes essentielles du parcours d’Abbey Lincoln. Son
affirmation dans le jazz «Afro Blue», 1959), ses années aux côtés du
batteur Max Roach («Driva’ Man», 1960, «Lonesome Lover» 1962), et ses
grandes compositions du dernier album («Throw It Away», «Down Here
Below», 2006). Aïda, dans un esprit très gospel, chanta un émouvant
«Come Sunday», de Duke Ellington, qu’Abbey Lincoln avait gravé 1959 sur
l’album Abbey in Blue. Un concert très applaudi.
Dimanche 13 novembre
Le Parvis des Arts-La Nuit où Nina a chanté, de et par Emma Battesti-La Cie d’Ici
La
comédienne Emma Battesti évoque le parcours chaotique de Nina Simone
(née Eunice Kathleen Waymon), de sa Caroline-du-Nord natale à
Carry-le-Rouet où elle s’est éteinte à 70 ans comme elle l’avait
annoncé; une pianiste qui espérait devenir concertiste classique et qui
autant par le racisme que par le fait culturel est devenue pianiste
puis «Diva» du jazz. Atlantic City, New-York, Lagos, l’Europe, la
France, ses années de militante, cette folie qui l’habite et ce désir
d’affirmer sa liberté. En une heure de théâtre on découvre sa vie, ses
lubies, son exploitation par le système et ses maris, sa ruine et une
renaissance tardive admirée par le monde entier. Du choix de son nom
Simone, en l’honneur de Simone Signoret, de son amour pour les chansons
de Jacques Brel, qu’elle immortalisera par sa version anglaise de «Ne me
quitte pas» et sa magnifique interprétation de «Strange Fruits» qu’elle
s’approprie à l’égal de Billie Holiday. Emma Battesti dans un décor
très sobre et sombre et avec le soutien d’extraits musicaux, sollicite
notre attention et notre émotion. En ce dimanche, Le Parvis des Arts,
petit théâtre du 3e arrondissement, a intégré Jazz sur la Ville avec le public inhabituel des concerts de jazz.

Lundi
14 novembre-Cité de la Musique de Marseille-Andy Emler Running
Backwards: Andy Emler (p), Claude Tchamitchian (b), Eric Echampard (dm),
Marc Ducret (g)
Ce nouveau projet d’Andy Emler réunit une
fine équipe habituée à travailler à ses côtés, la rythmique fait partie
intégrale de son trio et Marc Ducret, en tant qu’invité, a souvent joué
avec Andy, notamment en duo. Il s’agissait du second concert du groupe
qui rodait un répertoire destiné à être enregistré au studio de la
Buissonne. Les musiciens ont offert une belle surprise presque
maîtrisée. Tous les musiciens sont des habitués des chemins de
l’improvisation mais les partitions sont là et il faut suivre la piste
du maître Emler. Le sourire est de rigueur, la complicité et le talent
font le reste. Les titres interprétés ce soir-là seront à écouter
prochainement sur disque…
Mardi 15 novembre
BMVR l’Alcazar-Marseille-Lecture Musicale, Thelonious Sphere Monk: Frank Cassenti (récit), Pierre Baillot (sa, oud), Julien Etheredge (perc), Paul Pioli (g)
Cette
lecture musicale était précédée de la projection du film Music is My
Way de Frank Cassenti, réalisé durant le Festival de Porquerolles avec
Charles Lloyd, Archie Shepp, André Minvielle, Jean-Jacques Avenel… qui
permit de découvrir la magnificence de l’ile mais aussi l’esprit amical
et intime de ce festival qui a fêté l’été dernier ses 15 ans. Frank
Cassenti, auteur et réalisateur de films, se révèle aussi un excellent
conteur et les anecdotes, tirées du livre But Beautiful: A book About Jazz de Geoff Dyer, nous font revivre l’étrangeté, la folie et le charme de
Mr. Monk. Les musiciens très discrets s’inscrivent parfaitement dans
cette démarche et illustrent avec simplicité les thèmes de Monk.
Jeudi 17 novembre
Le Cri du Port: Itamar Borochov (tp) Quartet, Shai Maestro (p), Avri Borochov (b), Jay Sawyer (dm)
Très
attendu pour sa première tournée en leader, le jeune trompettiste
israélien, Itamar Borochov, installé à New York, a rempli pleinement les
promesses annoncées par ses deux premiers albums, dont Boomerang2 qui vient de paraître sur le label Laborie Jazz.
Complétement
envouté par la musique, Itamar semble côtoyer les esprits et avec une
grande inspiration et une maîtrise parfaite va subjuguer le public venu
nombreux, qui lui a fait une véritable ovation. Il a interprété les
titres de son dernier album, Jones Street, sa rue préférée à New-York
City, «Wanderer Song», «Prayer» et un émouvant «Avri’s Tune» dédié à son
frère qui l’accompagne sans oublier «Samsara» tiré de l’album Outset.
On ne peut que vanter le pianiste invité, Shai Maestro, qui s’est
affirmé depuis des années en leader. Est-ce l’intimité de la salle, la
complicité avec le public ou tout simplement sa capacité à transcrire
une musique ancrée dans l’histoire du jazz mais qui n’hésite à flirter
avec l’Orient sans jamais tomber dans la facilité, qui transforma ce
simple concert en concert mémorable?

Fort
Napoléon, La Seyne-sur-Mer-Denis Césaro/Claude Basso Quartet: Denis
Césaro (p), Claude Basso (g), Jean-Marie Carniel (b), Thierry Larosa
(dm)
Pour souffler un air de Jazz sur la Ville sur La
Seyne-sur-Mer, Art Bop avait convoqué la vieille garde en la personne de
Denis Césaro et Claude Basso qui ont tenu leur promesse de fêter avec
chaleur leurs retrouvailles au Fort Napoléon. Devant un public
légèrement plus nombreux que d’habitude, ils ont su évoquer avec talent
et chaleur un répertoire varié allant de Michel Petrucciani à Bill Evans
en passant par John Abercrombie et Jim Hall. Les compositions
personnelles de Denis et Claude Basso (qui vient de publier un nouvel
album) ont pu compter sur la solide rythmique toulonnaise formée par
Jean-Marie Carniel, et Thierry Larosa.
Vendredi 18 novembre
Le Non-Lieu-Francis Varis, Raúl Barboza (accordéon)
Arrivant
pour la fin du premier set, je découvre Francis Varis dans une
magnifique version du légendaire thème nordestin Asa Branca de Luis
Gonzaga, suivi par un solo de Raúl Barboza, dédié aux indiens mapuches
d’Argentine. Les deux amis, invités par François Billard (animateur du
lieu, producteur discographique notamment de Francis Varis et coauteur
avec Didier Roussin du pavé: Histoires de l’Accordéon), se
sentaient comme à la maison, et allaient dans une simplicité (caractère
des plus grands) et avec humour nous livrer l’âme et le cœur de leur
piano du pauvre, devenu ce soir, le plus magnifique des instruments.
Tour en à tour en solo ou en duos, les accordéons chromatiques, à
touches pour Francis, à pistons pour Raúl, nous font voyager du jazz
musette à la pampa argentine, de la tradition française au tango de
Buenos Aires. Francis Varis salue la mémoire de son ami et guitariste
Didier Roussin, avec qui il a participé au renouveau de l’accordéon jazz
en France et passant au mélodica rendra aussi hommage à Toots
Thielemans, dans un Bluesette original.

Samedi 19 novembre
Bibliothèque
du Merlan-Andrea Caparros Trio Regra Três: Andrea Caparros (voc), Emile
Melenchon (g), Wim Welters (g7 cordes, cavaquinho)
La jeune
chanteuse d’origine franco-brésilienne a été bercé dès son enfance par
la musique de son père Georges (saxophoniste et accordéoniste), de son
oncle José (trompettiste) et dans la tradition de la Musique Populaire
du Brésil par sa maman. «La règle de trois» conforte cette jeune
formation où la voix est épaulée par deux bons guitaristes dont Wim
Welker à la guitare 7 cordes (typique) et au cavaquinho qui par ses
nombreuses collaborations (Caroline Tolla, Ze Boiade) devient le plus
brésilien des guitaristes marseillais, comme aurait pu le dire Vinicius
de Moreas. La chanteuse candidate malchanceuse du dernier tremplin Jazz à
Porquerolles, a fait d’énorme progrès est désormais maîtrise son
répertoire. Elle puise dans l’œuvre de Jobim (Samba do avião, Luisa), de
Dorival Caymmi (Doralice), de Baden Powell (Berimbao) et fait un clin
d’œil aux chanteuses, Elis Regina, Gal Costa, qu’elle admire. La
bibliothèque du Merlan, dans les quartiers Nord de Marseille, s’associe
chaque année, depuis 1998, à Jazz sur la Ville et a choisi la voix comme
référence.
Samedi 19 novembre-dimanche 20 novembre
La Meson-Reggie Washington (elb), Vinx (voc, perc)
La
Meson donne régulièrement une Carte Blanche à un musicien. Pour la
sienne, Reggie Washington a invité, pour une première inédite, le
percussionniste et chanteur Vinx, célèbre pour ses collaborations avec
Sting, Herbie Hancock ou Taj Mahal…Deux musiciens hors normes pour une
si petite salle qui affichait complet. On connaît surtout Reggie
Washington pour son travail auprès de Steve Coleman, Brandford Marsalis,
Cassandra Wilson…, le nouvel Attica Blues Band d’Archie Shepp et
actuellement auprès de Lisa Simone. Reggie va épauler avec une technique
parfaite la chaude voix de Vinx qui attaque avec un «Hello Sunshine
Where You Gone» fort original, utilisant delay, reverb et autre
technique pour multiplier sa voix. La formule fonctionne. La suite est
d’un grand professionnalisme mais limité par un manque de diversité. Ce
soir, c’était une première et cette expérience marque peut-être le début
d’un intéressant voyage.
Le 20 novembre, pour le second concert de
sa carte blanche, Reggie Washington a réuni un trio avec Hervé Samb,
avec qui il officie auprès de Lisa Simone2 et Ulrich Edorh (dm) mais
aussi producteur et animateur du Studio Da Town (Marseille). On marie
rock, funk, fusion et blues. Après un long premier titre où Hervé Samb
s’envole dans un superbe solo, le groupe enchaine un long titre en solo
par Reggie, «Mr. Pastorius» (qu’il avait gravé en 2006 sur A Lot of
Love, Live!) rejoint par un Ulrich Edorh funky.
Lundi 21 novembre
Cité
de la Musique de Marseille-The Frenchtown Connection: Pierre Fenichel
(b), Thomas Weirich (g), Romain Morello (tb), Simon «Braka» Fayolle (dm)
The
Frenchtown Connection est en liaison directe avec Trenchtown, quartier
emblématique des productions musicales de Kingston en Jamaïque. Une
plongée dans les multiples rythmes qui sont nés dans cette petite île:
nyahbinghi (burru), manto, ska, rocksteady et reggae bien sûr. Sous la
houlette de Pierre Fenichel, ce nouveau quartet livre sa première devant
un petit public car la pluie et le vent frappe Marseille ce soir-là.
Puisant dans le vaste répertoire, on marche dans les pas de Count Ossie
avec «Bongo man», «Light of Saba, des Skatellite ; Herb Challis, «Rock
Bottom, Ken Boothe ; I don’t see you cry ou encore du célébrissime Them
Belly Full (But We Hungry) de Lecon Cogill et Carlton Barrett chanté
par Bob Marley (album Natty Dread). Chaque titre a été arrangé pour
sonner plus jazz et les solistes à tour de rôle auront le loisir de
s’illustrer.
Mardi 22 novembre
Salon de Musique-Guzu et Michel Zenino Quartet
A
Salon-de-Provence, en première partie, nous avons apprécié la bonne
performance du jeune quartet Guzu, venu de Toulouse, représentant
l’école Music-Halle: Damien Gouzou (dm, compos),
En seconde partie,
Michel Zenino (b, compos) proposait un ensemble idéal avec Sophie Le
Morzadec (voc), Etienne Manchon (p, keyb), Antoine Paulin (g),
Christophe Monniot (as, sops), Leonardo Montana (p), Jeff Boudreaux (dm)
et c’est presque en qualité d’hôte de l’IMFP3 qu’il présente la musique de son nouvel album. La soirée est lancée par
un superbe double hommage à Horace Silver et Sigfried Kessler, Siggy
pour les intimes, compagnon de scène de Michel, qui signe avec «Silver
Blues Siggy» une composition de qualité. Michel Zenino présente un
nouveau quartet international avec Jeff Boudreaux venu de Baton Rouge
(LA), Leonardo Montana, natif de Salvador da Bahia (Brésil), Christophe
Monniot de Normandie et lui, le régional de l’étape natif de Marseille.
Des compositions originales, toujours présentées avec humour, nous font
découvrir, une très belle ballade «Malcolm», «The Mouse» racontant une
histoire de Roméo et Juliette revisité par des souris. Passionné de
chanson française, Michel, réinvente une version de «Sarah» de Georges
Moustaki, suivie de «San Francisco» de Maxime le Forestier. Le public,
en grande majorité jeune, en redemande.
Mercredi 23 novembre
Hôtel C2-No Drums Jazz Trio: Thierry Maucci (ts), Claude Vesco (g), Christophe Cuzzucoli (elb)
Dans
l’élégant salon de ce très chic hôtel, le No Drums Jazz Trio, sans
batterie, comme l’indique son nom, joue un répertoire puisé dans le jazz
des années 1960-1970. Volume adapté à l’auditoire qui très sagement
écoutera ce trio qui comprend deux vétérans (Thierry et Claude) du jazz
régional. Les deux compères présentent une longue carrière, dans des
styles très différents, free pour Thierry redevenu plus classique et
bop, fusion, modern jazz pour Claude. Le premier a signé une dizaine
d’albums sous son nom et le second, seulement deux, mais sa carrière
sillonne la nuit jazzistique marseillaise. Complété par Christophe,
adepte de la basse cinq cordes et admirateur de Jaco Pastorius, le
groupe s’est formé il y a deux ans et joue régulièrement un répertoire
revisité à sa manière. Entre Rollins et Pat Martino.
Jeudi 24 novembre
Le Cri du Port-Chicago Blues Festival 48e Edition: Eddie Cotton Jr. (g, voc), Grady Champion (harp, voc, g),
Diunna Greenleaf (voc), Kendero Webster (dm), Darryl Cooper (clav),
Myron Bennett (elb)
Cela fait près de 15 ans que le Chicago
Blues Festival, n’a pas fait étape à Marseille, le dernier concert de
Lil’ Ed & the Bues Imperials n’avait rassemblé qu’une cinquantaine
de personnes. Ce soir, carton plein au Cri du Port qui refuse du monde
depuis deux jours. Dans la pure tradition de ce tour, le groupe du
leader, en l’occurrence celui d’Eddie Cotton, avec l’invité, Grady
Champion, chauffe la salle, avant l’arrivée de la vedette puis du second
invité, la chanteuse Diunna Greenleaf. Niveau sonore à fond, les fender
twins crachent leur puissance et la chaleur monte dans la nuit. Le
public mi-debout mi-assis applaudit et danse, comme dans un lieu de
culte du blues éternel. Même si les musiciens, ne font pas (encore)
partie du panthéon du blues, ça assure et on en redemande. En fait les
musiciens viennent plutôt du Sud que de Chicago, Eddie Cotton Jr. et
Grady Champion sont natifs du Mississippi, et se sont illustrés à leur
début à Memphis et Diunna Greenleaf vient de Houston, Texas. Peu
importe, quand on a le blues… On y met ses joies et ses peines et tout
cela devient le blues, ici rageur comme à Chicago, la cité des vents.
Tradition oblige, on passera du blues endiablé à des chants d’amour
perdu, et chacun aura son morceau de bravoure à l ‘harmonica, solo de
guitare et chant. Dans la simplicité et avec bonne humeur les musiciens
nous ont offert une belle soirée avec authenticité. Commencé à fort
volume, le concert se termina sur la belle voix a cappella de Diunna
Greenleaf dans un pur gospel qui se sentit à sa place dans cet ancien
lieu de culte protestant.
Vendredi 25 novembre
Centre
Hospitalier Valvert-Les Impatients du Jazz II & Bloom Project. Fred
Pichot (ss, as, dir), Jean-Michel Troccaz (dm), Andrew Sudhibasilp (g),
Sylvain Terminiello (elb), Perrine Mansuy (keyb), Tania Zolty (voc)
invité spécial Didier Malherbe (duduk, fl, ss)
Les Impatients
du Jazz II est le second volet des ateliers que mène Fred Pichot avec
les patients du Centre Hospitalier Valvert, présenté par Marseille Jazz
des Cinq Continents & Osé l’Art. Il rassemble sur scène une
trentaine de personnes; pensionnaires, personnel hospitalier et
soignants, épaulés par des musiciens professionnels pour une démarche de
création collective. Le musicien mène la danse mais certains des
patients peuvent en devenir durant un moment le chef d’orchestre. Si les
arrangements semblent simples et répétitifs ils n’en demeurent pas
moins communicatifs et tous semblent enflammés dans la préparation et
l’exécution du concert. Le second volet de la soirée est consacré à la
rencontre entre l’orchestre de Fred Pichot et leur invité de marque, ce
soir le légendaire Didier «Bloom» Malherbe. Toujours aussi zen, Didier
nous conte en coulisse comment Fred lui a proposé cette rencontre
incluant des reprises du groupe Gong où il a officié depuis son origine.
Didier Malherbe connaît bien Marseille où il s’est produit avec le
premier Gong (Théâtre Toursky-mai 72) et plus tard avec Bloom, l’Equipe
Out, en duo avec Pierre Bensussan, et Haddouk Trio puis Quartet, sans
oublier en invité de Leda Atomica. Le groupe a pu répéter durant 3 jours
pour offrir ce soir un concert inédit, lui aussi à guichets fermés.
Samedi 26 novembre
L’Alhambra Cinemarseille-Louise & The Po’ Boys-The Whole Gritty City
Alexandra
Satger (voc, tom bass), Matthieu Maigre (tb), Seb Ruiz-Levy (tp),
Renaud Matchoulian (banjo), Djamel Taouacht (washbord, perc), Julien
Baudry (soubassophone)
L’Alhambra Cinemarseille et le Cri du Port
présentent chaque trimestre une soirée thématique où se combinent
concert et projection. Cette soirée dédiée à La Nouvelle-Orléans, a,
fait salle comble, un public de tous les âges dans ce quartier de
l’extrême-nord de Marseille, St-Henri. En lever de rideau, Louise alias
Alexandra Satger, en véritable chef de troupe, chantant dans un
mégaphone, suivie de ses musiciens, descend dans la salle par les
escaliers, enthousiasmant immédiatement le public qui les accueille
debout. Le groupe revisite des standards de la Crescent City, comme on
l’a baptisée, et sans aucun temps mort, en 50 minutes, gagne ses galons
de petit marching band. Mais ce soir son excellente prestation sera un
vrai concert, plus qu’un défilé, en hommage au berceau du jazz. Chacun
des musiciens assurent parfaitement son rôle, la section rythmique menée
par Renaud Matchoulian, Julien Baudry et Djamel Taouacht, ne lâche
jamais la pulsation qui permet aux solistes de nous offrir quelques
beaux solos, trombone (Matthieu Maigre) et cornet (Seb Ruiz-Levy), tant
en dialoguant chacun à son tour. Un salut particulier à Alexandra
Satger, dont la voix légèrement éraillée, et la fougue mènent de main de
maître son petit combo. Le programme allègre de ce soir comporte aussi
deux belles chansons d’amour tirées de la tradition du French Quarter,
interprétées en français, une des langues de la Louisiane.
Après un court entracte, le film de Richard Baber, The Wole Gritty City,
projeté en première régionale, nous plonge dans le quotidien de trois
marching bands de collèges de la Nouvelle-Orléans. Il suit pendant une
année des enfants qui grandissent dans la plus musicale et la plus
dangereuse des villes américaines. Leurs chefs d'orchestres les
préparent à participer en tant que musiciens à la parade du Mardi Gras
mais aussi à survivre à la violence de leur environnement. Ce document
social et musical fut salué par le public, faisant de cette soirée un
succès populaire.
Dimanche 27 novembre
La Maison des Arts (Cabriès)-Jacky Terrasson (p), Stephane Belmondo (tp)
Les musiciens se côtoient depuis des années et ont souvent joués ensemble au sein de diverses formations et d’albums (Gouache de Jacky, Ever After de Stéphane…) mais le duo s’était rarement produit dans la région. Fort de la parution de leur album, Mother,
paru chez Impulse!, dont ils jouent plusieurs titres, ils vont colorer
cette belle fin d’après-midi ensoleillée dans le village de Cabriès qui
s’est doté d’un beau petit auditorium et d’un piano de bonne facture. A
leur habitude dans une parfaite entente, ils vont ravir un public très
familial qui savoure leur musique et en redemande.
Mercredi 30 novembre
Hôtel C2-Géraldine Laurent Quartet At Work: Géraldine Laurent (as), Paul Lay (p), Yoni Zelnik (b), Donald Kontomanou (dm)
Ces
quatre musiciens se sont produits à plusieurs reprises dans la ville
mais jamais dans cette formation. Géraldine Laurent sans états d’âme
entraîne son équipe en droite ligne du bebop, revisité avec une fougue
juvénile. Dans le premier set, les titres s’enchaînent sans temps morts,
laissant juste un souffle aux applaudissements. Les échanges piano sax,
sont remarquables, et si l’on croyait Paul Lay calme, son jeu intrépide
et précis le place en tête des jeunes loups du clavier national.
Concert parfait, seul regret le bar et l’environnement bruyants, voir à
modérer leur dialogue incessant et le bruit des cliquetis des couverts.
Jeudi 1er décembre
Cinéma Le Bourguet-Film The Whole Gritty City et Thomas Weirich Trio
Le
Cinéma de Forcalquier et La Plage Sonore (qui organise à Forcalquier
chaque été le Cooksound Festival) ont fait le pari de présenter une
soirée musicale en pleine semaine dans cette petite ville des
Alpes-de-Haute-Provence. Le film choisi rejoignait la thématique de la
Nouvelle-Orléans. Un public attentif a eu le loisir de découvrir en
première partie le trio du guitariste Thomas Weirich, programmé
tardivement, qui assura une superbe introduction à cette balade à
travers la Louisiane. Le film bénéficia ainsi d’une seconde projection
dans le sud pour un public très satisfait de cette initiative automnale,
à un moment où la ville s’endort après l’animation estivale.
Samedi 3 décembre,
le jour de clôture de Jazz sur la ville, d’autres concerts se sont
déroulés à la Cité de la Musique de Marseille, au Conservatoire Pablo
Picasso de Martigues et à Vitrolles. La dernière soirée de concerts de
Jazz sur la Ville se terminait donc après un mois intense, marqué par un
véritable succès populaire. L’édition 2017 est déjà annoncée et fêtera
les 100 ans de l’arrivée à Brest du premier orchestre de jazz composé de
musiciens afro-américains. Mais, pendant cette année 2017, les
différents acteurs de cette manifestation, et c’est là que réside
l’originalité de Jazz sur la ville, poursuivent leur activité
permanente, jazz ou pas jazz, musicale, théâtrale ou autre, car pendant
l’année, à Marseille et dans la région, la vie culturelle ne s’arrête
pas…
1 Le collectif Jazz sur la Ville préfère le terme de
«manifestation» plutôt que celui de festival dont le caractère ponctuel
résulte d’une seule entité.
2 Jazz Hot n° 677, automne 2016
3 Institut Musical de Formation Professionnelle de Salon de Provence
Michel Antonelli
remerciements à Mikhaele Elfassy, Florence Ducommun, Claire Pericart,
François Billard, Christian Ducasse, Christian Palen,
Dominique Michel, Guillaume Peyre, Franck Tanifeani
Photos Florence Ducommun, Christian Palen et Michel Antonelli
© Jazz Hot n° 677, automne 2016
|

Cormons et diverses communes du Collio, Italie et Slovénie
Jazz & Wine of Peace, 26-30 octobre 2016
Plus riche que les années précédentes la 19e édition
de Jazz&Wine a confirmé son fort lien avec le territoire et son
caractère multiculturel, aussi bien par les contenus musicaux que par la
présence de nombreux spectateurs autrichiens et slovènes.
Comme de
coutume, le Teatro Comunale de Cormons a abrité les concerts du soir,
plus attractifs pour le grand public. Les villages, les propriétés, les
domaines vinicoles (Le Collio est un terroir vinicole, une appellation
contrôlée, ndlr), et les caves dans lesquels avaient été
distribué tous les autres événements ont fourni pas mal d’éléments de
réflexion, et pas moins d’agréables surprises. Et c’est par ces
dernières que cela vaut la peine de commencer.

A
la Villa Attems de Lucunico, Emile Parisien (ss), Michele Rabbia (perc,
el), et Roberto Negro (p) ont fait la démonstration de la façon dont on
peut actualiser des langages de contextes historiques sans tomber dans
le «déjà entendu». Dans le jeu de piano de Negro on trouve des traces de
Satie, des échos de Paul Bley et une nette influence de la musique
contemporaine de la seconde moitié du XXe siècle
par l’utilisation du piano préparé. Empreint d’une marque
postwebérienne, le processus de construction graduelle privilégie les
timbres et intègre des fragments électroniques, des sons parasites du
soprano et la vaste gamme des percussions. Tout cela se concrétise en
constructions polyrythmiques, réélaborations jazzistiques insolites (Cantabile de György Ligeti!) et se déstructure en progressions free que le soprano pénètre comme une lame tranchante.
Dans
le cadre de l’Abbazia di Rosazzo, Jean-Louis Matinier (acc) et Marco
Ambrosini (nyckelharpa) ont donné vie à une forme joyeuse
d’improvisation, au delà du genre. Le choix d’Ambrosini est des plus
originaux. Ne pouvant plus pratiquer l’activité de violoniste classique à
cause d’un accident, il a exhumé un instrument encore utilisé dans les
musiques populaires suédoises: semblable à la vielle dotée à cordes
mélodiques et de résonances, et en mesure de produire des bourdons.
L’interaction vitale avec Matinier évoque la tradition folklorique, la
musique ancienne, Gesualdo et Monteverdi, rappelant à l’esprit les
collaborations de l’accordéoniste avec Michel Godard, Renaud Garcia-Fons
et Michael Riessler.
Près du domaine d’Angoris, Andrea Massaria
(g) et Bruce Ditmas (dm) ont reproposé le contenu d’un récent travail
dédié à Carla Bley, adoptant deux procédés différents. Ils jouent sur
des dynamiques raréfiées dans la reprise de «Olhos de gato», dans le
climat en suspens (favorisé par l’utilisation du delay) de
l’«Utviklingssang», et dans la paraphrase de «Ida Lupino». Ils donnent
vie à de longues et torrides improvisations sur «Vashkar», «And Now the
Queen» et «Batterie», en déstructurant et masquant les thèmes. Dans ce
contexte les seules limites se situent dans une certaine unité de timbre
et dans la prépondérance sonore des polyrythmies de Ditmas.
A
Buttrio, près de la Villa di Toppo Florio, le Living Being Quintet de
Vincent Peirani a fait preuve d’une notable capacité à puiser dans des
sources disparates. Tony Paeleman (elp), Julien Herné (elb) et Yoann
Serra (dm) forment une section rythmique qui construit des
implantations modales efficaces (l’ombre de Miles Davis plane dans le
coin). Les compositions originales sont riches d’intéressantes
trouvailles mélodiques et quelques intuitions heureuses alimentent la
réélaboration d’un autre matériel. «Some Monk» prend forme de deux
fragments de «We See» et «Played Twice». Le collectif s’exprime sur des
sommets de grand lyrisme dans «Dream Brother» de Jeff Buckley et grâce à
une efficace cohésion dans la frénétique version de «Mutinerie» de
Michel Portal. Peirani se comporte en vrai leader, coordonnant les
exécutions, interagissant avec un surprenant Emile Parisien, auteur de
piquants solos de soprano et dans une certaine mesure débiteur de David
Liebman.
A la Kulturni Dom de Nova Gorica, le quartet Made to
Break, dirigé par Ken Vandermark, a confirmé qu’il représentait une
continuation digne d’estime de l’énorme patrimoine de Chicago. La soif
d’expérimentation du saxophoniste abreuve de longues séquences dans
lesquelles convergent la recherche des timbres et la variété du fond
propre des musiciens de l’AACM, avec d’occasionnels rappels au free et à
l’électronique de Christof Kurzmann. Soutenu par le travail intense de
Tim Daisy (dm), Vandermark développe une puissance impressionnante dans
le phrasé du ténor (Ayler est une référence crédible), tandis qu’à la
clarinette, il conserve une clarté exemplaire même dans les passages les
plus impraticables. Avec lui Jasper Stadhouders (elb), avec son
Rickenbacker, instrument très en vogue dans le rock progressif et qui
véhicule des solutions de timbres originales, interagit efficacement.
Une
grande créativité et une inclination pour les compositions
extemporanées ont caractérisé le set du duo Groove & Move à
l’Azienda Agricola Borgo San Daniele de Cormòns. Gabriele Mitelli (tp,
pocket trumpet, flh, perc) et Pasquale Mirra (vib, perc) opèrent
librement sur les traces de Don Cherry et Karl Berger. La mémoire de
disques historiques comme Symphony for Improvisers, Togetherness et Eternal Rhythm affleure indirectement, mais la référence à Cherry se concrétise quand
tous les deux citent «Art Deco» et «Brown Rice». L’esprit du grand Don
se traduit par une exploration des timbres, souvent générée par des
bourdons émis par la pocket trumpet ou par une trompette préparée (qui
sonne presque comme un didjeridoo), ou par l’emploi de petites
percussions. Dans les deux cas, on procède de toute façon à la
construction des structures. De fugaces citations d’«Epistrophy» et «I
Mean You», ou bien le thème de «Orange Was the Colour of Her Dress»
démontrent que la mémoire historique et toujours vigilante.
Que
certaines des plus prestigieuses écoles puissent créer des répliques de
modèles, le concert de Nir Felder à Vila Vipolže l’a prouvé. Formé à la
Berklee de Boston, le guitariste fait la preuve qu’il a approché des
notions de tous les spécialistes majeurs. Pourtant le phrasé et le son
–pourvu aussi d’une infrastructure rock– ne révèle pas une identité
précise. En outre ses compositions, pour agréables qu’elles soient, sont
assez prévisibles sur le plan harmonique. Orlando le Fleming (elb) et
Jimmy MacBride (dm) s’adaptent à ce canevas prévu.
Beau projet
que celui présenté à la Tenuta Villanova de Farra d’Isonzo par Klaus
Gesing (bcl, ss), Björn Meyer (elb) et Samuel Rohrer (dm). Comme
l’atteste Amiira, le trio fait son point fort de l’interplay, de la
recherche de timbres, et d’une lente mais graduelle construction de
mélodies raffinées. La circulation continuelle de signaux et de
trouvailles contribuent d’une manière égale aux constructions
méticuleuses et à la prononciation limpide de Gesing, ainsi que la vaste
gamme de solutions de Meyer (pédales, arpèges, notes amorties, effets,
cordes et caisse harmonique de percussions) et le travail sur les
couleurs –digne d’un percussionniste– de Rohrer. Il en résulte une
parfaite unité formelle.
A la Cantina Renato Keber de Zegla, le
trio São Paulo Underground –Rob Mazurek (corn, el), Guilherme Granado
(synt), Mauricio Takara (dm, cavaquinho)– a organisé un
concert-événement aux aspect plus ou moins rituels. De furieuses et
pulsantes progressions rythmiques, renforcées par le synthétiseur
analogique, introduites et scandées par leurs successions de rengaines
vocales de saveur tribale et d’effets électroniques vintage. Sur ce flux
presque ininterrompu se détache le cornet de Mazurek avec un phrasé
bouillonnant et des improvisations emportées qui convoquent la leçon
irrévérencieuse de Lester Bowie et la poésie naïve de Don Cherry. On
assiste donc à une représentation qui –une fois les équilibres de
circonstances faits– évoque les lointaines expériences de Sun Ra
Arkestra et de l’Art Ensemble of Chicago, mais pourvues de
significations bien plus profondes.
Quant aux concerts du soir au
Teatro Comunale de Cormons, ils ont attiré un nombreux public et offert
une très grande qualité dans l’ensemble, suscitant pourtant quelque
perplexité et quelques désillusions, fruits des discussions entre les
chargés du travail et les passionnés.
Avec son quartette
désormais classique, Jan Garbarek s’est fossilisé dans une formule
figée, dans laquelle il convie en même temps quelques heureux traits
mélodiques d’inspiration populaire, dans lesquels il glisse une world
music superficielle. Le show est construit d’une façon impeccable, sur
la base d’un répertoire privé de nouveautés, qui prévoit aussi d’amples
espaces réservés aux (inutiles) solos des autres membres, libérés de
leur tâche de second rôle, selon une pratique plus typique d’un concert
rock; le funambulesque et parfois débordant Trlok Gurtu est le seul apte
à ajouter des touches de couleurs et de créativité; l’honnête mais
impersonnel Yuri Daniel (elb); l’humble et didactique Rainer Brüninghaus
(p, syn). Le peu de moments de pure émotion coincident avec quelques
interventions de Garbarek, en vertu de son timbre diamantin, et avec la
suite «Molde Canticle» qui tourne autour de «I Took Up The Runes
(1990)».
Par respect pour les spectacles italiens de 2015, le
quartette Aziza a pris une physionomie plus homogène, mais aussi plus
prévisible et sans doute moins encline au risque. En dépit des
constructions magistrales de Dave Holland (b) et de l’inventivité d’Eric
Harland (dm), les exécutions se dirigent souvent sur de solides grooves
parfois enjôleurs. On apprécie la cohésion du collectif et l’effort de
composition des quatre membres. Dans ce domaine, il semble avoir acquis
plus de poids par les contributions de Chris Potter (ts, ss) et Lionel
Loueke (g). Malheureusement le premier emploie un dixième de son
enviable talent, recourant trop souvent à des patterns et à un langage
«breckerien». Le second utilise de multiples effets, mais il arbore un
son et un phrasé personnels seulement dans certaines prestations
polyrythmiques proches de ses propres racines africaines.
Avec
son récent «Charlie», Gonzalo Rubalcaba a rendu un hommage sincère à son
maître Haden. Renonçant quasi complètement à sa virtuosité, il aborde
avec respect «Firts Song» et «Silence», faisant un usage de bénédictin
du staccato en lui appliquant des pauses opportunes: pratique exaltée
dans l’exécution en trio de «Blue in Green». Il ajoute aussi, avec
mesure, des connotations afro-cubaines au côté latino de Haden («La
Pasionaria» en est un exemple brillant), ou des morceaux d’autres
compositeurs insérés par le contrebassiste dans son propre répertoire,
comme «Hermitage» de Pat Metheny. En digne héritier de Haden, Matt
Brewer élabore des lignes essentielles mais prenantes avec un son
somptueux et enveloppant, stimulant Jeff Ballard à produire une ample
gamme de nuances percussives. Dans ce contexte il revient à Will Vinson
(as) de jouer un simple rôle d’exposition et de conclusion du thème.
Par rapport au CD, When You Wish Upon A Star,
Bill Frisell a présenté une formation privée de la viole d’Eyvind Kang,
se trouvant devant l’obligation de faire coexister le trio –avec Thomas
Morgan (b) et Rudy Royston (dm)– et la voix ténue de Petra Haden, gênée
de plus par la toux et un rhume. Il était licite de se demander si le
répertoire (adapté de musiques de film) aurait dû subir cette
présentation. Tous comptes faits, on peut parler d’épreuve brillamment
surmontée malgré quelques inévitables défaillances (en français) vocales. Petra a réussi à apporter une certaine expressivité –avec une
approche quasiment rock– aux interprétations de «Moon River», «When You
Wish Upon a Star» et «The Windmills of Your Mind». Frisell et ses
collègues se sont engagés avec une grande conscience des tessitures
dynamiques dans les aspects de «Lush Life» et «To Kill a Mocking Bird»,
réussissant à ne pas banaliser des thèmes archiconnus, comme «Once Upon a
Time in the West» de Morricone et «The Godfather» de Rota. Le mérite en
revient aussi à la capacité interactive et au goût mélodique de Morgan,
ainsi qu’aux solutions inventives et à la sensibilité coloriste de
Royston. Quant à Frisell on ne peut qu’admirer son sens de l’économie
dans la construction des phrases et le soin à moduler le son, qualités
indispensables pour affronter un répertoire apparemment sans surprise et
à ajouter un autre chapitre à sa recherche dans le cadre de la popular music.
En
conclusion d’une édition qui connut un grand succès sous tous rapports,
il est juste de souhaiter d’heureux auspices pour la vingtième édition.
Enzo Boddi
Traduction Serge Baudot
Photo de Luca d'Agostino/Phocus Agency by courtesy of Jazz & Wine
© Jazz Hot n° 677, automne 2016
|

Toulouse, Haute-Garonne
Jazz sur son 31, 8 au 23 octobre 2016
«Métissage culturel, mouvement musical ouvert sur le monde», «diversité des univers» tels sont les maîtres-mots de ce 30e anniversaire du festival Jazz sur son 31 organisé par le Conseil
départemental de la Haute-Garonne sous la plume de Georges Méric son
président. Une dimension politique également en faisant d'un événement
culturel un remède contre l'exclusion et le repli sur soi dans un esprit
d'universalisme et de valeurs humanistes. Un bien vaste projet dont le
résultat est finalement de ressembler à l'ensemble des programmations de
festivals de jazz où le jazz, parfois de haut niveau ou très convivial
comme ici, est cependant dilué au sein de diverses musiques de mode.
Ainsi
le jazz Django à la sauce occitane, Savignoni tri e lo Papet, côtoie la
scène européenne avec le norvégien Peter Wettre (ts); les voix de la
madrilène Lorena del mar à Lou Tavano et Leila Martial à la world du
batteur Jean-My Truing, aux rives des Balkans avec le duo entre Bojan Z
(p) et Julien Loureau (ts) sans oublier l'Afrique de Ray Lema (p) et la
scène israélienne autour de Shaï Maestro (p) et Yonathan Avishaï (p). La
génération contemporaine hexagonale est fortement représentée avec
Géraldine Laurent (ts), Laurent Coulondre (p), Airelle Besson (tp),
Nicolas Calvet ou le collectif Awake. Des formations dont le jazz est
souvent un des éléments fondateurs parmi tant d'autres tout comme les
poids lourds des festivals que sont Manu Katché ou l'inévitable Ibrahim
Maalouf. Cette quinzaine nous a permis d'entendre quelques remarquables
prestations.
On se concentre donc dans ce compte rendu sur le jazz de culture…
C'est
d'ailleurs une forme de succès qui caractérise cette ouverture de
festival tant le public fut nombreux dans cette salle d'Odyssud de
Blagnac en périphérie de Toulouse. L'affiche est fort prometteuse avec
une rencontre comme les aime le saxophoniste Joe Lovano. Par le passé,
il a toujours privilégié les expériences diverses d'un classicisme
assumé autour du piano d'Hank Jones à un hommage à Charlie Parker ou
Tadd Dameron sans oublier les formules plus libres avec Gunther
Schuller, Paul Motian ou le Masada de John Zorn.
Cet état de fait se
caractérisait déjà il y a une vingtaine d'années dans ses deux approches
du quartet avec Mulgrew Miller ou Tom Harrell sur la scène du Village
Vanguard. Son ouverture au monde est ce soir au cœur d'une rencontre aux
couleurs latines avec le pianiste cubain Chucho Valdes qui n'est pas
sans rappeler son formidable duo avec Gonzalo Rubalcaba sur Blue Note.
L'axe
ténor-batterie fonctionne à merveille avec son complice Francesco Mela
dont la polyrythmie en fait un partenaire idéal mêlant jazz et formes
latines. Démarrant sur un boléro, Joe Lovano impose sa personnalité
évoquant Sonny Rollins en forçant son vibrato; la formule se veut
classique en quintet avec percussion. Un hommage sincère à l'ancien
président de Blue Note, Bruce Lundvall, qui nous a quittés l'année
dernière avec cette composition «BL» de Joe Lovano qui a permis au
quintet d'installer un climat plus méditatif autour de la sonorité
légèrement voilée et dure du ténor rappelant Joe Henderson. Si la
formation se veut cubaine avec Yaroldy Abreu (perc), Gaston Joya (cb) et
le coleader Chucho Valdés qui s'en donne à cœur joie dans un déluge de
notes avec un lyrisme exacerbé, le jazz reste un élément fort de cette
rencontre, notamment par le répertoire d'où se détache le superbe «The
Star Crossed Lovers» du duo Ellington-Strayhorn, «Confirmation» de
Parker ou un thème modal de Miles Davis. Le final en formule piano-ténor
sur «Body and Soul» étant le reflet d'une soirée à la musicalité
exemplaire.

La où le
trio avait trouvé un équilibre dans l'excellence avec ses prestations au
Village Vanguard, l'ensemble perd aujourd'hui un peu de sa superbe dû à
l'absence de Ulysses Owens Jr. aux baguettes. Un musicien complet à la
grande qualité de frappe utilisant de légers roulements, toujours à
l'écoute en maintenant une dynamique tout au long d'un thème. Jerome
Jennings son remplaçant est plus dans une approche globale
d'accompagnement en soutenant le soliste en permanence. Cela fait
maintenant sept ans que le pianiste et le contrebassiste collaborent
avec un répertoire rappelant celui du Vanguard comme cet excellent
«Fried Pies» de Wes Montgomery ou du thème plus méditatif «Sand Dune» de
Christian Sands. Ses passages en block chord à la Phineas Newborn
donnent une impression de virtuosité non dénuée de musicalité.
Philadelphie étant la ville de naissance de Christian McBride, le côté
funky s'exprima pour le plus grand bonheur du nombreux public de cette
salle de Diagora de Labège aux portes de Toulouse. D'une mélodie de
Stevie Wonder à un hommage à James Brown où Jerome Jennings fait
quelques clins d'œil à Clyde Stubblefield, la piste de dance n'est plus
très loin. Le final monkien clôtura une soirée qui s’avérera être l'un
des sommets du festival.
L’Automne club qui reste le lieu
privilégié de Jazz sur son 31 au cœur du Conseil général de la
Haute-Garonne, affichait complet pour le concert du jeune trompettiste
Marquis Hill. Le phénomène de Chicago, heureux lauréat du prix
Thelonious Monk en 2014 présenta des extraits de son nouvel album The Way We Play avec quelques versions de compositions de musiciens tels «Maiden
Voyage» d'Herbie Hancock ou «Fly Little Bird Fly» de Donald Byrd. La
déception est au rendez-vous de par un jeu linéaire sans expressivité,
bien loin des références qu'on nous vend (Woody Shaw), sans le vibrato
ou la brillance doublée de la rondeur d'un Freddie Hubbard. Cette
discontinuité rythmique entre binaire et ternaire, où les thèmes
interchangeables s'enchaînent, laissent peu de place à l'improvisation
du leader. Seul le jeune vibraphoniste Joel Ross, qu'on a découvert
l'été dernier auprès de Wynton Marsalis, surnage avec un jeu plus proche
d'un Bobby Hutcherson ou Steve Nelson. On est loin des jeunes loups des
années 1980-90 tels Roy Hargrove, Terence Blanchard ou Brian Lynch qui
avaient déjà au même âge plus de maturité et de personnalité.
Le
lendemain, sur la même scène, le guitariste Jérôme Barde à la sonorité
si singulière venait présenter son excellent groupe les Jazztronautes
d'où émerge le formidable contrebassiste Darryl Hall dont le
prolongement peut se faire sur l'album Spinning (Space time records).

«Trick Baby» qui est
également le titre d'un livre de Iceberg Slim est un thème évoquant
l'univers funky d'Horace Silver quand «Hopscotch» nous entraîne dans une
valse au swing irrésistible. La proximité du leader avec son public
échangeant des anecdotes sur son mentor Jaki Byard, partageant avec ce
dernier le respect de la tradition du jazz au sens large ou bien cette
histoire de musicien new-yorkais raté qui retrouve le goût de la musique
dans sa simplicité, donne à la soirée une ambiance décontractée de
club. Spike Wilner est entouré d'une superbe rythmique amenée par Tyler
Mitchell (b) qu'on avait déjà découvert il y a plus de vingt ans auprès
d'Art Taylor, et par Anthony Pinciotti (dm) d'une grande personnalité
tout en souplesse et swing. Les activités autour des clubs du Smalls et
du Mezrrow (cf. Jazz Hot n°678) sont également au cœur des deux soirées
car les musiciens sur scène font partie de l'histoire de ses deux lieux
si singuliers fonctionnants de manière familiale. Le final sur «Blues
for the Common man» est un démarquage du classique «After Hours» dont
les longues phrases sinueuses du ténor à la Eddie Harris est un pur
bonheur.
La soirée de clôture à la Halle aux Grains de Toulouse
affichait complet bien avant l'ouverture du festival avec en tête
d'affiche l’éclectique talentueux chanteur Gregory Porter. Une voix
sublime aux inflexions faisant une double allégeance à Donny Hathaway et
Stevie Wonder, pour une soul sophistiquée se baladant dans les contrées
du jazz et du gospel. Un seul regret dû à la formation pop
fonctionnelle qui entoure un tel diamant vocal.
Non loin de là,
l'Automne Club revisitait le swing des années 30 et 40 autour de Paul
Chéron (ts, cl) en septet. Une forme de promesse pour la prochaine
édition de Jazz sur son 31.
David Bouzaclou
© Jazz Hot n° 677, automne 2016
|
Verviers, Belgique
Jazz à Verviers, 9 septembre-4 novembre 2016
A
l’est de la Belgique, la ville de Verviers est l’épicentre d’un
triangle dont les angles, Liège, Maastricht et Aix-la-Chapelle forment
l’Euregio. Cette apparente communauté de 500 000 âmes cherche depuis
Charlemagne –ou, pour le moins depuis 1945– à développer des liens
économiques et culturels qui fédèrent par-delà les langues et les
anciennes frontières. On peut ainsi rêver d’un nouvel essor sur les
friches lainières des bords de Vesdre. En jazz, il y eut une éphémère
B.D.N. Jazz Federation (pour Belgique/Deutschland/Nederland), baptisée à
Vaals en février 1977, qui regroupait sept associations et clubs de
Liège, Bilzen Maastricht, Würselen, Spa et Verviers. Dans l’ex-cité
lainière, le Bihain, la Jument Balance et le Chapati Two ont disparus,
mais le Hot Club subsiste et programme encore un concert mensuel pour
quelques amateurs de new orleans et de dixieland. Verviers
s’enorgueillit aussi d’une belle palette de musiciens qui va de Louis
Dops (tp) à la famille Houben –Steve (as,fl), Grégory (tp,voc)– en
passant par Roger Claessen (cl), Milou Struvay(tp), Tony Liégeois (dm),
Félix Simtaine (dm), Jano Buchem († eb, b), Pirly Zurstrassen (p, acc)
et son fils Félix (b, eb).
Béatrice Pottier, directrice du Jazz à
Verviers, rêve de succès depuis 2007. Elle en compte quelques-uns à la
mesure d’un public trop souvent frileux. La fermeture du Grand Théâtre
local, pour rénovations, l’a poussée à éclater sa 10e édition en dix dates et divers endroits de Saint-Vith à Dison en
passant par Waimes, Eupen, Malmédy et Verviers: Hôtel de Ville, Eglise
Saint-Remacle, Centre Culturel de l’Espace Duesberg. Nous étions à
l’Espace Duesberg du vendredi 7 au dimanche 9 octobre.
De
retour du festival de Rimouski (Québec), Béatrice avait ramené dans ses
valises le trio d’Emie Roussel (p) et le quintet de son père Martin
(p). C’est Emie qui nous est apparue en premier le vendredi à 19h30. La
jeune pianiste a livré quelques-unes de ses compositions de structures
minimalistes par l’écriture et le rendu. Où l’on attendait des
improvisations, on écouta de longues redites de phrases courtes, sans
modulations. Le toucher de la pianiste est beaucoup trop raide et,
malheureusement, nous nous sommes ennuyés à son écoute, nonobstant les
solos créatifs de Nicolas Bédard (b, elb) et le tempo rigoureux de
Dominic Cloutier (dm, «Mario»).

Le
samedi 10 octobre, c’est donc Martin Roussel (p) qui prenait le relais
de sa fille. Sans vouloir trop pousser la comparaison, force fut de
constater que la musique de ce second groupe était bien plus
aboutie. Le pianiste, qui s’était produit en trio deux jours plus tôt,
revenait ainsi en quintet avec Alexandre Côté (as, ss), Frédéric Alarie
(b), Guillaume Perron (dm) et Marie-Josée Cyr (voc). Certes, on reste
dans une esthétique «Effendi» (le label d’Alain Bédard très
représentatif de la scène jazz québécoise), soit un jazz introspectif
tourné vers la composition. Le concert s’est d’ailleurs ouvert sur le
«Deuxième mouvement» du dernier album de Martin Roussel, Planetarium,
tout à fait dans cet état d’esprit. Mais c’est avec un standard, «What
Is This Thing Called Love» que la formation a accueilli sa chanteuse,
laquelle a révélé une expressivité particulièrement saisissante sur le
«Quatrième mouvement» (du même album), un véritable cri de douleur
évoquant nos temps troubles. Le concert a eu également des moments plus
enlevés, notamment avec «La ballade de la mouche» où chaque soliste a pu
mettre en avant ses qualités.

Mais
l’événement de la soirée était la venue de Biréli Lagrène (g) qui
n’avait plus foulé la scène belge depuis plusieurs années. A la tête
d’un trio bien rôdé (Hono Winterstein, g, et William Brunard, b), Biréli
a donné un superbe récital, aux accents variés: un «After You’ve Gone» à
la tonalité country (avec une cocasse citation du thème de James
Bond!), un magnifique «All of Me» nanti d’un solo virevoltant, «Just the
Way You are» de Billy Joel ainsi que sa très belle composition,
«Mouvement», créée avec son quartet électrique. Tant la complicité avec
les accompagnateurs (tous deux excellents) que la virtuosité ce soir-là
très fluide (et sans recherche de performance) du leader ont offert au
public (étrangement un peu clairsemé) un jazz à la fois enraciné et
capable d’assimiler avec succès des musiques autres. Un excellent
concert qui s’est évidemment achevé sur «Nuages» pour le rappel.
Le
dimanche 9 octobre, en début de soirée, les organisateurs avaient
programmé un quartet d’élèves du Conservatoire de Maastricht –dont deux
Verviétois. Pouvait-on espérer un encouragement, un soupçon de curiosité
de la part des citoyens locaux? Que nenni! Chez ces gens-là, Monsieur*,
le dimanche à 16 heures, on déguste en famille chez la tante ou la
belle-famille: une part de doreye (tarte au riz et macarons) ou un quart
de tarte à l’makèye (tarte au fromage blanc caillé) avec on’bonne djate
di cafè (une tasse de café, en wallon dans le texte). Or donc, rien
qu’une trentaine de personnes pour écouter ceux qui, demain peut-être,
leur feront honneur! Nous, nous les avons écoutés attentivement! Robin
Rebetez (sax, Verviers) et John Wolter (dm, Luxembourg) ont encore du
chemin à faire pour trouver l’assurance; Yannick Heselle (eb, Verviers)
tient un bon tempo; Tae Jung Kim (g, Corée du Sud) déjà créatif, ajoute
de belles couleurs à ses solos («Difference Between», «The Will»). En
soirée, Antoine Pierre (dm) aurait dû remplir les trois cents sièges du
Centre Culturel puisque son groupe «Urbex» fait l’unanimité de la
critique spécialisée en Belgique.
Et bien re-nenni! Juste la famille et quelques proches venus
spécialement pour eux! Pour nous: surprise et déception! Le groupe s’est
présenté en quintet, sans Steven Delannoye (ts, bcl) ni Toine Thys (ts,
ss), avec un Bram De Looze (p) timoré et un Jean-Paul Estiévenart (tp)
en crise de foi(e) vraisemblable. Prestation intéressante toutefois de
Félix Zurstrassen (eb) et jolies parties du guitariste Bert Cools.
Autoritaire, sûr de ses compositions et de ses arrangements, Antoine
Pierre (dm) semblait le seul à prendre beaucoup de plaisir.
La
Directrice du festival, Béatrice Pottier, déçue par la froideur du
public cantonal, se réjouissait quand même des succès engrangés par les
cinq premiers concerts. C’est avec un grand optimisme qu’elle attendait
les deux dernières dates: le 14 octobre à Waimes et le 4 novembre à
Malmédy. Faudra-t-il en 2017 reconduire le partenariat avec l’Espace
Duesberg éloigné du centre-ville? That is The Question!
Jean-Marie Hacquier et Jérôme Partage
Photos Jérôme Partage
* pour ceux qui ne connaissent pas, référence à Jacques Brel (ndlr)
© Jazz Hot n° 677, automne 2016
|
Bar-sur-Aube, Aube
Jazzabar, 9-11 septembre 2016
Ce
festival du fond de l’Aube, animé par les dynamiques Jean-Pierre et
Myriam Chouleur, propose à l’amateur de jazz de profiter de la musique
tout au long de la journée: de la fanfare dans la ville à la dégustation
dans une cave, au déjeuner en terrasse et bien-sûr aux concerts du
soir. Pour sa 8e édition Jazzabar a fait la part belle aux hommages en
évoquant Django Reinhardt, Stéphane Grappelli, Fats Waller, Erroll
Garner, Ray Charles, Louis Prima. En ouverture de chaque soirée du
festival, Jean-Pierre Chouleur a rendu hommage à Jean Richer disparu
cette année, figure connue et aimée de la vie associative de
Bar-sur-Aube et fidèle de Jazzabar depuis sa création.

La
seconde partie de soirée était occupée par le trio Adrien Moignard (g),
Noé Reinhardt (g) et Diego Imbert (b) dans leur répertoire Django joué
sans fioriture ni virtuosité trop démonstratives. Ils ont ensuite invité
Didier Lockwood (vln) à les rejoindre sur scène. Star très attendue de
ce festival (le public, nombreux, était venu pour lui) il a vite pris
l’ascendant sur le trio.
Le
lendemain, la parade matinale du Mardi Brass Band de Didier Marty a
promené ses cuivres dans les rues de la ville en faisant raisonner la
musique de New Orleans. Il a poursuivit son parcours jusqu’à la salle
Davot où le même Didier Marty (ts, voc), avec son autre formation, Les
Amuse-Gueules (Didier Quéron, soubassophone, Pierre-Yves Plat, p, voc,
Frank Mossler, dm, voc) a fait pétiller le déjeuner.
Le
soir, l’intime duo de pianistes Stéphanie Trick et Paolo Alderighi a
proposé un récital à quatre mains dominé par le ragtime («Stoptime Rag»,
«Handful of Keys») et passant également par le blues et le swing
(«L.O.V.E.»).

Il
a été suivi par une prestation autrement plus démonstrative, celle du
Slovène Uros Peric (p, voc), accompagné par ses trois choristes (les
Pearlettes: Sandra Feketija, Suzana Labazan, La Likar).
Drew
Davies (ts), David Blenkhorn (g), Sébastien Girardot (b) et Guillaume
Nouaux (dm). Bien connu pour son épatante imitation de Ray Charles, il a
enthousiasmé le public qui lui a réservé une standing ovation.
Le
11, la dégustation en cave s’est déroulée en compagnie de Jeff Hoffman
(g, voc), flanqué de Philippe Petit (org) et Jean-Philippe O'Neill (dm),
lesquels ont également animé le déjeuner en terrasse avec leur gros son
blues et groovy.
Le
soir, Dany Doriz (vib) était présent avec sa fidèle rythmique: Philippe
Duchemin (p), Patricia Lebeugle (b) et Didier Dorise (dm) qui a croisé
les baguettes avec Jean-Philippe O'Neill pour une battle réjouissante.
Enfin,
pour clore le festival, le spectacle Prima for Ever, sous la direction
de Stéphane Roger (dm) réunissait Pauline Atlan (voc), Patrick
Bacqueville (voc, tb), Claude Braud (ts), Michel Bonnet (tp), Fabien
Saussaye (p), Nicolas Peslier (g) et Enzo Mucci (b) sur le répertoire du
chanteur de New Orleans: «Just a Gigolo» ou «Sentimental Journey» ou
encore «Nothing’s too Good for My Baby»… Un moment de bonne humeur qui
incita, sans tarder, les spectateurs à la danse. Une joyeuse conclusion.
Patrick Martineau-
Texte et photos
© Jazz Hot n° 677, automne 2016
|

Bucarest, Roumanie
Bucharest Jazz Festival,
19-25 septembre 2016
La première édition du Festival de Jazz de Bucarest (Bucharest en anglais, București en roumain) a eu lieu en 1999 avec un programme international,
notamment le saxophoniste anglais John Surman et le musicien de jazz le
plus renommé du pays à cette époque, le pianiste Johnny Răducanu 1.
Le festival 2016 présentait donc sa 18e édition, sous la direction artistique nouvelle de l’excellente chanteuse roumaine, Teodora Enache 2. Sa carrière internationale l’a parfois conduite sur les bords de la Seine à Paris.
Entre
ces deux dates le festival a accueilli le trio de Carlos Barreto, Herb
Robertson, Kenny Garrett, Eric Le Lann, le Trio Baláz et, entre autres,
les musiciens du cru Anca Parghel, Mircea Tiberian, Christian Solenau,
Nicola Simion ou encore Florin Răducanu,
marquant ainsi sa volonté d’ouverture à différents courants du jazz
contemporain. Le pianiste roumain Lucian Ban, installé aux Etats-Unis,
partenaire d’Abraham Burton, en a été le directeur artistique en 2014.
Cette
nouvelle édition se voulait complète et, en accompagnement des
concerts, étaient aussi proposés une exposition des photos de Jakab Tibor,
des conférences, films, workshops et master classes, le tout avec entrée
gratuite. Le festival se déroulait principalement dans deux lieux:
l’Hanul Gabroveni, pour les conférences, master-classes, expositions,
films, et la Piata George Enescu pour les concerts du soir, place qui
porte le nom du grand compositeur roumain (Georges Enesco,
en français) né en 1881 et décédé à Paris en 1955, qui compta parmi ses
maîtres Jules Massenet et Gabriel Fauré, et qui eut pour élève, entre
autres, Yehudi Menuhin…
En complément, nous avons découvert un club, le Green Hours Jazz Cafe, que nous présentons en post-scriptum de ce compte rendu et qui proposait sur sa scène pendant le festival un concert du trio de Mircea Tiberian.
Un
festival au cœur de la musique donc, et du jazz en particulier,
puisqu’en ouverture, le Bucharest Jazz Festival nous avait fait le
plaisir et l’honneur de proposer une conférence sur l’histoire de notre
revue, Jazz Hot, dans le cadre de l’histoire du jazz. Jazz Hot a, il est vrai, une très ancienne relation avec la Roumanie en matière de jazz…

Lundi 19 septembre
Hanul Gabroveni
Avant le lancement officiel et la conférence consacré à Jazz Hot,
l’audience a pu apprécié l’exposition photos de Jakab Tibor: «Musical
Body Sounds». L’artiste, diplômé en 1995 du New York Institute of
Photography, propose un travail en noir et blanc qu’il décrit ainsi: «Ces
photos reflètent mon amour pour la musique, une danse symbolique
érotique entre le corps de la femme et l’instrument de musique.»
Après
une présentation dynamique de Teodora Enache, votre serviteur a eu la
tâche facilitée par une bonne organisation, une excellente traduction de Iulia Damian que nous remercions vivement, et une assistance attentive
et savante pour mener à bien une conférence intitulée: «Jazz Hot: une
présence essentielle dans l’histoire du jazz». Le public très attentif
et très intéressé n’a eu de cesse de poser des dizaines de questions
pour un échange plus qu’intéressant. Les Roumains –mais aussi des
Italiens, Français et même des Brésiliens étaient présents– sont en demande d’informations et avides de programmation de jazz.

Mardi 20 septembre
Hanul Gabroveni
A midi, l’éminent musicologue et producteur T.V, Florent Lungu, nous retrace, avec passion et humour, la vie de son ami Johnny Răducanu incontournable compositeur, contrebassiste et pianiste qui a animé,
depuis les années 1950 jusqu’à sa disparition en 2011, la vie
jazzistique de Bucarest et de toute la Roumanie. Extrait de films,
écoute d’extraits musicaux et anecdotes ont ravi un public très ému par
cette évocation. Florent est reparti heureux de cet échange, et avec
sous le bras le numéro de Jazz Hot qui avait publié en 2003 un entretien du maître 1.

Mercredi 21 septembre
Hanul Gabroveni
A midi, Virgil Mahaiu (universitaire, écrivain, poète et correspondant de Down Beat)
et Doru Ionescu (écrivain) évoquent l’histoire du jazz en Roumanie, à
travers la mémoire des festivals roumains, des publications culturelles,
l’écoute de quelques extraits musicaux, et en présentant quelques
albums de référence. Des producteurs, parmi la petite dizaine de labels
de jazz de Roumanie, évoquent la difficulté de produire pour un petit
marché. La distribution dans le pays reste très limitée (82 points de
ventes maximum dont la plupart non spécialisés) l’essentiel des ventes
se faisant par le net et surtout lors des concerts. Etaient présents les
labels Fiver House Records, Soft Records, Green Records, EM Records,
e-media, pour un échange décontractée, certains évoquant une mise en
valeur exclusive par les médias du jazz du premier âge.
Place George Enescu
Installée
sur l’une des plus belles et grandes places de la ville, entouré
d’immeuble anciens et de nouveaux hôtels, l’espace du festival est
concentré autour de son parterre et d’une scène de dimension
raisonnable. Il s’agit d’un festival à taille humaine dont la capacité
assise varie autour de 800 à 1000 places et pour la totalité de 2000
places avec les places debout. Le festival devait avoir lieu en juillet,
mais la nomination tardive de sa directrice a reporté son organisation
en septembre où la température est déjà basse, un petit 15° nocturne.
Sous un ciel menaçant, un présentateur joue son rôle de maître de
cérémonie, bavard et très professionnel mentionnant les partenaires dont
Jazz Hot. Teodora Enache, qui se présente pour cette fois sur
scène avec sa casquette de directrice artistique, salue son auditoire
qui en retour l’applaudit, et présente le premier groupe dont le
pianiste a été son accompagnateur, un air d’amitié plane sur le
festival.

Sárosi
Péter Azara & Tasi Nóra/Tasi Nóra (voc), Sárosi Péter (clav), Gábor
Szabolcs (as), Gyergyai Szabolcs (b), Pál Gábor (dm)
Très inspiré
par la fusion, notamment Weather Report et Wayne Shorter dont le groupe
jouera un thème, les musiciens s’empare calmement de la scène pour
installer un répertoire rodé. Les musiciens jouent ensemble depuis trois
ans et, tour à tour, expriment leurs qualités musicales. Le
saxophoniste Gábor Szabolcs révèle un talent certain qui se délivrera
vraiment sur les derniers titres. La chanteuse, Tasi Nóra, qui aborde la
scène avec son manteau devra se réchauffer pour donner le meilleur
d’elle-même. Le répertoire est en anglais; certains titres, entre
ballades d’inspirations traditionnelles et blues, oscillent vers le jazz
rock. Sárosi Péter, après une année très chargée en 2015 (collaboration
avec huit groupes) avait décidé de faire une retraite dans la forêt
roumaine. Ce concert marque son retour avec son groupe régulier. Ce soir
aux commandes de son clavier, tour à tour Fender Rhodes ou orgue
Hammond, il en aura parcouru toutes les touches pour un discours
personnel très original. Les caprices du temps ont compliqué les choses;
le groupe termine son concert sous la pluie devant un public se réfugiant sous les espaces abrités.

Elena
Mîndru et Jyväskylä Big Band featuring Tuomas J. Turunen: Elena Mîndru
(voc), Tuomas J. Turunen (p), Ilkka Mäkitalo (direction), Harri Koivisto, Kerttuli Koivisto, Tero Savolainen (tp), Kalle
Keränen (as, ss) Ville Lähteenmäki (as), Antti Kettunen (ts, fl), Sanna
Tanninen (ts, fl), Ville Huovinen (bar), Florian Radu, Henriikka
Steidel-Luoto, Heikki Sillanpää, Tuomo Kangas (tb), Sebastian Burneci,
Antti Kuusela, Hanna Turunen (cb), Matias Luoto (g), Tommi Taavila (dm), Markus Snellman (perc)
Fondé
en Finlande dans les années 1970, le Jyväskylä Big Band est l’un des
orchestres les plus renommés en Finlande et dans les pays scandinaves.
Pour ce projet, il a fait appel à la chanteuse Elena Mîndru,
d’origine roumaine installée à Helsinski, et au pianiste finlandais,
Tuomas Juhani Turunen, déjà partenaires depuis de longues années.
Diplômée de l’académie de musique d’Ârhus, au Danemark, Elena mène
ensuite des études de doctorat au département de jazz de l’Académie
Sibelius à Helsinski. Avec plus de 400 concerts à son actif et deux
albums sous son nom, elle mène une carrière professionnelle depuis plus
de 13 ans. Tuomas Juhani Turunen, compositeur et pianiste reconnu, se
produit souvent en invité de big bands, avec son groupe, en solo ou en
duo avec Anna Inginmaa.
Dès la première composition, l’orchestre
implante son décor, efficacité et harmonie mises au service des leaders
mais aussi de plusieurs solistes qui s’illustrent de façon parfaite et
originale. Il est évident que la vedette de ce soir est Elena Mindru, de
retour au pays, qui avec la fougue et la passion d’une grande dame
amène son orchestre vers la lumière. Si les titres sont chantés pour la
plupart en anglais, elle interprète aussi des compositions inspirées de
la tradition finlandaise et dans sa langue natale. On note en
particulier un thème inspiré de l’Espagne, dont l’introduction rappelle
«Sketches of Spain» de Miles Davis, et qui laisse la part belle à
plusieurs musiciens. Durant le concert, les solistes se succèdent avec
brio: on citera le trompettiste Sebastian Burneci, le tromboniste
Florian Radu, Kalle Keränen au sax alto mais aussi un cours passage très
remarqué du guitariste Matias Luoto. Cet orchestre solidement soudé
sous la direction efficace de Ilkka Mäkitalo peut compter sur une
rythmique talentueeuse en la personne de la contrebassiste Hanna Turunen
et des deux percussionnistes. Par bien d’aspect, ce big band a rappelé
celui de Don Ellis. Le temps à la pluie, peu clément, priva cette belle
prestation d’un plus grand public, le final étant salué par les
aficionados qui avaient bravé température et humidité.
Une première soirée intéressante qui a permis de découvrir des groupes de qualité inconnus en France.

Jeudi 22 septembre
Place George Enescu
Alexandru Pădureanu (p), Laurentiu Horjea (b), Albert Gheorghe (dm)
Découverte
en lever de rideau impromptu du pianiste Alexandru Pădureanu qui livre
une version époustouflante de «Caravan». Maîtrise totale, maestria,
improvisation originale, comment qualifier cette belle surprise? Il est
évident que ce pianiste est hors du commun. Sans se faire prier, il
passe par un «Watermelon Man» impeccable et s’offre une superbe version
lente puis rapide des «Feuilles Mortes». La Roumanie est coutumière de
tels virtuoses, du piano et d’autres instruments, et Alexandru évoque
parfois un autre virtuose par ses unissons main droite-main gauche, ses
cascades de notes: Phineas Newborn. Chapeau l’artiste!

Bega
Blues Band/Johnny Bota (b), Mircea Bunea (g), Lucien Nagy (sax, fl),
Maria Chioran(voc), Toni Kühn (clav, melodica), Ligâ Dolga (dm)
Si à l’origine, en 1983, le groupe fondé par le guitariste Bela Kamosca, aujourd’hui disparu,
s’inspirait du blues, désormais son parcours emprunte les voies de la
fusion. Fusion du jazz et du rock mais aussi de la variété roumaine et
de la musique de leur région d’origine la Transylvanie. Le groupe se
produit en 1992 au Festival de Privas où il remporte le premier prix et
joue en 2002 aux côtés de Toots Thielemans au Festival de Sibiu
(Roumanie).
Ce soir les titres parfaitement chantés par Maria
Chioran sont tous en langue roumaine. Désormais sous la direction du
bassiste Johnny Bota, qui signe la quasi totalité des compositions, on
découvre un groupe homogène dont tous les membres résident et jouent
régulièrement en Roumanie. Les musiciens s’installent sur scène comme à
la maison, pas de vraie présentation, mais immédiatement ils sont en
action. Sur un premier titre très décapant, on rentre dans une musique
qui s’inspire fortement de la fusion des années 1970; le saxophoniste,
Lucian Nagy, se situe entre David Sanborn et Michael Brecker, et
maîtrise aussi bien son jeu au saxophone que ses interventions à la
flûte traversière et à la flûte traditionnelle. Leur musique, peut-être
est-ce due à la langue, rappelle par moment l’univers kobaïen du groupe
Magma mais aussi celui de la chanteuse polonaise Ursula Dudziak. Toni
Kühn, tantôt au clavier électrique, tantôt au piano acoustique mais
aussi au mélodica, propose toutes une palette d’atmosphères, quant à
Licà Dolga, impeccable dans son rôle de tambour major, et Mircea Bunea à
la guitare ils complètent ce sextet au profil très sympathique. On peut
regretter le titre «Song for Sacha» qui plonge le répertoire vers la variété,
apprécié par le public (pour une raison qui nous échappe), mais, sur le
final qui revisite «Afro Blue», les musiciens donnent une nouvelle
marque de leur énergie: un concert très professionnel, qui sonne dans
l’esprit d’un style déjà ancien des années 1970-80, mais la musique
n’est qu’une histoire d’un éternel ressourcement.

Dan Ionescu Quartet/Dan Ionescu (g), David Restivo (p), Jim Vivian (b), Kevin Dempsey (dm)
Dan
Inonescu «le» guitariste de jazz de Roumanie a été classé 12 fois
consécutivement comme le meilleur guitariste du pays. Il tourne depuis
les années 1980 et 1990 empruntant les voies de la fusion. En 1996, il
s’installe à Toronto et se produit avec la scène locale et dans tout le
Canada. Il a opté pour une guitare à huit cordes construite sur ses
indications.
Pour lui aussi, c’est un retour au pays avec comme il le dit: «pour la première sur une scène roumaine un groupe de jazz canadien».
Ses accompagnateurs ont tous des références sérieuses, le pianiste
David Restivio a travaillé avec Mel Torme, le contrebassiste Jim Vivian a
étudié auprès de Dave Holland et Marc Johnson. Kevin Dempsey, le
batteur, a étudié auprès de Marvin Smitty Smith, Joe Morello… La
virtuosité du guitariste n’est pas en question, mais sa mise en valeur
n’est pas des plus évidentes. Très fortement inspiré par les guitaristes
brésiliens, notamment Toninho Horta, il joue un répertoire marqué par
cette musique. Il reprend même un choro dédié à Villa Lobos qui a
beaucoup écrit pour la guitare.
On peut se demander si le choix d’une
guitare à huit cordes n’est pas dû à l’envie de jouer comme les
Brésiliens qui ont souvent utilisé des guitares inspirées du bandolim
(10 cordes pour Egberto Gismonti) ou la sept cordes traditionnelle du
Nord. Le répertoire est bien interprété, les musiciens assurent, le
pianiste est remarquable. La froideur de la nuit a peut-être découragé
une partie du public, moins nombreux que la veille.
On retient en particulier de cette soirée, la magnifique introduction d’Alexandru Pădureanu.

Vendredi 23 septembre
Hanul Gabroveni
Master
Class Dan Ionescu (g), David Restivo (p). Cette rencontre, à midi, est
plus un échange avec le public qu’un cours de musique. Dan Ionescu
revient sur son parcours et explique que son approche de la musique est
très sensitive, très émotionnelle, et précise que dans l’improvisation,
l’esprit et le jeu ne font qu’un: «On ne peut pas jouer et penser en
même temps. Je communique mieux avec mes musiciens en jouant qu’en
parlant. La musique vient du cœur, c’est le meilleur chemin pour un
agnostique.» Répondant à une question sur sa guitare à huit cordes, il
précise qu’il l’a conçue pour qu’elle soit à la fois légère pour son
dos, ergonomique pour son poignée, ses doigts et son bras et qu’elle
puisse lui permettre d’aller vers les horizons qu’il souhaite.» Il
revient sur sa passion pour la musique brésilienne et offre un medley de compositions d’Antonio Carlos Jobim lors d’un superbe duo très émouvant. A la fin, l’enfant du pays a salué ses amis, rapidement car une voiture l’attendait pour un retour vers l’aéroport et Toronto…

Place George Enescu
Second Meeting/Decebal Bădilă (b 6 cordes, b fretless), Petrică Andrei (p), Vlad Popescu (dm)
Comme
son nom peut l’indiquer, ce groupe marque les retrouvailles de vieux
complices issus de la communauté jazzistique de Roumanie. Decebal Bădilă
est le «Jaco Pastorius» local. Professionnel depuis 1984, il s’est
installé depuis 1990 à Francfort où il participe notamment à des
émissions TV, séances de studio, concerts et tournées avec des groupes
allemands. Il est membre du SWR big band de Stuttgart. Petrică Andrei
accède à la notoriété durant le Festival de Sibiu 3 en 1993. Lauréat de plusieurs prix dont celui du concours de piano de
Vilnius (Lithuanie), c’est surtout sa participation en tant que
finaliste au Concours Martial Solal de Paris en 1998 qu’il revendique le
plus 4. En tant que soliste, il a donné une centaine de récitals en Europe (Vienne, Berlin, Barcelone, Paris…). Le batteur, Vlad
Popescu, rejoint en 1992 le big band de la Radio roumaine au sein
duquel il se produira jusqu’en 2011. Il collabore à différents groupes
locaux et se produit avec le pianiste italien Guido Manusardi, le
trompettiste français Michel Marre ou le tromboniste et éducateur américain Tom
Smith. Aujourd’hui, Vlad enseigne à l’Université nationale de Musique de
Bucarest. Pour cette «seconde rencontre», les musiciens ont préparé un
programme spécial basé en partie sur le dernier disque de Decebal
Bădilă, Joy of Love. Se succédent différents hommages: à Chico
Buarque avec une très belle version de «O que Sera» ou encore pour
honorer la mémoire de Toots Thielemans (et celle de Jaco qui a joué aux
côtés du Sage belge) un émouvant et étonnant «Bluesette». La technique
ni le talent des musiciens ne sont à remettre en cause, mais cette
sympathique réunion n’est qu’une opportunité. En passant, Decebal Bădilă joue une version de «Satisfaction» des Rolling Stones et une
composition de Decebal Bădilă dédicacée à son pianiste et ami Petrică
Andrei qui nous livre une solo de haut vol. Une bonne première partie
pour chauffer le public venu en nombre (plus de 1500 personnes) en
attendant la vedette de la soirée, Lisa Simone.

Lisa Simone/Lisa Simone (voc), Hervé Samb (g), Sonny Troupé (dm), Reggie Washington(b)
Le
public découvrait, pour la première fois sur scène en Roumanie, Lisa
Simone et son groupe, en fait presque un groupe «made in France» car à
part Reggie Washington installé en Belgique, toute cette petite troupe
vit en France. Lisa demeure près de Marseille dans l’ancienne villa de
sa mère. Pas de surprise, le groupe comme à chacun de ses concerts,
carbure à l’énergie. Parfaitement rodée, la musique nous entraîne sur
les pistes d’un rhythm and blues actuel des plus efficaces. Lisa Simone
interprète plusieurs titres de son second album, My World, paru
en mars dernier. Superbement épaulé par une équipe de choc très présente
sur la scène française mais aussi mondiale (Reggie Washington à joué
avec Steve Coleman, Brandford Marsalis, Roy Hargrove… et plus récemment
avec Archie Shepp, The Head Hunters ou encore Randy Brecker, Hervé Samb a
été partenaire de David Murray, Jimmy Cliff, Oumou Sangaré. Sonny
Troupé, avec son complice Grégory Privat mais aussi Jacques
Schwarz-Bart, a donné de nombreux concerts cette saison.
Après un
démarrage très funky, le groupe garde un tempo d’enfer et Lisa Simone de
sa puissante voix séduit un public qui ne demande que ça. Chaque
soliste a droit à son moment de bravoure: celui d’Hervé Samb, très
inspiré du «Voodo Child» d’Hendrix, sidère l’auditoire ne comprenant pas
comment une guitare acoustique peut délivrer une telle puissance.
Reggie Washington, imperturbable, installé sur un haut tabouret en fond
de scène, est le pilier d’un groupe illuminé par la batterie de Sonny
Troupé en très grande forme. Lisa Simone, en grande professionnelle,
amène peu à peu la foule à participer à son rituel, et n’hésite pas à
descendre au milieu d’elle, partageant son chant avec des spectateurs
conquis. Après un début de carrière compliqué, depuis deux ans avec son premier album, All Is Well, Lisa
Simone s’est définitivement affirmée comme une des grandes chanteuses
d’aujourd’hui. Elle a choisi de porter son nom de scène en hommage à sa
mère, et perpétue ainsi une voix revendicatrice forte et un répertoire
ouvert. Elle n’oublie pas Nina, et interprète l’un de ses titres de
1963, «If You Knew», connu aussi par son refrain «Just me, Just you My
love».

La
photo aérienne, prise par le drone du festival, nous donna une
certification sans contestation de la réussite de la soirée du concert
de Lisa Simone: la place était bondée.
Les deux derniers jours du
Bucharest Jazz Festival, auquel nous ne pouvions assister, ont vu deux
master-classes, présentés par Kenny Werner, puis Mino Cinelu et
Theodosii Spassov (fl), le très bon musicien, coleader du dernier disque
de Teodora Enache, Incantations (cf. chronique CD de Jazz Hot).
Etaient
également prévu en concert, le samedi 24, le duo Mino Cinelu-Theodosii
Spassov, The Kenny Werner Trio, et le dimanche 25 Nicolas Simion Group,
Jazz Syndicate-Charlie Parker & Dizzy Gillespie Tribute et un final
avec le Trilok Gurtu Quartet
Le Bucharest Jazz Festival,
exceptionnellement en fin d’été cette année, aura en principe lieu en
juillet l’an prochain. Il a le mérite, en plus d’être gratuit, de
présenter des musiciens du pays mais aussi des groupes étrangers avec
des projets originaux (Finlande, Allemagne, Inde, Etats-Unis, Bulgarie,
France...). Très décontracté, on peut circuler dans l’enceinte sans
contrôle, et les professionnels n’ont ni besoin de badges ni
d’accréditations pour rencontrer les artistes. C’est aussi une manière
originale de découvrir une ville et un pays 5. Servi par une équipe dynamique et très sympathique, présidée par Mihaela Păun, Alina Teodorescu, Ralica Ciută,
Teodora Enache (direction artistique), Anamaria Antoci, Tereza Anton,
Hubert et toute l’équipe souriante croisée tout au long de ce séjour, ce
festival, organisé sous l’égide de l’Arcub, le Centre Culturel de la Ville de Bucarest, possède ses spécialistes et fins connaisseurs du jazz, plus ou moins âgés et parlent plusieurs langues.
La
musique et le jazz en Roumanie, c’est déjà une longue et riche
histoire, et s’il fallait s’en persuader, on consulterait les premiers
numéros de Jazz Hot en 1935 pour se rendre compte que, dès cette époque, il y avait un correspondant roumain!
1. Jazz Hot n° 601 en 2003, entretien avec Johnny Raducanu
2. Jazz Hot n°587 de février 2002 entretien avec Teodora Enache
3.
Le Sibiu Jazz Festival est le plus ancien festival de jazz de Roumanie.
Sa première édition date de 1970 et avait eu lieu à Ploiesti. Il est le
grand évènement jazz de l’année pour les amateurs.
4. Plusieurs
pianistes roumains rencontrés évoqueront ce concours, pour eux le plus
important dans le domaine du jazz et du piano.
5. cf. notre post-scriptum ci-dessous…
Michel Antonelli
photos de Christi Mitrea, Daniel Oprea by courtesy of Bucharest Jazz Festival
 Post Scriptum Post Scriptum
Le Green Hours Jazz Cafe, un club de Jazz à Bucarest
Le
Green Hours Jazz Cafe est un club en plein centre de la ville. C’est
aussi un lieu de théâtre et il revendique le titre de «Théâtre Off» de
Roumanie. Installé au sous sol d’un bâtiment ancien, il dispose a son
entrée d’un beau patio, le tout associé à une activité de restaurant.
Le
directeur artistique du club, Voicu Rădescu, joue un rôle essentiel
dans la permanence de la diffusion du jazz dans cette grande ville. Les
soutiens apportés par l’Etat ou la ville restent inexistants. Seule la
recette peut payer les musiciens, et, en de rares occasions, avec le
soutien d’institutions de pays étrangers, il peut élargir sa
programmation. Il organise chaque année un petit festival, le Green
Hours Jazz Fest. Cette année, c’était en mai, et il a pu présenter le
duo franco-allemand Vincent Peirani et Michaël Wolny, le quartet italien
de Caterina Palazzi ou encore le quartet isralien de Daniel Zamir…
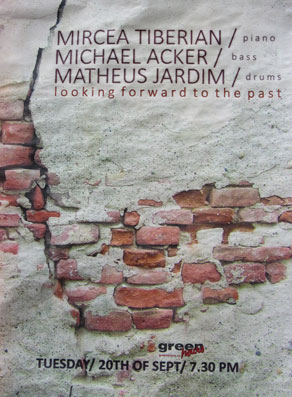
Depuis
1994, il partage un batiment avec une association, le Groupe pour le
Dialogue Social (sorte d’O.N.G), avec le siège du magazine Revistei 22 et la librairie Librariei Humanitas,
le tout dans un système hérité de l’underground. Il propose aussi des
soirées consacrées au blues, à la musique classique et à différents
événements culturels. Parmi le grand nombre de musiciens accueillis, on
compte des Roumains: Johnny Răducanu, Harry Tavitian, A.G. Weinberger,
Lucian Ban, Ada Milea, Mircea Tiberian, Pedro Negrescu, i ORDACHE,
Marius Popp, Cristian Soleanu, Ion Baciu Jr., Vlaicu Golcea, Electric
Brother, Raul Kusak, Sorin Romanescu, Marta Hristea, Teodora Enache et
venus d’autres pays: Jurg Solothurnmann (Suisse), Ferdi Schukking
(Pays-Bas), Astillero (Mexique), Harold Rubin Quartet (Israel). C’est un
lieu d’expression pour la jeune relève du jazz local: Jazz Unit, Urma,
Aievea, Kumm (Cluj), Slang, Blazzaj (Timisoara), East Village, Arthur
Balogh, Maria Răducanu, etc.
Le club est aussi éditeur discographique et compte aujourd’hui une vingtaine de références: Jazz Unit Sextet-Changes live at Green Hours, Trei Parade/Bazar, George Baicea-Cinderella, Vlaicu Golcea & Marta Hristea-Lina Music for 1001 poems, Trigon-Glasul Pământului, Teodora Enache & Jean Stoian-Meaning of Blue, Ruxandra Zamfir-Being Green, Jazz Unit-Frow Now ON, Johnny Răducanu meets Teodora Enache-Jazz Behind the Carpathians, George Baicea-Trafic greu, Ada Milea-No mom’s Land, East Village-Non entropy, Martha Hristea & Vlaicu Golcea-Colinda noastra, East Village/Open Village-Live at Green Hours…
En dehors de l’accueil technique et du bar, l’équipe du Green Hours, pour le jazz, se limite à deux personnes. MA
Green Hours Jazz Cafe: Calea Victoriei 120, Bucureşti, ROMANIA - http://greenhours.ro/
© Jazz Hot n° 677, automne 2016
|

Monterey, Californie, USA
Monterey Jazz Festival, 16-18 Septembre 2016
Bien
que cela n’ait pas été le meilleur festival, dans l'ensemble, des
récentes éditions d’une longue histoire, le Festival de jazz de Monterey
2016 -qui en est à sa 59e édition, un record- a été très bien articulé
par l’admirable équilibre réalisé par son directeur artistique de longue
date, le toujours attentif Tim Jackson. Dans les obligations d’un
directeur de mettre sur pied le programme du festival chaque année, il
convient d'aborder les multiples facettes de cette belle et déroutante
chose qu’on appelle «jazz», de la vieille garde (par exemple, Quincy
Jones, 83 ans) aux jeunes lions (voire très jeune, avec la «prise» de
Joey Alexander, 13 ans, la sensation du piano qui draine les foules), du
mainstream à l'avant-garde (comme dans le piano trio de Christian
McBride, un contraste frappant avec le trio de l’aventureux pianiste
Kris Davis, aux prises de risques systématiques) et avec toutes les
nuances entre ces tendances.

Il
fallait d’abord penser à la commande annuelle du festival qui varie
énormément d'une année à l’autre. En 2016, le prestigieux spot a été
inspiré par Wayne Shorter et sa captivante musique de chambre pour
quartet «The Unfolding». Cela a été clairement le clou du Festival de
Monterey 2016, une œuvre qui prend sa place dans le cadre des inventions
orchestrales coloristes de Wayne Shorter, dont l’orchestre est par
nature désordonné et explorateur, et pas toujours connecté aux muses
–malgré ses grandes compositions astucieusement écrites– comme la belle
et bien nommée «The Unfolding» (le dépliage), qui a, dans l’ensemble,
mis en valeur son génie de la composition mêlé à des moments de roue
libre impulsés dans l'instant.

Ce
n’est pas un hasard si Tim Jackson, lui-même, a été brièvement sous le
feu des projecteurs de la scène de l'arène principale cette année, pas
seulement dans son rôle familier de maître de cérémonie, mais en tant
que récipiendaire du prix George Wein, du nom du saint patron du jazz,
encore actif dans les festivals. La récompense que lui ont remise un
groupe de sympathisants et de représentants du festival, comprenant des
fans du festival de longue date et ami Clint Eastwood, Quincy Jones et
d'autres, est bien méritée. Tim Jackson est un inconditionnel du
festival dont le travail est un modèle pour la façon dont les choses
doivent être faites.
Comme cela arrive dans le paysage du jazz en
général, une part de la musique la plus intrigante entendue ici n'a pas
attiré nécessairement la grande foule. Le groupe de Billy Hart, l'un
des plus passionnants dans le jazz d’aujourd’hui, se produisait dans une
petite salle, au «Night Club». Mais le groupe du batteur, âgé
aujourd’hui de 75 ans, enrichi par le très musical Mark Turner au
saxophone et le virtuose longiligne Ethan Iverson au piano (échappé de
son set avec son groupe The Bad Plus), repoussa les limites de la
création tandis qu’il conservait un swing impérieux pour se propulser
sur de nouvelles voies. Au «Coffee House», conçu comme la vitrine pour
les trios avec piano, il était bon d'entendre le grisant Stanley Cowell
rejouer après une longue semi-absence, et le Kris Davis trio –avec le
remarquable Tom Rainey à la batterie et ses formes rythmiques
changeantes– procurer certains des moments les plus stimulants et
enrichissants du week-end.

L’attention
du public a été attirée par deux grands chanteurs –Cécile
McLorin-Salvant et Gregory Porter– dont on a, à juste titre, apprécié la
trajectoire ascendante rapide dans le jazz dernièrement.
Pat
Metheny est revenu au Festival de Monterey avec un orchestre à moitié
renouvelé –la bassiste Linda Oh et le pianiste britannique, Gwilym
Simcock, avec l’habituel Antonio Sanchez à la batterie– et un set basé
sur un grand nombre de partitions déjà anciennes, à l'inverse de
l’habituelle tactique du prolifique guitariste-compositeur de venir avec
de nouveaux projets musicaux.
Quincy Jones était un pile
électrique et une présence marquante de la fête du comté de Monterey
tout le week-end, avec son cérémonial, son magnétisme et «ses
orientations spirituelles» jusqu’à son big band en hommage à ses
enregistrements des années 1960 (A & M Records), Walking in
Space, Gula Matari, and Smackwater Jack. Un ensemble avec l’apprécié
Hubert Laws, Christian McBride, le suprêmement mélodique maître de
l’harmonica chromatique, Gregoire Maret, James Carter et la chanteuse
invitée, Valerie Simpson, revisitant l’influente musique hybride
jazz-soul de Quincy Jones, captant à la fois le charme intemporel et ses
harmonies un peu statiques dans une ambiance rétro.

Mis
à part le jeune phénomène, étonnamment virtuose, le jazzman mainstream
Joey Alexander, à peine adolescent, la jeune garde comprenait également
la dynamique et douée Elena Pinderhughes, à la flûte et au chant. En
tant qu’accompagnatrice, Elena Pinderhughes a fait son chemin sur la
scène du jazz en jouant avec Christian Scott, Kenny Barron, Stefon
Harris et d'autres, mais elle possède aussi un impressionnant son
progressif jazz/R&B pour faire son chemin, et nous avons pu
l’entendre dans son set sur la scène du Garden Stage, et dans ses liens
artistiques étroits avec son frère, l’impressionnant claviériste Samora
Pinderhughes.
D’un
autre coin des talents des vingt et quelques années a surgi l'artiste
soliste, autosuffisant et agile, le britannique Jacob Collier, qui a
ébloui la foule avec son set de clôture du festival. Aidé par un système
vidéo interactif élaboré, qui multiplie efficacement sa présence par
des additions fantomatiques, le
claviériste-guitariste-percussionniste-chanteur-athlète-perfectionniste a
proposé de vertigineuses restitutions de Stevie Wonder: «Do Not You
Worry 'Bout a Thing» et Gershwin «Fascinating Rhythm». Sensationnelle et
techniquement poussée, la performance de Collier était prenante, même
si un peu stérile. Maintenant, nous aimerions voir s'il joue bien avec
les autres.
Officiellement, l'artiste en résidence était la très
talentueuse batteur-compositrice-chef d'orchestre Teri Lyne Carrington,
dont le Mosaic projet se jouait sur la scène principale, et qui a
également joué avec le prometteur jeune Next Generation Big Band le
dimanche après-midi.
Mais un autre artiste récurrent –il a
beaucoup de casquettes ici– l’artiste-phare Joshua Redman, avait, comme
son compagnon du Berkeley High School Ambrose Akinmusire, pour projet de
revenir jouer ici dans l’orchestre de son lycée.

Cette
année, Joshua Redman a dévoilé sa polyvalence innée –et sa récente
tendance au jonglage– en mettant en place un set spirituel et peaufiné
avec Bad Plus et son propre quartet. Joshua Redman, qui a produit un
album fascinant et frais sur Nonesuch l’année dernière, est encore plus
captivant avec son nouveau groupe, Still Dreaming. Cet orchestre, avec
Joshua Redman, Brian Blade (dm), Ron Miles (cnt) et Scott Colley (b) est
une lumineuse nouvelle-vieille équation, un «groupe hommage à un groupe
hommage», comme Joshua Redman l’a dit au public. Ce groupe s’appelait
auparavant Old et New Dreams, avec les anciens sidemen d’Ornette Coleman
(Dewey Redman, Charlie Haden, Don Cherry et Ed Blackwell) rendant
hommage à Ornette, sans Ornette, et apportant un nouveau son en chemin.
Bien sûr, Dewey est le père de Joshua (le jeune saxophoniste n’a
reconsidéré l'influence de son père que plus tard); Scott Colley était
un protégé assidu de Charlie Haden; et Ron Miles, un grand fan de Don
Cherry. Ensemble, les musiciens modernes prolongent l'héritage de Old
and New Dreams, avec des rebondissements originaux, en renouvelant la
«nouvelle» manière.
D'une certaine façon, Still Dreaming de
Joshua Redman et «The Unfolding» de Wayne Shorter ont servi d’idéale et
pratique métaphore de ce qu’est le Festival de Monterey à tous points de
vue: c’est un tribut annuel à une musique profonde et
multidimensionnelle, qui ajoute sa propre dimension au plaisir,
actualisant la pile du jazz, contenu et contexte.
Josef Woodard
Traduction-adaptation Yves Sportis
Photos © Josef Woodard
© Jazz Hot n° 677, automne 2016
|

Buis-les-Baronnies, Drôme
Parfum de Jazz, 15 au 27 août 2016
Il
s'agit d'un festival qui est une alternative économique, sinon
sécuritaire, aux grandes entreprises d’animation où le nombre de clients
ou présents est l'objectif premier. Parfum de Jazz est une
manifestation itinérante dont le budget est de 120 000 euros et qui
fonctionne avec environ 50 bénévoles. Le but d'Alain Brunet, directeur
artistique, est de tenter d'inculquer une base de l'histoire du genre
auprès des jeunes (prix des places à 5 euros pour les moins de 25 ans!).
But louable face à un constat que nous faisons tous, l'indifférence des
moins de 50 ans à ce que l'on qualifie de jazz. Nous avons assisté aux
concerts du 16 au 19 août.

Le
premier concert payant s'est tenu derrière la Mairie de
Mollans-sur-Ouvèze. Au programme, Steeve Laffont en quartet pour
illustrer la musique à Django. Un public de plus de 250 personnes (pas
vraiment jeunes). Belle tenue artistique, avec un Steeve Laffont (bien
connu des vétérans de Jazz in Marciac), guitariste originaire du
Haut-Verney, toujours aussi virtuose notamment dans «Them There Eyes»
(excellent solo de William Brunard, b), «Nuages» (co-soliste Jérôme Brajtman,
g), «All of Me», «Limehouse Blues», «Honeysuckle Rose» (solo en accords
de Rudy Rabuffetti, g), «Aranjuez/Spain» (Brunard, très virtuose).
Alain Brunet est venu se joindre au groupe en fin de concert, et
l'alliage bugle et cordes swing fut du meilleur effet.
Les
concerts suivants furent donnés à Buis-les-Baronnies, lieu central du
festival. S'y tient un festival off, gratuit, en fin de matinée (11-12h)
et en fin d'après-midi (18-19h), avec à l'affiche l'Akpé Motion
(fusion: «Desert», avec solo construit en crescendo de Pascal Bouterin,
dm; 18/08, «In a Silent Way») et le Parfum de Jazz All Stars (José
Caparros, Tony Russo, tp, Daniel Barda, tb, Baby Clavel, as et le
Magnétic Orchestra: solo de Russo, modèle Holton, dans «Do You Know What
It Means» et son stop chorus dans «Take the ‘A’ Train», 18/08; son de
bugle de José Caparros à la trompette Monette dans «Summertime», 19/08).

La
soirée du 17 fut consacrée au maître, Louis Armstrong. D'abord un
concert derrière le cinéma, Le Reg'Art, par les Louis Ambassadors. Dès
le premier titre, «Atlanta Blues» (Handy), Irakli a montré, à 76 ans,
une forme olympique sur la trompette (Selmer équilibrée de 1948). Ceux
qui ont vu Louis Armstrong en concert (comme le signataire) ont été émus
par cette évocation si fidèle; ceux qui ne l'ont jamais vu pouvaient
imaginer ce qu'ils ont loupé. Irakli, avec décontraction et humour, a
présenté chaque titre qui comme au temps du All Stars alterne des
incontournables (le «Medley»!) et morceaux moins célèbres («Say It With a
Kiss»), avec des «spécialités» pour chacun: «Somebody Loves Me» par
Jacques Schneck (p), «Whispering» pour Philippe Plétan (b), «I Surrender
Dear» par Alain Marquet (cl), «Stars Fell On Alabama» par Jean-Claude
Onesta (tb), «Steak Face» et «Mop Mop» par Sylvain Glevarec (belle
sonorité de batterie). Irakli est saisissant avec la sourdine straight
(même modèle que celle de...Louis) («Rose de Picardie»). Daniel Barda
(tb King modèle Silver Sonic) s'est joint aux Louis Ambassadors dans les
cinq derniers titres dont «Way Down Yonder in New Orleans», «Do You
Know What it Means to Miss New Orleans» (beau team Barda et Onesta!).
Puis
au cinéma ce fut la projection d'un film qui dresse un tableau parfait
du Paris perdu (que j'ai connu) avec un niveau d'expression musicale
qu'on n'a pas su préserver (musique de Duke Ellington/Billy Strayhorn,
orchestre d'Ellington avec Paul Gonsalves et Lawrence Brown, et deux
titres avec Louis Armstrong en re-recording sur un orchestre de studio
français comptant Roger Guérin, Gus Wallez, etc -les solistes doublant
Sidney Poitier et Paul Newman étant ici Guy Lafitte et Billy Byers,
tandis que Jimmy Gourley jouait dans la jam une partie écrite par Duke
alors que l'on voir à l'écran Serge Reggiani)...ça m'a fichu le blues:
Paris Blues de Martin Ritt (sorti en septembre 1961).

Le
18, il a été question, chose rare de nos jours, de Bessie Smith,
artiste essentielle du blues-jazz. Il y a deux façons d'aborder un
projet, soit s'imprégner de l'expressivité de l'artiste, soit de lui
emprunter son répertoire (les deux approches réunies peuvent ne pas
éviter le piège de la copie). C'est la seconde voie que Sarah Lenka a
choisi, attachée au texte des chansons pour bâtir le scénario de son
spectacle. Sauf peut-être un peu dans «After You've Gone» (bon
arrangement pour Camille Passeri, tp), on n'entend pas l'art
d'interpréter de Bessie Smith. Nous avons eu une musique très agréable,
bien jouée, tendant vers le folk (avec Fabien Mornet, bj, dobro, Taofik
Farah, g sèche, Manuel Marches, b) et la pop (le deuxième bis,
«Radioactive» sonnait comme les reprises de Bessie Smith: «Do Your
Duty», «It Won't Be You», «You've Got to Give Me Some», «On Revival
Day», etc). Le public qui, dans l'ensemble ignore tout de Bessie Smith,
fut enchanté.
Le 19, fut donné au théâtre Le Pallun, le spectacle Frank Sinatra for Ever du crooner Gead Mulheran (voc), né près de Manchester, avec les Brass
Messengers de Dominique Rieux (tp), un mini big band qui sonne comme un
grand avec Tony Amouroux, lead tp, Rémy Vidal, tb, Christophe Mouly,
ts-fl, Thierry Ollé, p, Florent Hortel, g, Julien Duthu, b, André
Neufert, dm, Pellegrin, arr. On connait l'amour de «The Voice» pour les
big bands jazz (Count Basie) et pour les trompettistes (de Harry James,
son premier employeur célèbre, à Harry Edison): nous n'avons pas été
déçu! Gead Mulheran, baryton plus léger que Sinatra (baryton Martin;
«Stranger in the Night») sait phraser comme lui («I Got You Under My
Skin«-bon solo de Vidal). Les arrangements, exigents! (bravo Tony
Amouroux!: «Time Goes By») sont intéressants (2 bugles dans «Moonlight
in Vermont»; passage guitare+voix dans «La Mer»; alliage flh-tp
harmon-fl-tb sourdine bol dans «Chicago Is»; «Les Feuilles Mortes» à
quatre, voc, p, b, flh). Parmi les bons solistes: Thierry Ollé («What Now
My Love»), Dominique Rieux («Fly Me to the Moon»), Rémy Vidal («Mack
the Knife», «Lady is a Tramp»). Un niveau international salué par un
public enthousiaste. Au total, souhaitons longue vie à ce festival!
Michel Laplace
Photos Michel Laplace et André Henrot
© Jazz Hot n° 677, automne 2016
|

Rossignol-Tintigny, Belgique
Gaume Jazz Festival, 12-14 août 2016
La
Gaume est à la Belgique ce que la Provence est à la France, et «le»
Gaume est au jazz ce qu’Avignon est au théâtre. Depuis trente-deux ans,
Jean-Pierre Bissot, son directeur-programmateur, garde la même image: un
rendez-vous à dimension humaine avec des consécrations de jazzmen
belges et des rencontres internationales peu courues. Sans œillères
artistiques, on y vient pour des découvertes et pour la convivialité.
Cette année, pour la 32e édition, à mon grand regret, je n’ai pas pu me consacrer aux trois
journées champêtres, me limitant aux concerts du vendredi sous
chapiteau. Raté donc, les groupes de Nicole Johänntgen (sax), Elina Duni
(voc), Pascal Schumacher (vib), Lionel Loueke (g), Jean-François Foliez
(cl), Johan Dupont (p), Jérémy Dumont (p), Aka Moon et le Scarlatti
Book, l’Orchestra Vivo de Garret List et le «Clair de la Lune» de Manu
Hermia («Jazz For Kids»).
Heureusement, vendredi, je
n’ai pas raté la première prestation publique du quintet de Lorenzo Di
Maio (g). L’album sort en septembre mais un vent favorable me l’avait
déjà fait découvrir en juillet (Igloo 273). Ne manquez pas de lire
l’engouement qui est mien en le cherchant au sein de nos multiples
chroniques de disques! Avec ces musiciens, j’ai retrouvé en live
toutes les qualités découvertes à mes premières écoutes: richesse
d’écriture, singularité des arrangements, unité et implication de tous.
Les spectateurs, enthousiastes, ovationnèrent le groupe, le compositeur,
le collectif.

Je
suis fan de Jacky Terrasson (p), et j’aime bien Stéphane Belmondo (tp,
flh). Les voir réunis à Rossignol ne pouvait que me plaire. L’adjonction
du musicien gnaoua Majid Bekas (oud, guembri, chant) me laissait plus
dubitatif.
Le concert s’est ouvert par deux duos piano-trompette. Le
pianiste appelle le trompettiste qui répond puis s’imbrique dans le
discours. En symbiose ou en écho, avec force (Jacky) ou délicatesse
(Stéphane), ils s’unissent et plaisent («All the Things You Are»). Dès
le troisième thème, Majid Bekas rejoint les complices. Heureux de
l’entourage il étonne par de très belles lignes à l’oud. On aimerait que
ça dure! Au cours d’un quatrième morceau, Jacky Terrasson se démène,
percute, évoque et déstructure «Summertime»; le musicien maghrébin suit
avec goût. Vient un cinquième morceau et l’oud est abandonné pour le
guembi: une sorte de guitare-basse africaine. Bekas chante, nasillard,
et Belmondo pose la trompette pour jouer du coquillage. Suivent un long
solo de guembi puis une valse de Michel Legrand joliment exposée en duo
piano-bugle. Le huitième thème, au cours duquel Jacky Terrasson
surprend, flamboyant, les choses vont se gâter lorsque Majid Bekas
s’éternise en imprécations, psalmodiant sur une incessante ligne de
basse répétitive. Lorsqu’il se met au likembé, la mesure est à son
comble, le muezzin a remplacé le musicien, et la rencontre tourne
franchement à l’aigre pour les oreilles des amateurs de jazz venus,
ouverts aux rencontres… surprenantes! On ne peut pas tout aimer ni tout
réussir. Le mérite de Jean-Pierre Bissot est d’essayer; le nôtre, est,
parfois, de résister!
Jean-Marie Hacquier
Photos Pierre Hembise
© Jazz Hot n° 677, automne 2016
|

Javea, Espagne
Xàbia Jazz, 6-8 août 2016
Le Festival est précédé par diverses manifestations parmi lesquelles un atelier pour les jeunes intitulé Juguem a fer jazz, (Jouons à faire du jazz).
L’initiative est intéressante. On peut penser et espérer que dans cet
espace, il s’agit de faire comprendre aux jeunes participants, par le
jeu, ce qu’est le jazz. Le programme annonce en effet clairement que
l’atelier vise à «éveiller la curiosité et la sensibilité des enfants
pour le jazz», mais, à l’écoute des concerts du XVIe Xàbia Jazz, on est en droit de s’inquiéter…
Plaça
de la Constitució,
6 août. Nuit étoilée avec une belle brise. Le bar
bien situé, en hauteur, face à la scène, avec bocadillos, cocas, tapas
et cervezas.
Mauvaise soirée pour le jazz.
Deux formations espagnoles
étaient invitées, Achromatic Project et St Fusion. Des musiciens
(presque) tous très corrects, qui, sans aucun doute, s’investissent dans
leur travail, mais pas un gramme de jazz. Un peu de tout, du classique,
du rock, du brésilien et même un éventail de produits japonais pour St
Fusion dont la vedette est la chanteuse et pianiste Satomi Marimoto. Il
existe sans doute un public pour ce type de musique. Mais à l’affiche
d’un Festival dit «de jazz», présenter de telles formations ne fait
qu’entretenir la confusion dans l’esprit du public qui, à terme, peut
penser que le jazz finalement c’est n’importe quoi pourvu qu’il y ait
des instruments. Le festival pourrait se discréditer à vouloir emprunter
cette voie.

Théoriquement,
le niveau musical se haussait nettement pour la soirée du 7 août qui a
mis à son menu le guitariste John Abercrombie accompagné de ses
partenaires actuels, le pianiste Marc Copland, le batteur Joey Baron et
le contrebassiste Drew Gress. Ils ont déjà écumé la côte (Barcelone,
Peñiscola…) et, à l’exception de Joey, la pile électrique du groupe,
semblent passablement émoussés et démotivés. John, l’expérimentateur
infatigable, l’innovateur, a perdu de vue les racines du genre et,
imperturbablement endormi, abandonne huit thèmes au public de Javea.
Deux d’entre eux font un peu sens pour les amateurs de jazz et possèdent
deux doigts de swing grâce à l’implication de Baron, le seul qui
transmet un sentiment. Pour le reste on dans une sorte de musique de
chambre et l’on peut se demander si Abercrombie s’est aperçu qu’il y
avait presque 900 personnes devant lui.
Le jour suivant, le
concert de clôture proposait la chanteuse portugaise Maria João,
accompagnée par l’Orchestre de Jazz de Matosinhos. L’exceptionnelle voix
de Maria, son enthousiasme contagieux, son dynamisme, sa présence sur
scène sauve un peu la XVIe édition de Xàbia Jazz.
Les dix-sept musiciens dirigés par Pedro Guedes sont d’excellents
interprètes. Tout est écrit minutieusement et arrangé par le pianiste
Carlos Azevedo. Les quelques soli offerts sont agréables à écouter. La
plupart des thèmes proviennent du disque Amoras e Framboesas,
enregistré par l’OJM et Maria. Ils s’inscrivent dans la musique
portugaise, brésilienne, pop. Deux sont porteurs de valeurs du jazz «The
Surrey With the Fringe on Top», chargé de swing pour lequel le public
du festival répond avec chaleur. Devant la même ferveur des
festivaliers, «Dancing in the Dark» est bien jazzifié par l’orchestre et
Maria João.
L’an prochain, le XVII° Xàbia Jazz ne manquera
sans doute pas de remettre le festival sur ses rails et le jazz au cœur
de son programme.
Patrick Dalmace
Texte et photos
© Jazz Hot n° 677, automne 2016
|
Langourla, Côtes-d'Armor
Jazz in Langourla, 5-7 août 2016
Cette 21e édition de Jazz in Langourla poursuit inlassablement sa défense d’un
festival 100 % jazz. Sans véritable thématique cette année, sinon celui
d’un jazz sans postures, la programmation privilégie les coups de cœur
de la directrice artistique Marie-Hélène Buron, assistée de Gildas Le
Floch. Dans un cadre chaleureux, grâce à la qualité des musiciens
invités, à l’accueil et à l’investissement des bénévoles sur place,
cette édition est une réussite.
Comme
chaque année, en dehors des groupes de jazz de Bretagne, invités à se
produire vers 19h, la soirée se déroule en deux temps, avec une première
partie à 20h, et une seconde à 22h dans le splendide Théâtre de
Verdure, cette ancienne carrière réaménagée en salle de concerts en
plein air.

Le
5 août, le lauréat du Tremplin Jazz in Langourla 2015, François Collet
(g) et son trio composé de Denis Pitalua (b) et Fabien Blondet (dm), a
ouvert la 21e édition du festival devant le Théâtre de Verdure. Il a interprété des titres de son premier album, EP.1,
sorti en mars dernier. Dans la veine de John Scofield, le guitariste ne
manque pas de talent. La performance est excellente. Le public a
apprécié.
La première partie a été particulièrement raffinée
avec le guitariste bayonnais Sylvain Luc. En solo, il a interprété des
compositions originales, toutes superbes («Bleu tendre», «Ameskeri»,
«Langourla la») et deux standards («Nardis», «Yesterdays»). Chez Luc,
tout est poésie. Tout est juste et délicat. Chaque titre n’en finit pas
de se dérouler. Plutôt que d’impressionner par sa technique virtuose, le
guitariste privilégie l’émotion. Seule elle parle.

Changement
de registre avec Sweet Screamin’ Jones et Boney Fields. L’altiste et
chanteur Yannick Grimault, dit Sweet Screamin’ Jones, qui a parfaitement
assimilé l’art des bluesmen, et son acolyte trompettiste de Chicago
(tous deux bien connus des habitués du Caveau de La Huchette) en ont mis
plein les yeux et les oreilles. Accompagné du brillant Pierre Le Bot
(p), Philippe Dardelle (b) et Patrick Filleul (dm), le quintet nous fait
passer de «The Way You Are» à «Place du Tertre» (Lagrène) dans un set
très rodé et au swing survolté.

Le
lendemain, vers 19h, une belle surprise nous attendait: le trio d’Eric
Doria (g), avec Jeff Alluin (claviers) et Raphaël Chevé (dm). Dans la
tradition des excellents trios à l’orgue, Doria a interprété des
compositions originales («Thumb’s Up», «Little Kitty Cat Groove»,
«Amazone», «Corduroy»). Le tout, bien ficelé, ne manquait pas de groove.

Puis,
retour aux sources avec Sarah Lenka (voc), en quintet qui a proposé sa
relecture de Bessie Smith. Secondée par les excellents Fabien Mornet
(banjo, dobro, voc), Taofik Farah (g, voc), Manu Marches (b, voc),
Camille Passeri (tp, voc). La chanteuse, pétillante, a offert un set
très swing. Pleine d’humour et de légèreté, elle raconte Bessie, en fait
une femme d’aujourd’hui, avec ses histoires d’amour et ses coups durs.
Elle s’approprie ce répertoire sans nostalgie. Le résultat, très frais, a
donné parmi les meilleurs moments du festival.

Changement de cap avec Géraldine Laurent, et son dernier album At Work («Odd Folk», «At Work», «An Overdue», «Room Number 3», «Epistrophy» de
Monk). Accompagné des ultrasolides Paul Lay (p), Yoni Zelnik (b) et
Donald Kontomanou (dm), l’altiste poursuit son aventure personnelle dans
un jazz très contemporain, qui dialogue avec ses figures tutélaires,
Sonny Rollins, Lee Konitz, Charlie Rouse. Son jeu est sincère, captivant
et le climat, planant.
Le 7 août, la soirée
débutait vers 19h avec les stagiaires de la master class de swing
manouche. Cette année, ils suivaient les conseils du guitariste Nicky
Elfrick, accompagnateur régulier de Tchavolo Schmitt. Les musiciens sont
très jeunes et doués (Matteo, Gireg, Ivan). Le répertoire de Django, on
le connaît bien, (« Blue Bossa », « I’ll See You In My Dreams »,
« Douce Ambiance ») et joué avec autant d’enthousiasme, on se régale.

Au
Théâtre de Verdure, Angelo Debarre a assuré la première partie,
accompagné du virtuose William Brunard (b) et de l’épatant Raangy
Debarre (g). On connaît la prédilection de Marie-Hélène Buron pour les
guitaristes. On se souvient du concert fameux de Boulou et Elios Ferré
l’été dernier, aussi de l’épatant Daniel Givone avec Alma Sinti ou David
Reinhardt avec son trio, lors d’éditions précédentes. Debarre prouve,
comme toujours, qu’il n’est pas qu’un maître du swing manouche, mais un
immense guitariste de jazz. Les racines présentes, sa curiosité, elle,
vogue vers d’autres horizons. Par son élégance, sa sophistication et
l’émotion de son jeu, Angelo Debarre est l’un de ces conteurs qui vous
touchent au cœur.
Suivait le dernier concert de cette édition. Le
pianiste Lorenzo Naccarato, avec Benjamin Naud (dm) et Adrien Rodriguez
(b). Ce jeune groupe, sympathique, repose sur la personnalité de son
leader qui présente ses compositions originales («Komet», «Shapes and
Shadows», «Breccia», «Animal Locomotion», «From Now On», «Mirko Is Still
Dancing», «Medicea Sidera»). Si Naccarato abuse des motifs obsédants, à
la façon de Tigran Hamasyan, en moins aboutis, et nous bombarde de
références intellos, inutiles, entre les titres pour justifier le sens
de ses compositions, le set a été brillant. Le public a beaucoup
apprécié.

Cette
année, les jam sessions qui se sont tenues au bar Le Narguilé ont été
particulièrement conviviales. Animées par les excellents Paddy (ts) et
Manue Paumard (b) jusqu’au milieu de la nuit, les têtes d’affiche du
festival –Sweet Screamin’ Jones, Boney Fields, Philippe Dardelle,
Lorenzo Naccarato, Raangy Debarre, entre autres– sont venues jouer le
bœuf avec les autres musiciens, amis, bénévoles.
Par les
temps qui courent, entre un climat général peu serein et des festivals
de jazz qui disparaissent brutalement, gageons que ce beau festival sera
aussi soutenu l’année prochaine qu’il l’est aujourd’hui par les acteurs
locaux et les festivaliers.
Mathieu Perez
Texte et photos
© Jazz Hot n° 677, automne 2016
|

Ystad, Suède
Ystad Sweden Jazz Festival, 3-7 août 2016
7e édition pour le festival de jazz de Scannie, région du sud de la Suède,
lequel a pris désormais son rythme de croisière et continue
d’enregistrer une fréquentation chaque année en progrès. Le programme
reste globalement de bonne tenue –même si le jazz straight ahead
n’est pas la seule couleur– et toujours propice à la découverte de bons
artistes, en particulier scandinaves. Le festival proposant jusqu’à neuf
concerts sur une journée, des choix s’imposent naturellement mais
permet à chacun, en fonction de ses goûts, de s’y retrouver. Par
ailleurs, Ystad, ville natale du commissaire Wallander (pour les
amateurs de polars), paraît aujourd’hui moins indifférente à
l’événement, davantage signalé; on a même vu certains commerçants du
centre-ville arborer le tee-shirt du festival. A l’inverse –et c’est
donc particulièrement regrettable–, au restaurant de bord de mer Marinan,
où se tient la jam nocturne depuis l’année dernière, on ressent une
distance certaine avec le jazz: sur les trois soirées de jam, on a pu
observer qu’une partie de la clientèle présente était là simplement pour
boire (bruyamment), selon les habitudes du lieu, lequel ne s’était
fendu d’ailleurs d’aucune communication particulière autour du festival
et a même interrompu brutalement la dernière soirée alors que les
musiciens n’avaient pas fini de jouer! Ajoutons à cela que,
contrairement à l’année précédente, ces jam-sessions festivalières ne
furent guère passionnantes, peu de tête d’affiche y ayant participé en
dehors de Joachim Kühn (p) et de Cyrille Aimée (voc).
La
soirée inaugurale du 3 août, selon l’habitude à l’Ystad Teater, était
réservée aux sponsors, journalistes et fidèles du festival. Passés les
habituels discours de remerciements de la part du président du festival,
Thomas Lantz, et de son directeur artistique, Jan Lundgren, ainsi que
l’introduction de l’invité d’honneur de l’édition 2016, Richard
Galliano, la partie musicale a été assurée par un trio de chanteuses
suédoises: Vivian Buczek, Hannah Svensson et Anne Pauline, soutenues par
une bonne rythmique: Ewan Svensson (g, papa d’Hannah), Matthias
Svensson (b, sans lien de famille avec les deux autres) et Cornelia
Nilsson (dm). Vivian Buczek a davantage de personnalité; son «God Bless
the Child», en hommage à Billie Holiday, accompagné d’un joli solo
d’Ewan Svensson, était assez réussi. Malgré de bonnes interventions,
Hannah Svensson n’a pas convaincu sur une composition de son cru, «For
You», ballade pop un peu fade. Quant à Anne Pauline, elle est
sympathique, mais transparente… Pour autant, les interprétations en trio
étaient plaisantes: «You Don’t Know What Love Is», «Sophisticated
Lady», entre autres.
A 22h, la tradition, initiée en 2012, de faire
jouer un trompettiste en haut du clocher de l’église Ste Marie a été
respectée, Paolo Fresu ayant été chargé de quatre solos à faire retentir
aux quatre coins cardinaux. Après quoi, le Sarde était au centre d’un
concert donné au monastère d’Ystad dans le cadre de l’exposition
«Archeomusica» (une belle exposition sur les instruments de musique de
l’Antiquité, en Grèce, en Egypte, dans l’Empire romain et en
Scandinavie, visible jusqu’au 8 janvier 2017). Fresu y était entouré de
Daniele di Bonaventura (bandonéon) et de l’Ensemble Mare Balticum: une
rencontre entre musique médiévale et expression contemporaine non sans
charme.

C’est donc le 4 août que démarrait vraiment le festival. Les concerts de 11h, dans la cour historique (XVIe siècle) de Per Helsas Gård, sont ceux les plus tournés vers la
tradition. Ce matin-là, c’était Marlene VerPlanck (voc) qui inaugurait
la journée, flanquée d’une très bonne rythmique britannique (John
Pearce, p, Paul Morgan, b, Bobby Worth, dm), qui la suit habituellement
quand elle tourne en Europe. A 82 ans, la chanteuse du New Jersey reste
dynamique, même si la voix a les accents de la vieillesse. Après une
vingtaine d’années de travail en studios, en collaboration avec son mari
Bobby VerPlanck (tb, décédé en 2009), Marlene VerPlanck a relancé sa
carrière à la fin des années soixante-dix. Elle est aujourd’hui heureuse
d’être sur scène, et son plaisir est communicatif. Passant en revue les
standards («So Easy to Love», «Speak Low», «But not for Me»…), elle a
évoqué l’un de ses modèles, Peggy Lee, donnant un récital plaisant.
A
15h, au Hos Morten Café (autre cour extérieure fort agréable), Per-Arne
Tollbom (dm) présentait son quintet suédois, Kind of New, où se
distingue un bon trompettiste, Anders Bergcrantz. Si le groupe swingue
sous l’impulsion post-bop de son leader, la prestation est restée
inégale par le manque d’inspiration du guitariste (Anders Chico
Lindvall, cherchant des effets psychédéliques) et du ténor (Anders
Nyvall). Dommage.
A 17h, Richard Galliano (acc) se produisait en solo dans l’église Ste Marie. L’invité d’honneur du festival a aligné ses succès («New York
Tango», «Tango pour Claude») ainsi que quelques thèmes bien connus du
grand public, comme la musique du fil Le Parrain de Nino Rota ou
«Imagine» de John Lennon. Un concert très populaire dans sa thématique,
sa manière, et qui n’a pas manqué de plaire.

Le dernier concert du jour se tenait à 23h au théâtre avec une nouvelle édition du projet Mare Nostrum (qui a fait l’objet d’un album chez ACT) réunissant Jan Lundgren (p),
Richard Galliano et Paolo Fresu. Rien de très neuf sous le soleil de la
Méditerranée: chacun des trois musiciens a apporté ses propres
compositions dans le prolongement du concert présenté à Ystad en 2012.
Il est à noter que c’est le Suédois qui en rabat aux deux Méridionaux
question jazz: lui seul swingue par intermittence et laisse échapper
quelques accents blues. Mais on a globalement affaire à une plaisante
musique du monde, légèrement jazzy ou folky selon les moments, et très
bien servie.

Le
5 août, la cour du Per Helsas Gård fut le théâtre d’une scène
émouvante. Un épatant quintet suédo-danois, emmené par l’excellent Jacob
Fisher (g), entouré de Bjarke Falgren (vln), Gunnar Lidberg (vln),
Matthias Petri (b) et Andreas Svendsen (dm) rendait hommage à une grande
figure du jazz danois (et scandinave), le violoniste Svend Asmussen qui
a fêté ses 100 ans le 28 février dernier. Asmussen a joué et enregistré
avec tous les grands de son époque: Django, Stéphane Grappelli, Duke
Ellington, Stuff Smith, etc. Son compatriote Jacob Fisher, qui l’a
accompagné pendant quinze ans, était donc tout désigné pour ce tribute
concert, de même que le Suédois Gunnar Lidberg (86 ans), une de ses
émules. La surprise fut générale quand le Maître fit son apparition au
tout début du concert. En fauteuil roulant, mais visiblement en bonne
santé et heureux d’être là, on l’a installé devant la scène. La musique
convoquée fut celle de Django et Stéphane Grappelli («Nuages»), mais
aussi de Stuff Smith («Timmy Rosenkrantz Blues»), servie par un Fisher
d’une invariable finesse. Le dialogue des violons fut également
réjouissant, avec notamment un «When You’re Smiling» très swing. Puis
Ligberg s’est adressé à Asmussen. Si la langue nous était étrangère, on
devinait l’amitié et la reconnaissance que témoignait le plus jeune à
son aîné.

Les
jeunes groupes scandinaves étaient programmés l’après-midi. Pour le
concert de 20h au théâtre, Joe Lovano (ts) était l’invité du Bohuslän
Big Band qu’on avait déjà pu apprécier la veille. Mais le contexte était
là bien différent: il s’agissait de reprendre le répertoire du ténor
américain, compositions personnelles ou titres marquant enregistrés au
cours de sa carrière. Ce n’est pas la première fois que Lovano se frotte
à un big band européen (Brussels Jazz Orchestra, WDR Big Band); il semble
goûter l’exercice. Si le Bohuslän Big Band est l’un des très bons
orchestres de jazz en Europe, il lui manque quelques solistes de
caractère pour sortir du lot. D’où, sans doute, la bonne idée de Jan
Lundgren de le programmer avec des guests à la forte personnalité: en
effet, Lovano apportant sa puissance et sa mélodicité au big band, le
concert fut un régal dont on retiendra en particulier une composition
très swinguante «Bird’s Eye View», une très jolie version de «Duke
Ellington’s Sound of Love» et une évocation de Caruso, auquel Lovano a
consacré un album en 2002, avec deux originaux: «The Streets of Naples»
(pour laquelle le pianiste, Tommy Kotter, a pris l’accordéon) et «Viva
Caruso».
Le concert suivant, à 23h, consacrait le retour à Ystad
de Hugh Masekela (flh, voc), qui était l’invité d’honneur de l’édition
2013. Si au bugle Masekela s’exprime dans un idiome bop, ses
interventions vocales (nettement plus présentes), comme sa formation
(composée de musiciens sud-africains) s’inscrivent dans une musique
africaine électrifiée, mêlée de pop et de funk. Les rythmes très
dansants, sur lesquels Masekela a fait son numéro de cabotinage, ont
enthousiasmé le public. Tant pis pour le jazz…
Le 6
août, à 11h, la scène du Per Helsas Gård nous réservait une nouvelle
découverte: la jeune Danoise Kathrine Windfeld (p) et son big band
Aircraft, formation dont les membres –scandinaves et polonais– doivent,
pour la plupart, avoir autour de 30 ans. Le répertoire présenté était
constitué de morceaux originaux, bien arrangés, dans l’esprit Kenny
Clarke–Francy Boland Big Band (même si ça ne swingue pas autant) et où
l’on retrouve aussi l’influence de Dave Holland. Une bonne formation.
A
15h, au cinéma Scala, se produisait le quartet de Filip Jers (hca) pour
un concert supplémentaire, celui prévu à 18h30 étant complet. On ne
doute pas de l’intérêt du public suédois pour cette formation qui
explore la musique folk de son pays (d’ailleurs sans chercher de lien
artificiel avec le jazz). Mais pour les étrangers, l’intérêt de ce
groupe est tout relatif.

A
17h, au théâtre, Franco D’Andrea (p) avec Mauro Ottolini (tp) et
Daniele D’Agaro (cl) présentait un projet singulier: la musique du trio
accompagnant la présentation d’une série de photos de Pino Ninfa portant
sur l’Afrique du Sud. Les compositions délicates du pianiste créèrent
des atmosphères tantôt sombres (en jouant sur les notes graves), tantôt
mélancoliques (à l’évocation des victimes de l’apartheid) ou plus
joyeuses devant des scènes de fête et de danse. Jouant avec les ponts
culturels, en interprétant «Basin Street Blues» et «St Louis Blues», le
trio donnait l’impression que les scènes photographiées provenaient de
New Orleans (en particulier à l’église). Une expérience intéressante.
A
20h, l’un des pères du «smooth jazz» (ce courant dérivé du jazz-rock
qui connaît un grand succès commercial aux Etats-Unis), Bob James (p)
montait sur la scène du théâtre avec son quartet: Perry Hugues (elg),
Carlitos Del Puero (elb) et Bill Kilson (dm). Ouvrant le concert sur un
bon blues, sur lequel Hugues a pu démontrer ses qualités, le quartet
s’est rapidement orienté vers un traitement «easy listening» des
standards: toucher de piano très «variétés», rythmes binaires. Assez
logiquement donc, on eut aussi droit à une reprise pop («Downtown», le
tube de Petula Clark). Bob James pratique ainsi un jazz aseptisé, sans
consistance, formaté pour le robinet radiophonique.
A 23h, Jan
Lundgren donnait son second concert, dans la même formule que celui
donné en 2015 avec Mathias Svensson et un quatuor à cordes; lequel a
fait l’objet d’un enregistrement récemment paru chez ACT, The Ystad Concert.
Centrée sur un hommage au pianiste Jan Johansson (1931-1968), la
rencontre entre jazz, folk suédois et musique classique, a de nouveau
fonctionné. On peut se reporter au compte-rendu de l’année précédente
pour en apprécier la teneur, tout en regrettant que le pianiste et
programmateur ait manqué de se renouveler cette année pour cause
d’actualité discographique.

Le
7 août, dernier jour du festival, un bon duo de sax se trouvait à 11h à
Per Helsas Gård: Bernt Rosengren (ts) et la Danoise Christina von Bülow
(as). Le premier, qui au tout début de sa carrière s’est produit au
festival de Newport (1959) a joué avec George Russell, Don Cherry,
Horace Parlan. La seconde, fille d’un guitariste de jazz, a notamment
étudié et joué avec Lee Konitz, pris quelques cours avec Stan Getz, et
enregistré avec Horace Parlan. Si les interventions de Rosengren furent
les plus marquantes, le duo (soutenu par la rythmique du ténor) a donné à
entendre un excellent bop.
A 13h, à l’hôtel Ystad Saltsjöbad,
s’est tenu sans doute le meilleur concert du festival: Martin Taylor en
duo avec Ulf Wakenius. Complices et emplis d’humour, les deux
guitaristes ont évoqué Stéphane Grappelli («Two for the Road») ainsi que
Barney Kessel («Blues for a Playboy»). Jouant également en solo à tour
de rôle (Taylor sur «They Can’t Take That Away From Me», Wakenius sur un
superbe medley brésilien), les compères ont en outre mis en valeur
quelques belles compositions de Martin Taylor: «Last Train to
Hauteville» ou encore, pour le rappel, un clin d’œil aux Antilles, «Down
at Cocomo’s». Du très beau jazz.
A 15h, au Hos Morten Café, une
énième rencontre entre jazz, pop et folk suédois nous attendait avec le
quintet d’Iris Bergcrantz, surtout remarquable pour le bon trompettiste
déjà en vue sur cette même scène trois jours plus tôt: Anders
Bergcrantz.
A 17h, au théâtre, Oddjob, le quintet animé par
Goran Kajfes (tp, perc) rendait hommage à Bengt-Arne Wallin, autre
figure du jazz suédois ayant puisé dans le folklore national (voir nos
«Tears» du 23/11/15), parrain du festival, lequel aurait dû fêter cette
année le 90e anniversaire. Cinquante ans après Wallin, Oddjob
réinterprétait à son tour l’imaginaire musical suédois par le filtre du
jazz. Vingt-cinq ans de pratique commune de la musique ont donné au
groupe une évidente cohésion: Per Ruskträsk-Johansson (s, bcl) est
l’alter-ego du leader, tandis que la rythmique (Peter Forss, b, Janne
Robertsson, dm) est emmenée par l’excellent Daniel Karlsson (p). Et
c’est tout le talent Kajfes d’être arrivé, à partir de cette matière, à
produire du véritable jazz, aux accents free et à flux tendu.
A
22h, au théâtre, c’est Avishai Cohen (b, voc) qui a conclu l’édition
2016 du festival d’Ystad, avec son trio (Omri Mor, p, Daniel Dor, dm).
Attendu comme l’un des must de la semaine, le concert de l’Israélien
s’est révélé, dans l’esprit, plus proche des «musiques actuelles», tel
qu’on les pratique en Europe, que du jazz. Dépourvue de swing, enfermée
dans des boucles répétitives, la musique du contrebassiste a l’aridité
du désert du Néguev. Elle a séduit le public scandinave, il est vrai
déjà habitué au désert de glace.
Le final fut réchauffé par des
derniers instants comme toujours chaleureux, partagés avec la belle
équipe de bénévoles du festival. Rendez-vous du 2 au 6 août 2017!
Jérôme Partage
Texte et photos
© Jazz Hot n° 677, automne 2016
|
Ospedaletti, Italie
Jazz sotto le Stelle, 3-5 août 2016
Le
drame épouvantable qui a frappé Nice le 14 juillet dernier rendait
impensable le maintien du Nice Jazz Festival. La vie, en particulier
celle de la musique, a repris peu à peu sur la Côte-d'Azur et sur la
Riviera italienne; les amateurs de jazz comptaient sur les «petits»
festivals de la région pour épancher leur soif de swing et
d’improvisations. Leurs attentes furent comblées par une programmation
de ces petites organisations proposant des affiches originales. Parmi
celles-ci, nous faisons un arrêt comme chaque année à Ospedaletti, pour
le Jazz sotto le stelle que concocte, avec son équipe, notre excellent
ami et photographe, Umberto Germinale. En pensant à Chet Baker, Umberto avait sous-titré cette 13e Edition de Jazz sotto le Stelle «I remember you», mais ce fil
conducteur avait assez de souplesse pour permettre aussi quelques
écarts.

Ainsi, le mercredi 3 août, le West Project Orchestra,
orchestre de 18 musiciens italiens, pros et semi-pros dirigés par le
guitariste Riccardo Anfosso, se proposait de reprendre le répertoire du
Liberation Orchestra de Charlie Haden sur les arrangements de Carla
Bley, dans son aspect le plus militant: les chants révolutionnaires.
Légères ou austères, les partitions originales laissent aux solistes
des moments d’improvisations généreuses dont Alberto Mandarini (tp),
«guest star de l’orchestre», prend avec un grand talent, la plus grande
part.

Le jeudi 4 août se produisait Evidence,
le trio de Mike Melillo (p), Elio Tatti (b) et Gianpaolo Ascolese (dm),
qui, on l’aura deviné, se consacrait à la relecture inspirée et très
originale des thèmes de Thelonious Monk. Une entreprise périlleuse,
parfaitement réussie, avec toujours ce toucher si percussif, ce swing et
cette intensité si fidèles aux originaux. Mike Melillo est à n'en pas
douter l'un des plus authentiques représentants de cet art incomparable
du piano jazz qui de Bud Powell à Thelonious Monk a peu d'équivalant en
intensité, en tension. Du grand Art et l'événement de ce festival! We
like Mike…

Le vendredi 5 août, Paolo Fresu, (grand admirateur de Chet Baker s’il en est) avec son Devil Quartet composé de Bebo Ferra (g), Paolino Dalla Porta (b) et Stefano
«Brushman» Bagnoli (dm), présentait une des dernières facettes de son
œuvre personnelle si prolifique. Cohésion parfaite de l’ensemble
(plusieurs disques et tournées ont été réalisés dans cette
configuration). Et si, pendant la balance, les musiciens esquissèrent
les standards, le concert ne donna à entendre que des compositions
originales, pour la plupart inédites. Comme un tour de chauffe avant un
nouvel enregistrement…
Bien dans l'esprit du jazz, Jazz sotto le
Stelle creuse avec modestie, et beaucoup d'intégrité, un sillon qui
fabrique la mémoire du jazz, celle qui dure.
Daniel Chauvet
Photos G. Gardone et Umberto Germinale by courtesy
© Jazz Hot n° 677, automne 2016
|
Royan, Charente-Maritime
Jazz Transat, 2, 9, 16, 23, 30 août 2016
Avec
en arrière-plan la mer, les carrelets et les dernières lumières du
soleil couchant, le Jazz Transat a offert chaque mardi soir d’août un
concert de jazz en plein air, gratuit, sous le kiosque surplombant la
plage de Pontaillac. Un public dense a pu successivement écouter Julie
Morillon, Didier Conchon, le crooner Pablo Compos, Antoine Hervier et
Christian Escoudé ainsi que le Good Life Quartet.
Jazz Hot a choisi
d’écouter le guitariste Christian Escoudé et le trio d'Antoine Hervier, le 23, et le Good Life Quartet, avec le batteur Jean-Pierre Derouard et le tubiste Fred Dupin, le 30.

Christian
Escoudé était l’invité du pianiste Antoine Hervier et de son trio,
Laurent Vanhee, contrebasse –excellent– et Rudy Bonin, une figure locale
de la batterie. Après un thème en trio, Christian Escoudé est entré sur
scène avec son indicatif, «Take Five», court mais bien enlevé. Le
guitariste a choisi, plutôt que d’interpréter ses compositions ou celles
de jazzmen actuels, de renouer avec les œuvres qui l’ont accompagné
lors de ses premiers pas dans le jazz. On a donc compris qu’on aurait
une soirée de standards, ce qui n’a pas manqué de ravir le public –pas
trop jeune!–, et ne fait pas de mal dans une période où le mot jazz
recouvre tout et n’importe quoi. Le plat de résistance débute avec «Four
on Six», une historique composition d’un de ses maîtres, Wes
Montgomery, que Christian Escoudé a parfaitement assimilé. Le guitariste
enchaîne avec une pièce de son autre mentor, Django Reinhardt,
«Hungaria». L’originalité du jeu reste dans l’esprit du Gitan. Un autre
grand standard suit, «April in Paris». Escoudé rappelle que le thème
figure dans Bird, le film de Clint Eastwood sur Charlie Parker.
La chanson française est aussi à l’honneur avec tout d’abord la jolie
valse «Sous le ciel de Paris» et une magnifique version personnelle,
jouée en solo, de «La Vie en rose».
Le swing, au centre de la plupart
des thèmes, monte en puissance sur «Just One of Those Things». Django
revient avec l’incontournable «Nuages», qui emballe le public, et
« Blues for Ike ». C’est banal de le répéter, mais existe-t-il un
meilleur disciple de Reinhardt que Christian Escoudé?
Pour le rappel,
celui-ci et ses partenaires ont choisi «Moon River», une mélodie simple
adaptée à la voix d’Audrey Hepburn, qui sans être véritablement
chanteuse, l’interprète dans le film Diamants sur canapé, mais
dont Mancini, son compositeur, a fait un succès devenu un standard.
Au
final, cette quatrième soirée de Jazz Transat a permis aux amateurs de
jazz mais aussi, étant donné le répertoire, à un public plus large, de
vivre un beau moment, favorisé par une superbe météo.

La
dernière soirée de la saison et du Jazz Transat a été marquée par une
exceptionnelle polémique dans le public, les uns se plaignant que «la
Ville» ne mettait pas assez de chaises, les autres répliquant que ça
s’appelait Jazz Transat, et qu’il fallait donc apporter son fauteuil de
camping, et tous de s’en prendre à ceux qui, debout, les empêchaient
d’apprécier le concert. Mais parlons musique! Apprécions d’abord les
paroles d’introduction de Rudy Bonin rendant hommage à Rudy Van Gelder,
décédé quelques jours auparavant. Nouvelle nuit axée sur les standards.
Le Good Life Quartet, formation initiée par Fred Dupin et Rudy Bonin,
qui, pour cette fois, va laisser sa place à Jean-Pierre Derouard, met à
l’honneur les crooners, Sinatra et Nat King Cole principalement,
auxquels redonne vie la voix de François-Marie Moreau, par ailleurs
brillant instrumentiste que l’on a pu écouter au ténor, soprano,
baryton, à la flûte et clarinette basse au fil des thèmes. Même si la
voix de François-Marie Moreau
n’est pas réellement celle d’un crooner, les interprétations sont
belles. Avec lui, le pétillant et dynamique F. Mazurier (clav) et deux
maîtres du jazz, Jean-Pierre Derouard, excellent tout au long de la
prestation et, tout aussi parfait, Fred Dupin (tuba) prenant
admirablement la place d’une contrebasse. C’est «Fly Me to the Moon» qui
lance le concert et, déjà, on sent battre le swing propulsé par
Derouard. Suivent «Call Me Irresponsible», «A Foggy Day», avec un beau
solo au soprano. Les standards défilent: «Cry Me a River», «Come Fly
With Me»… avec de bons moments à la clarinette basse, à la flûte, et
toujours un soutien sans faille de tous les partenaires. Les hommages se
succèdent. Pour Nat, «I Wish You Love », pour Frank, «Beyond the Sea»…
On apprécie un très beau «All of Me». Les soli de Derouard et Dupin
déclenchent un tonnerre d’applaudissements! Après un rappel ovationné,
le Jazz Transat, soigné par la météo tout au long des soirées qu’il a
égrainé, s’achève de la plus sympathique façon.
Patrick Dalmace
Texte et photos
© Jazz Hot n° 677, automne 2016
|
Pertuis, Vaucluse
Jazz à Pertuis-Festival Big Band, 1er au 6 août 2016

La 18e édition de ce festival, dont le bon esprit jazz ne se dément pas,
innove quelque peu dans son titre, puisque nous voyons apparaître
l’appellation «Jazz à Pertuis», avec en sous-titre le rappel de la
spécialité du lieu: les big bands. Gageons qu’il s’agit là de donner un
non plus direct car plus court que l’ancien. De fait, aucun changement
dans l’organisation, l’esthétique et l’esprit, et cela fait du bien de
retrouver, année après année, un festival très convivial qui respecte
son identité jazz en respectant la musique qu’il propose (du jazz), la
thématique qu’il a choisie (les big bands) et pour un succès public
toujours constant, un public qui se forme d’année en année grâce au
professeur Léandre Grau. Au demeurant, et malgré la modestie naturelle
de Léandre, un enseignant à la Pagnol (La gloire de mon père), le
festival est devenu un événement mondial jazzique quasi-unique. La
qualité en jazz n’est pas une affaire de quantité ni d’accumulation de
stars, mais d’esthétique, de culture, d'esprit, de dimension humaine et
de conviction.

Le 1er août, la traditionnelle ouverture par le Big Band de Pertuis sur la
grande scène, est savamment orchestrée par son bras juvénile en première
partie, les Tartôprunes, émanation partielle de la grande formation,
réunissant les plus jeunes. «Jeunes» ne signifie pas ici approximatifs.
Cela fait plusieurs années que cette formation ouvre le festival, et la
jeune classe des musiciens de Pertuis et des alentours bouge mais ne
faiblit pas, et rend parfaitement justice à l’esprit du festival. Le
directeur musical en est Romain Morello, brillant tromboniste et soliste
du Big Band de Pertuis entre autres, et on retrouve également plusieurs
musiciens du big band. L’esprit est ludique, modeste et complice avec
un public très populaire, au vrai sens du terme, on ne s’en étonnera pas
pour ce festival sans grosses têtes.
Le répertoire propose du jazz
(Mingus par exemple, mais aussi des parties néo-orléanaises, Miles
Davis, etc.), mais aussi de la musique populaire jazzée, « plaisantée »,
piratée avec beaucoup d’humour. Le thème de 2016 étant autour de la
sécurité, le groupe avait d’ailleurs choisi de se déguiser en pirates
surveillant l’horizon, avec perruques, costumes et accessoires (sabre
gonflable, brassards de sécurité, etc.), allusion non voilée (c’est déjà
ça) à l’opération vigipirate (vigie et pirates). L’humour est donc au
rendez-vous malgré la période. Brassens, dont le collège qui accueille
le festival porte le nom, est au rendez-vous.
Dans une cour pleine à
craquer (plus de 1000 personnes, assises, debout, couchées…), ça rigole,
ça swingue, ça chante et ça danse (les enfants surtout), avant que le
groupe, qui ne se présente que par les prénoms, comme certains des big
bands –Philippe (g), Clément (b), Alex (b, le MC à l’humour léger),
Romain (tb, dir), Bastien (bon chanteur, voc, g), Valentin (tp, voc),
Ezequiel (bon ts), la belle Caro’ (clav), Maxime (dm), Arno (as)– amène
tout ce public, dans un rappel où alternent Miles (clapping) et esprit
new orleans dans un défilé vers la grande scène et le second concert.
Une bonne entrée en matière qui montrent « qu’aux âmes bien nées, la
valeur n’attend pas le nombre des années » et qu’on peut être jeunes et
déjà avoir du métier.

Le
concert du Big Band de Pertuis, introduit par le parrain légendaire du
festival de Big Band de Pertuis, le grand et fidèle Gérard Badini, plein
d’humour avec sa voix cassée de bluesman, se déroule en deux parties,
sur la grande scène. Toujours aussi généreux (près de 2h de musique), le
Big Band de Pertuis renouvelle d’année en année son répertoire. Léandre
Grau dit que «c’est pour ne pas lasser…». La vérité, pour ce pédagogue
amateur de big band, est qu’il aime le travail et la musique, le jazz,
et qu’il veut jouer tout type de répertoire un jour ou l’autre. Le choix
est aussi fait de la variété des compositions: on passe ainsi de «Lulu
Left Town» de Mark Taylor à Lennon/McCartney, une composition des
Beatles sortie tout droit de l’esprit du Basie Beatle Bag, album
célèbre du Count, dont le big band de Léandre Grau s’inspire à n’en pas
douter. «Between the Devil and the Deep Blue Sky» (Koehler et Arlen),
«Daahoud» (Clifford Brown) sont l’occasion de re-découvrir l’excellente
Alice Martinez (voc) à qui ce big band convient tout à fait. Dans le
seconde partie, parmi beaucoup de thèmes comme «Moment’s Notice»
(Coltrane), «The Very Thought of You», «I Thought of You», «Bolivia»,
«If I Were a Bell », etc., on retiendra les bons ensembles, une écriture
classique et l’intervention de solistes inspirés au premier rang
desquels on retrouve Alice Martinez (voc), Lionel Aymes (tp), Romain
Morello (tb), Christophe Allemand (ts), Maxime Briard (dm)… Une belle
soirée de plus pour ce big band exemplaire de la cohérence culturelle
profonde de ses instigateurs, car le festival est le point d’orgue
annuel d'un travail qui ne s'arrête jamais, et qui va au-delà de la
seule école de musique pour générer dans cette petite ville un
engouement sincère et largement partagé par la population dans toute sa
diversité.
 Le
2 août, c’est Marseille qui est invitée à Pertuis, avec le Phocean Jazz
Orchestra de Thierry Amiot, un autre prof’ du Conservatoire de
Marseille venu avec sa classe de jazz, et, en première partie, une
habituée de Pertuis, la talentueuse et dynamique Mariannick Saint-Céran
(voc) qui rend un hommage original et profond à Nina Simone qui passa
une part de sa vie non loin de là, en Provence. Ce «We Want Nina» est
savamment préparé pour évoquer toutes la facettes de la légendaire
artiste, car Nina Simone, comme tous les grands artistes, a d’abord fait
du Nina de tout ce qu’elle a abordé, le jazz et le blues entremêlé bien
entendu, mais aussi la variété, les standards, la chanson. Nina a été
une artiste profonde, engagée sans avoir besoin de le dire comme l’est
la grande musique afro-américaine, par essence. Le répertoire retenu par
Mariannick est bien équilibré pour témoigner de cette œuvre, et la voix
elle-même et l’expression de la chanteuse se prêtent parfaitement à cet
hommage, sans faiblesse avec le nécessaire respect pour Nina, une Diva,
pour le plaisir d’un public toujours aussi nombreux et attentif. «It
Ain’t Necessarily So» (Gershwin), «Love Me or Leave Me»
(Donaldson-Kahn), «Be My Husband» (Nina Simone), un duo voix-batterie
magique, «Old Jim Crow» (Nina Simone), «Work Song» (Nat Adderley), «For
Four Women» (Nina Simone), «My Baby Just Cares for Me» (Donaldson-Kahn),
«Black, Young and Gifted», etc., ont évidemment débouché sur un rappel
mérité. Mariannick Saint-Céran était bien entouré de Laurent Elbaz
(clav-org), Lamine Diagne (ts), Cedric Bec (dm) et de Marc Campo (g) qui
est un excellent guitariste de blues dans «Old Jim Crow», dans la
tradition électrique dénuée de ses extensions rock, ce qui est rare à
trouver en dehors de la tradition américaine. Le
2 août, c’est Marseille qui est invitée à Pertuis, avec le Phocean Jazz
Orchestra de Thierry Amiot, un autre prof’ du Conservatoire de
Marseille venu avec sa classe de jazz, et, en première partie, une
habituée de Pertuis, la talentueuse et dynamique Mariannick Saint-Céran
(voc) qui rend un hommage original et profond à Nina Simone qui passa
une part de sa vie non loin de là, en Provence. Ce «We Want Nina» est
savamment préparé pour évoquer toutes la facettes de la légendaire
artiste, car Nina Simone, comme tous les grands artistes, a d’abord fait
du Nina de tout ce qu’elle a abordé, le jazz et le blues entremêlé bien
entendu, mais aussi la variété, les standards, la chanson. Nina a été
une artiste profonde, engagée sans avoir besoin de le dire comme l’est
la grande musique afro-américaine, par essence. Le répertoire retenu par
Mariannick est bien équilibré pour témoigner de cette œuvre, et la voix
elle-même et l’expression de la chanteuse se prêtent parfaitement à cet
hommage, sans faiblesse avec le nécessaire respect pour Nina, une Diva,
pour le plaisir d’un public toujours aussi nombreux et attentif. «It
Ain’t Necessarily So» (Gershwin), «Love Me or Leave Me»
(Donaldson-Kahn), «Be My Husband» (Nina Simone), un duo voix-batterie
magique, «Old Jim Crow» (Nina Simone), «Work Song» (Nat Adderley), «For
Four Women» (Nina Simone), «My Baby Just Cares for Me» (Donaldson-Kahn),
«Black, Young and Gifted», etc., ont évidemment débouché sur un rappel
mérité. Mariannick Saint-Céran était bien entouré de Laurent Elbaz
(clav-org), Lamine Diagne (ts), Cedric Bec (dm) et de Marc Campo (g) qui
est un excellent guitariste de blues dans «Old Jim Crow», dans la
tradition électrique dénuée de ses extensions rock, ce qui est rare à
trouver en dehors de la tradition américaine.
La
seconde partie, à 21h30, comme toujours décomposée en deux sets,
présentait donc le Phocean Jazz Orchestra (cf. la formation en fin de
compte rendu) mêlant des élèves et des prof’s du Conservatoire de
Marseille, des anciens pas très âgés, dont l’excellent bassiste, Franck
Blanchard, à l’origine du projet dirigé par Thierry Amiot qui signe la
plupart des arrangements. Comme annoncé, le programme présentait d’abord
un répertoire «acoustique», sous-entendu jazz classique, puis une
partie «électrique», sous-entendu un répertoire plus récent, se
traduisant par le passage à la basse électrique et aux claviers
synthétiques.
Le
premier set présenta en effet des compositions d’Horace Silver
(«Nutville»), bonne entrée en matière, Count Basie («Flight of the Foo
Bird» de Neal Hefti, «One O’Clock Jump»), un bon «When I Fall in Love»,
belle ballade où le chef Thierry Amiot a fait briller sa trompette, sa
sonorité et sa technique, Charles Mingus («Nostalgia in Time Square»),
un fort beau thème mis en valeur par un bon chorus du saxophoniste alto,
Thomas Dubousquet, et du contrebassiste, Franck Blanchard, et pour
finir le set un thème hispanisant de Chick Corea, «La Fiesta», qui
aurait pu se trouver en seconde partie. Cette première partie, fort
agréable et appréciée, malgré quelques belles interventions du chef, resta sage, à l’exception du thème de Corea où l’orchestre se libéra.
Le
second set «électrifié» commençait bien, par un bon «A Night in
Tunisia», où le leader faisait encore apprécier sa belle virtuosité dans
les aigus qu’exige ce thème du grand Dizzy Gillespie, thème qui aurait
pu d’ailleurs finir la première partie à la place de «La Fiesta», pour
la cohérence du programme, malgré l’électrification… Puis vint la
thématique annoncée, plus électrique avec ses lignes de basses
accentuées, plus funky, plus récente aussi, avec «Mercy, Mercy, Mercy»
de Joe Zawinul, et si le thème est plus rudimentaire, bien que balancé,
paradoxalement l’interprétation de l’orchestre est plus enlevée, plus
possédée, les trompettes, les sax, tous en fait, dansant leur musique
avec conviction… et un plaisir évident (sourires).

Puis,
nouvel écart par rapport au programme, l’orchestre choisi de mettre en
valeur le régional de l’étape, le lead Hugo Soggia (tb), sorti des
classes de Léandre Grau pour aller suivre l’enseignement du
Conservatoire de Marseille. Hugo a choisi «Georgia», immortalisé par le
grand Ray Charles (bien qu’il en existe d’autres très belles versions),
et la réussite est au rendez-vous d’un superbe chorus de trombone, avec
de beaux arrangements, cette fois très classiques bien qu’originaux, de
Thierry Amiot. Sans doute, un des meilleurs moments sur le simple plan
de la musique, car ce morceau réunit toutes les qualités d’expression,
de répertoire et d’intensité, de blues et de swing. Retour au funk avec
le «Chameleon» d’Herbie Hancock, arrangé par Maynard Ferguson si nous
avons bien compris le chef car c'est une de ses inspirations, en bon
virtuose de la trompette, et là encore, la simplicité du thème mais la
tonicité rythmique, provoque l’électrochoc nécessaire au dépassement de
l’orchestre, pour un moment intense de partage avec le public. La suite
avec «Strasbourg-St-Denis» de Roy Hargrove, «Pick-Up the Pieces» de
l’Average White Band, fut dans la logique de cette bonne soirée, très
enlevée, par un orchestre plus familier de Weather Report, du R’n’B, du
funk, que de l’univers plus lointain de la swing era dont les musiciens
ne possèdent pas la clé sur le plan émotionnel et de la sensibilité,
individuellement et collectivement, malgré une exécution tout à fait
acceptable et bien travaillée.
Ce constat était finalement clarifié
par le rappel sur un thème de Mercer Ellington «Things Ain’t Not What
They Used to Be», joué sur un tempo shuffle accentué, réunissant les
deux univers. Le public a tout apprécié, mais sans doute plus la seconde
partie, et il n’avait pas tort. Quoi qu’on pense de la plus grande
qualité des compositions de Mingus, Silver, Basie (ou ses arrangeurs),
Gillespie, bien que «A Night in Tunisia » se soit prêtée à la deuxième
manière, c’est sur des thèmes qui appartiennent davantage à la culture
de la génération de cet orchestre que les musiciens sont les plus
libres, les plus persuadés, les plus rentre-dedans, qualités
essentielles pour l’expression en big band. On peut danser sur le
répertoire de Basie, Silver ou Mingus, mais c’est une danse différente.
Un
bon big band en devenir, il n’a que 2 ans, avec outre le chef,
excellent trompette, auteur de bons arrangements, un bon bassiste,
Franck Blanchard, un bon batteur de big band, Nicolas Reboud, un
excellent altiste, Thomas Dubousquet qui promet beaucoup, et en général
de bonnes mais rares interventions des moins jeunes de la section de
saxophones, Samuel Modestine (bar) et Thierry Laloum (ts) qui possèdent
leur réserve de blues.

Le
3 août, retour dans le temps avec le groupe, néo-orléanais dans l’âme,
du toujours jeune et pétillant Pierre Bruzzo, un disciple de Sidney
Bechet qui nous a dit ne pas avoir été de la fête parisienne de
l’Olympia, l’automne passé pour les 60 ans du concert de l’Olympia. Une
erreur de casting à n’en pas douter, car, entouré de Philippe Bruzzo
(tb), Guy Mornand (g), Philippe Coromp (p), Bernard Abeille (b), Alain
Manouk (dm), Pierre Bruzzo (ss) a fait revivre l’univers du grand Sidney
Bechet par la manière, un son de saxophone vibrant et intense, malgré
les printemps qui s’accumulent, ce dont a plaisanté un leader en verve.
Il a également repris le répertoire du légendaire Néo-Orléanais qui fait
encore partie de l’inconscient collectif, à Pertuis comme partout,
puisque le public a réagi en connaisseur aux différents thèmes :
«Struttin’ With Some Barbecue» (Lil Harding), «Ain’t Misbehavin’» (Fats
Waller), «Le Marchand de poissons» (Bechet), un «Glory Hallelujah»,
hymne américain repris à la Bechet, comme il le fera de l’hymne
provençal, «La Coupo Santo», un peu plus loin, l’indispensable «Petite
Fleur» (Bechet), vibrant à souhait, les inusables «Some of These Days»,
«On the Sunny Side of the Street» avec, pour la partie vocale, Philippe
Bruzzo et un chorus de contrebasse de Bernard Abeille, «Dans les rues
d’Antibes» (Bechet), et en rappel l’incontournable «When the Saints»,
pour le plus grand bonheur du public. Dans la bonne formation, on a
remarqué le style Hawaïen et savant de Guy Mornand (citation
«traditionnelle» de la Rhapsodie n°2 de Liszt). Bechet étant
inépuisable, on avait encore de la réserve, mais il fallait laisser la
place à la seconde partie de la soirée.
L’Azur
Big Band, parce qu’il vient de Nice, est venu nous rappeler l’attentat
tragique qui a endeuillé l’été 2016. C’est avec tact que le leader de la
formation, Olivier Boutry, les a évoqués dans le cours du concert. La formation, très
professionnelle dans sa présentation et son programme, proposait un
répertoire classique dans l’esprit de ce qu’ont pu produire les grandes
formations américaines depuis l’ère de la swing era, alternant
instrumentaux et accompagnement de chanteurs/ses de variétés influencées
par le jazz. Il y avait ainsi une chanteuse américaine, Jilly Jackson,
efficace, et un crooner américano-suédois, vivant sur la Riviera, ainsi
présenté, Ricky Lee Green, au beau phrasé évoquant l’idéal universel du
genre qu’est Frank Sinatra. Au physique rappelant Thierry le Luron, il a
de réelles qualités d’expression dans ce genre.

L’orchestre,
dans la partie instrumentale, dirigé et présenté par Olivier Boutry, a
proposé en ouverture, comme en fin de concert un classique blues, bien
tourné, joué avec toute l’énergie nécessaire, de bons chorus de Laurent
Rossi (p) et de Bela Laurent (tb). De bons «Flying Home»
(Goodman-Hampton, immortalisé par Lionel Hampton et Illinois Jacquet),
«Sing Sing Sing» (Luis Prima), avec un bon chorus de batterie sur les
peaux in the tradition (Krupa-Rich), «Mambo 5» , le «Ticle Toe» de
Lester Young immortalisé par le Count basie Orchestra ont démontré que
cet orchestre, sans mettre en avant ses solistes, a de belles qualités
d’ensemble, une rigueur et une énergie qui séduisent le public
connaisseur car elles sont des qualités indispensables d’un big band.
«Cry Me to the Moon», «Fly With Me», «Fever» , «I Love You», «The Lady
Is a Tramp», «You Are the Sunshine» et autres standards, ont mis en
valeur Ricky Lee Green et la belle Jilly Jackson, avant un rappel
réunissant tout le monde sur la très fréquentée «Route 66», pour le
plaisir non dissimulé d’un public encore nombreux, et pour la plus
grande satisfaction des musiciens, ainsi récompensés, de ce bon
collectif.
Le 4 août, le jeudi, est comme chaque année dévolu
à la salsa, une sorte de respiration du jeudi, qui se présente très
clairement pour ce qu’elle est, un à-côté du festival, et qui est
l’occasion aussi pour le public de danser. Nous n’y étions pas mais ça a
chauffé pour le plaisir des danseurs d'après les échos du lendemain.

Le
5 août, c’est le beau quartet de Bastien Ballaz qui a introduit une
soirée de découvertes. Le tromboniste, qui a été à bonne école
(Conservatoire de Marseille, Bruxelles avec Phil Abraham, etc.), est un
excellent compositeur, instrumentiste, et il a côtoyé déjà du beau monde
(Cécile McLorin Salvant, Liz McComb, Bill Mobley, James Carter…).
Entourée de jeunes musiciens excellents (Maxime Sanchez, p, Simon
Tailleu, b, Gautier Garrigue, dm), il joue le répertoire du jazz («Four
in One», Monk, «Henya» d’Ambrose Akinmusire) et sa musique originale,
des suites qui alternent des atmosphères, un beau récit qui témoigne
d’une vraie imagination très «cinématographique» («Lullaby», «Synopsis»,
«New Orleans Drunk Party») qui évoquent d'autres références, les
compositions de Charles Mingus ou Horace Silver par exemple. Ils ont eu
droit à un rappel mérité («Lost in My Dreams» de Bastien Ballaz). Un
musicien à suivre!

La
seconde partie invitait un groupe allemand, le Lutz Krajenski Bib Band,
composé de 13 musiciens dont deux chanteurs très intéressants, Ken
Norris, parfaitement francophone car séjournant régulièrement en France,
et Myra Maud, une très belle Parisienne aux racines malgaches et martiniquaises, tous deux possédant de réelles qualités musicales et un métier certain. Lutz
Krajenski est le leader, pianiste et organiste de cet orchestre, aussi
professionnel que d’autres dans ce festival, mais avec une touche
supplémentaire qui confère une dimension plus dynamique au spectacle. Le
public ne s’y est pas trompé, et c’est dans cette soirée que les
danseurs sont venus sur le devant de la scène pour participer à un
moment fort de cette édition.

Le
répertoire éclectique, parfois variété américaine, soul, teintée de
jazz ou de ferveur avec ses deux chanteurs talentueux, parfois même
brésilien, parfois broadway (West Side Story), sans être le plus
jazz de la semaine, possédait cette étincelle qui a déclenché
l’enthousiasme du public et une bonne soirée. De beaux arrangements,
avec des ensembles de flûtes en particulier, donnait une couleur
particulière au big band, et il y avait dans chaque pupitre un solide
soliste capable d’enrichir les ensembles de bons chorus. Terminé sur un
beau «Everytime We Say Goodbye» par l’excellent Ken Norris et sur un
rappel enfiévré sur l’inusable «Cheek to Cheek» et un bon duo Ken
Norris-Myra Maud, ce moment a permis de vérifier qu’en matière de big
band, l’énergie, la conviction sont une des composantes importantes pour
le public, un élément de métier autant qu’une donnée générale de
l’expression artistique.

Le 6 août, c’est le sextet d’Olivier Lalauze (b, comp, arr) qui ouvrait la soirée de clôture, en compagnie d’Ezéquiel Célada (ts),
Alexandre Lantieri (as, cl), Romain Morello (tb), Gabriel Manzanèque
(g). Après une formation au sein de l’IMFP de Salon-de-Provence, puis du
Conservatoire d’Aix-en-Provence, Olivier Lalauze en parallèle à ces
activités d’accompagnateur (Cécile McLorin-Salvant, Archie Shepp, Cie
Nine Spirit, Jean-François Bonnel…) développe depuis 2012 un projet en
sextet. C’est un groupe bien soudé qui défend un répertoire original.
Fort d’un prix au Tremplin Jazz de Porquerolles en 2015 qui lui valut
une programmation à Jazz sur la Ville puis à assurer un première partie
d’Otis Taylor cet été, le sextet se produit régulièrement sur les scènes
du Sud dont il est l’une des jeunes formations les mieux rodées. Sa
musique s’inspire autant de Charlie Mingus, époque petit combo, que de
la musique contemporaine et se présente souvent comme des petites
suites. L’attention du public est requise car le groupe ne pratique pas
les habituelles séquences du jazz (exposition-chorus) dans un festival
où le public a été formé à ça. Le pari fut réussi malgré parfois
quelques silences interrogateurs. Pour le rappel, Olivier Lalauze a
proposé un thème sur la Guerre d’Espagne, revu et corrigé dans l'esprit du Liberation Music Orchestra de Charlie Haden.
Le
dernier concert du festival était très attendu, avec le programme
annoncé en deux parties, musique profane-musique sacrée, du Duke
Orchestra de Laurent Mignard qui consacre son travail à une relecture
proche de l’original de l’œuvre de Duke Ellington (cf. Jazz Hot
n°656). Le concert avait lieu à guichets fermés, ce qui a été le cas de
la plupart des soirées, et, ce soir-là, on a refusé du monde…

La
première partie a été l’occasion de constater que l’orchestre a les
moyens artistiques de ses ambitions, et le public a répondu par une
belle ovation à un set de haut niveau. Sur les «standards» du répertoire
ellingtonien «I’m Beginning to See the Light», «Take the ‘A’ Train»
(chorus Philippe Milanta, Jérôme Etcheberry), «Cotton Tail» (Carl
Schlosser, Fred Couderc), «Rocks in My Bed» (Sylvia Howard), «Just
Squeeze Me» (Sylvia Howard, Jérôme Etcheberry), etc., l’orchestre répond
au défi avec beaucoup d’énergie, de mise en place et de sensibilité à
cette musique. Le savant et grand pianiste Philippe Milanta est
l’élément indispensable de l’ensemble comme en témoigne l’extraordinaire
«Rockin’ in Rhythm», et Jérôme Etcheberry apporte ses contrechants et
sa puissance à la Cootie Williams, quand Richard Blanchet colore
l’ensemble de ses aigus dans la tradition de Cat Anderson. Myra Maud,
présente la veille, est à nouveau de la fête, et c’est sur un «It Don’t
Mean a Thing» incandescent, en présence des deux chanteuses et du
danseur Fabien Ruiz (claquettes) que se termine ce premier set
exceptionnel.

La
seconde partie proposait une relecture de la musique sacrée de Duke
Ellington, l’orchestre étant soutenu pour l’occasion par deux chorales
(Chorale du Pays d’Aix, Chorale Free Son). Si le travail est encore ici
considérable, la réussite est moindre. La musique religieuse américaine,
même celle du Duke, nécessite une certaine ferveur qu’ont pu rendre les
deux chanteuses, elles-mêmes de cette culture ou de ce feeling, mais
étrangère au reste de l’orchestre et surtout aux chorales. Très
attentifs au respect de cette musique, ils ne possèdent pourtant pas
cette conviction intérieure nécessaire à ce registre. Bien sûr le «Come
Sunday», immortalisé par Mahalia Jackson et Duke Ellington, reste un
magnifique moment, et cela n’enlève rien ni au talent, ni au travail
exceptionnel de cet ensemble pour cette partie du répertoire, mais si le
jazz d’Ellington, dans sa tradition instrumentale non sacrée, peut
supporter des relectures extérieures au monde afro-américain, fidèles ou
moins fidèles, pour peu que les instrumentistes solistes aient une
vraie intériorisation du blues et du swing et un respect de l'œuvre,
cela devient contestable pour la musique à vocation religieuse ou le
blues, la voix ne pardonne pas. L’ensemble manquait d’âme, malgré les
excellentes Sylvia Howard et Myra Maud, un Philippe Milanta hors pair et
un chef très pédagogique.
Cela n’empêcha pas une conclusion
enthousiaste, un public debout et une fin de festival chaleureuse, où
Laurent Mignard –qu'il faut féliciter pour l'étendue de son travail
autour de l'œuvre d'Ellington, un grand compositeur du XXe siècle– n’en finissait pas de remercier avec son talent de showman, et
son humour, un Léandre Grau et son équipe (une sonorisation de big bands
sans faute pendant une semaine, bravo!) qui le méritent, et qui ont eu
droit, tout au long d’un festival bien rempli et pourtant convivial,
sans service d’ordre intempestif, aux éloges de tous les orchestres,
pour le son, l’organisation, l’accueil et l’ensemble.
Un festival
de jazz, avec un programme jazz, populaire à tous les sens de
l’adjectif, qui ne sombre pas dans la mondanité, est donc encore
possible, et c’est tant mieux pour le jazz qui retrouve ses valeurs!
Yves Sportis
Photos Ellen Bertet, Christian Palen et Marcel Morello by courtesy of Jazz à Pertuis
© Jazz Hot n° 677, automne 2016
1/8/2016
Tartôprunes
Valentin Halin (tp), Romain Morello (tb, arr, dir), Arnaud Farcy (as), Ezequiel Celada (ts), Bastien Roblot (voc, g), Caroline Such (clav), Clément Serre (g), Philippe Ruffin (g), Alexandre Chagvardieff (b), Maxime Briard (dm)
Big Band de Pertuis
Léandre Grau (dir, arr)
Alice Martinez (voc)
tp: Yves Douste, Lionel Aymes, Nicolas Sanchez, Roger Arnaldi, Valentin Halin
tb: Yves Martin, Loni Martin, Romain Morello, Hugo Soggia,
Tuba contrebasse: Bernard Jaubert
sax:
Christophe Allemand (ts, fl), Michaël Bez (as), Yvan Combeau (as, fl),
Laurence Arnaldi (ts), Arnaud Farcy (as), Jérémy Laures (bar)
Yves Ravoux (p), Bruno Roumestan (b), Gérard Grelet (g), Maxime Briard (dm)
2/8/2016
Phocean Jazz Orchestra
Thierry Amiot (dir, tp)
tp: Augustin Héraud, Benjamin Deleuil, Pierre-Olivier Bernard, Fan Hao Kong
tb: Hugo Soggia, Bertrand Chappa, Félix Perreira, Alain Delzant (btb)
sax: Thomas Dubousquet (as), Aurore Guidaliah (as), Antoine Lucchini (ts) Thierry Laloum (ts), Samuel Modestine (bar)
Jean Sallier-Dolette (p, clav), Franck Blanchard (b, cb), Nicolas Reboud (dm)
3/8/2016
Azur Big Band
Olivier Boutry (dir, as)
tp: Philippe Giuli, Jean Vincent Lanzillotti, Cyrille Jacquet, Benoît Roiron
tb: Bela Lorant, Gilles Barrosi, Jean-Louis Zanelli, Cyril Galamini
sax: Michael Labour (as), Eric Polchi (ts), Alexis Roiron (bar)
Philippe Villa (p), Michel Romero (b), Olivier Giraudo (g), Max Miguel (dm)
voc: Jilly Jackson, Ricky Lee Green
5/8/2016
Lutz Krajenski Big Band
Lutz "Hammond” Krajenski (dir, arr, p, clav)
tp: Axel Beineke (tp, flh), Benny Brown (tp, flh)
tb: Andreas Barkhoff, Sebastian John
sax: Ulrich Orth (as, fl), Thomas Zander (bar, fl), Gabriel Coburger (ts, fl), Felix Petry (as, fl)
Hervé Jeanne (b, elecb), Matthias Meusel (dm)
voc: Myra Maud, Ken Norris
6/8/2016
Duke Orchestra-Laurent Mignard
Laurent Mignard (dir)
tp: Jerôme Etcheberry, Sylvain Gontard, Gilles Relisieux, Richard Blanchet
tb: Jerry Edwards, Michaël Ballue, Nicolas Grymonprez
sax: Fred Couderc (ts), Carl Sclosser (ts), Didier Desbois (as) Aurélie Tropez (as, cl), Philippe Chagne (bar)
Pierre Maingourd (b), Philippe Milanta (p), Julie Saury (dm)
Myra Maud (voc), Sylvia Howard (voc), Fabien Ruiz (claquettes)
Chorale du Pays d’Aix, Chorale Free Son
|

Marciac, Gers
Jazz in Marciac, 29 juillet au 15 août 2016
Les
considérations générales (lieux de spectacles) n'ont pas changé. Mais
cette année, un choix s'impose pour ces 17 soirées données parallèlement
sous chapiteau et à L'Astrada (souvent deux concerts par soir). Un
total de 18 jours avec 59 concerts payants, pour environ 140 gratuits au
Festival Bis officiel (la place, La Péniche). Pour de multiples
raisons, ce 39e Jazz in Marciac (JiM)
a connu des fléchissements de fréquentation. Il y eut les contraintes
sécuritaires qui alourdissent les conditions de travail de reportage
(interdicton d'accès au back stage). Sans parler des dictats des
producteurs: 32 balances fermées pour 29 ouvertes. La programmation
«diverse» est typique de JiM (cf. Hot News). Abordons des moments choisis de ce que nous avons pu entendre.
La trompette lance le festival, le 29, via le Bis, à 11h30 avec le jeune Niels' Trio d'où se détache Noé Codjia (tp) qui
donne toute sa dimension expressive en tempo lent (beau son, sobriété,
feeling et gestion de la tension: «Alfie» de Rollins). Puis c'est la
première prestation de Malo Mazurié (tp), solide et inspiré dans le
funky Sophie Alour (ts, ss) 5tet («Unsatisfied» de Stanley Turrentine
avec Hugo Lippi, genre Grant Green, et Fédéric Nardin, org), avant la
soirée sous le chapiteau où, en première partie du récital Diana Krall
(sous influence King Cole, avec l'excellent Bob Hurst, b, «Let's Fall in
Love», «I've Got You Under My Skin»), Christian Scott (tp) a fait sa
seconde apparition ici (Stretch Music). Une musique dense où contrastent
le style «exaspéré» de Braxton Cook (son à la Jackie McLean) et la
paisible Elena Pinderhugues (fl) sur un drumming binaire («New Heroes»).
Christian Scott joue en force et que dans la nuance ff. Ses effets sur le travail du son dans le micro retiennent l'attention («Last Chieftain»).
Le
30/07, nous avons choisi, à L'Astrada, la rencontre du Quatuor Debussy
et du duo Jean-Philippe Collard-Jean-Louis Rassinfosse: un traitement du
son classique avec les improvisations du pianiste (dans leur adaptation
du Concerto en fa mineur pour clavecin de Bach, la lecture stricte de la partition balance plus que les développements).
Le
31/07, avant une démonstration d'énergie par les frères Moutin, nous
avons eu l'excellente performance du Nicolas Folmer Electric Group.
Folmer s'inspire du Miles Davis des années 1970 (pédale wa-wa) et 1980.
Il délivre une musique spectacuaire (thèmes-riffs accrocheurs comme
«Safari»), bien épaulé par Laurent Coulondre (org), Damien Schmitt (dm)
et le «guitar hero» Olivier Louvel («Jungle Rock»). Sur tempo rapide les
souffleurs jouent avec la précision d'un ordinateur. A noter un passage
en duo «section de trompettes» (grâce à l'électronique) et drums, et
bien sûr le son avec la sourdine harmon notamment dans «Kiss kiss bang
bang» (médium répétitif, avec changement de tempo pour le solo décapant
d'Antoine Favennec, as).
Le 1/08, 7000 personnes sous le chapiteau venues pour Ibrahim Maalouf (synthé, tp) et son show «participatif» Red & Black Light (lumières, volume sonore, rythmique rock)! Son introduction dans
«Improbable» est une démonstration du son arabe à la trompette
(utilisation du 4e piston mais aussi bends avec
les lèvres). A cette occasion, Stéphane Belmondo put jouer
(magnifiquement) devant une vaste audience. En trio (Thomas Bramerie, b,
Jesse Van Ruller, g), il nous a délivré son programme Love for Chet,
surtout au bugle (son rond, chaud). Nous avons tout spécialement
apprécié «la chanson d'Hélène» de Philippe Sarde tirée du film Les choses de la vie, où il souffle les notes sans attaque pour plus de feeling.

Le
2/08, Ellis Marsalis a offert un bref concert (1h30) strictement bop,
avec des références à Monk («Rhythm-A-Ning», «Evidence», «Epistrophy»)
et un «Broadway» très réussi (citation de «Straight No Chaser» du très
parkerien Jesse Davis et excellent solo de Darryl Hall).
Le
3/08, la charmante Cyrille Aimée a fait dans la variété (de «T'es beau,
tu sais» créé par Edith Piaf à «But Not for Me» en duo avec Shaw Conley,
b, en passant par «Three Little Words» avec solo à la Django d'Adrien
Moignard), puis, comme l'an dernier (cf. compte-rendu), Lisa Simone
s'est imposée par son sens de la scène et une ferveur digne d'une
chanteuse gospel («Work Song» torride). Elle sait chanter le blues
(«Don't Wanna Go», Hervé Samb, g -passé en Bis avec son groupe).
Le
4/08, Ahmad Jamal a donné en exclusivité «Marseille» chanté en français
et anglais par Mina Agossi en début de soirée: bon motif mélodique. Dès
le second titre, Herlin Riley (dm) a confirmé sa stature unique (bons
solos de James Cammack, b, Manolo Badrena, perc). Jamal a utilisé des
mélodies simples ou connues («Perfidia», «Poinciana») et un style de
piano, sobre et très percutant (ce qui, avec ses trois accompagnateurs,
nous a valu une orgie rythmique).
La soirée contrebasse (5/08)
permit d'apprécier avant le virtuose Avishai Cohen (bonne version de «A
Child Is Born») la formation de Kyle Eastwood augmentée de Stefano di
Battista (as, ss) qui ne manqua pas de swing («Boogie Stop Shuffle» de
Mingus, bons solos de tous; «Marciac» avec Quentin Collins au bugle;
«Blow the Blues Away» avec alternative Brandon Allen-di
Battista-Collins).
Retour aux cuivres le 6/08, avec la 6e rencontre du LTP3 et d'une harmonie: celle de Roquefort des Landes
(dir. Sylvie Labèque). Compositions (festives, souvent dansantes) de
Michel Marre (flh, tp de poche) tant à quatre («Etoile Rouge», «Down to
the Festa»,…) qu'avec l'harmonie («Mestre 'Amor» d'après «You Don't Know
What Love Is», «Bagad Cafe» avec multiphonie du tubiste,…). Feu
d'artifices de cuivres avec l'humour de Marre, la virtuosité de
Jean-Louis Pommier et François Thuiller!

Soirée
des riffs funk le 8/08 avec Fred Wesley (tb, voc) en première partie
(Gary Winters, tp-flh, solide) d'un Maceo Parker épaulé par Greg Boyer
(tb) (bref «Satin Doll» du leader pour démontrer qu'il n'est pas
jazzman).
Kamasi Washington (ts), par sa sonorité massive, s'apparente à John Coltrane-Albert Ayler (9/08).
L'alliage
voix-ténor-trombone (Ryan Porter) est intéressant et son traitement de
«Cherokee» original. Abraham Mosley est un peu le Jimi Hendrix de la
contrebasse. Même filiation coltranienne chez David Sanchez (ts, perc)
en quartet (10/08).

Lucky Peterson (org, voc) a préludé son Tribute to Jimmy Smith du 11/08 par un passage au Bis en trio (Kelyn Crapp, g, Herlin Riley, dm) d'une heure et demie, 2
jours plus tôt («The Champ», etc). Sous le chapiteau son concert fut de
premier ordre, entouré des mêmes et de Keith Anderson (ts, as) (beau
prêcheur dans «Purple Rain»). L'invité officiel, Nicolas Folmer, fut bon
dans «Everyday I Have the Blues», l'invité surprise, Wynton Marsalis, a
pris un solo dans «Blues in B flat». Le Wynton Marsalis 5tet a ensuite
occupé la scène (avec en invité Herlin Riley, tambourin, dans «My Soul,
My Jazz»). Musique de haut niveau (un seul bis) par une équipe
très soudée (Walter Blanding, ts-ss, Dan Nimmers, p, Carlos Henriquez,
b, Ali Jackson, dm) autour du leader bon dans la ballade («The Very
Thought of You») comme dans l'utilisation du plunger («America»).

Le
12/08, Charles Lloyd s'est présenté entouré de Jason Moran (p, bon dans
ce contexte), Harish Raghavan (b, solide) et Eric Harland (dm). Au
ténor, il retrouve l'aspect serein de Coltrane dans les ballades («How
Can I Tell You?») et il opte pour la flûte sur des motifs dansants
(«Tagore»).
Le torride James Carter (ts, as, ss) lui fit suite avec
Gerard Gibbs (org, excellent) et Alex White (dm) dans un programme
prenant Django en alibi («Manoir de mes rêves», «Valse des niglos»,
etc.): ampleur de son (ténor), slap tongue, multiphonie, respiration
circulaire et swing.
Le 13/08, soirée dédiée à
Michel Petrucciani par Philippe Petrucciani (g) et Nathalie Blanc (voc):
certains titres sollicitaient Nicolas Folmer (tp, grande forme: «c'est
une carioca»), Francesco Castellani (tb), Sylvain Beuf (ts, ss), et en
invité André Ceccarelli (dm).
L'Astrada a terminé le
14/08 par le fervent gospel, surtout instrumental, des Campbell Bros
(la steel guitar de Chuck et Darick Campbell évoque la voix; Phil
Campbell, g-voc, aurait fait un bon bluesman, mais «Hell no, Heaven
yes”!).

Le festival Bis,
comme chaque année propose des talents médiatiquement négligés. Nous
avons remarqué le virtuose Bastien Ribot (vln) (30/07, invité du
Corsican Trio: «Night in Tunisia»), Julien Alour (tp, flh) en 5tet
(31/07, François Theberge, ts: «Blue Monk», «Big Bang»), Antoine Hervier
(p) (hommage à Oscar Peterson), Pierre Christophe 4tet (1/08, Fabien
Marcoz, b, Mourad Benhamou, dm, Olivier Zanot, as disciple de Paul
Desmond: «Fats Meets Erroll»), le swing de Guillaume Nouaux (3/08, Paul
Chéron 6tet: «Pee Wee's Blues»), Francis Guéro (tb) (6/08, Ting a Ling:
«You Always Hurt», «Girl of My Dreams»), Philippe Petit (org) (6/08 avec
Florence Grimal, voc: «Gone with the Wind», «Lady is a Tramp»), Mélanie
Buso (fl) (7/08, Music'Halle Toulouse: «Another Stupid Death»), les
Soul Jazz Rebels (10/08, Jean Vernheres, ts, Hervé Saint-Guirons, org,
Cyril Amourette, g, Tonton Salut, dm), Alain Brunet (flh, tp) (Sylvia
Howard-Black Label: «In a Sentimental Mood», 13/08, «Lover Man», 14/08),
Damien Argentieri (p) (13/08, Véronique Hermann: «Sweet Georgia
Brown»), la soul de Nicole Quinteta Whitlock alias Ms Nickki (14-15/08,
«Big Girl», «Stand by Me»,...) et le funk de Nicolas Gardel (tp
virtuose) (14/08, Headbangers: «What is this thing called jazz?»).
Ces bons moments vécus masquent les profonds changements sociaux. Que seront les 40 ans de JiM?
Michel Laplace
Texte et photos
© Jazz Hot n° 677, automne 2016
|
 Fano, Italie Fano, Italie
Jazz by the Sea, 28-30 juillet 2016
Après
quelques années d'une restructuration due aux lourdes coupes dans le
financement, Fano Jazz by the Sea a relancé son activité avec une 24e édition riche de points de réflexions et de propositions réparties dans des lieux divers selon un projet bien défini.
Les
concerts grand public avaient lieu au Teatro della Fortuna où l’on a vu
défiler des protagonistes –avec l’immanquable succès public– tels que
le trio Scofield-Mehldau-Guiliana, Yellowjackets, le Volcan Trio (les
Cubains Gonzalo Rubalcaba, Armando Gola et Horacio «El Negro» Hernández)
et le Kenny Garrett Quintet.

Les
événements programmés dans la Corte Sant’Arcangelo pour être sur un
créneau plus confidentiel, n’en sont pas moins intéressants. Guidé par
le bassiste danois Høiby, Phronesis est une des formations les plus
intéressantes de la scène européenne actuelle. La poétique du trio est
basée sur une interaction constante faite de continuels échanges de
stimulations et de signaux. Les compositions reposent sur une harmonie
ouverte, des implantations modales, des structures polyrythmiques
développées avec un recours aux mètres impairs, des passages en tempo
libre, et des thèmes d’une articulation dense. Høiby dirige les
exécutions avec un phrasé fluide et dialectique qui rappelle de loin
Gary Peacock, et un son somptueux qui d’une certaine manière rappelle
son regretté compatriote Niels-Henning Ørsted Pedersen. En collaboration
et en contraste en même temps, le Norvégien Anton Eger se distingue par
un drumming fiévreux et découpé, et par des décompositions et des
fractures continuelles, enrichi par une attention particulière aux
timbres. L’Anglais Ivo Neame (p) intègre le dialogue en produisant une
confrontation profitable sur des plans verticaux et horizontaux,
creusant à fond la substance harmonique par des interventions incisives.

Sur la base des deux récents volumes des Liberetto,
le contrebassiste Lars Danielsson fait preuve d’une prédilection pour
les harmonies riches et ensorceleuses, et des thèmes finement ciselés,
souvent sur la base de mélodies chantantes. Dans cette formulation, se
localisent aussi bien l’infrastructure classique que les racines du folk
scandinave et d’autres formes de la tradition populaire européenne,
comme la Passacaglia in 4/4 le met en évidence, élaboration de la
structure conventionnelle en 3/4. Il en résulte une proposition
musicale plaisante, ingénieusement construite, mais à traits très
narcissiques, et finalement trop méticuleuse dans les détails, qui
n’exclut pas l’improvisation mais renonce à affronter le moindre risque.
Dans ce cadre l’habileté des musiciens passe au premier plan de toute
façon. En premier lieu le pizzicato limpide du leader à la manière d’un
violoncelle, particulièrement dans les intros et les interventions en
soliste. La dynamique hétérogène de Magnus Öström (ancien batteur de
E.S.T.) obtenue par les balais et les différents types de baguettes, est
en équilibre entre le swing, les rythmes binaires d’origine rock et son
jeu frénétique et proverbial entre la charleston et la caisse claire.
D’autre part la science rythmico-harmonique de John Parricelli (g) et sa
discrétion dans la distribution des timbres, est « transgressée »,
seulement dans un long solo au phrasé rock et en couleurs blues. Pour
finir, le toucher rythmique de Grégory Privat (p), remplaçant Tigran
Hamasyan, nous valut quelques progressions en solo basées sur des
séquences télégraphiques et vertigineuses.

Chargé
par la direction artistique de Fano Jazz de présenter un nouveau
projet, Roberto Gatto a rassemblé une formation de musiciens avec
lesquels il collabore dans des contextes différents: le fidèle Dario
Deidda (b), Sam Yahel (p) et Javier Vercher (ts). Malheureusement il a
déçu les attentes en proposant un répertoire composé de peu d’originaux
et de nombreux standards exécutés avec le critère habituel de la
succession des expositions du thème-séquence, avec des solos en reprises
du thème. C’est dommage car le début informel, en tempo libre et
glissements atonaux, avait laissé présager des développements des plus
intéressants. Une version en trio piano de «Moonlight in Vermont» a fait
exception, jouée sur la pointe des pieds avec des pauses savantes et de
subtiles dynamiques. On a évidemment apprécié la maîtrise individuelle
des membres du groupe: le swing fluide et décontracté, la gamme
dynamique du batteur; l’invention mélodique de Deidda capable de faire
sonner l’instrument électrique comme une contrebasse; le jeu de
soustraction et les phrases essentielles de Yahel, un talentueux
spécialiste de l’orgue Hammmond dans d’autres contextes; le timbre
puissant, voisin de celui de Joe Henderson, de Vercher.
Sur
la base d’une heureuse intuition du directeur artistique Adriano
Pedini, la Pinacoteca di San Domenico accueillit une exposition des
concerts de l’après-midi sous le titre Gli echi della migrazione,
on ne peut plus en phase avec les événements de ces dernières années.
Evénements sonores en solos, tout à fait appropriés à la dimension
acoustique de l’église désacralisée, qui ont vu se succéder le
trompettiste Luca Aquino, le percussionniste Michele Rabbia et les
saxophonistes Dimitri Grechi Espinoza et Gavino Murgia.
Oreb-Preghiera Sonora de Grechi Espinoza est un vrai projet, quant au son et aux structures.
On pourrait le définir comme une « architecture sonore », étant donné
qu’il exploite précisément l’interaction entre les espaces et les
volumes architectoniques. L’opération est née des expériences réalisées
dans le «duomo romanico di Barga», qui s’est ensuite concrétisée par un
enregistrement effectué au baptistère de Pise et visibles sur Angel’s Blows.
Grechi Espinoza construit un monologue-dialogue intérieur grâce à la
réverbération naturelle. La voix du ténor se prête bien au projet par sa
gamme de timbres particuliers et dynamiques. Dans les mouvements qui
composent la suite, Grechi Espinoza développe des cellules mélodiques
avec une méticulosité de chartreux, procédant par accumulation et
stratification progressives, créant par moments des passages
contrapuntiques. Plus que le phrasé, l’élément jazzistique de
l’opération s’individualise dans l’énoncé et dans le procédé exécutif
qui ne renonce pas à l’improvisation, ou à une citation occasionnelle,
comme il advient dans le cas des structures élaborées sur la base d’un
minuscule fragment de «’Round Midnight». L’auditeur assiste à une longue
prière affligée qui s’extériorise en un blues réduit à son essence et
élevé au rang de spiritual.
Profondément attaché à ses
racines sardes natales, Murgia remplit de façon exemplaire le rôle d’un
musicien européen moderne capable de greffer le langage du jazz sur le
substrat de sa propre culture, les repeignant avec des instruments
traditionnels, mais toujours avec le filtre de l’improvisation. Murcia
est également membre d’un quartette vocal sarde spécialisé dans les
chants traditionnels a tenore. Par la suite, il exploite son
registre de basse et certains traits gutturaux, soit pour exécuter un
solo riche de dynamiques et de multiplications de cellules rythmiques,
soit pour préparer une base polyphonique d’échantillons sur laquelle
improviser au soprano. Murgia maîtrise aussi les instruments sardes
traditionnels comme il sulittu (flûte piccolo, ou zufilo en canne), et les antiques launeddas,
anches jouées avec la technique du souffle continu, formé d’une double
canne avec laquelle on crée un bourdon, et une canne seule avec laquelle
on exécute la mélodie. Le lien avec sa terre se perçoit dans l’approche
plus délicieusement jazzistique; dans le phrasé sinueux du soprano, en
pleine dialectique avec la réverbération de l’église, ou sur une base
préenregistrée; dans la voix puissante du ténor qui se superpose à un
fond électronique. Une poétique qui place Murgia sur les traces des
expériences réalisées par John Surman et Jan Garbarek, mais qui révèle
en même temps une identité forte et bien définie.
Dans le merveilleux décor nocturne de l’église en ruine de San Francesco, l’exposition YoungStage a proposé un thème cher à Fano Jazz, qui montre une belle attention aux
jeunes musiciens italiens. Parmi les concerts, on a distingué le trio
du contrebassiste Matteo Bortone, très actif sur la scène française.
Bortone, Enrico Zanisi (p) et Stefano Tamborrino (dm) sont non seulement
des talents émergents qui s’imposent, mais ils témoignent du fait
d’avoir dépassé la dépendance aux modèles afro-américains, définissant
ainsi une identité et une poétique originales. Les compositions de
Bortone mettent en évidence une conception architectonique accomplie,
minimaliste et de tempos libres. On perçoit à l’intérieur un sens
mélodique aigu, libéré de la stricte dépendance au thème. Assez souvent,
en fait, on assiste à un renversement du déroulement performatif. Ils
séparent l’empathie et la syntonie avec lesquelles Bortone et ses
collègues contribuent au processus de l’improvisation. Zanisi apporte
des interventions concises et prégnantes, avec un toucher limpide,
quasiment classique et avec un riche langage harmonique. Bortone
privilégie les lignes sèches, les pédales, et les phrases essentielles
et en même temps mélodiques. Tamborrino complète le cadre avec une ample
gamme dynamique, une nette propension pour les couleurs et une rare
capacité d’écoute. Une démonstration efficace et peu commune de comment
on devrait interpréter le piano trio aujourd’hui. Et c’est aussi la
confirmation (l’énième) que l’avenir des festivals de jazz en Italie ne
peut faire abstraction d’une promotion adéquate du riche réservoir de
nouvelles idées que la scène nationale propose.
Enzo Boddi
Traduction Serge Baudot
photos Maurizio Tagliatesta by courtesy of Fano Jazz by the Sea
© Jazz Hot n° 677, automne 2016
|

Marseille, Bouches-du-Rhône
Marseille, Jazz des Cinq Continents, 20-29 juillet 2016
Pour cette 17e édition,
le Marseille Jazz des Cinq Continents (MJ5C) était associé à
différentes manifestations, regroupées dans son programme sous
l’appellation «Marseille Heure du jazz» qui ont commencé dès le 2 juin.
Ces différents concerts, expositions, films, conférences, master-classes, présentés dans de beaux parcs (Maison Blanche, de la Moline),
des Bibliothèques (l’Alcazar, Gaston Defferre), le Conservatoire
national de région ou des hôtels, a permis d’élargir le public et
d’animer différents points de la ville. On retiendra, la petite
exposition «ECM, une autre esthétique du Jazz» inaugurée en présence de
Manfred Eicher, son fondateur toujours très sobre et précis, avec en
fond musical le percussionniste Don Moye en trio. On passera rapidement
sur l’exposition «Accordé O Jazz» consacrée aux archives musicales du
Mucem qui semblent bien pauvres ou mal exploitées, avec néanmoins la
présence en vidéo du regretté guitariste marseillais Claude Djaoui. Côté
masters classes, elles étaient animées par Thomas Bramerie (b), André
Ceccarelli (dm) et Didier Lockwood (vln), musiciens qu’on retrouva en
concert durant le festival, ces manifestations bénéficiant a priori
d’autres budgets gérés par chacun des organisateurs.
Acte 1-Toit terrasse de la Friche de la Belle de Mai
Mercredi 20 Juillet–Ilhan Ersahin’s Istanbul Sessions: Ilhan Ersahin (ts), Alp Ersonnez (b), Turgut Alp Bekogiu (dm), Itzen Kizil (perc)
Le
coup d’envoi a été lancé par un concert électrique du saxophoniste
turc, Ilhan Ersahin, sur le toit terrasse de la Friche de la Belle de
Mai. Cet espace rassemble un public jeune, souvent habitué de ce lieu
ouvert le soir en été. Il faut dire que le concert était gratuit et que
la soirée sous les étoiles était attractive. A son habitude, ce groupe a
donné toute sa fougue à une musique puisée dans sa tradition orientale
revisitée par l’électro-jazz. Ilhan Ersahin anime à New York son propre
club ouvert à l’underground qui brasse largement toutes les tendances et
les mouvances actuelles. En fait, c'est un des rares résidents
new-yorkais du festival. Le groupe s’était produit à Marseille il y a
quelques années en compagnie d’Erik Truffaz.

Acte 2-Théâtre Sylvain
Jeudi 21 juillet-Didier Lockwood Quartet: Didier Lockwood (vln), Antonio Farao (p), André Ceccarelli (dm), Darryl Hall (b)
Didier
Lockwood, musicien familier de Marseille (il prépare d’ailleurs un
spectacle sur Léo Ferré avec le comédien-metteur en scène Richard
Martin), proposait un groupe composé de valeurs sûres permettant
notamment de retrouver le pianiste italien Antonio Farao rare sur les
scènes locales. Dans le cadre magnifique du Théâtre Sylvain, bel amphithéâtre très bien éclairé sur la Corniche, retrouvait son lustre d’antan (fin XIXe siècle). Si le concert ne fut pas des plus originaux, le professionnalisme de l’équipe assura un premier set agréable.
Lars Danielsson European Sound Trend: Lars Danielsson (cb), Cæcilie Norby (voc), Itamar Borochov (tp), Iiro
Rantala (p) Theodosii Spassov (kaval ) Gérard Pansanel (g) Hussam Aliwat
(oud) Wolfgang Haffner (dm). Ce nouveau groupe European Sound Trend,
dirigé par le contrebassiste suédois, était la création maison du MJ5C.
Avec cette création, le festival voulait symboliser son ancrage dans un
jazz ouvert à tous les continents. Tout d’abord la distribution était à
cette image, car elle réunissait des musiciens venus (dans l’ordre) de
Suède, Danemark, Israël, Italie, Finlande, Bulgarie, France, Palestine et
Allemagne, et se voulait ouverte à des sources d’inspiration populaires
ou classiques. Le mélange, malgré les risques, fut réussi, et le public
fut touché par cet ensemble a priori hétéroclite. On connaissait ce
musicien nordique pour ses albums chez Act, toujours bien réalisés.
Cette première (a priori sans autre point de chute pour le moment)
permet de vérifier son talent de rassembleur dans une formule originale.
Ce groupe devrait trouver preneur, nous le lui souhaitons, dans le
réseau des festivals de l’Association Jazzé Croisé dont le MJ5C fait
partie. Affaire à suivre.

Vendredi 22 Juillet-Jan Garbarek featuring Trilok Gurtu:
Jan Garbarek (sax pic/ts), Trilok Gurtu (perc, dm, voc), Yuri Daniel
(b), Rainer Bürninghaus (clav,p). Qui mieux que Jan Garbarek, à part
Keith Jarrett, pouvait représenter le label ECM, musicien symbolique du
label allemand. A noter que le label a enregistré, depuis ses débuts, la
majeure partie de sa production au Talent Studio à Oslo en Norvège,
pays de Garbarek. Dans un amphithéâtre quasi complet et sous le chant
des cigales, Jan Garbarek, démarre son set au piccolo sax avec un
maîtrise parfaite, soutenu par un groupe rodé. Pour un second titre au
ténor, son staff est au complet et vraisemblablement c’est son ingénieur
du son qui est aux manettes, hyper basses qui couvrent un peu la voix
et pad électronique de Trilok Gurtu, un morceau un peu trop répétitif
mais qui plaît au grand public. Trilok Gurtu se distinguera dès le
troisième morceau, tirant la couverture à lui et soulevant
l'enthousiasme du public. Jan Garbarek a toujours divisé les amateurs de
jazz, certains le rangeant dans une froideur nordique, seulement sauvés
par ses anciennes collaborations avec Jarrett ou Egberto Gismonti,
d’autres le plaçant au sommet des musiciens européens. Il est sûr que ce
n’est pas un musicien qui swingue mais force est de reconnaître que
certains passèrent une belle soirée. Il ne s’était pas produit à
Marseille depuis fort longtemps.
Acte 3-Mucem
Samedi 23 Juillet-Sarah McKenzie: Sarah McKenzie (voc, p), Joe Caleb (g), Pierre Boussaguet (cb), Marco Valeri (dm).
Sous
un ciel orageux, la soirée a pu commencer avec un léger retard et un
léger changement d’ordre de programmation. On passera sur la mauvaise
organisation de l’accueil du Mucem (qui
se renouvèlera le lendemain) pour se rattraper sur les belles visions
nocturnes et les paysages que nous offre ses remparts. Dans la lignée
des nouvelles chanteuses (et ici aussi pianiste), la belle Sarah
McKenzie très sympathique et très pro’ nous interpréta, avec une belle
assurance, le répertoire de son dernier disque. Répertoire classique,
compositions personnelles et encore jazz bossa, devenu le passage
inévitable pour «se vendre» dont on peut préférer les versions
originales. Reste une question, voire deux: est-ce parce qu’elle est
signée sur le label Impulse! (légendaire mais cédé à de nombreuses
reprises depuis l'origine) ou parce qu’elle est australienne que son
étoile brille bien plus que de nombreuses autres chanteuses plus
authentiques. Bien fait, bien propre, mais aucune trace de blues dans se
prestation, bien épaulé avec notamment l’excellent contrebassiste
Pierre Boussaguet.
Onefoot: Yessaï Karapetian (clav, fl),
Marc Karapetian (b, synt), Marc Font (dr, sampling). Le jeune groupe
marseillais qui monte, d’abord à la capitale où les deux frères
Karapetian se retrouvent au Conservatoire national supérieur de musique
dans la classe de jazz, dirigé par Riccardo Del Fra, et sur la scène
nationale avec la signature chez un producteur important dans le réseau
electro et funk. Après un premier EP paru fin juin, des dates dans des
scènes de musiques actuelles, des concerts remarqués aux Transmusicales
de Rennes, au Festival de Vienne, à Jazz à la Défense, sans décrocher
hélas de prix, le groupe affrontait une scène importante à Marseille.
Livrant une musique électrique fraîche, sans compromis mais dans son
époque, il n’hésita pas à interpréter deux titres emblématiques
d’Arménie, prouvant à son auditoire que la transition peut se faire dans
la tradition, certes bien revisitée et mondialisée. Disposant d’un
temps de balance assez court (dû aux intempéries), le groupe réussit
quand même à avoir son «son», servi par son technicien (Fabien Terrail).
Sans aucun doute le groupe le plus filmé, enregistré et retransmis sur
les réseaux sociaux.
Minuit 10: Thibaud Rouvière (voc,g),
Sylvain Rouvière (g,cl,voc), Mathis Regnault (bs, voc), Etienne Rouvière
(dr,pad elec,voc). Issu de l’Institut musical de formation
professionnelle de Salon-de-Provence, cette jeune formation s’intègre
dans la lignée d’un jazz rock progressif. Découvert grâce au réseau Jazz
Emergence qui réunit des écoles de musiques, Minuit 10 était le coup de
cœur du Conseil Départemental. Une autre fratrie pour une musique
électrique. Ces deux jeunes groupes prouvent que le jazz intéresse la
jeunesse et peur élargir un public qui ce soir là était déjà
intergénérationnel.

Kyle Eastwood: Kyle Eastwood (b, cb), Quentin Collins (tp) Brandon Allen (saxes), Andrew
McCormack (p), Chris Higginbottom (dm). Toujours très classe, ce
séducteur de Kyle livra un énième concert de bonne qualité; pas de
nouveauté ici, il interpréta les titres de son dernier album. Très
présent sur les scènes du sud cette saison, son groupe, inchangé, à le
mérite d’assurer lors de chaque représentation, un parfait équilibre de
jazz classique et moderne. Très disponible, il participa à l’Alcazar à
une rencontre autour de l’œuvre de son père intitulé «Eastwood after
hours».
Dimanche 24 Juillet-Hugh Coltman/Shadows-Songs of Nat King Cole: Hugh Coltman (voc) Thomas Naïm (g), Gaël Rakotondrabe (p), Christophe Minck (cb), Raphaël Chassin (dm)
De
«Mona Lisa» à «Nature Boy», le crooner anglais rend hommage à la voix
du célébrissime chanteur de charme et pianiste, Nat King Cole, un des
premiers musiciens afro-américain à avoir été admis dans la haute-société
blanche. Hugh Coltman est sans aucun doute sincère et très humble
devant son inspirateur; hélas, il manque un peu de conviction et le tout
reste trop poli, sans doute par un trop grand respect à son icone.
Terminant sur un blues, sorte d’hommage au pionnier anglais du revival
de ce style outre manche, Alexis Korner, il sera salué par un public en
petit nombre par rapport à la veille.
Jean-Pierre Como/Express Europa. Jean-Pierre Como (p), Hugh Coltman et Walter Ricci (voc), Stéphane Guillaume (sax),
Louis Winsberg (g), Thomas Bramerie (cb), Stéphane Huchard (dm). En 95,
Jean-Pierre Como, après ses aventures avec Sixun, signait l’album Express Paris Roma.
Vingt ans après, il renouvelle le voyage qui consiste à intégrer dans
le jazz la chanson, italienne en particulier. Après la création de ce
nouveau projet en octobre dernier au Café de la Danse, avec presque la
même équipe renforcée de quelques invités, il semblait intéressant
d’écouter le résultat après maturation. Bonne surprise, le répertoire et
son interprétation se sont épanouis, et le groupe sonne parfaitement.
Stéphane Guillaume, en remplacement de Stefano Di Battista, donne son
maximum et assure entièrement sa partie; Louis Winsberg, toujours
l’esprit ouvert, contribue à l’enrichissement des compositions. On
saluera la performance du jeune chanteur napolitain, Walter Ricci, qui
est de plus en plus sollicité en France. Quant à Jean-Pierre Como,
simple et discret, il sait diriger ses musiciens vers son but. Il est
vrai que la rythmique, contrebasse, batterie n’a plus rien à prouver et
sert de tremplin à maître Como. En l’occurrence, une soirée agréable
marquée par le chant entre le blues, la méditerranée et la mer.
Les concerts des soirées au Mucem étaient présentés en coproduction par le MJ5C et le Mucem.
Acte 4 – Palais Longchamp
Lundi 25 Juillet-Ester Rada: Ester Rada (voc)
Chanteuse
israélienne d’origine éthiopienne, Ester Rada est apparue, après une
carrière d’actrice, sur la scène musicale en 2013. Sa musique, définie «comme une rencontre où s’entremêlent Ethio-Jazz, funk, soul et R&B, avec des nuances de groove issues de la black music» reflète le mélange de ses goûts et influences qui vont de Nina Simone
au Fugees. Epaulée par un bon groupe, elle nous a offert une chaude
première partie appréciée par un public venue en majorité pour la
seconde partie.

Ibrahim Maalouf/Oum Kalthoum: Ibrahim Maalouf (tp), Franck Woeste (p), Rick Margitza (ts), Christophe Wallemme (cb), Nicolas Charlier (dm).
Ibrahim Maalouf/Red & Black Light Tour-10 ans de Live: Ibrahim Maalouf (tp, cl), Martin Saccardy (tp), Yann Martin (tp), Youenn Le Cam (biniou, fl, tp), Eric Legnini & Franck Woeste (cl, fender rhodes), François Delporte (g), Antoine Guillemestre (b), Stéphane
Galland (dm). Depuis le début de sa notoriété Ibrahim Maalouf était
pour la quatrième fois l’invité du festival. Une sorte d’hommage à la
place qu’il tient aujourd’hui. Il fera en décembre un concert à
l’AccordHotels Arena, ex-Bercy, soit une des plus grandes salles de
France. Peu ou pas de jazzmen ont réussi cet exploit, mais le statut
d'Ibrahim Maalouf est déjà au-delà du jazz. Salué, primé et presque
béatifié, il faut admettre qu’aujourd’hui il tient une place
particulière. Présent sur tous les fronts, albums, concerts, musiques de
films, enseignement, son omniprésence galvanise le public qui en
redemande. On
le voit beaucoup plus que d’autres trompettistes talentueux du jazz, mais il faut lui reconnaître le grand mérite d’être
un véritable showman.
Pour cette soirée il avait
décidé d’intervertir l’ordre prévu des deux groupes pour commencer par
son hommage à Oum Kalthoum, dont la tournée était déjà terminée et finir
la soirée par son super groupe électrique. Les deux groupes ont plu à
la grande audience, la seule soirée à guichets fermés. La célébration d'Oum Kalthoum par
le groupe fut très chaleureuse, Rick Margitza, saxophoniste méconnu
(malgré son passage chez Miles Davis) se pose en alter ego du
trompettiste et contribue pleinement à la réussite de ce répertoire. Le
second groupe annonçait la fête et, Maalouf en maître de cérémonie,
véritable Monsieur Loyal du Parc Longchamp, alluma le feu. Seul regret, un changement de plateau un peu long.

Mardi 26-Christian Scott/Atunde Adjuah presents Stretch Music: Christian Scott (tp, flh), Braxton Cook (saxes), Elena Pinderhughes (fl, voc), Lawrence
Fields (p, clav), Kris Funn (b), Corey Fonville (dm). Pour beaucoup la
«seule soirée vraiment jazz» du festival et, hélas, un public moins
nombreux, un Palais Longchamp à moitié-plein pour les optimistes, a
moitié-vide pour les autres. Mais les présents, dont de nombreux
musiciens, ont pu savourer deux excellents concerts donnés par des
musiciens de haut niveau. Christian Scott, comme il y a deux ans sur la
même scène, arrive avec un groupe très carré, en fait un vrai groupe
avec des musiciens qui jouent ensemble depuis des années, et cela
s’entend. Compositions originales baignées d’un esprit néo-orléannais au
service d’un jazz puissant, puisant sa force dans le passé mais collant
à l’actualité, un jazz vivant. Chaque soliste, le pianiste Lawrence
Fields, le saxophoniste Braxton Cook, le batteur Corey Fonville et Elena
Pinderhughes, merveilleuse lutine de la soirée, marquent de leur
empreinte le son du groupe. Christian Scott les remerciera pour leur
talent, leur fidèle compagnonnage et, dans une présentation, parfois un
peu bavarde, contera leurs parcours. Quant au leader, on ne peut que
saluer sa prestation, sobre efficace, concise, pleine d’imagination pour
un répertoire sans cesse renouvelé, bref un grand, un vrai jazzman!
Snarky
Puppy: Michael League (b, direction), Chris Bullock (sax, fl), Mike
Maher (tp), Justin Stanton (tp, clav), Shaun Martin (cl) Bill Laurance
(cl) Bob Lanzetti (g), Larnell Lewis (dm), Marcelo Woloski (perc).
Groupe
a géométrie variable allant jusqu’à 25 membres (dont Cory Henry),
Snarky Puppy a conquis un vaste public avec une dizaine d’albums et un
réseau internet des plus efficaces. Vu sur la toile dans le monde
entier! Avec des centaines de concerts dans les pattes, le groupe, ici
en formule réduite, tourne au quart de tour, et le moteur est
parfaitement réglé. Pour leur premier concert à Marseille, on aurait pu
espérer un plus grand nombre de fans, mais le groupe a rempli son
contrat. Véritable machine, Snarky Puppy enchaîne les titres, morceaux
de bravoure, avec efficacité, entre
Blood Sweat and Tears et Frank Zappa sans le génie et l’humour. Ce mini
big-band moderne louche entre le rock et le jazz. Les «Chiots Moqueurs»
seront rejoint par Christian Scott et Elena Pinderhughes dans le final
pour un mariage sympathique entre New York et New Orleans.

Mercredi 27 Juillet-Jacob Collier Solo (p, g, dm, b, voc, machines)
Chanteur
et multiinstrumentiste, Jacob Collier a été annoncé comme la découverte
jazz de l’été en France. Ce jeune anglais de 22 ans, parrainé par
Quincy Jones, et dont le premier album, In My Room, paru en 2015, distribué par Sony –ce qui ouvre bien des portes– a été baptisé par le Guardian «nouveau messie du jazz»,
rien de moins! En fait de messie, il s’agit avant tout d’un bon
touche-à-tout, très sympathique et très séducteur qui ravirait les
belles mères. Son show efficace, en parfaite coordination avec
l’ingénieur du son et les lumières, séduit d’abord mais lasse vite. On a
compris, il sait tout faire mais le recours systématique aux techniques
de studio, reverb, juxtaposition, echo… font sonner ces compositions,
assez banales, comme très monotones. Vu sur le net en solo au chant et
piano, plus sobre ou avec Snarky Puppy, bien entouré, sa qualité devrait
s’affirmer à moins qu’il ne préfère une carrière sous les paillettes.
St Germain:
Ludovic Navarre-St Germain (pad, etc.), Didier Davidas (p), Cheikh
Diallo (kora), Sadio Kone (n’goni), Guimba Kouyate (g), Edouard Labor
(sax), Sullyvan Rhino (b), Jorge Bezerra (dm, perc). Venu
par curiosité pour Jacob Tellier, je pensais repartir juste après,
erreur de ma part car St Germain «roi de la Frenchtouch» revisitait une Afrique Enchantée avec
un groupe plein d’énergie. Certes, nous ne sommes plus dans le domaine
du jazz, mais ce groupe nous emmène joyeusement vers les rives des
fleuves du continent noir. Efficace, sans état d’âme, bien que peu
originaux, on se laisse prendre aux solos de kora et aux polyrythmies.
Le temps du disque d’or est bien terminé celui qui à l’époque de son
album Tourist, vendu a des milliers d‘exemplaire, avait rempli la
pelouse du Palais a du se contenter ce soir, lui aussi, d’une audience
très moyenne.
Jeudi 28 Juillet-Autour de Chet: Luca
Aquino, Stéphane Belmondo, Airelle Besson, Erick Truffaz (tp), Hugh
Coltman, José James, Camélia Jordana, Sandra NkaKé (voc), Bojan Z (p,
clav), Cyril Atef (dm, perc), Christophe Mink (cb), Pierre-François
Dufour (dm,cello) + violons. Présenté comme ce qui devait être un grand
moment du festival et malgré la qualité des interprètes, l'idée de
prolonger le succès de l’album Autour de Chet, paru en avril
dernier chez Verve/Universal, ne semble qu’une formule de producteur. Le
plateau réinvitait la plupart des participants de l’album, et si on
peut saluer les belles prestations des chanteuses (un duo inventif) de
Camélia Jordan et Sandra Nkaké, de José James et des trompettistes Luca
Aquino et Stéphane Belmondo, on reste déçu sur l’ensemble. On aurait pu
rêver d'une rythmique plus fine comme la voix de Chet.

Jamie Cullum:
Jamie Cullum (voc,p), Tom Richards (sax), Rory Simmons (tp,g), Loz
Garratt (b). Nouvelle invitation au pianiste-chanteur anglais dans sa
formule quartet où il assure le show en permanence. Entre jazz, rythm’n
blues, rock et variétés, Jamie Cullum sait faire plaisir à son public
venu tout autant pour sa musique que pour sa belle gueule d’amour. Si
son dernier album, Interlude, rend hommage à Nina Simone et Sarah
Vaughan, il emprunta ce soir-là une piste royale bordé de bonnes
intentions. Il sait y faire. Il se double depuis quelques années d’un
talent d’animateur d’un programme de jazz sur BBC2 et connaît son
auditoire. Pas de surprise donc, un groupe qui soutient son leader
depuis longtemps, une musique bien travaillée qui s’intègre aussi bien
sur les scènes des grands théâtres que sur la scène plus jazz du Ronnie
Scott Club de Londres où Jamie Cullum est régulièrement programmé.
Vendredi 29 juillet-Aron Ottignon: Aron Ottignon (p), Rodi Kirk (electroniques), Sam Dubois (steel drums, perc)- Seal
Je
ne ferai pas le correspondant de guerre commentant l’actualité depuis
le bord de la piscine. Je n’ai pas assisté à ces concerts dont les échos
furent variables, grand spectacle et ravissement pour les fans de Seal,
dure première partie pour Aron Ottignon (dixit musicien local présent) qui n’a pas enthousiasmé les présents.
Malgré
le grand succès des manifestations gratuites, on note une audience
moyenne sur les concerts payants, à part pour les concerts événements
qui sont de moins en moins du jazz. Ce phénomène se retrouve d’ailleurs
dans de nombreux grands festivals aux capacités d'accueil importantes
qui évacuent le jazz pour des spectacles intéressants sans doute, mais
dont le parcours et les concerts relèvent d’autres esthétiques et
d’autres histoires. Paradoxalement (pour le souci de rentabilité), on
remarque des plateaux «maisons» très chers, clefs en main, qui peu à peu
remplacent l’artistique pour une rentabilité non avérée, au détriment
d’une véritable esthétique qui pourrait être la marque de fabrique et la
fierté d’un festival de jazz. Pour cette édition, dédiée à Bernard
Souroque, premier directeur artistique du festival qui nous a quittés en
octobre 2015, l’équipe a suivi ses indications. Force est de constater
qu’en 17 ans, le festival n’a pas réussi à créer un vrai public de
fidèles, curieux de jazz et de son renouveau. Peut-être une formule à
repenser, des prix d’entrée à revoir, notamment au Palais Longchamp où
le public est mal assis ou debout, subit les nuisances d'un restaurant
trop proche et un manque de visibilité de la scène. Un public plus
bavard et mondain qu'à l'écoute, car justement pas formé par une
démarche de longue haleine. Enfin, dernière surprise de cette édition,
juste avant le début du festival, on apprenait le départ de Stéphane
Kochoyan, appelé à remplacer Bernard Souroque. Il dirige par ailleurs les festivals
de jazz à Orléans, Barcelonnette, Nîmes et après s’être chargé du Festival de Vienne, il venait à peine d’être engagé à Marseille en mars dernier comme nouveau
directeur artistique. Compte tenu du budget pour une fois à la
hauteur des plus grandes ambitions, on attend mieux d'un grand festival
de la capitale méditerranéenne, vieux bastion du jazz en Europe!
Dominique Michel
Photos Florence Ducommun
et Valentine Kieffer by courtesy of Marseille Jazz des Cinq Continents.
© Jazz Hot n° 677, automne 2016
|

San Sebastián, Espagne
San Sebastián Jazzaldia,
20 au 25 juillet 2016
Cette
édition qui s'est déroulée de la meilleure des façons sur le plan
musical, où il y a eu d'excellents moments, a été ternie par le
comportement de certains «artistes» ou de leur environnement, empêchant
les photographes accrédités de faire ce qu'ils font depuis que le jazz
existe et qui est tout à l'honneur du jazz, de l’art ou du reportage
photographique, c'est-à-dire prendre des photos. Décidément, la
démocratie et l'art en général vivent une sale période, et bien que ce
ne soit pas le seul fait de ce grand festival, on comprend mal que les
festivals, dans leur ensemble, ne s'organisent pas collectivement pour
empêcher cette dérive de quelques stars, la plupart du temps, que nous
détaillons en conclusion car cela commence à devenir insupportable.
20 juillet. Le 51 Heineken Jazzaldia a accueilli cette année la 10e édition du Festival 12 Points dédié à la découverte de nouveaux talents du jazz européen. 12 concerts
de 12 groupes de douze villes européennes composaient le noyau de 12 Points, qui comportaient en plus un séminaire de personnalités expertes en jazz (Jazz Futures), et des jam sessions nocturnes (European Jams)
dans le récemment étrenné Kutxa Kultur Kluba de Tabakalera. Voilà
pourquoi les nocturnes au Musée San Telmo sont devenues des matinales.
21
juillet. La première matinale au San Telmo a présenté le concert
d'Ainara Ortega «Scat», l’excellent groupe dont nous avons déjà parlé
dans la chronique du Festival de Getxo de cette même année.
L’habituel
Jazz Band Ball sur les terrasses du Kursaal a démarré sur le concert de
Dave Douglas «High Risk». Le trompettiste est venu accompagné du DJ
Shigeto et, comme base rythmique, Jonathan Maron (elecb), et Ian Chang
(dm). C'est une leçon de jazz contemporain très proche du Miles Davis
électrique.
Le guitariste Norvégien Terje Rypdal et Elephant Nine ont fait un concert plus proche du rock progressif que du jazz.
Gloria
Gaynor a rendu hommage à Diana Ross, Roberta Flack, Barry White,
Pharrell Williams ou Police et n'a pas oublié ses succès les plus
populaires. L’apothéose finale fut, bien sûr, son «I Will Survive».
Marc
Ribot et ses Young Philadelphians, trio à cordes, ont fait danser le
public avec leurs versions enfiévrées des grands succès du Philadelphia
Sound. Le guitariste Américain, accompagné de Mari Halvorson, Jamaaladen
Tacuma, et Grant Calvin Weston, a joué des morceaux emblématique du
genre («The Hustle», «Love Rollarcoaster», «Love Epidemic», la suite «TSOP'» ou «You Are Everything»), utilisant sa manière, la distorsion portée à la limite.

En
même temps, le trio composé par Cyrus Chestnut (p), Buster Williams
(b) et Lenny White (dm) se produisait sur la scène Frigo. Cyrus
Chestnut était souriant. De leur côté, Buster Williams et Lenny White
ont été le support rythmique parfait pour le phrasé du pianiste. Le
trio, parfaitement cohérent, a joué ses propres morceaux («I Remember»)
ainsi que des standards («I Cover the Waterfront») qui sont dans son
disque Natural Essence.

22 juillet. A la matinale, le saxophoniste Mikel Andueza a présenté son disque Cada 5 segundos.
Le concert a commencé par «Mr. MB», un hommage à Michael Brecker.
Après, ils ont joué des morceaux comme «Zortziko para Mauro», «Kenny»
(dédié à Kenny Garrett) ou «Axuri Beltza», un arrangement d’une chanson
populaire de Navarre. Mikel Andueza est, sans aucune doute, l'un des
grands du jazz espagnol, comme ses partenaires: Iñaki Salvador (p, kb),
Gonzalo Tejada (cb, b), Chris Kase (tp), Gonzalo del Val (dm) et Dani
Pérez Amboage(g).
Ellis Marsalis fait partie de l’histoire du
Jazz. Malgré son âge, il possède toujours beaucoup de musique en lui. Il
s’est produit à la Place de la Trinidad, accompagné par Jesse Davis
(as) , Darryl Hall (b) et Mario Gonzi (dm): un jazz bebop d'une grande
élégance et serein. Il nous a donné, entre autres, un très beau «With
a Song in My Heart». Le concert terminé, son fils Brandford, qui
officiait pour le deuxième set, lui a remis le prix Donostiako Jazzaldia
de cette édition. Après la cérémonie, ils nous ont offert un ravissant
duo piano sax soprano sur l'éternel «Do You Know What It Means to Miss New Orleans».
Dans
la seconde partie, après un puissant démarrage du quartet de Branford,
l'invité d'honneur de ce groupe dans sa tournée estivale, Kurt Elling,
est monté sur la scène. Dès sa première intervention, le chanteur de
Chicago a démontré encore une fois sa maîtrise de la scène et de l'art
vocal. Pendant les deux heures environ du concert, ont résonné «I'm Not Promising the Moon», la bossa de Jobim «Só Tinha d'Être Com Você», «Blue Gardenia», «One Island to Another», «Mama Said», «As Long As You're Living», toujours soutenu par le soprano et le tenor de Branford. Pour finir, le traditionnel «St. James Infirmary», a permis à Kurt Elling de reproduire une sonorité de trompette-sourdine avec un gobelet en carton.
23
juillet. À la Trini, une séance de jazz sérieux, dur, intense, sans
concession, est à mettre au compte de DeJohnette, Ravi Coltrane et
Matthew Garrison au premier set. In Movement, est le dernier
projet de Jack DeJohnette où il réunit avec la descendance des membres
du quartet de John Coltrane, Ravi et Matthew, pour récréer des morceaux
de Coltrane, Miles Davis, Earth Wind & Fire mais aussi des
originaux. Le concert a été divisé en deux suites qui intégraient des
morceaux comme «Alabama», «Two Jimmys«, «Serpentine Fire» ou «Lydia». A souligner aussi, la version de «Blue in Green» avec DeJohnette au piano.
Steve
Coleman, au deuxième set, nous a offert le meilleur concert que nous
l’avons vu donner depuis plus de vingt ans. Accompagné par Jonathan
Finlayson (tp), Miles Okazaki (g), Anthony Tidd (b) et Sean Rickman
(dm), Steve Coleman a joué des longs développements musicaux agrémentés
de quelques surprenants changements de rythme. «Round Midnight» a été l'un des temps forts. L'autre a été l'apparition de Ravi Coltrane invité pour un dernier morceau passionnant.
24
juillet. Jerry Bergonzi (ts) et Perico Sambeat (as) se sont produits à
midi, au Club du Théâtre Victoria Eugenia. Jerry Bergonzi, un vrai
maître du ténor, déployait un son parfait, propre, dans la tradition
coltranienne. Perico Sambeat était plus lyrique. Leurs deux partenaires
n'ont pas été en reste: Renato Chicco (Hammond B3), et Andrea Michelutti
(dm), ont démontré leurs qualités rythmiques sur lesquelles les deux
saxophonistes ont pu s’appuyer.

Au
Musée San Telmo, le Workshop de Lyon (Jean Aussanaire, Jean Paul Autin,
Jean Bolcato et Cristian Rollet) a présenté son spectacle «Lettre à des
Amis Lointains», plein d’humour, de poésie et à la sauce free jazz, le
tout bien équilibré. Chaque morceau était un monde plein de saveurs de
chansons folkloriques, d'airs sud-africains, arabes, arméniens, de
ballades ou des moments de bruit infernal, mais parfaitement disposés et
cuisinés pour que le public en profite.
L'après-midi,
l’auditoire du Kursaal a reçu le saxophoniste Jan Garbarek et le
percussionniste Trilok Gurtu. Garbarek a répété en plusieurs reprises
qu'il ne faisait pas de jazz mais de la musique improvisée, ce qui est
très honnête de sa part, et très juste. De toute façon, sa musique
méditative, introspective et quelque part religieuse plaît beaucoup au
public de San Sebastián.
A la Place de la Trinidad, accompagné
d'un trio que commandait le grand batteur Nate Smith, José James a
présenté quelques-uns des morceaux qu'il va inclure dans son prochain
disque, Love in a Time of Madness. Au contraire d'autres
chanteurs de jazz plus orthodoxes, James se caractérise par son
ouverture à d'autres styles, spécialement le rap. Mais ce chanteur
maîtrise aussi la tradition du soul et du meilleur jazz, une évidence
dans son disque Yesterday I Had the Blues: the Music of Billie Holiday. Ça nous aurait bien plu qu'il intègre quelques thèmes de ce beau travail, mais nous avons dû nous contenter de «Park Bench People», «Grandma's Hands», «Come to My Door», et d’hommages à Bill Whiters («Ain't No Sunshine») et David Bowie («Man Who Stole the World»). Pour le bis,
le trompettiste Christian Scott s'est joint au groupe; son intervention
a fait monter le niveau d'un concert qui avait décliné.
Le deuxième set de la soirée a accueilli Steps Ahead «Réunion Tour». Une bonne partie des morceaux appartenaient à leur disque Holding Together (1999) dont «Bowing to Bud», «Pools» et «Copland», qu'ils ont complété
avec deux standards («The Time Is Now» et «Lush Life» (beau chorus de
Mike Manieri). En outre Manieri, cette réunion rassemblait les anciens
du groupe, Marc Johnson (b), Bill Kilson (dm) et Eliane Elias (p). Le
«petit nouveau» était le saxophoniste Donny McCaslin, un indispensables
du big band de Maria Schneider; Donny a joué fort et bien, combinant
ses interventions avec le vibraphone de Manieri. Il y a eu dans ce
concert deux détails qui ne sont pas passé inaperçus pour les plus
attentifs; primo, la pianiste Eliane Elias a ordonné de braquer deux
projecteurs supplémentaires sur elle seule; secundo, elle a demandé à
plusieurs reprises à la sonorisation de monter le son du piano dans une
lutte avec le saxophoniste qui n'a échappé à personne…
25
juillet. Au Théâtre Victoria Eugenia, La Marmite Infernale est venu
pour présenter son dernier travail «Les Hommes … Maintenant». Un projet
inattendu du groupe de 13 musiciens capables de tout. Le groupe a joué
du free jazz, du funk, du rock, du folklore, du classique, etc. Tout
était réuni pour un tabac, mais leur performance n'a reçu qu'une tiède
ovation imputable à la surprise de l'auditoire.
A la Trini, le pianiste suédois Bobo Stenson a présenté son dernier disque, Indicum.
Stenson, accompagné d’Anders Jormin (b) et Jon Fait (dm), a offert un
vrai récital. Lyrique et tranquille, il a commencé par «La
Peregrinación», la chanson d'Ariel Ramirez que Mercedes Sosa a rendu
célèbre en son temps. La suite est allée crescendo avec les morceaux
«Gysing», «Linnea», «Symphony of Birds» ou «Post scriptum», une fin idéale pour son concert.

Au
Kursaal, Christian Scott a offert le dernier grand concert de cette
édition du Jazzaldia, son projet «Stretch Music». Avec Braxton Cook
(as), Lawrence Fields (clav), Kris Funn (b), Corey Fonville (dm) et
Elena Pinderhughes (fl, voc), Christian Scott a alterné des parties
acoustiques et électriques avec de bons chorus de la flûtiste, du
saxophoniste, en dehors des siens. A souligner, l'hommage à Herbie
Hanckok ( «Hurricane»), et en bis «Equinox» de John Coltrane. Malgré
quelques problèmes de son, un beau final final pour cette 51e édition du grand festival de San Sebastián.
Le
bilan de ce Jazzaldia 2016 est donc très bon sur le plan musical avec
beaucoup de temps forts. Sur les diverses scènes, la programmation des
concerts de jazz a été variée, récupérant l'équilibre qui avait fait
défaut à l'édition précédente.
Néanmoins, il faut revenir sur
l’attitude de certains artistes qui a obscurci le festival, imposant des
conditions inacceptables au travail des reporters photographes.
Heureusement, ces faits n’étaient pas généralisés, mais, par leur
répétition, ils traduisent une tendance plus qu'inquiétante.
- Le 22 juillet, encore une fois Brad Mehldau a interdit la présence de photographes accrédités.
-
Le 23 juillet, Ibrahim Maalouf a exigé des photographes accrédités
qu'ils signent un soi-disant contrat de renonciation à leurs droits.
- Le 24 juillet, Eliane Elias a essayé d'imposer ces conditions aux photographes accrédités; le reste des artistes du Steps Ahead Réunion Tour n'ayant posé, eux, aucune condition.
-
Le 25 juillet, Diana Krall a exigé des photographes accrédités la
signature d'un soi-disant contrat qui attente à leurs droits d'auteur.
Il faut ajouter l’interdiction de scène pour l'organisation qui n'a pas
remis le traditionnel bouquet. L'interdiction de photographier, même pour
le public, a provoqué les huées mais, malgré les efforts de la
road-manager, la prise d'images n'a pas pu être empêchée. Avec la
prolifération des smartphones, le résultat de ces interdictions est qu'il n'y a plus que des photos et des vidéos de qualité médiocre.
Lauri Fernández et Jose Horna
Photos Jose horna
© Jazz Hot n° 677, automne 2016
|
Toulon, Var
Jazz à Toulon, 19-28 juillet 2016
Respectant
les trois jours de deuil national suite aux événements tragiques de
Nice, le Festival Jazz à Toulon, prévu à partir du 15 juillet, n'a
démarré que le 19. Les concerts annulés, en accord avec les musiciens,
ont pu être reportés après ces dates.

19 juillet, Sylvain Luc-Luis Salinas (g). Silvain
Luc et Luis Salinas donnaient le départ du Festival sur une Place Louis
Blanc bondé où le public assis et debout écoutait en silence, dans un
profond respect des musiciens et des autres spectateurs. A chaque
édition ce public très attentif me surprend, à l’écoute des solistes,
les ovationnant à chaque passage de bravoure, et applaudissant
chaleureusement à la fin de chaque titre. Et pourtant c’est gratuit; on
pourrait penser qu’il n’est que de passage et se fiche du plateau mais,
bravo, c’est le contraire! En comparaison de nombreux festivals, dont le
prix d’entrée est de plus en plus élevé, recueillent un public bavard, sans
aucune attention pour la musique, ignorant la présence de ses voisins
et les abreuvant de banalités téléphonés ou histoires insipides.
Digression faîte, retournons à cette rencontre inédite pour une première
tournée française. Si l’Argentin, Luc Salinas, est bien connu du public
sud-américain et des aficionados de la guitare, il reste à découvrir en
France, malgré un album sur le label Dreyfus. Sylvain Luc a fait le bon
choix et s’est entouré d’amis fidèles avec André Ceccarelli (maintes
fois son partenaire) et Remi Vignolo qui faisait à cette occasion son
retour à la contrebasse après l’avoir délaissée plusieurs années pour la
batterie. Cette belle équipe a alterné solos, duos et quartet dans un
répertoire qui puise plus dans la chanson populaire que dans les
standards de jazz. D’inspiration mondiale, on passera de «You Are the
Sunshine of My Life» de Stevie Wonder à «Estate» de Bruno Martino
sacralisé par João Gilberto, Chet Baker ou Michel Petrucciani, en
passant par «Someday My Prince Will Come». Un répertoire grand public
entrecoupé de solos de maestria; on peut regretter un manque de
profondeur dans les formules de ces rencontres d’été mais, pour ce
groupe, la technique et l’inspiration pallient à cette impression. Pour
le rappel, face à une audience très satisfaite, le jeune Juan Salinas,
digne fils de son père, est venu compléter ce quartet pour une brève
joute amicale s’inspirant du flamenco revisité jazz.

21 juillet, Robin McKelle. Autre
Place historique dans l’histoire du festival, la dénommée, Martin
Bidouré, où la scène est installée devant le parvis d’une église qui
illumine le soir, comme aurait dit Claude Nougaro. Robin McKelle démarre
un show réglé à la perfection, servi pas des musiciens bien rodés. Elle
interprète quasiment les titres de son dernier album The Looking Glass dont
elle a signé la totalité des compositions. Depuis son premier album
consacré au jazz et ses concerts accompagnés par un big band, Robin Mc
Kelle a choisi un voie nettement plus soul, voire country rock. Très
inspirée a ses débuts par Ella Fitzgerald, elle penche aujourd’hui vers
les reines de la soul comme Gladys Knight qu’elle cite souvent comme une
de ses références, et dont elle reprendra un hit pour le rappel. Alternant tempos rapides et ballades, elle séduit un
public qui se lève à chaque demande, et qui l’applaudit chaleureusement.
Présente à Paris pour un concert le soir des attentats de novembre 2015
et suite à celui de Nice, elle remercie le public d’avoir le courage de
venir aux concerts, de résister, puis rend hommage aux victimes dans un
solo vocal-piano très sombre et élégant, dédié aussi à Prince. Derniers
roulements de tambour en deux titres funky avant de quitter la scène et
de re-saluer ses fidèles musiciens et le public très nombreux. Mentions
spéciales à Jake Sherman (p, fender, org HB3) et à Eli Menezes (g)
renforcés d’une rythmique efficace, Matt Brandau (b) et Adam Jackson
(dm).
23 juillet. Bill Evans (saxophones, fender rhodes), Darryl Jones (b), Keith Carlock (b), Dean Brown (g), Plages du Mourillon. Juste
quelques jours avant le début de la tournée européenne qui démarrait
par Toulon, Mike Stern s’est fait renversé par une voiture et a dû
annuler sa participation au groupe. Bill Evans a donc fait appel au
guitariste Dean Brown, fidèle compagnon de route, qui a déjà fait parti
de ses groupes antérieurs. Tâche pas si ardue pour Dean Brown qui n’est pas le premier venu, car il joué et enregistré aux côtés de Marcus
Miller, The Brecker Brothers, Billy Cobham, David Sanborn, Bob James,
George Duke, Roberta Flack ou Joe Zawinul, et qui dirige son propre
quartet. Cette véritable machine de guerre avec Darryl Jones (Miles
Davis, Rolling Stones) et Keith Carlock (Sting, Steely Dan, Diana
Ross, Mike Stern) était prête à dompter un ciel plus que menaçant et
chasser au loin les nuages. Programme presque habituel depuis des années
pour Bill Evans qui pratique, au delà de sa fusion, un style très
proche du funk et du bluegrass. Dans son dernier album en leader Rise Above il a même fait appel aux musiciens très country blues du dernier Allman Brothers Band.
Sans
surprise véritable, le groupe trouve ses marques et assènent sa
puissance rythmique dévastatrice et balaie toute hésitation. Pour la
soirée du festival qui rassemble le plus de monde, le long des plages du
Mourillon, le choix était parfait; touristes et amateurs ont répondu
présents et sont repartis satisfaits et repus de son. Au contraire des
différentes places de dimension variable mais conviviales, le concert
sur le grand parking du Mourillon revêt souvent un caractère plus festif
et nécessite un renfort de sonorisation qui chaque fois est très bien
maîtrisé. Le choix de Bill Evans, qui a donné un concert sans
concession, peut sembler risqué, mais il n’en était rien: qualité et
populaire ont fait une excellente alchimie. Même si la musique de Bill
Evans au fil des albums et des concerts se ressemble, elle a le mérite
d’être très bien interprétée par un vrai groupe quasi permanent,
l’exception (Mike Stern) ce soir-là confirma la règle.

24 juillet, Olivier Ker Ourio Quartet «Oversea». La
petite place Monseigneur Deydier, dans le Mourillon Village, était
parfaite pour accueillir le coup de cœur du festival, hélas les patients
spectateurs sous leur parapluie n’auront pas eu le plaisir d’écouter ce
groupe original. Après l’attente de l’accalmie, qui n’est pas venue,
c’est finalement la météo marine qui a été la plus forte et le concert a
dû être annulé. Mathias Allemane, l’original de l’étape, avait roulé
700 kilomètres pour célébrer cette fête à la grenouille.
Jazz à
Toulon s'est poursuivi avec le report des concerts prévus du 15 au 18
juillet, mais nous n’y étions plus. Une bonne édition comme toujours,
malgré des circonstances très lourdes. Un baptême difficile mais réunssi
pour la nouvelle présidente de jazz à Toulon, Bernadette Guelfucci (une
ancienne de l'équipe qui a succédé à Daniel Michel), à qui nous
souhaitons beaucoup de prochaines éditions dans une atmosphère plus
légère.
Michel Antonelli
Photos Ellen Bertet et Michel Antonelli
© Jazz Hot n° 677, automne 2016
|
Toucy, Yonne
Toucy Jazz Festival, 15-16 juillet 2016
Le
Toucy Jazz Festival est né en 2008 sous l’impulsion de Ricky Ford et de
son épouse Dominique. Ce saxophoniste américain installé en Bourgogne,
qui a joué entre autres avec le Duke Ellington Orchestra et Charles
Mingus, organise, chaque année dans cette petite ville de la Puisaye,
une véritable fête du jazz. Après une édition 2015 circonscrite pour
l’essentiel à l'église toucycoise, principalement pour des raisons
économiques, le Toucy Jazz Festival profite d’une météo ensoleillée et
renoue avec les concerts de plein air dans le parc de la Glaudonnerie en
2016. Ces réjouissances se voient malheureusement entachées par
l’ignoble attentat de Nice, qui nous vaudra une minute de silence
pétrifiante et lourde de signification à l’entame de la manifestation,
chacun ayant sans doute alors en tête le rêve de fraternité et de paix
porté par le jazz, avant que Ricky Ford ne puisse officiellement ouvrir
le festival en ce vendredi 15 juillet 2016.
La vie reprenant ses
droits coûte que coûte, force est de constater qu’une volonté
d’ouverture caractérise cette édition, marquée par la présence de deux
formations clairement liées au patrimoine musical africain. L’une des
têtes d’affiche de ces 15-16 juillet 2016 est en effet Manu Dibango,
figure emblématique de la World Music, et Ricky Ford prendra à son heure
la tête de son quartet African Connection pour cette édition particulière, qui, circonstances obligent, comporte un fort relent de «life goes on».
Pour
débuter, un groupe béninois du nom de Eyo’N, le Brass Band, prend place
sur la petite scène du belvédère pour une session haute en couleurs.
Tentant le grand écart entre musiques issues du golfe de Guinée et
répertoire de la chanson française, ils égayent les esprits au moyen de
relectures très fun du «Poinçonneur des Lilas» de Gainsbourg, et du
«Temps ne fait rien à l’affaire» de Brassens. Le nom du groupe a pour
signification «Réjouissez-vous», et l’aspect fanfare clairement assumé
fait voisiner des aspects urbains façon Tambours du Bronx avec
l’esthétique steel drums du folklore caribéen, un positionnement
parfaitement illustré par leur récente tournée avec les Ogres de
Barback. Une joie de jouer contagieuse et jamais prise en défaut les
anime.

Manu
Dibango est le saxophoniste camerounais emblématique par excellence.
Promoteur d’une esthétique dont l’ambition est de restituer à la
musique afro-américaine ses origines africaines, il nous propose ce
soir un concept très métissé, Africadelic, un nom qui fait immédiatement
penser à ce que George Clinton et Bootsy Collins réalisaient sous la
bannière de Funkadelic, en même temps qu’une tentative d’ancrer le jazz
dans un certain œcuménisme. Née dans les années 70, la "World Music
s’incarne notamment dans le makossa camerounais, et évolue depuis lors
dans un territoire ondoyant qui unit certaines des composantes de la
soul, du jazz et du rythm'n blues au sein d’un même creuset.
Lors des
balances, Manu Dibango vient tancer ses jeunes et fougueux musiciens en
modérant des ardeurs jugées préjudiciables à la simple écoute de la
musique. Ce concert fédérateur eut le mérite d’attirer plus de public
que les sièges du parc ne pouvaient en accueillir. Cette affiche
hétéroclite ayant vocation à fédérer bien au-delà du seul public jazz,
Dominique Ford escomptait au moins 400 personnes, et de ce point de vue,
ce premier concert en tête d’affiche de l’édition 2016 est une totale
réussite.
L’artiste annonce d’emblée la couleur en parlant
d’un «safari musical»au public pour évoquer le défrichage de terres
exotiques en forme d’afro-jazz funk auquel il s’adonne ce soir. Notes de
guitare saturée, pédale wah-wah, orgue Hammond ou sonorités de Fender
Rhodes, le paysage instrumental fait penser au travail de Dominic
Miller, David Sancious ou encore Branford Marsalis.
Tout au long du
concert, on songe aussi tour à tour à l’univers musical de Youssou
N’Dour, Salif Keita ou Papa Wemba, à Angélique Kidjo, Peter Gabriel, et
Manu Katché, notamment au travers du superbe travail vocal des
choristes, omniprésents tout au long du concert. Les musiciens ne
bougent quasiment pas de leur emplacement initial sur la scène. Ce parti
pris, qui sert le charisme du leader, prive parfois ses musiciens d’une
mise en valeur méritée sur scène lorsqu’ils exécutent une partie qui
les voit briller individuellement. C’est particulièrement le cas lors de
ce superbe hommage à l’Argentine et à la poétesse Alfonsina Storni
«Alfonsina y el mar», un moment qui nous rappelle que le jazz, à
l’instar de toute forme d’art authentique, a partie liée avec l’histoire
de la démocratie et la quête de l’égalité des droits.
L’usage de
syncopes permet au groupe de jouer du reggae avec naturel, en utilisant
des sonorités plus liquides pour ses cocottes funky. On note aussi
l’emploi de deux snare drums chez le batteur. La profondeur du saxophone
de Dibango est accentuée par l’utilisation d’une réverbération assez
prononcée. Dès que le leader se fait plus discret, on évolue très près
des terres défrichées en leur temps par le Santana Band ou Jimi Hendrix,
alliant psychédélisme et influences latines sud-américaines greffées
sur les racines africaines de Manu Dibango.
C’est sans doute lors
d’un hommage chanté à son village natal que le leader se sera le plus
éloigné de l’idiome jazz ce soir. Comme à l’accoutumée, le set de
Dibango se clôt sur une interprétation endiablée de «Soul Makossa»,
titre pourtant destiné à constituer une face B de single en 1972, et qui
est depuis devenu le plus grand succès de l’artiste. C’est le moment
que choisit Ricky Ford pour rejoindre une première fois la scène du
Toucy Jazz Festival, en s’adonnant avec une vigueur et une joie de jouer
communicative à l’une de ces jams qui marquent les esprits. Le concert
se termine par un ultime rappel sous forme d’hommage à Sidney Bechet et à
La Nouvelle-Orléans, lors d’une émouvante et magnifique improvisation
solo de Manu Dibango autour du thème de «Petite Fleur» sous le clair de
lune de Toucy. L’image du saxophoniste seul sur scène avec au-dessus de
lui le disque de la lune constitue l’une des images fortes d’un week-end
qui n’en a d’ailleurs pas manqué. Un instant magique qui nous ramène
dans ce qui fut l’aurore du world jazz.
Après cette fête de
tous les sens, la Vandoren Jam Session accueille Clément Prioul à
l’orgue et Baptiste Castets à la batterie. Ensemble, ils vont rendre
hommage à Jimmy Smith et Larry Young, deux figures mythiques de l’orgue
Hammond, en plusieurs occurrences tout au long du week-end. On peut
ressentir l’exercice comme plutôt scolaire dans l’ensemble, mais la
sincérité évidente de l’interprétation de même que la fidélité absolue
manifestée envers l’œuvre de Jimmy Smith achève ce soir de convaincre
ceux des membres du public qui n’ont pas quitté immédiatement les lieux
après le concert de Manu Dibango. Clément Prioul nous confiera le
lendemain utiliser un authentique Cabin Leslie pour recréer le son
tournoyant caractéristique de l’orgue Hammond B3 (il nous cite aussi
deux musiciens rock, qui comptent certainement parmi ses influences
personnelles, comme ayant particulièrement popularisé l’instrument
auprès des mélomanes, Jon Lord et Keith Emerson). L’absence de bassiste
est totalement dans l’esprit des œuvres de Jimmy Smith, même si
l’obligation de recréer les lignes de basse à la main gauche limite
vraisemblablement l’audace harmonique des lignes mélodiques jouées par
la main droite. L’aspect par trop percutant de la batterie Pearl est
nuancé par l’usage de baguettes et de balais en fonction des titres
interprétés. Fred Burgazzi, un tromboniste qui rend régulièrement
hommage au swing traditionnel avec Ricky Ford au sein de Ze Big Band en
Bretagne, s’adjoindra le lendemain au duo lors du festival off.

Le
samedi 16 juillet, ce sont plusieurs sessions off organisées toute la
journée au cœur de la Ville qui retiennent notre attention.
Concomitantes du grand marché de Toucy, les prestations matinales de
Bobby Few et Clément Prioul ont lieu dans un climat d’agitation qui a
peu à voir avec l’ambiance des clubs new-yorkais. Bobby Few est
désormais un habitué du festival de Toucy où le retiennent ses attaches
amicales avec Ricky et Dominique Ford. Cette année, il nous propose deux
mini-concerts en solo au sein même de la Galerie14, lieu où Dominique
organise des expositions d’art. C’est donc dans un contexte plus
intimiste et sous des toiles colorées que la légende de Cleveland
interprète deux sets dans la même journée. La première prestation revêt
des apprêts d’une grande simplicité, eu égard au contexte précité et à
l’heure sans doute fort matinale pour un musicien de jazz. La seconde,
en revanche, constituera l’un des moments forts du festival, au moment
où une certaine torpeur s’est emparée de Toucy après le marché et
l’heure du repas. Bobby est manifestement fébrile avant de commencer son
set, le trac étreint donc jusqu’aux plus grands et expérimentés des
musiciens. Après quelques notes égrenées sans conviction particulière,
une sorte de mise en train destinée à conjurer l’angoisse liminaire, les
hommages aux grandes figures du jazz défilent. C’est à un véritable
voyage dans le temps et l’histoire du jazz que Bobby nous convie en
cette après-midi radieuse. Miles Davis, Thelonious Monk, Gershwin ou une
fantaisie en La mineur qui ressuscite l’esprit de Scott Joplin
émaillent une prestation à la fois intimiste et puissante, qui attire
l’attention de passants pas spécialement présents pour assister à un
concert de jazz en cette heure normalement plus propice à la sieste. La
performance comporte un aspect expressionniste. D’un chaos de formes
digne du chef-d’œuvre inconnu de Balzac émergent des accords, des
harmonies qui prennent forme devant nous comme le feraient les avatars
perçus au sein d’une toile pointilliste. L’émotion s’empare de
l’assistance, et des larmes roulent sous les paupières tandis que
l’artiste finit son set.
Le samedi soir retour au in avec
African Connection, Ricky Ford nous offre un succédané de ses plus
récentes expériences musicales, animées d’un désir de concilier un
certain avant-gardisme avec l’héritage du blues et du jazz
traditionnels. Composé de Raymond Doumbe (b), de Steve McCraven (dm) et
d'Alex Legrand (g), le quartet de Ricky Ford se distingue d’emblée par
la vigueur d’ensemble qui l’anime. Les différents titres sont annoncés
par le leader sous forme de numéros. Une démarche originale qui a le
mérite d’évoquer de prime abord l’aspect fortement structuré des
prestations du combo. La Gibson ES 335 du guitariste introduit des notes
chaleureuses et sensuelles dans la structure même des morceaux
interprétés, combinées avec des accents plus lyriques lors des parties
en solo. Le timbre de Ricky Ford et la conviction qui empreint chacune
de ses interventions sont les deux choses qui frappent immédiatement
l’esprit lorsqu’il s’empare de son instrument. Plus proche en cela de
Coleman Hawkins que de Lester Young, il détache les notes les unes des
autres, ne recourant au phrasé legato que pour des motifs ornementaux.
Avant le concert, Alex Legrand nous confiait combien il se sentait
honoré de jouer avec une légende comme Ricky Ford, insistant sur la
beauté du timbre de son saxophone et sur la source d’inspiration qu’il
représente pour les jeunes musiciens de jazz. Entrecoupé de commentaires
très personnels du leader, les titres s’enchainent rapidement et
semblent animés d’une rigueur presque mathématique. Le numéro quatre
aurait été composé en à peine une demi-heure et comporte quelques
syncopes hybrides sur des figures binaires. Le numéro 5 est dédié à
Charlie Mingus et semble une sorte d’adultération d’un thème de John
Coltrane. Le final fait penser aux excès en vigueur dans la musique
contemporaine, dans une ambiance très jazz fusion à la Weather Report.

C’est
maintenant l’heure du Kirk Lightsey Quartet qui célèbre le bebop de
Charlie Parker et Dexter Gordon. Il s’agit là de la formation la plus
jazz, au sens le plus traditionnel du terme, parmi toutes celles
présentes sur l’affiche. De ce point de vue, la foule d’admirateurs
présents semble à la fois bien moins nombreuse et plus «parisienne» que
celle présente pour le concert de Manu Dibango (200 personnes tout au
plus, à rapprocher des 600 annoncées par Dominique Ford la veille). Ce
clivage illustre la complexité des choix qui s’offrent aux organisateurs
de festivals contemporains, partagés entre fidélité à un héritage
immémorial et devoir de viabilité financière. Ricky Ford nous a confié
l’après-midi espérer un maximum de suffrages pour ce concert vedette, et
on comprend implicitement qu’il tente de concilier l’aspect musical
aventureux des formations auxquelles il s’associe et les préoccupations
commerciales qui en assurent la visibilité.
Les principales
influences de Lightsey sont ses «professeurs» de piano Hank Jones et
Tommy Flanagan. Il revendique également la filiation de Bud Powell et
d’Art Tatum, Son intérêt réitéré pour les chanteurs nous vaut ce soir la
présence de Fred Tuxx pour sa première au festival de Toucy. Il nous
demande d’ailleurs de faire en sorte qu’il se sente le bienvenu parmi
nous, avec un humour qui ne se démentira pas au cours de ce très long
set vespéral. De par le classicisme évident de la prestation, on songe à
l’influence des collaborations du leader avec des orchestres de musique
classique. Avec en tête la figure tutélaire de Dexter Gordon, Lightsey
essaie d’ouvrir le jazz à un plus large public, tout en rendant hommage
aux grands artistes qui lui donnèrent envie de faire de la scène. De ce
point de vue, on peut dire qu’il remplit la mission qu’il s’est assignée
avec une grande classe, tant l’élégance de ses traits mélodiques et
l’inspiration constante dont il fait preuve ravissent l’esprit de
l’amateur de jazz le plus exigeant ce soir. Jouant sur un piano de
location, Lightsey nous offre une introduction purement acoustique de
toute beauté, dans la brume de laquelle on jurerait voir se dégager une
ambiance urbaine digne des plus grandes métropoles. Un Sangora Everett
sobre (dm) confère une assise solide à l’ensemble. Son drumming subtil
et peu démonstratif développe un jeu de cymbales parmi les plus fins qui
soient, jouant au fond du temps, bien calé sur Thibaud Soulas (b) qui
anime le set de sa vigueur et de sa précision rythmique. Au fil de
l’écoute, on comprend que le travail presque primal du contrebassiste
est destiné à offrir un contrepoint esthétique à la sophistication
harmonique du leader. L’apport de Fred Tuxx, quant à lui, relève
davantage de la tradition du music-hall et de Broadway. La prestation
atteint son apogée sur le classique «All or Nothing at All», sur lequel
Fred Tuxx approche le niveau des meilleurs crooners, avec un timbre de
voix similaire à celui d’Al Jarreau. On se serait peut-être passé de
quelques rires et jeux de scène un peu forcés du chanteur, mais c’est
déjà la fin du festival et pour conclure cette très belle édition, qui
dédaignera une nouvelle jam avec notre hôte Ricky Ford dont les
admirateurs scandent le nom lors du rappel ? Pas nous en tout cas, car
celle-ci atteint un niveau de complicité combiné à une folle envie de
jouer qui font oublier l’horreur des faits de terrorisme qui endeuillent
le monde aujourd’hui. «La beauté sera convulsive ou ne sera pas». Un
bien beau moment de musique, d’art et de partage.
Jean-Pierre Alenda
Photos Patrick Martineau
© Jazz Hot n° 677, automne 2016
|
Vitoria, Espagne
Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz, 12-16 juillet 2016
Le mardi 12 juillet a démarré au Théâtre Principal la 40e édition du Festival de Jazz de Vitoria avec le contrebassiste Pablo
Martín Caminero et le saxophoniste Américain Chris Cheek. Pour une
nouvelle édition de la proposition «Konexioa» (connexion), ces deux
musiciens, accompagnés par Albert Sanz (p) et Borja Barrueta (dm), ont
entremêlé les styles, de la «Soleá de Gasteiz», de Martín Caminero, au
«Panels» de Cheek– avec sagesse et bon goût. Les jours suivants, la même
scène a accueilli les concerts du guitariste valencien Ximo Tebar, le
trio GoGo Penguin, le pianiste Yaron Herman et le saxophoniste Rudresh
Mahanthappa, qui présentait son projet plebiscité «Bird Calls».
Revenons
sur la première journée, le 12, dans le Complexe omnisports de
Mendizorroza: le gospel était au programme, comme d’habitude, à cette
occasion-là sous la férule de Bryant Jones & The Victory Singers.
Malgré la qualité des voix, cette sorte de format et ces répertoires se
répètent excessivement.

Le mercredi 13 juillet, Mendizorroza a dédié sa programmation au blues.
Au
premier set, Ruthie Foster a débuté son concert avec «Singing the
Blues». Les réminiscences de la southern music américaine ont établi le
point de départ de quelque chose qui est allée au-delà du blues.
Elle-même l’avait dit: «du gospel, du blues, de la soul et un peu de
reggae». Accompagnée par Larry Fulcher (b, 5 cordes), Samantha Banks
(dm) et Hadden Sayers (g), Foster a parcouru tous les chemins annoncés.
Au
deuxième set, Taj Mahal a aussi proposé au public un voyage qui allait
dès bayous de La Louisiane jusqu'aux abords africains. «Good Morning
Little Schoolgirl», «Corrina, Corrina», «Fishin’ Blues» et «C.C. Rider»,
parmi d’autres, ont émergé de la voix, des cordes ou des touches des
différents instruments dont s’est servi Taj Mahal pour une grande soirée
mémorable.

La
nuit du 14, le jazz est revenu en force au Complexe omnisports grâce à
la double performance de Tom Harrell (tp, flh), et de Joshua Redman (ts,
ss) à la tête de leur quartet respectif.
Voir et écouter
Harrell, c’est une expérience, tenir un fil qui semble pouvoir se briser
à tout moment. Ses silences sont mortels et perturbants, mais, quand il
embouche la trompette ou le bugle, tout semble coller et s’écouler en
altitude. Accompagné par Ralph Moore (ts), Okegwo (bs) et Adam Cruz
(dm), Harrell a égrené «Adventures of a Quixotic Character», «Sunday» ou
«Shuffle»… Un moment moment tenu en haleine le public, c’est
l'interprétation d'un «Body and Soul» mémorable, où Tom Harrell n’a
bénéficié que du soutien d’Ugonna Okegwo.

Après
lui, Joshua Redman a présenté son nouveau projet avec Kevin Hays (p),
Joe Sanders (b) et Jorge Rosy (dm). Le répertoire, qui recueillait des
compositions des quatre membres du quartet, a permis d’écouter des
magistraux jeux de dynamiques ou des déroulements de solos passionnants,
dans une proposition d’un haut niveau musical. Reste à savoir si
l’actuelle veine lyrique de Redman, de grande qualité, va faire
disparaître ou pas ses déchaînements hardbop d’il y a vingt-deux ans …

Le
vendredi 15 juillet, Mendizorroza a présenté deux concerts
diamétralement opposés par l’esprit: Kenny Barron et Dave Holland au
premier set et Jamie Cullum au deuxième.
Avec des morceaux
comme «Pass It On» ou «Waltz for Wheeler», Barron (p) et Holland (b) ont
recréé la magie du jazz. Ils ont joué une musique élégante qui ne
s'appuyait pas sur la virtuosité mais sur un savoir-faire ancré dans
leur énorme capacité de création artistique. L’intensité se
démultipliait dans leurs échanges, à l’image de leur enregistrement The Art of Conversation.
«Rain» et «Seascape» de Barron, «Segment» de Charlie Parker, ou «In
Walked Bud» de Thelonious Monk en fin de concert ont trouvé sur la scène
une nouvelle dimension.
A propos de Jamie Cullum, on
ne peut rien dire de plus que dans les précédentes chroniques: Cullum
lui-même reconnaît, dans une interview récente, qu'il n’est pas un
pianiste de jazz. Ses concerts sont un show où domine le spectacle
par-dessus tout (les sauts du haut du piano, les courses d’un bout à
l’autre de la scène, les coups de cymbales à tout bout de champ…) Un
standard de jazz et le bis où il a joué la chanson de Kyle
Eastwood «Grand Torino» (musique du film) ont été les seuls moments
d’originalité. Il a massacré indifféremment «Wind Cries Mary» de Jimi
Hendrix et «Love for Sale» de Cole Porter, mieux vaut ne pas s’en
souvenir…

Le samedi 16 juillet, Pat Metheny et Ron Carter, puis Cécile McLorin Salvant ont mis le point final au 40e Anniversaire du Festival de Jazz de Vitoria.
Il
est difficile de ne pas établir de parallèle entre ce duo avec Carter
et celui que Metheny a fait avec Charlie Haden il y a quelques années.
Et non parce que Ron Carter n’a pas été à la hauteur, mais par
l'attitude quelque peu erratique du guitariste. Cette année, nous
n'avons pas trouvé la complicité et le feeling qu’il avait entretenu
avec Haden dans le disque Beyond the Missouri Skyes, au concert
de 2009 sur la même scène, ou encore au Jazzaldia de San-Sebastian en
2001. Le concert a pris quelque peu corps dans «Manhá de Carnaval» ou
«Saint Thomas», mais le concert durant, les moments beaucoup trop plats
ont foisonné, ternes malgré les efforts de Ron Carter, auteur du
meilleur chorus de la nuit, entremêlant avec un goût exquis une fugue de
Bach et la très populaire chanson «You Are My Sunshine».
Pour
la seconde partie, Aaron Diehl (p), Paul Sikivie (b) et Lawrence
Leathers (dm), ont introduit la jeune Dame du jazz, Cécile McLorin
Salvant. Cécile est, avant tout, une voix miraculeuse! En dehors de
l’opéra contemporain de Kurt Weill et Langston Hughes («Somehow I Never
Could Believe») ou du plus classique «Devil May Care», son set a repris
«What a Little Moonlight Can Do», «Wild Women Don't Have the Blues»,
«Wives and Lovers» de Burt Bacharach au programme dans son récent
disque. Son concert a été intense et d’une extraordinaire générosité
avec ses musiciens auxquels elle a laissé des chorus en toute liberté,
notamment au formidable Aaron Diehl. Comme touche finale, Cécile a
chanté en espagnol «Alfonsina y el mar», coupant le souffle à un public
par ailleurs déjà totalement fasciné.
Lauri Fernández et Jose Horna
photos © Jose Horna
© Jazz Hot n° 677, automne 2016
|

Iseo, Italie
Iseo Jazz/La Casa del jazz italiano, 10-17 juillet 2016

Iseo
est une petite ville pittoresque de Lombardie dans la province de
Brescia, située sur les bords du lac homonyme dans un écrin naturel de
grande beauté, à quelques kilomètres au nord de la Franciacorta, région
renommée pour ses excellents vins. Depuis 24 ans, Iseo abrite un
festival qui, sous l‘appellation «La casa del jazz italiano» se focalise
sur une programmation bien précise: réserver de l’espace aux musiciens
italiens, illustrant la scène nationale dans son ampleur et privilégiant
par dessus tout de vrais projets et des productions originales. Une
chose qui ne compte pas pour rien, en considérant le peu d’attention que
prête la plupart des festivals aux jazzmen italiens.
La direction
artistique est confiée au musicologue Maurizio Franco enseignant aux
«Civici Corsi di Jazz della Civica Scuola di Musica» de Milan. En outre,
ce qui n’est pas du tout négligeable, la manifestation tient aussi
compte du rapport avec le territoire, répartissant quelques événements
dans d’autres localités bresciannes.
Dans
la cour du Palazzo Municipale di Palazzuolo sull’Oglio le quartet de
Roberto Rossi a présenté un projet expressément conçu pour le festival,
dédié à Clifford Brown, compositeur: loin des intentions philologiques
ou revivalistes, l’opération a mis en lumière la vitalité des matériaux
examinés. Le mérite en revient à l’ample vocabulaire bien maîtrisé du
tromboniste, grâce sa féconde interaction avec Giacomo Uncini (tp), un
jeune et brillant virtuose, et au solide support de Larco Vaggi (b) et
Tony Arco (dm).
Le trio de Stefano Battaglia a proposé le répertoire de In the Morning (ECM), disque basé sur les musiques d’Alec Wilder. Une analyse
brillante et profonde valorisée par le bagage culturel du pianiste et
par la dialectique empathique instaurée avec Salvatore Maiore (b) et
Roberto Dani (dm). C’est assurément un trio piano actuel des plus
intéressants pour l’audace harmonique et la recherche des timbres.
La
Villa Mazzotti de Chiari a constitué le décor pour un autre projet
spécial: la représentation en forme interdisciplinaire de «Such Sweet
Thunder» d’Ellington au moyen d’une des émanations du Civici Corsi di
Jazz, le workshop Big Band, dirigé par Luca Missiti, en collaboration
avec les acteurs et les danseurs sous la direction de Valentina
Mignogna.
L’Auditorium de Darfo a abrité une soirée
réservée à Gershwin. Ex-élève de Marco Fumo (parmi les meilleurs
spécialistes mondiaux du ragtime et des musiques afro-américaines
savantes), le pianiste Michele Di Toro a affronté des pages
contraignantes comme Rhapsody in Blue et Prelude n° 2, en plus de «Rialto Ripples» appartenant à la production de jeunesse de Gershwin. Dans la version piano de la Rhapsody in Blue,
plutôt rare, Di Toro a correctement marqué ces aspects rythmiques
souvent ignorés ou négligées dans beaucoup d’exécutions classiques, y
insérant aussi des parties improvisées –prévues du reste dans la version
originale du compositeur– avec un toucher limpide, cristallin, et
d’opportunes variations dynamiques. Il a également mis en valeur la
section d’inspiration afro-cubaine, introduite par des notes répétées,
et en exaltant l’utilisation des block-chords dans les passages
importants. Di Toro a interprété plus librement et avec bonheur le Prélude n°2»
en l’appréhendant avec une variation sur le thème de «Summertime»
carrément déstructuré, duquel il a successivement exploité quelques
fragments pour y imprégner la ligne thématique du prélude, énoncée par
étapes avec un grand sens du blues. Dans «Rialto Ripples», il a
reproposé le Gershwin amoureux du ragtime et du novelty, y incorporant
des figures de stride et quelques dissonances.

En
duo avec la chanteuse américaine Joyce Yuille, le pianiste Enrico Intra
(directeur du Civica Jazz Band) a proposé une étude avec son habituelle
finesse pour interpréter des standards majeurs de Gershwin :
«Embraceable You», moyennant sa pratique insolite de faire précéder le
thème avec le couplet «I Got Rhythm», vidé et dépouillé des approches
conventionnelles: «I’ve Got a Crush on You» caractérisé par d’efficaces
glissements des syllabes et des accents flûtés: «They Can’t Take That
Away From Me» riche de brefs rappels à James P. Johnson, Fats Waller,
Teddy Wilson et Erroll Garner. Dans la version en solo de «Summertime»
avec une introduction en ostinato lancinant, y entremêlant des fragments
du thème, d’abord savourés et puis enrichis par des ornementations,
revenant ensuite–avec des variations de thème et d’atmosphère– à une
forme de «Walking». Dotée d’un contralto puissant, Joyce nous a réservé
une version a cappella émouvante de «Motherless Child».
Tous
les autres concerts se sont déroulés à Iseo dans deux cadres
évocateurs: le côté sacré de l’église paroissiale romaine de Sant’Andrea
et le Lido di Sassabanek. La vocalité est réapparue sous des formes
diverses dans le duo Boris Savoldelli (voc) et Walter Beltrami (g),
musiciens de la région brescianne, mais également actif sur la scène
internationale. Avec le support de l’électronique, Salvoldelli et
Beltrami appliquent un traitement radical à de notables standards et de
vieilles chansons italiennes. Comme le démontrent le bouleversement de
«Caravan» grâce aux stratifications vocales obtenues avec un
échantillonneur; la tonalité désuète imprimée à «Giorgia on My Mind»; la
présentation étrange, quasi psychédélique, d’une chansonnette comme
«Pipo non lo sa»; le coupage rock appliqué à un classique comme «Ma
l’amore no». Fort d’une gamme caméléonique, Salvelli est un
expérimentateur curieux; de son côté, Beltrami joue son rôle de
guitariste moderne, maître d’un vocabulaire étendu.

A sa 30e année d’existence le quartet Enten Eller a confirmé les traits
distinctifs de sa poétique. On note une propension à dépouiller les
mélodies greffées sur des installations essentiellement modales et pour
des thèmes géométriques de goût vaguement «ornettien». Dans ce cadre,
trompette (Alberto Mandarini) et guitare (Maurizio Brunod) dessinent de
substantiels unissons, parfois avec le filtre de l’électronique. Même
dans les passages les plus informels, la rythmique jouit d’une ample
respiration en vertu des longs coups d’archet, des lignes pénétrantes et
des pédales puissantes de Giovanni Maier (b) et de la discrétion de
Massimo Barbiero (dm) dans l’utilisation de ces dynamiques et de ces
couleurs qui sont la marque de la philosophie du quartet.
Le
piano solo original d’Oscar Del Barba, un autre «local hero», nous a
réservé une très belle surprise. Son approche se sert des mouvements de
l’arrière plan européen cultivé, ce qui lui permet d’élaborer les
cellules des thèmes d’une structure dodécaphonique construisant des
formes polytonales et polyrythmiques avec la méthode de la
superposition. Son jeu de piano se trouve au confluent d’éléments
post-wéberniens et des influences de Tristano et Bley, spécialement dans
le jeu rythmique sur le registre grave. En outre, Del Barba fait la
preuve qu'il sait dialoguer efficacement avec le silence par
l’utilisation du staccato et des pauses.

Résidant
en France depuis longtemps, le contrebassiste Riccardo Del Fra a fourni
avec son quintet italo-français une grande preuve de cohésion et de
maîtrise interprétatives. Des éléments tangibles dans l’approche
critique et dans la coupe moderne appliquées à «But Not For Me» et «I’m
Old Fashioned», complètement revitalisés, ou bien un «Love For Sale»
transposé dans une implantation soul jazz ravivée à la teinte funk. Del
Fra interagit avantageusement avec Ariel Tessier (dm), tandis que
Maurizio Giammarco (ts, ss) et Francesco Lento (tp) en font autant: le
premier avec un langage transversal, riche d’intuitions, spécialement au
soprano; le second avec des phrases articulées, mais toujours méditées.
Bruno Ruder (p) fait preuve d’un style brillant, avec des traces
d’Herbie Hancock et McCoy Tyner. Le traitement réservé par Del Fra à
«I’m a Fool to Want You», dans un duo poétique avec Ruder, constitue un
sommet de rare expressivité: le contrebassiste exécute le thème en le
scandant méticuleusement, et puis «chante» littéralement dans la partie
improvisée.
Maria Pia De Vito (voc) et
Rita Marcotulli (p) peuvent se permettre d’affronter n’importe quel type
de matériau avec perspicacité critique et créativité fertile, en
maintenant dans un esprit inaltéré un langage rythmico-harmonique et
d’accent jazz. Les compositions de Marcotulli privilégient des figures
rythmiques articulées sur lesquelles De Vito s’aventure dans des
acrobaties dangereuses, en utilisant la voix à la manière d’un
instrument à vent ou à percussion, dans une dialectique serrée et
symbiotique. L’essence mélodique, propre à l’infrastructure du chanteur,
s’extériorise dans l’usage du napolitain, notamment dans «Voccuccia de
no pierzeco» (villanella du XVIe siècle) et dans
la traduction d’un texte de Borgès. Il pénètre ensuite dans des aires
disparates, se confrontant à la chanson d’auteur; c’est le cas de
«Rainbow Sleeves», écrite par Tom Waits pour Rickie Lee Jones. Le Prix
Iseo a été attribué à De Vito.

Enzo
Jannacci (Milan, 1935-2013) était l’un des chanteurs italiens les plus
géniaux, auteur de chansons surréalistes au goût doux-amer, riches de
trouvailles ingénieuses. A son actif, on peut aussi revendiquer des
expériences de jeunesse comme pianiste de jazz, accompagnateur de
musiciens américains de passage. Réuni par le clarinettiste Paolo
Tomolleri, l’Orchestra Jannacci est un sextette formé de musiciens qui
avaient collaboré avec l’auteur-chanteur milanais: Marco Brioschi (tp),
Paolo Brioschi (p), Sergio Farina (g), Piero Orsini (b) et Flaviano
Cuffari (dm). Ciao Enzo in jazz est un projet spécial du festival, dédié affectueusement à l’ami disparu, composé des versions des chansons («L’Armando», «Il tassì», «Vincenzina», «Veronica», «El portava il scarp del tennis»)
déjà prévues harmoniquement à une réélaboration jazz. Un savoureux
mainstream riche de swing, un rappel au dixieland, et une substantielle
pointe de bossa.

Le
festival d’Iseo prend donc en grande considération les multiples
aspects de l’actualité nationale, cherchant à affirmer une identité
commune à travers une empreinte fortement en rapport avec un projet. Arrivederci en 2017 pour le 25e anniversaire.
Enzo Boddi
Traduction Serge Baudot
Photos X by courtesy of Iseo Jazz
© Jazz Hot n° 677, automne 2016
|


Pescara, Italie
Pescara Jazz, 8-10 juillet 2016
Malgré les problèmes qui en phase de préparation avaient semblé quasiment compromettre sa réalisation, la 44e édition de Pescara Jazz a offert un programme varié et de bon niveau, suivi comme toujours par un public fidèle et nombreux.
Avec
l’E-Collective, Terence Blanchard s’empare de la tendance, propre à de
nombreux représentants du jazz afro-américain, à interpréter les
différents segments de la black music actuelle et de les traduire en
stimuli pour leurs propres créations. La conception de Blanchard est
aussi alimentée par un souffle socio-politique. Une grande partie de la
jeune population afro-américaine a orienté ses préférences vers le hip
hop, le rap, le drum’n’bass, le jungle, tout comme leurs parents ou
grands-parents avaient une prédilection pour le rhythm and blues, la
soul et le funk. Blanchard cherche à donner une même dignité à tous ces
genres pour montrer leur plein droit d’appartenir à l’univers
afro-américain. Avec des hauts et des bas, malgré tout, il poursuit une
opération intellectuellement honnête, intégrant l’électronique dans la
palette sonore. La programmation par ordinateur est utilisée pour
insérer de courts extraits de récitatif avec des connotations précises
de protestation sociale et de références aux tensions récentes («I Can’t
Breathe»). Le parcours touche à différents territoires: des allusions
au Davis électrique, des rythmiques funk et jungle, des crachements
mélodiques à la Michael Jackson, des riffs rock. La seule limite est
dans le filtrage constant du son de la trompette qui rend le phrasé
irritant, presque guitaristique, mais aussi terriblement uniforme.
Le grave accident de Mike Stern à trois jours du départ pour la tournée européenne a contraint Bill Evans à
le remplacer par un habitué des tournées, Dean Brown, bouleversant
ainsi le répertoire. Point fort du groupe, l’inébranlable couple
rythmique, Dennis Chambers (dm)-Darryl Jones (b). Ce dernier, très
jeune encore, fut membre, comme Evans, du groupe de Miles Davis. Depuis
longtemps, Evans poursuit avec ses groupes la mise au point d’un mélange
entre jazz, R&B, funk et rock. Certes, c‘est une opération qui
n’est pas sans arrières pensées commerciales, conduite en leur temps par
David Sanborn et les Brecker Brothers, et définie tout simplement comme
musique populaire. On saisit dans le phrasé et les inflexions du ténor
le son d’une lointaine connexion coltranienne, en affinité avec le
regretté Bob Berg et de nets rappels du R&B. La matrice de Wayne
Shorter apparaît au soprano dans une version efficace de «Jean-Pierre»
de Miles Davis. Dean Brown s’est inséré dans ce contexte avec une
variété de solutions de timbres, une syntaxe plus proche du rock et un
phrasé saccadé, corrosif, teinté de nuances hendrixiennes.

A
74 ans, Jack DeJohnette ne se repose certes pas sur ses lauriers. Le
trio constitué avec Ravi Coltrane et Matthew Garrison (documenté par In Movement)
témoigne d’une poussée constante vers l’exploration de nouvelles
conceptions et de modalités d'exécution. Il prend son envol, souvent à
égalité avec des interactions alimentées et soutenues par le batteur,
qui atteint des sommets de grande expressivité même dans les passages
informels sur tempo libre. La gamme des timbres s’enrichit de l’éventail
des solutions choisies mijotées par Garrison aussi bien à la basse
électrique qu’avec des inserts électroniques pilotés à travers le
pédalier et l'ordinateur. Avec des pédales denses, dans un domaine
essentiellement modal, et de sèches lignes mélodiques qui par traits
évoquent la figure du père, il intègre le jeu polyrythmique et les
démontages de DeJohnette. Coltrane a désormais acquis sa propre
identité, qui au ténor l’éloigne résolument des comparaisons
inconfortables avec le père, tandis qu’au soprano et surtout au
sopranino il construit des parcours frétillants, asymétriques et à
traits abrasifs, contrastant violemment avec le flux rythmique. Quand le
trio affronte «Alabama», affleure inévitablement l’esprit des pères,
Coltrane et Garrison, mais la montée en tension trace une nette et
opportune distinction par rapport à l’original.
Ceux
qui s’attendaient à un kaléidoscope de latin jazz crépitant avec le
sextet d’Arturo Sandoval seront restés partiellement déçus. Surtout dans
la première partie du concert où le trompettiste cubain s’est étendu
sur une manière entertainment, s’adonnant aux timbales et au chant. Un
processus d’américanisation, interprété comme façon de concevoir la
performance, plutôt tape-à-l’œil et un peu kitsch, avec des greffes
vocales qui s’étendent d’un improbable crooning à un scat emprunté au
maître Gillespie. Evidemment, quand il embouche la trompette, Sandoval
est encore un formidable virtuose capable de monter dans les aigus et
les suraigus avec une enviable netteté. Quand il s’identifie avec les
racines puisant dans le patrimoine afro-cubain, il exploite les
possibilités du groupe avec ces stratifications polyrythmiques, qui,
partant de la superposition classique clave et montuno, ont donné la
rumba, le mambo et la salsa. Appliquant cette formule à «A Night in
Tunisia» et surtout à «Seven Steps to Heaven», le groupe a obtenu des
résultats encore plus efficaces.

Le
trio bien établi, Carla Bley-Steve Swallow-Andy Sheppard, a
indubitablement recueilli l’héritage, et développé les intuitions des
formations nées dans le sillage des innovations de Lennie Tristano: en
premier lieu le trio de Jimmy Giuffre, dont le bassiste a longtemps été
membre. Encore plus que dans un passé récent, le trio applique aux
compositions de la pianiste un soin maniaque pour le son, les timbres et
la dynamique, traduit en phrases ciselées avec un raffinement
méticuleux. L’attention à la page écrite n’entame pas le processus
créatif, ni ne porte préjudice aux espaces pour l’improvisation. De
temps à autres, un goût pour le contrepoint moderne émerge, source
d’efficaces entrelacements à travers les voix instrumentales. L’apport
du piano est dépouillé, fréquemment basé sur l’usage du staccato. Comme
à l’accoutumée, Swallow déroule une double fonction rythmico-mélodique
avec ses lignes riches carrément guitaristiques. Sheppard, surtout au
ténor, développe ses phrases sur la pointe des pieds, avec une sorte de
souffle vital qui semble avoir de lointaines racines dans Lester Young
et une référence évidente à Wayne Marsh. Dans l’unique morceau qui ne
soit pas un original, «Misterioso», l’arrangement de Carla Bley prévoit
une intro’ et une coda quasi classiques et opposées aux cellules du
thème, tandis que les développements ramènent avec force à la lumière
l’essence du blues de l’écriture de Monk.

Dans le sillage de Upward Spiral,
Branford Marsalis a inséré solidement Kurt Elling dans son quartet,
dans le but de disposer -plus que d’un chanteur– d’un alter ego avec qui
inter-réagir. Le vocaliste de Chicago possède un sens inné de la scène,
une maîtrise des ressources et du matériel explorés. Il affronte avec
un swing décontracté «There’s a Boat Dat’s Leavin’ Soon for New York»
(de Porgy and Bess), module avec adresse les pauses et les
inflexions des vers de la ballade «Blue Gardenia» de Nat King Cole,
traite avec un ton rythmique incisif «Só tinha de ser com você» de
Jobim. Il est en outre doté d’une diction claire, d’une articulation
fluide pour le scat et d’une capacité remarquable de sauter d’un
registre à l’autre. Les caractéristiques des originaux sont encore plus
évidentes, d’où émergent l’habileté narrative et un processus accompli
d’identification avec le texte. Le quartet bien rôdé bénéficie de la
propulsion massive de Eric Revis (b) et Justin Faulkner (dm), et de
l’ample soutien harmonique de Calderazzo (p), également protagoniste de
quelques apparitions en solo qui exploraient les implications des
morceaux. Que ce soit au ténor ou au soprano, Marsalis renonce à la
virtuosité, en faveur de constructions calibrées. L’intense duo avec
Elling, sur la base d’appels et réponses, sur «I’m a Fool to Want You»
exprime la profonde conscience de la tradition et produit un sommet
expressif au grand impact émotionnel.
On ne peut que souhaiter longue vie à Pescara Jazz, en dépit des difficultés affrontées ces années dernières. Le 50e anniversaire n’est pas loin!
Enzo Boddi
Traduction Serge Baudot
Photos Alessandra Freguja
© Jazz Hot n° 677, automne 2016
|
Saint-Cannat, Bouches-du-Rhône
Jazz à Beaupré, 8-9 juillet 2016
Ce
n’est pas exagérer –même quand on est de Marseille– que d’affirmer que
Jazz à Beaupré se tient dans l’un des plus beaux sites offerts à un
festival de jazz en France: le parc, planté de platanes vénérables,
d’une propriété viticole, le Château de Beaupré où s’élève ledit
château, une élégante bastide provençale, à quelques kilomètres
d’Aix-en-Provence, tel est le décor raffiné d’un festival qui se
consacre au «beau» piano jazz et plus si affinité, et qui continue
d’être porté avec passion par ses créateurs, Roger Mennillo, lui-même
excellent pianiste, et Chris Brégoli. Chaque soirée débute autour d’un
verre (issu de la production du domaine, bien entendu) que l’on déguste à
l’heure où la température se fait plus aimable, en regardant le soleil
se coucher. Puis le «speaker», Jean Pelle, le légendaire patron du
Pelle-Mêle, club mythique du Vieux-Port de Marseille, invite les
spectateurs à se presser de rejoindre leurs places. Et Môssieur Pelle
d’introduire chacun des musiciens avant leur entrée en scène avec un art
certain de la prise de parole didactique et décontractée.

Une
place de choix était réservée cette année à Cuba puisque, sur les
quatre concerts répartis sur les deux soirées de festivals, la moitié
mettait à l’honneur des musiciens caribéens. Ainsi, c’est Harold
López-Nussa, 33 ans, étoile montante du piano cubain qui a ouvert les
festivités. Diplômé de piano classique, il débute sa carrière au sein de
plusieurs orchestres symphoniques tout en se joignant à des formations
de musique traditionnelle et de jazz. Il fait d’ailleurs le choix du
jazz en 2007, montant son propre groupe, tourne de 2008 à 2011 avec
Omara Portuondo (voc) et aujourd’hui se joint régulièrement à Orlando
Maraca Valle (fl). A Beaupré, il était en trio avec Felipe Cabrera (b)
et son frère Adrián López-Nussa (dm). Le répertoire présenté est
essentiellement celui tiré de son disque à sortir en septembre, El viaje (Mack Avenue), dominé par des compositions de son cru. López-Nussa est à
la croisée des chemins: sur les ballades, on entend le pianiste de
formation classique, délicat, introspectif; sur les thèmes rapides
émergent les racines latines et ce rapport naturel au rythme qui se
marie si bien avec le jazz. C’est dans ce second registre qu’on le
préfère, d’autant que le soutien de Cabrera est impeccable. On retient
toutefois un bel original, sur tempo lent, «Herencia», issu d’un
précédent album.

Le
second concert de cette première soirée proposait un duo prometteur:
Kenny Barron (déjà présent avec son trio l’année précédente) et Dado
Moroni se faisant face, chacun derrière son piano. Quelle merveille de
concert! Le dialogue a été riche, chacun parlant le langage du jazz avec
son propre accent: Moroni, très mélodique, tricote autour des thèmes de
belles notes perlées; Barron, plus rugueux, arbore un jeu percussif
davantage ancré dans les graves. De Gershwin à Monk, en passant par
Randy Weston («Hi Fly»), le duo a donné à entendre du jazz essentiel. A
noter quelques jolies compositions de Dado Moroni dans le répertoire
abordé, comme «First Smile» par laquelle l’Italien évoquait la naissance
de son premier enfant. Le concert s’est achevé sur une invitation qui a
ému plus d’un habitué du festival: Dado Moroni a cédé sa place à Roger
Mennillo qui a partagé, avec l’entrain d’un jeune homme, un blues coloré
en compagnie de Kenny Barron.

La
soirée du lendemain a débuté avec le trio de Pierre de Bethmann (p),
composé de Sylvain Romano (b, le régional de l’étape) et de Tony Rabeson
(dm). A 51 ans (malgré des allures de jeune homme timide), De Bethmann a
atteint la plénitude de son art. C’est ainsi qu’il s’est attaché –avec
une indéniable réussite– à traduire en jazz quelques titres marquants de
la chanson française ou thèmes du patrimoine hexagonal (projet qui est
au centre de son dernier album, Essais. Volume 1, chroniqué l’hiver dernier dans Jazz Hot).
Si pour certains titres, le lien avec le jazz est évident («La Mer» de
Charles Trenet, qui est depuis longtemps devenu un standard), d’autres
adaptations sont plus inattendues («Pull marine» de Serge Gainsbourg).
La reprise d’«Indifference» de Tony Murena fut d’une grande beauté, le
trio parvenant à rendre toute l’intensité de l’interprétation originale à
l’accordéon. En revanche, le pianiste n’a pu faire émerger le swing de
la «Sicilienne» de Fauré, se heurtant à la limite de l’exercice: le
passage d’un idiome musical à un autre. Toujours est-il que De Bethmann,
maniant l’improvisation avec une poésie onirique, a réalisé une bonne
synthèse entre jazz et culture musicale européenne.
Enfin, retour
à Cuba avec Omar Sosa (p) et Cuarteto Afrocubano. Pour autant qu’elle
fût festive et jubilatoire, la musique de Sosa se situe au-delà des
frontières du jazz. On a cependant apprécié tout ce qui relevait d’une
expression authentique, de la joyeuse convocation des rythmes de La
Havane, nous rappelant que la piano est un instrument basé sur un
système de percussion; on a été moins convaincu par les ambiances
planantes de quelques compositions.
Beaupré est devenu en
quelques années un rendez-vous incontournable pour les amoureux du
piano, et cela sans aucun doute par la science jazzique de son directeur
artistique, Roger Mennillo, et ses atouts de charme nous rendent
impatients de la prochaine édition.
Jérôme Partage
Texte et photos
© Jazz Hot n° 677, automne 2016
|

Gent/Gand, Belgique
Gent Jazz, 7-8 juillet 2016
Evacués
les 175 mm² de précipitations du mois de juin! Les canaux gantois ont
retrouvé leur quiétude et les vergers du Bijloke (abbaye) leurs pommes
sauvages. La quinzième édition du festival de jazz peut alors dérouler
son programme de sept jours en deux week-ends. L’entreprise est
gigantesque: deux podiums – un petit et un grand, cinq cents artistes
et des infrastructures de gastronomie et de confort remarquables. Nous
avons choisi de vous brosser l’ambiance des deux premiers jours.
Jeudi,
dès l’entrée, en salle de presse, les chroniqueurs débattaient en
toutes langues des velléités de réduction des subventions accordées à la
Culture par la Région Flamande. Dans la foulée, on murmurait que
l’organisateur gantois avait sollicité 750000 euros auprès des sponsors
institutionnels. Il n’en aurait finalement reçu que 315000 alors que,
l’an dernier, la manne en comptait encore 350000! Mais, revenons au
programme…
Le 7, dès 16h30, Terence Blanchard (tp) et son «E. Collective Band» essuyaient les plâtres (sic)
sous la grande tente devant un public encore confidentiel. Pour ceux
qui gardent en mémoire les prestations d’un jeune trompettiste
néo-orléanais avec les Messengers d’Art Blakey (1982), ce fut une grande
gifle. Blanchard use du modèle d’instrument qui fit la réputation de
son concitoyen Wynton Marsalis, mais Terence, 54 ans, compositeur et
arrangeur, s’inscrit dans son époque: celle des moogs, des loops, des
synthés et des fusions-modulations-distorsions. L’électronique, présente
dans la plupart des groupes de ce festival, est ancrée dans la musique
du siècle. Elle est généralement bien maitrisée. Les rythmes du quintet,
souvent orientés two beats, font immanquablement penser au
Miles-électro. C’était au début des années 80… déjà! Les arrangements
de Terence Blanchard sont parfaits; l’usage des synthés est
discrètement maîtrisé; la mise en place des jeunes accompagnateurs:
impeccable: Charles Alture (g), Taylor Eigsti (p), Gene Coye (b) et
David Ginyard (dm). C’était bien; un calque de l’album «Breathless»
publié par Blue Note l’année dernière.
Après un interlude au petit podium, le pianiste Wout Gooris présentait à 18h30, en quintet: une musique de climats,
sorte de longue suite incantatoire. L’œuvre est bien écrite, dans
l’esprit - sans surprise - du tronc commun des diplômés des
conservatoires belges. En solistes, on retrouvait avec plaisir Erwin
Vann (ts), doublé par le néo-zélandais Hayden Chisholm (as). La musique
du groupe est intéressante mais prévisible («Twaalf»); elle est
acoustique, en contraste total avec ce qui s’était passé avant et tout
ce qui se passera après!
Dans
la foulée de la publication de son triple album «The Epic», Kamasi
Washington (ts) est apparu à la tête d’une tribu afro-américaine, funk
et jazz, de dix musiciens. Les compositions et les arrangements sont
signés par le leader avec la volonté de pulser une énergie proche de la
transe (une expression chère à Robert Goffin, malheureusement tombée en désuétude);
un jazz moderne pour la jeunesse des banlieues. Du bruit, beaucoup de
bruit avec deux drummers (Tony Austin et Ronald Bruner JR.) et un
contrebassiste: Miles Mosley, qui tire à tout va, comme un diable dans
un bénitier (solo à l’archet sur «Askim»). De cet orphéon polymorphe,
on peut retenir quelques chorus intéressants de Miles Mosley (b), de
Brandon Coleman (kb), de Cameron Graves (p) et d’un flutiste apparu en
fin de concert sur une composition dédiée à la mère de Kamasi. Je n’ai
pas pu saisir le nom du flutiste, mais il s’agit d’un membre de la
famille Washington (son père?). A jeter néanmoins: la vocaliste
Patrice Quinn! Kamasi Washington n’est pas un nouveau Coltrane; son
écriture et ses arrangements valent bien mieux que ses solos. Issu
d’Inglewood (LA), il met dans sa musique la force revendicative des
Noirs de la côte Ouest. Le jazz est revivifié, proche du peuple,
accessible mais contemporain. Héritier de Sun Ra, de Mingus, d’Albert
Ayler et des Black Panthers, il mâtine tout l’héritage, des marching
bands jusqu’au hip hop en passant par le rhythm and blues, le groove, le
jazz et, bien sûr: l’électro-jazz. Cette fusion vigoureuse est
intelligente et séduisante pour tous!
Sur
le petit podium (Garden Stage) on pouvait écouter, en trois passages
alternés: l’autre feeling, celui de la Côte Est (N.Y) avec les jeunes
jazzmen de Kneebody (Adam Benjamin/kb, Shane Endsley/tp, Ben Wendel/ts,
Kaveh Rastegar/b et Nate Wood/dm) alliés au DJ-sampler Aka Daedelus
(Alfred Darlington). Une autre manière (blanche) de mixer le jazz
post-bop et le scratch; une manière plus proche de ce qui se joue chez
nous. Contrastes côtiers, choix; voix divergentes ou voies parallèles?
En
clôture de la première journée, Ibrahim Maalouf (tp) proposait son
hommage à Oum Kalthoum (voc). Cette symphonie sur un poème de la
chanteuse égyptienne ne laissera pas un souvenir impérissable. Elle
pêche par sa longueur et notre langueur, nonobstant (j’aime cet adverbe) l’originalité d’arrangements aux rythmes variés et des solistes,
excellents accompagnateurs: Mark Turner (ts), Frank Woeste (p) et les
sublimes Scott Colley (b) et Clarence Penn (dm).
Deux
rencontres inhabituelles encadraient la seconde journée, le 8. La
première, en lever de rideau: Pat Metheny (g) avec Ron Carter (b); la
deuxième, en clôture: John Scofield (g), Brad Mehldau (p, kb) et Mark
Guiliana (dm). Etonnés, nous espérions trouver dans ces rencontres
matière à orgasmes auditifs. Ça commence très mal, avec deux standards:
«Tristesse» et «My Funny Valentine». Pat Metheny n’est pas du tout
dans le coup: mauvaise pince, idées absentes. On court à la catastrophe
jusqu’à ce qu’un blues et un beau solo de basse de Ron Carter lui
permette de respirer. C’est réparé, croyons-nous, avec une ballade en
cinquième morceau; les notes sonnent pleines. Enfin? Suivent
«Question and Answer», puis «Freddie Freeloader» et le solo de
guitare retombe dans les banalités; Carter prend la suite, inventif,
merveilleux en rythmes, remettant la syncope à sa place - une syncope
qui fait totalement défaut chez Metheny. Au huitième titre, la
multi-manche «Pikasso 42» remplace la guitare «Ibanez» et le
guitariste est chez lui, dans son groove. Pour suivre, avec une valse
lente, nous aurons droit à un beau solo de basse relayé aux doigts sur
une guitare sèche de type espagnol. Une chansonnette insignifiante
précède, «The Theme» pour terminer l’affrontement. Pat Metheny n’avait
peut-être pas encore récupéré du jet-lag? En sera-t-il remis le
lendemain à Rotterdam?
Moins
décevante était la rencontre de Brad Mehldau (p, kb, moog, synthés)
avec John Scofield (g, eb). Rencontre de l’eau et du feu? C’est ce qui nous préoccupait! Palliant l’absence (voulue) de bassiste, le pianiste assure la ligne rythmique en accompagnant le guitariste de la main gauche sur le «moog»; lorsque Mehldau prend un solo, Scofield échange sa guitare pour une basse électrique. Les solos sont de longueurs
démesurées. Le guitariste est en retenue, en-deçà des envolées rockeuses qui le caractérisent. Brad Mehldau glisse sous ses notes des ondes
joliment colorées à l’aide du piano, des claviers et des synthés. «Wake
Up», «He Was What He Was!». Avec ses compositions, Mehldau est à
l’aise, construisant, comme il en a l’habitude, par
répétitions-progressions. Mark Guiliana (dm) accompagne discrètement; Il faut attendre la fin du concert pour qu’il s’envole dans un solo qui
n’ajoute rien à la conversation. «Love the Most» conclut une rencontre
intéressante, tempérée. En devenir?
Au
cours de cette seconde journée, le Garden Stage offrait d’écouter en
carte blanche le saxophoniste Steven Delannoye en trois formules
acoustiques; un duo avec Nicola Andrioli (p); un trio avec les mêmes +
Lode Vercampt (cello); un quartet avec Andrioli (p), Jean-Paul
Estiévenart (tp), Reinier Baas (g) et Mark Schilders (dm). Une
consécration méritée pour ce sympathique saxophoniste passé par le
Lemmensinstituut de Leuven et la Manhattan School of Music de New York.
Airelle Besson (tp) et son quartet avait été ajoutés en supplément after midnight.
J’aurais sans doute pu l’écouter plutôt que de passer deux heures dans
les embouteillages au retour vers Bruxelles! La rencontre avait été
manquée à la Jazz Station, mais je l’avais écoutée et vue sur Mezzo.
Nous
avions découvert «De Beren Gieren» l’an dernier au festival de
Middelheim (Anvers). Le trio de Fulco Ottervanger (p,kb) n’a rien perdu
de sa créativité et de son énergie. A la manière de feu E.S.T, il
procède par petites structures évolutives. Le pianiste hollandais
percute les notes et les cordes, envoûté, voire: endiablé. La rythmique
est collée aux pulsions du leader; bassiste et batteur s’affichent à
tour de rôle alors que le claviériste joue des harmonies modulées en
vagues graduelles. Lieven Van Pée (b) est remarquable par son
accompagnement obsessionnel en quatre ou cinq notes; lorsqu’il est
soliste, il use joliment de l’archet, montant en harmoniques pour créer
la tension. Sur des structures répétitives du bassiste, breakées aux
drums, Fulco Ottervanger (p) improvise, inspiré, usant des résonances
piano-keyboards. L’osmose entre les musiciens est fusionnelle. Le swing
explose. Ce furent sans doute les meilleurs moments de ces deux
premières journées!
Après
la proclamation des Sabam Jazz Awards 2016: Bram De Looze (p): jeune
talent et Peter Vermeersch (cl, sax, compos): talent confirmé, le
chanteur Hugh Coltman est venu rappeler les douces heures de Nat King
Cole. La voix charme les flemish mamies («Sweet Lorraine», «Mona
Lisa»). Avec «Smile», la perle de Chaplin, il monte en voix de tête.
Suit «Nature Boy». Au fil des morceaux, le crooner passe du sirop au rhythm ’n’ blues; il prend deux petits chorus à l’harmonica, s’en va chanter dans l’ouïe du Steinway, feature ses accompagnateurs et termine en force, conquérant, ovationné pour un show bien rodé.
Le
Gent Jazz Festival est devenu un événement incontournable et très
couru, malgré la proximité du gigantesque Festival de Northsea de Rotterdam. Tous
les concerts ne sont pas du même niveau, il y a des rencontres ratées,
mais aussi quelques instants de vrai bonheur… Ça, ça vaut le
déplacement!
Jean-Marie Hacquier
Photos: Bruno Bollaert © by courtesy of Gent Jazz
© Jazz Hot n° 677, automne 2016
|
Pléneuf-Val-André, Côtes-d’Armor
Jazz à l’Amirauté, 5 juillet-23 août 2016
Depuis 20 ans (c’est la 21e édition), l’association Jazz à l’Amirauté, en étroite collaboration
avec la municipalité aujourd’hui dirigée par M. Jean-Yves Lebas, promeut
le jazz en cette magnifique station balnéaire sur la côte nord de la
Bretagne, la Côte d'émeraude (en raison disent certains de la couleur de
la mer, je pense plutôt en raison de celle de certaines roches), dans
un des plus beaux départements de France, toujours authentique ouvert à
un tourisme encore équilibré, familial.
Tous les mardis donc de ces
mois de juillet et d’août 2016, la trentaine de bénévoles de
l’association, coordonnée avec beaucoup d’efficacité par Elie Guilmoto,
met en œuvre une belle scène de jazz, ouverte et gratuite, où se presse
une assistance remarquable (1000 à 2000 personnes selon les soirs).
Dans cette charmante station qui offre encore un beau décor début de XXe siècle, le cadre est enchanteur pour le jazz dans ce verdoyant parc de
l’Amirauté, en référence au généreux donateur du parc et de la belle
demeure, l’Amiral Charner.
Parrainé par Philippe Duchemin, qui
apporte sa contribution à l'élaboration d'une programmation très jazz et
variée, l’équipe est maintenant très bien organisée et rodée. Attrait
supplémentaire, l’atmosphère malgré la grande affluence, reste
familiale, simple et sans aucun des travers qui s’accumulent aujourd’hui
dans beaucoup de festivals. Tout reste à l’échelle, du jazz, de la
ville, et c’est la meilleure façon d’aborder un festival.

Il
ne nous était pas possible de couvrir tous les mardis, et dans un bon
programme qui faisait la part belle aux pianistes avec Arnaud Labastie
Trio (le 5/7), Olivier Leveau Quartet (12/7) et Pierre Le Bot (23/8),
qui proposait du jazz d’inspiration ou filiation new orleans les 19/7 et
2/8 avec The New Washboard Band (19/7), le Santadrea Jazz Band (2/8),
Daniel Sidney Bechet (9/8), Mathieu Boré Quintet (16/8), nous avions
donc choisi de nous arrêter le 26/7, pour cette première visite de Jazz Hot à Pléneuf-Val-André, et d’assister au bel hommage à Claude Nougaro, intitulé «Danser sur Nougaro», multidimensionnel et conçu par le parrain du festival Philippe Duchemin (p), entouré
de son trio habituel (Les frères Christophe, b, et Philippe Le Van,
dm), de Christophe Davot (voc, g), et d’un ensemble à cordes de 12
musiciens, Cenoman, sous la direction d’Arnaud Aguergaray (vln).
L’ensemble classique comprenait 12 musiciens, violons, altos,
violoncelles et contrebasse.
Le leader du jour, pas vraiment
perturbé par un bras dans le plâtre, résultat d’un enthousiasme peu
raisonnable pour le Tour de France, a dirigé cette belle heure et demie
de musique de son clavier, n’hésitant pas de sa main valide à non
seulement accompagner mais également à improviser dans d’acrobatiques
chorus de main droite, bien appréciés par le public. Au demeurant, Ravel
a composé un Concerto pour main gauche, et, dans le jazz, Bud Powell, pour taquiner Art Tatum, avait lui aussi joué une pièce virtuose pour la main gauche.
Les
arrangements recherchés du leader, aux tonalités originales car ils
mêlent la couleur jazz de Duchemin, jazzy de Nougaro et classique de
l’ensemble à cordes, ont fait la part du lion à l’excellent Christophe
Davot, le chanteur indispensable et courageux pour un tel hommage, car
il n’est pas facile de passer derrière l’interprète Nougaro de ses
propres chansons et poésies. Christophe Davot donna aussi un échantillon
de ses qualités guitaristiques et fut, de fait, au centre de ce bon
spectacle musical.
Dans le registre poétique, l’utilisation des
cordes a été particulièrement appréciable, et le dynamisme du
trio-quartet jazz a permis de mettre en valeur le côté jazzy du
répertoire du Toulousain. On aurait même aimé que les cordes soient
présentes sur «Rimes» joué sans les cordes.
Le répertoire est
forcément sans surprise tant Claude Nougaro a enchaîné les succès et
imprégné l’imaginaire collectif. Commencé avec «La Pluie fait des
claquettes», malgré le beau temps du jour, le concert s’est fini sur
l’inévitable «Le Jazz et la java» lors du rappel des 1200 spectateurs
ravis. «Ma Femme», «Cécile, ma fille», «Armstrong», «Le Déjeuner sur
l’herbe» (en référence à Renoir, peut-être Jean plus qu’Auguste, et pas à
Manet, «Les Mains d’une femme dans la farine», «Prisonnier des nuages»,
«Rimes», «Tu verras», «Le Coq et la pendule», «Dansez sur moi»…
On
retient en particulier «Berceuse à Pépé», «Toulouse» où Christophe Davot
fut excellent; on note un blues instrumental du trio au milieu du set;
on apprécia la couleur poétique des cordes et des arrangements sur
plusieurs des thèmes, et au final le public ne s’y est pas trompé en
faisant une belle ovation à ces musiciens et à cette soirée, où chacun
fredonna avec l’orchestre ce qui est au sens littéral du domaine public,
l’univers de Claude Nougaro.
Bravo donc à l’initiateur du
projet, Philippe Duchemin, aux organisateurs du festival, car la soirée
fut un simple mais très appréciable moment de poésie musicale dans la
période actuelle. Quand on aime le jazz, et lorsque le programme, la
qualité de l’organisation et de l’environnement se conjuguent avec une
telle harmonie, il est recommandé d’en profiter pour découvrir une
région splendide, toujours très authentique.
Yves Sportis
© Jazz Hot n° 677, automne 2016
|
Getxo, Espagne
Getxo Jazz Festival 2016, du 1er au 5 juillet 2016
40e
édition du Festival International de Jazz de Getxo, avec cette année
des vedettes de l'envergure de Dee Dee Bridgewater, Esperanza Spalding,
Uri Caine, Hermeto Pascoal, et Jorge Pardo. A ces concerts vedettes se
sont ajoutés en outre ceux du concours de groupes et de la partie
«Troisième Millénaire», ainsi que les jam sessions nocturnes.
Lors
de la première journée, après le groupe du concours –Wilfried Wilde
Quintet– le saxophoniste et flûtiste Madrilène, Jorge Pardo, a dédié son
intervention au guitariste flamenco Juan Habichuela (83 ans), décédé la
veille. Voilà pourquoi son guitariste officiel, Josemi Carmona (neveu
d’Habichuela), n’a pas pu venir à Getxo et a été remplacé par Rycardo
Moreno. Pardo a présenté quelques morceaux de son disque Huellas («Puerta del Sol Expresso», «Sanlúcar-Mojácar») avec d’autres classiques comme «Historia de un amor» ou le standard très connu «Caravan»,
toujours dans la ligne du métissage jazz-flamenco qui le caractérise.
Avec sa guitare acoustique, Rycardo Brun a apporté des nuances plus
proches du jazz, tandis que Pablo Baez, à la contrebasse, et le
percussionniste José Manuel Ruiz «Bandolero» fournissaient une adéquate
base rythmique.
Pour
la deuxième journée, après le groupe du concours –Tomasz Wendt Trio–,
le trio d’Uri Caine a offert un concert solide et imaginatif avec sept
morceaux où il a fait alterner plusieurs perspectives musicales. Caine
(p, Fender), aux côtés de l’excellent John Hébert (b) et de Ben Perowski
(dm), a parcouru divers chemins, du funk à l'élégance classique, en
passant sur de beaux moments de scintillement minimaliste, sans oublier
non plus la facette politique et revendicative, dédiant le blues ragtime
«Smelly» (puant) au pathétique Donald Trump.

Lors
de la troisième journée, après le groupe du concours –Francesco Colombo
Trio–, s’est produit le groupe d’Hermeto Pascoal, l'un des grands
artisans de la fusion entre la musique traditionnelle brésilienne, le
jazz et d'autres musiques encore… On ne peut nier que c'était un concert
amusant et du goût du public, où il y a eu des moments de qualité, en
particulier du coté de Vinicius Dorin (sax) et d’Andrés Marques (p);
mais le jeu proprement dit d’Hermeto a eu des inégalités qui faisaient
penser plutôt à un one man show, basé sur ses traits
humoristiques habituels (l'imitation de Jerry Lee Lewis au piano, les
sons avec baigneurs ou la cafetière/trompette pleine d’eau…). Pour être
juste, disons qu'il y a eu aussi des moments musicaux de bon niveau
(«Irmãos Latino», «Frevo Em Maceio», ou même le numéro de toute la bande
soufflant dans des bouteilles en verre), néanmoins le bilan global
reste marqué par les clins d'œil faciles (un pasodoble espagnol
absolument oubliable), voire les auto-parodies…

Lors
de la quatrième journée, après le dernier groupe du concours –Daahoud
Salim Quintet–, le festival a présenté la star la plus remarquable du
programme 2016, la chanteuse Dee Dee Bridgewater. Elle s’est produite à
la tête d'un quintet de jeunes musiciens d'un bon niveau –Theo Crocker
(tp), Anthony Ware (s, fl), Michael King (clav), Eric
Wheeler (b), Kassa Overall (dm). Encore une fois, la chanteuse a
témoigné de l'étendue de son registre vocal, de son talent théâtral et
de sa capacité à se mettre le public dans la poche dès son entrée en
scène, lui offrant deux bis d'un style inhabituel, avec le public
dansant de tous côtés: le soul de Stevie Wonder, «Livin’ For the City»,
et le funk «Compared to What», chanté en son temps par Roberta Flack et
révisé ici par Dee Dee, qui a ajouté danse et bonds avec sa section à
vent. Le jazz était dans le répertoire précédant les bis: «Afro Blue» de
Mongo Santamaría, «The Music Is the Magique» d'Abbey Lincoln, ou
«Filthy McNasty» d’Horace Silver. Le meilleur a été deux morceaux en
scat de Dee Dee mimant le son des instruments avec sa bouche: un
trombone dans le génial «Blue Monk» de Thelonius Monk, et une trompette
avec sourdine dans le traditionnel de New Orléans «St. James Infirmary».
En définitive, un beau succès!

Pour
la cinquième et dernière journée, la contrebassiste Esperanza Spalding a
présenté son projet «Emily's D+Evolution», un show qui, paradoxalement,
n'a rien eu à voir avec le jazz. C'était plutôt une opéra-rock, une
performance conceptuelle ou une sorte de thérapie personnelle avec un
fond musical. L'histoire qu'elle tentait de raconter (d'une
compréhension difficile même si on maîtrise l'anglais) portait sur son
anti-évolution et sur son évolution comme femme et artiste, racontée par
l'intermédiaire des aventures d'Emily, comme une sorte d'alter ego. Le
format choisi, avec une guitare et une batterie de hard rock, et un
chœur genre high school, a beaucoup trop pesé jusqu'à estomper la
puissance d'Espérance Spalding comme bassiste. A notre avis, un
faux-pas dans son parcours musical.
Le gagnant du concours de
groupes a été le Daahoud Salim Quintet. Le pianiste et compositeur
Daahoud Salim, fils du saxophoniste Abdu Salim, est parvenu, chose
impossible depuis des années, à faire coïncider le jury et la voix du
public pour un prix qui, depuis cette édition, va s'appeler «Prix Juan
Claudio Cifuentes», du nom du regretté critique de jazz «Cifu», pour le
prix de meilleur groupe comme pour celui de meilleur soliste. Le
deuxième prix est allé au trio du saxophoniste Polonais Tomasz Wendt.
Il
faut ajouter au programme les concerts du «Troisième Millénaire» où de
jeunes projets comme Laurent Coulondre Trio et Ainara Ortega «Scat» ont
partagé l’affiche avec des anciens tels que Kiko Berenguer ou Gonzalo
del Val. Il faut aussi souligner que la Salle Torrene a accueilli
l'exposition de mosaïques «Le Jazz ? Yes!» de l'artiste Javier de la
Torre, d’après des photographies de jazz.
Le bilan de Getxo Jazz pour son 40e anniversaire a été bon tant pour la qualité artistique que sur le plan
de l’affluence. Seul point négatif, les lumières de scène avec des
effets visuels hors de propos. Il y avait beaucoup plus de réflecteurs
pour ces jeux de lumières ou d'images projetées –éblouissant
complètement les premiers rangs du public– que pour illuminer les
musiciens eux-mêmes! Une anecdote: pendant la samba jouée par le groupe
d’Hermeto Pascoal, un paysage arctique était projeté sur la toile de
fond… A résoudre pour les prochaines éditions de ce grand Festival!
Lauri Fernández et Jose Horna
Texte et photos
© Jazz Hot n° 677, automne 2016
|


Montréal, Québec, Canada
Festival International de Jazz de Montréal,
29 juin-9 juillet 2016
On
peut imaginer le déroulement des festivals de jazz de l'été canadien
comme une énorme vague d’énergie musicale roulant vers l’Est, sautant
par dessus le continent, devenu phénomène saisonnier traditionnel. Phénomène qui est son véritable ADN. Tout
débute avec l’impressionnante chaîne des festivals canadiens, qui
démarre sur les franges ouest de Vancouver, passe par l’Alberta,
Toronto, pour arriver au grand et remarquable festival de Montréal,
avant de s’en aller vers l’Est, vers les festivals européens.
Une fois de plus, le Festival international de Jazz de Montréal (FIJM), dans sa 37e édition cette année, prouve sa puissance et sa valeur artistique, avec une vision large de ce qu’il y a de mieux dans le jazz aujourd’hui.
Le
FIJM n’hésite pas présenter de la pop, du R&B et d’autres musiques à
côté du jazz, afin d’obtenir des subventions et dattirer ceux qui
n’éprouvent aucun intérêt pour un festival de jazz. Cet appât pour un
public de masse est apparu sous la forme de noms tels que Brian Wilson
et Melody Gardot. Mais le festival ne sacrifie ni ne lésine jamais avec
sa principale mission de présenter une gerbe de quelques-uns des
artistes de jazz parmi les meilleurs et les plus significatifs du
moment, aussi bien d’expression contemporaine que de la tradition, même
si les fans de l’avant-garde ont pu se sentir lésés, puisque la
programmation contemporaine a été pratiquement supprimée.

Cette
année, le concert d’ouverture a tracé une ligne ténue entre le jazz et
la pop, sous les traits du chanteur Gregory Porter, devenu rapidement
l’un des plus populaires chanteurs de « jazz », mais dont le charme
s’étend à une plus large audience qu’à celle plus strictement jazz. Avec
son répertoire inédit, Porter est en symbiose avec l’héritage et les
influences évidentes de Bill Withers, Marvin Gaye et Donny Hathaway qui
lui attirent les amateurs de « soul », tandis que son phrasé souple, sa
fluidité dans l’improvisation (son album «Liquid Spirit» est un modèle
pertinent de ce don) et son langage harmonique, titillent l’essence du
jazz.
En concert, au Théâtre Maisonneuve, place des Arts, centre du
festival et carrefour des lieux de concert, Porter entra sur scène sur
une annonce élogieuse quand le directeur artistique, André Ménard, le
présenta en vainqueur du «Festival’s Ella Fitzgerald Award»: «Je
la prends, dit Porter avec un sourire malicieux. Elle appartient aussi à
mon orchestre. Cependant elle restera chez moi.»
La grande
soirée Porter dans la grande salle faisait contraste avec le style vocal
de Cyrille Aimée, dont le répertoire à l’Astral Night-club allait de
Michael Jackson’s «Off the Wall» à «Light as a Feather» de Corea
(rappelant Flora Purim). Ses variations sur le thème de «Gypsy» alliaient des gestes théâtraux à sa musicalité.
Une
autre soirée, un autre style de chanteur, avec Rufus Wainwright, qui
s’en tira bien avec son œuvre pleine de promesse « La pop rencontre
l’opéra », dans la grande salle Wilfrid-Pelletier. Elevé à Montréal,
dans une dynastie musicale, fils de Loudon Wainwright III et de la
regrettée Kate MacGarrigle, frère de la talentueuse et sous estimée
Martha, il s’est créé un style unique, travaillant depuis la pop
sophistiquée de «Poses» « Cigarettes and Chocolate Milk», «California», jusqu’à un opéra ambitieux, de sa conception « Prima
Donna » à propos de Maria Callas, présenté ici dans une version
multimédia. Un «Show Capper» de sa version particulière de
«Hallelujah» de Leonard Cohen (autre Montréalais célèbre) lui permit
d’inviter sur scène les membres de la famille : Martha, Lily et Sylvia.
Pour
la captivante «Invitation Series », en première partie, le festival
avait dirigé les projecteurs sur le trompettiste multi-style, Christian
Scott, suivi par trois concerts qui démarrèrent avec Kenny Barron, (mais
j’étais alors déjà parti). Le Scott’s Band qui invitait la jeune et
étonnante flûtiste en pleine ascension, Elena Pinderhughes, avec le
saxophoniste aux doigts agiles, Braxton Cook, s’aventura dans un
répertoire à la fois électrifié et post-mainstream, qui est en quelque
sorte le concept de « Stretch Music » du trompettiste. D’autres invités
se produisirent à la soirée suivante, tout d’abord le guitariste à sept
cordes Charlie Hunter, qui donne son meilleur en lignes groove mâtinée
de funk, et la chanteuse Lizz Wright, une artiste en milieu de carrière
et qui est maintenant à son niveau le plus haut. Quand Scott eut chanté
chaleureusement et avec générosité les louanges de la chanteuse et dit
que sa musique lui était une source d’inspiration, l’élégante et
truculente chanteuse déclara à la foule : « Pour la première fois de ma
vie, je suis la plus vieille personne sur scène. » Son répertoire
incluait une nouvelle reprise de Neil Young’s «Old Man» et les
poignants gospels «Freedom» et «Surrender», tandis que son orchestre
occasionnel composé de copains lui construisait un soubassement ferme et
expressif.
Marsalis’ JALC Big Band, encore et toujours l’un des
meilleurs, joua pour un public totalement différent dans ce nouveau
Concert Hall, la Maison Symphonique de Montréal, à l’architecture et à
l’acoustique enchanteresses. L’orchestre était sur son trente-et-un,
aussi bien côté costume que musicalement. Comme toujours dans cet
orchestre, les racines du jazz se mêlent à la modernité.
L’orchestre est parti de Jelly Roll Morton («Le premier musicien de jazz intellectuel»,
commenta Marsalis) pour aller jusqu’à l’arrangement de Don Redman sur
«I Got Rhythm» et à l’esthétique plus récente de « Armageddon » de Wayne
Shorter, élégamment arrangé par le trompettiste Marcus Printup. Le
«Crescent City» de Victor Goines, s’enrichissait délicieusement des
percussions et des balancements de la valse, tandis que le «Jackson
Pollock» de Ted Nash (de Nash’s Art-Minded Portrait in Seven Shades)
était étourdissant, coloré par des traits rapides comme le jet des
couleurs dans l’action painting, tout en mettant en avant un solo du
trompettiste Ryan Kisor.
Pour la soirée suivante, un ensemble de
taille moyenne représentait une autre strate de la culture jazz, celle
de jeunes et solides musiciens qui composent la nouvelle génération de
Blue Note Records. Ce Blue Note 75 Band renvoie au 75e anniversaire
de l’auguste label en 2014, prouvant que la vie continue. Ce
groupe était composé de Robert Glasper (clav), d’Ambrose Akinmusire
(tp), de Marcus Strickland (sax), de Derrick Hodge (b), de Kendrick
Scott (dm) et, légèrement plus âgé, de Lionel Lueke (g), tous
d’impressionnants interprètes qui ont fait preuve de sensibilité et de
force expressive sur la scène.
En même temps ils ont rendu hommage au
fonds musical de Blue Note, démarrant avec «Witch Hunt» de Wayne
Shorter, et passant par des originaux des artistes des débuts de Blue
Note. Les clous de la soirée furent le méditatif «Henya» d’Akinmusire ;
Scott, en post-hard-bopper sur «Cycling through Reality»; et le joli
«Bayyinah» de Glasper, ouvrant le solo de piano sur d’habiles
entrelacements. Ils terminèrent avec un classique sans référance à Blue
Note, le «Turnaround» d’Ornette Coleman, en transformant avec un peu de
dérision la mélodie de «Turnaround» en un motif en boucles.
Au
risque d’en faire trop par rapport à ma brève apparition au festival, je
trouve que cette boucle hypnotique de «Turnaround» symbolisait avec
force le message, sous-jacent et partagé par tout le monde, de ce
festival aussi considérable et couvrant un si vaste champ. Après tout,
le jazz est une boucle, un chœur de voix fantomatiques et de mémoire de
la musicale ancestrale, confrontés à l’arrivée et à l’évolution de «New
Thing». L’ancien a rencontré le nouveau à Montréal, pour l’englober et
en prouver la justesse, comme cela arrive habituellement ici chaque été.
Josef Woodard
Traduction et Adaptation Serge Baudot
© Jazz Hot n° 677, automne 2016
|

Vienne, Isère (alternate)
Jazz à Vienne, 28 juin-15 juillet 2016
Il
a joué au sommet des Alpes dans la neige, a vécu un temps à Annecy et a
même ouvert un club de jazz au Maroc, entre la fin des années 1960 et
le début des années 1970, invitant des musiciens gnawas comme Abdellah
Boulkhair El Gourd à partager la scène avec lui. Il fête cette année ses
90 ans, et sa musique est de plus en plus belle. Bon pied, bon œil (et
surtout excellente oreille!), Randy Weston nous a enchantés lors de son
concert au Théâtre antique de Vienne ce lundi 4 juillet 2016. Guy
Reynard vous l’a déjà dit.
Je voulais juste ici rajouter quelques
lignes sur la profonde humilité, la profonde humanité, de ce pianiste
hors du commun qui fut parmi les premiers à réunir les musiciens des
deux continents, l’africain et l’américain. Mention toute spéciale à
Alex Blake, son formidable contrebassiste, assis sur une chaise basse,
la «grand-mère» presque couchée sur le corps, en jouant quasiment comme
d’une guitare flamenco, tout en accords, sans que jamais ce jeu atypique
puisse être assimilé à un quelconque procédé spectaculaire.

Randy
Weston, 90 ans de musique au cœur, était précédé de Lisa Simone.
J’avais rencontré sa maman en 1992 dans un festival à Pointe-à-Pitre.
Pas facile, la maman… Et vie tout aussi pas facile pour Lisa, sa fille.
Mais l’ancienne de l’US Air Force est d’abord excellente chanteuse et
compositrice. Surtout, elle est en empathie immédiate avec son public et
ceux qu’elle rencontre. Conséquence: ce jour-là, elle nous a accordé
deux petites séances photos en mode street photography puis en mode glamour en studio! C’est aujourd’hui devenu si rare (l’empathie, tout comme la
liberté photographique) qu’il faut saluer le changement d’attitude du
service de presse du festival cette année. Service qui mérite enfin son
nom après tant d’années de prise de pouvoir de la part de l’entourage
des musiciens, souvent trop habitué aux usages du show business et peu
sensible à l’univers particulier du jazz.

Soirée
féminine le samedi 9 juillet avec un joli plateau qui semble a priori
très hétéroclite: Esperanza Spalding en première partie, suivie du duo
Ibeyi, puis de la formation de la chanteuse Yael Naim. D’Esperanza
Spalding, on dira qu’elle a du culot. Et ce sera un euphémisme. Cette
fille est folle! Vous la croyez contrebassiste? Esperanza Spalding
habite son corps de liane comme si elle était une danseuse du grave pour
une sorte d’opéra jazz surréaliste et ébouriffé. Je l’ai connue en
2009. Plutôt sage. La voici en athlète de sa cinq cordes… Dix ans tout
juste après son premier album, Junjo, presque orthodoxe, il y a aujourd’hui du Frank Zappa dans Emily’s D+Evolution,
son nouvel opus (autobiographique!). Richesse des timbres et de
l’écriture, textes déjantés (et parfaitement incompréhensibles pour un
Français, même correctement anglophone), mise en scène et en costumes,
chorégraphies, bref, pure poésie que ce spectacle qui rugit d’une belle
énergie juvénile. Succès auprès du public. Moins auprès de la critique
jazz. Moi, j’aime l’audace insolente de cette compositrice d’à peine 30
ans, avec son parcours de première de la classe, son enfance dans les
quartiers difficiles de Portland (Oregon) et sa chevelure (en effet)
ébouriffée, qui se fiche de l’avis de ceux du sérail, tente le diable
et, au fond, aime d’amour son instrument comme son public. Quelqu’un,
qui vous remercie de citer «Silence», ce merveilleux thème composé par
Charlie Haden qu’elle interprète de façon impromptue sur le prototype
d’un instrument que lui a apporté backstage un luthier de la région, ne peut être qu’une grande musicienne!
Peu
commune, non plus, le prestation de Lisa-Kaïndé Diaz (chant et piano)
et Naomi Diaz (chant et percussions). Elles sont les filles (jumelles)
de feu le grand percussionniste cubain Miguel «Anga» Díaz qui joua avec
l’Irakere de Chucho Valdes, que j’avais croisé avec le pianiste Omar
Sosa à Tanger en 2005, et qui est décédé, trop tôt, l’année suivante, à
l’âge de 45 ans. Il y a peu, j’avais retrouvé Lisa et Naomi au festival
des Enfants du jazz à Barcelonnette, dans les Alpes-de-Haute-Provence.
Elles étaient alors… stagiaires! Aujourd’hui, elles ont créé le duo
Ibeyi. Beau chemin parcouru, les filles! Bel hommage à votre papa. Un
univers musical singulier qui, s’il est en effet un peu éloigné du jazz,
n’en reste pas moins sincère, exigeant et diablement séduisant. Lisa et
Naomi préparent actuellement un deuxième album avec quelques friends invités. On a hâte d’écouter…
Sincérité
et exigence sont deux qualificatifs qui s’appliquent également
parfaitement à Yael Naim. Il y a quelques mois, je l’ai vue à Lyon, avec
son homme, David Donatien, dans une formule atypique et musicalement
risquée, accompagnés par une formation classique: le quatuor Debussy.
Presque acoustique et tout en finesse. Ce samedi, les voici avec leur
propre orchestre. Dans un registre extrêmement différent, mais tout
aussi attachant. Arrangements aux petits oignons, sens du spectacle et
surtout, quelle voix! Message personnel: Yael, ne sois pas timide! À
quand l’enregistrement du répertoire jazz de Joni Mitchell entendu ici
même, au théâtre antique de Vienne, il y a quelques années?

Exceptionnellement, après sa traditionnelle All Night Jazz qui s’achève aux aurores, Jazz à Vienne s’est poursuivi en proposant
une soirée blues. Il ne fallait pas y rater Shakura S’Aida, une grande
chanteuse de blues américaine encore trop méconnue de ce côté-ci de
l’Atlantique que j’avais rencontrée en 2009 au festival Tanjazz avec le
pianiste français Rachid Bahri. Pas de doute: Shakura sait faire le show
et emballe les sept mille spectateurs du festival. Une parfaite
introduction au concert de Buddy Guy qui, lui aussi, distille un blues
qui plonge aux racines du genre. A bientôt 80 ans, chemise à pois, as usual,
Papy Guy a su garder son âme d’enfant et ne nous a rien épargné:
gratter avec les dents les cordes de sa Fender Stratocaster (laquelle a
la touche blanchie par endroits à force de bends), distribuer ses
médiators aux premiers rangs, prendre un chorus avec la guitare dans le
dos, s’amuser avec l’effet larsen, descendre de scène pour aller à la
rencontre de son public, jouer avec son… ventre (!), la guitare à
l’envers, la frapper avec une baguette de batterie, s’amuser de ses
effets de distorsion voire faire de la musique avec une… serviette de
bain! Jamais rien pourtant qui puisse sembler emprunté ou
superfétatoire. Buddy Guy? Un festival de blue notes pour marquer la fin du festival. Avec gourmandise!
Pascal Kober
Texte et photos
PS
du photographe aux organisateurs: remettez-nous donc la belle affiche
dessinée par Bruno Théry en fond de scène plutôt que ces infâmes effets
de lumières que l’on voit partout, rejetons de ces satanées boules à
facettes des boîtes de nuit des années 1970!
© Jazz Hot n° 677, automne 2016
|

Vienne, Isère
Jazz à Vienne, 28 juin-15 juillet 2016
Comme
à l'accoutumée, Jazz à Vienne 2016 propose un programme soutenu qui
s'étale sur la journée, de 12h30 sur la scène de Cybèle jusqu'à tard
dans la nuit avec le club de minuit dans un petit théâtre à l'italienne.
Tous ces concerts sont gratuits à l'exception du Théâtre antique où
passent les têtes d'affiche du festival. Les quatre journées auxquelles
nous étions invités présentaient donc beaucoup de musiques, et il n'est
pas incongru de mettre musiques au pluriel car le champ culturel du
festival s'élargit, ici comme ailleurs, à des projets qui s'éloignent de
plus en plus du jazz. Nous avions choisi ces quatre jours car le jazz y
était dominant.

Lundi
4 juillet. Lisa Simone ouvre la soirée au Théâtre antique. Il n'y a
aucune affectation mais une présence sympathique et décontractée. Le
soleil est encore présent, et la chanteuse se présente avec un grand
chapeau africain en cuir et des lunettes de soleil. Elle ne les garde
que peu temps et entre dans son spectacle habituel. On sait que Lisa
Simone a beaucoup fréquenté Broadway et la comédie musicale. Elle a
également chanté dans des groupes de gospel, et tous ces éléments se
retrouvent dans son spectacle. Elle est une chanteuse de soul naturelle
qui se rapproche de plus en plus du jazz. Elle possède une belle voix
chaude, et la comédie musicale lui a enseigné à mettre en scène ses
chansons. Son incursion dans le public, sans être spontanée, est
différente d'un spectacle à l'autre et varie selon les réactions du
public (certains sont plus intéressés par les selfies que par la
musique!). La musique demeure soul avec des éléments gospel, blues et
jazz et la touche personnelle d'une chanteuse qui s'est rapidement fait
un prénom en se distinguant de son illustre mère. Son quartet est très
soudé: Hervé Samb (g acoustique) et Reggie Washington (b) assurent
l'accompagnement, et lorsque Sonny Troupé (dm) se lance dans un chorus, c'est un percussionniste mélodiste qui réussit à faire
chanter les tambours. Lisa Simone a réuni un orchestre idéal pour
communiquer avec le public.
Randy Weston propose son African
Rhythms Quintet. A plus de 90 ans, il n'a rien perdu de ses qualité de
pianiste et de son enthousiasme pour retrouver le chaînon manquant entre
l'Afrique et la musique afro-américaine. Les deux saxophonistes se
complètent parfaitement: Billy Harper est d'une grande rigueur dans des
solos très élaborés alors que T.K. Blue qui a beaucoup joué avec les
musiciens sud-africains (Chris McGregor, Abdullah Ibrahim) est plus
effervescent. Neil Clarke aux percussions africaines est certes le plus
proche de l'Afrique tandis que le fidèle Alex Blake assure la maîtrise
rythmique de l'ensemble. Randy Weston joue plutôt sur des tempos assez
lents au cours de cette première partie où ses compositions constituent
le répertoire. «Hi Fly» qui termine cette première partie est d'abord
esquissé au piano sur un tempo assez lent avant de prendre son essor
avec l'entrée des saxophonistes. La deuxième partie constraste
complètement avec la première. Les saxophonistes sortent et Cheik
Tidiane Seck (elec p), Ablaye Sissoko (kora) et Mohamed Abouzekry (oud).
Mais la musique ne semble pas vraiment décoller malgré quelques bons
solos, montrant toute la difficulté à fusionner des musiques de
tradition différente.

Mardi
5 juillet. C'est le chanteur anglais Hugh Coltman qui ouvre la soirée
pour Diana Krall. Il se place dans la lignée du music-hall. Il a choisi
des chansons de Nat King Cole qu'il explore avec une voix sans
aspérités, douce. Il propose ainsi une belle séance nostalgique tournée
vers le swing des années 1950-60.

Diana Krall effectue également un
retour vers le passé, mais il s'agit ici de celui des débuts de sa
carrière. Elle n'a malheureusement pas oublié sa paranoia envers les
photographes. Pour ce retour vers le jazz Diana Krall a choisi un
orchestre de très haut niveau avec Anthony Wilson (g), Bob Hurst (b) et
Kerriem Riggins (dm). La chanteuse ne quitte pas son piano et distille
des mélodies swinguantes. Les tentations rock and roll sont ici
oubliées, et ses accompagnateurs sont choisis en fonction de ce retour à
ses premières amours. De belles mélodies bien insérées dans le jazz
peuvent aussi continuer à lui amener un fidèle public.
Mercredi
7 juillet. Cette soirée, largement consacrée à Django Reinhardt, débute
avec le quintet d'Angelo Debarre (g) avec Marius Apostol (vln). Le
quintet se place naturellement dans la tradition du Quintet du Hot Club
de France à la fois par l'instrumentation ainsi que par le répertoire et
la manière. Les deux solistes ont leur propre personnalité. Le
violoniste est beaucoup plus tourné vers la tradition tzigane. Soixante
ans après la disparition du «Divin Manouche», la forme a un peu tendance
à se figer.

Il
y a deux ans dans ce même théâtre antique le Amazing Keystone Big Band
proposait des arrangements sur la musique de Quincy Jones présent alors
sur scène. Cette fois, c'est la musique de Django Reinhardt en grand
orchestre. Une plus grande cohérence se fait sentir grâce aux
arrangements. Trois invités viennent exposer leur vision de Django.
Stochelo Rosenberg, un grand soliste, parvient parfaitement à s'adapter
au grand orchestre. Marian Badoï (accord) apporte sa sensibilité de l’Europe
orientale tandis que James Carter qui a déjà exploré la musique du
guitariste manouche, est nettement plus disert. Pour le final, avec
l'orchestre et les quatre solistes invités, «Nuages» est naturellement
convoqué.

Jeudi
8 juillet. Poursuivant ses recherches électriques, Brad Mehldau
retrouve Mark Guiliana (dm) avec lequel il a déjà beaucoup exploré le
duo. Et il a invité John Scofield (g) qui met beaucoup de blues dans son
jazz. Brad Mehldau refuse toute photo et, utilisant piano acoustique,
Fender Rhodes et synthétiseurs vintage, au son parfois pas très net,
n'est pas toujours en accord avec les autres instruments. Autant le trio
fonctionne bien sur la musique électrique avec Mark Guiliana, autant le
piano acoustique s'accorde très mal à ce même jeu de batterie. Les
mélodies de Brad Mehldau ont du mal à résister au travail rythmique de
Mark Guiliana, fait de profondes ruptures. John Scofield joue à la fois
de la basse et de la guitare et sa musique est toujours teintée de blues
et de retours au jazz des année 1970. Un projet hybride.

Rien de tel chez John McLaughlin dont le groupe, The 4th Dimension, existe depuis plusieurs années avec une remarquable
stabilité (Emile Mbappe, b, Gary Husband, clav). Seul Ranjit Barot (dm)
est indien. La musique reste indienne. Le jeu de guitare de McLaughlin
est fait à la fois de longues phrases et de bouffées où croît
l'intensité et le rythme du morceau. Quel que soit le groupe qui
l'accompagne, le jeu virtuose de John Mclaughlin est personnel, lyrique.
Les autres musiciens s'intègrent bien au projet et tous participent à
l'univers rythmique et mélodique d'un concert varié mais toujours d'une
belle unité.
A noter, pour finir sur une note ludique, un blindfold test proposé par le biographe Ashley Khan à James Carter avec pour thème, bien sûr, le saxophone…
Guy Reynard
texte et photos
© Jazz Hot n° 677, automne 2016
|
Ascona, Suisse
JazzAscona, 23 juin-2 juillet 2016
Ascona
est la capitale européenne des musiques de la Nouvelle-Orléans, et,
donc, on y a entendu en provenance de la Cité du Croissant, des artistes
en exclusivité comme Glen David Andrews, Aurora Nealand (ss, cl, voc,
Tom McDermott, p, Bechet revu), Jazz Vipers, Tremé Brass Band (Shamarr
Allen, tp, Terrence Tarpin, tb, Benny Jones, b dm), Palm Court All
Stars, Davell Crawford Trio (Herlin Riley), John Michael Bradford, Leon
Brown, les Boutté. Ces artistes absents de nos programmations
constituent la raison principale pour laquelle un jazzfan français
choisit de venir à Ascona. Il n'y avait pas de changement significatif
dans l'organisation.
 
Le premier jour, Glen Davis Andrews (tb-voc, showman) s'est produit avec un percutant trio soul-funk (org, g, dm). La découverte fut Jazz Vipers, à l'instrumentation inhabituelle, qui
swinguent les standards. La rythmique tourne avec Joshua Gouzy (b) et
Molly Reeves (g -genre Danny Barker). La front-line est excellente,
Kevin Louis (cnt), Craig Klein (tb), les Bonie, Earl (cl, ts) et Oliver
(bs): «Dinah» (Craig Klein, tb-voc), «I want a Little Girl» (Kevin
Louis, voc), «Shake It & Break It» (belles nuances).

Le
25, leur invité John Michael Bradford (tp, voc) a confirmé son
potentiel (en trio avec la rythmique: «Stardust»). L’Ascona Jazz Award
2016 a été décerné décerné à Davell Crawford qui nous donna un copieux
récital avec Barry Stephenson et l'incroyable, Herlin Riley (des
évocations de Ray Charles et surtout de Fats Domino –«It Ain't a Shame«, «I'm Walking«, «Blueberry Hill»–, un bon «St. James Infirmary»).

L'événement
du festival fut la Piano Night du 26 (2 pianos et 6 pianistes) au
Teatro del Gatto, conçue par Davell Crawford qui l'a présenté, et, en
solo, l'a ouverte (bel «Amazing Grace») et achevée («Do You Know What It
Means»). Nul mieux que lui, Tom McDermott et Paul Longstreth pouvaient
évoquer la lignée louisianaise du clavier (Fats Domino, James Booker,
Henry Butler, Dr. John). En valeur ajoutée, Herlin Riley, mais aussi
Barry Stephenson (pour David Paquette: solo à l'archet dans «New
Orleans» et en slap dans «Shake It & Break It»). Notons un «Maple
Leaf Rag» par McDermott tel que ne l'a pas pensé Scott Joplin, un bon
duo Paquette-Crawford sur «St Louis Blues», un «St. James Infirmary» par Silvan Zingg et un final sur «My Mojo Working» par les six pianistes (Christian
Willisohn, aussi)!
Autour de Lillian Boutté, Thomas L'Etienne
a réuni un All Star (Uli Wunner, as-cl, Fessor Lindgren, tb, Shannon
Powell, dm) dans un répertoire varié ouvert aux invités (belle soirée
Armstrong avec John Michael Bradford, Leon Brown, Shamarr Allen, tp,
28/06). Lars Edegran a réuni au sein des Palm Court All Stars des
vétérans que l'on a plaisir à retrouver, Gregg Stafford (tp, voc:
«Second Line»), Sammy Rimington (cl: «I Grow too Old to Dream»; as,
«Little Tenderness», avec Topsy Chapman, voc), bien soutenus par Richard
Moten (b: «Sweet Georgia Brown») et Jason Marsalis, parfait dans le
jazz tradtionnel («Avalon»).
Nous avons donc eu plusieurs
générations de trompettistes dont Gregg Stafford, qui fait désormais
figure de flambeau de la tradition (le 01/07, son «Moonlight Bay» vient
directement de Kid Thomas). Shamarr Allen a un style compatible avec le
traditionnel («Bogalusa Strut» avec Jazz Vipers, 30/06), mais sa vraie
nature est post bop, et c'est aussi le cas pour John Michael Bradford
(qui était à l'aise dans le funk de Glen David Andrews, 30/06). Tous
deux dotés d'une excellente technique, jouent fortissimo, sans nuances,
contrairement à Leon «Kid Chocolate» Brown qui soigne la sonorité («La
Vie en Rose», 01/07), et Kevin Louis, au phrasé souple, capable
d'envolées spectaculaires sans sacrifier la qualité du son et les
diverses dynamiques.

Il
n'y a pas que les Néo-Orléanais; le programme est complété par des
artistes européens. Des jazzfans suisses m'ont témoigné leur
enthousiasme pour le groupe Jazz à Bichon (avec remplaçants) qui fit le
plein à Piazzetta (26/06). La Section Rythmique (Guillaume Nouaux, dm,
Sébastien Girardot, b, David Blenkhorn, g) fait l'unanimité (avec Hetty
Kate, voc). Notons l'exploit de Pierre Guicquéro (tb) remplaçant au pied
levé dans les Primatics (vif succès). Pour les Français, les jazzmen
actifs en Italie sont à découvrir. L'Italo-américain, Michael Supnick
(tp, tb, voc) a démonstré au Pontile (26/06) tout ce qu'il doit à Louis
Armstrong: «Confessin'», «I Can Give You Anything But Love», etc. Le
vétéran Emilio Soana (tp) au sein du SMUM Big Band fit bonne figure avec
John Michael Bradford en guest (26/06). On a retrouvé Red Pellini (ts)
avec le Gotha Swing. Enfin, le talent d'Alfredo Ferrario (cl) et du
styliste, percutant et élégant à la fois, Fabrizio Cattaneo (tp) fut un
atout pour Anaïs St. John, fille de Marion Brown qui, plus qu'une
chanteuse, est une interprète («Is You Is», «Gee Baby», etc.).
Ceux qui souhaitent découvrir les artistes dont il est ici question doivent aller à Ascona!
Michel Laplace
texte et photos
© Jazz Hot n° 677, automne 2016
|

Bruxelles, Belgique
Brussels Jazz Marathon, 22 mai 2016
Alors
que le marathon se déroule le vendredi et le samedi dans les clubs, les
bistrots et sur les places de la capitale, le dimanche, la Grand-Place
est réservée aux Lundis d’Hortense pour la promotion de quatre des
meilleurs groupes belges du moment. C'est sur le dimanche que nous nous sommes focalisés.
Les frères Dellanoye et leur
Delvita Group ouvraient dès 15h.15. Nous avons écouté avec attention et
admiration le quartet de Jan De Haas. On voit souvent Jan derrière une
batterie, mais on oublie parfois qu’il est un excellent vibraphoniste
(trois albums à son nom). C’est d’ailleurs accompagné par les musiciens
de son dernier album (W.E.R.F. 123) qu’il avait choisi de se produire
–Ivan Paduart (p), Sal La Rocca (b), Mimi Verderame (dm). Le répertoire
est principalement construit autour des compositions du vibraphoniste
qu’on rapproche facilement de Sadi pour les valses. Moins excessif que
l’Andennais sur les tempos rapides, il a le bon goût de doubler ses
solos sur des toms placés en avant-scène. La cohésion du quartet est
excellente. Les sidemen ont apporté quelques-unes de leurs compositions
mais ils restent au service d’une jolie musique, collective, de facture
classique.

Vint
ensuite, le groupe de Lorenzo Di Maio (g): Cédric Raymond (b), Nicola
Andrioli (p), Antoine Pierre (dm) et Jean-Paul Estiévenart (tp). Cédric
est l’ainé ; les autres ont moins de trente ans et ça se ressent dans la
manière dont ils jouent (très bien): plus appuyée, avec des prises de
risques, des question/réponses et des structures qui soulignent la
complémentarité des solistes («Detachment», «No Other Way», «September
Song»). «Santo Spirito» joué en finale mit en lumière l’approche
surréaliste à la belge du pianiste transalpin. La musique est gaie!
Elle
le sera plus encore avec le dernier groupe : celui du batteur Yves
Peeters: Dree Peremans (tb), Nicolas Kummert (ts), Axel Gilain (eb),
Bruce James (p, voc) et François Vaiana (voc). Reflet de leur album Gumbo publié
chez WERF, le band propose un patchwork d’originaux («Lighthouse» de
Kummert), des lyriques écrits par François Vaiana, des backings
ténor/trombone et un feeling très Bourbon Street impulsé par Bruce James (p, voc).
Sur
le chemin du retour, nos pas nous ont heureusement entraînés à la porte
de L’Archiduc. Le mythique club art déco servait de cadre au duo Johan
Dupont (p)–Steve Houben (as). Dos à la porte, assoiffés, incapables de
nous faufiler au comptoir, nous nous sommes délectés du swing intense à la Fats Waller de Johan Dupont et des réparties élégantes de Steve Houben. Renaud
Crols (vln) se faufila en douce et tout swing dans ce concert-coda d’un
soir jouitif («Lament», «La Javanaise», etc.).
Jean-Marie Hacquier
Photos Pierre Hembise
© Jazz Hot n° 676, été 2016
|
Saint-Gaudens, Haute-Garonne
Jazz en Comminges, 4 au 8 mai 2016
Le
week-end de l'Ascension est depuis 14 ans la période choisie par les
fondateurs de Jazz en Comminges pour héberger leur festival, aujourd'hui
sur 5 journées pour le Off gratuit et 4 soirées pour le festival
officiel, avec toujours deux concerts chaque soir. Si l'on ajoute les
orchestres présents dans plusieurs bars et restaurants, le cinéma local
qui présente des films de jazz, les expositions, on peut dire que pendant
ces cinq journées, la ville entière vit au rythme du jazz.
Cette année
l'Ascension étant très précoce, les Pyrénées, toutes proches, étaient
encore largement recouvertes de neige. Le programme, comme à l'habitude,
est centré sur le jazz actuel sans exclusive de style, d'une belle
cohérence malgré quelques assemblages parfois curieux. Le cru 2016 ne
dérogeait pas, et la musique toujours extrêmement intéressante
avec une acoustique parfaite, dans un lieu qui n'est pas fait a priori
pour la musique mais parfaitement aménagé, et des techniciens du son et
de la lumière parfaitement efficace,.

La
première soirée est à guichets fermés. Le public très nombreux est
certainement venu, plus attiré par l'accordéon de Richard Galliano et le
violon de Didier Lockwood que par David Sanborn qui surfe depuis
plusieurs décennies sur les différentes modes. Il ne faut certes par
oublier Philip Catherine qui complète le trio. Quelques dizaines
d'années auparavant, ainsi que le rappelle Didier Lockwood, un premier
trio avait déjà existé avec Christian Escoudé, remplacé aujourd'hui pour
Richard Galliano. Chacun des musicien reste dans son propre univers et
prend des chorus parfaitement en place, mais au bout de quelques thèmes
le son du trio n'apparaît toujours pas: il reste une juxtaposition de
brillants solistes, et personne n'a la volonté de prendre la direction
de l'ensemble, sauf sur ses propres compositions. Les trois musiciens
proposent certes de belles musiques, mais on attend toujours ce jeu
collectif qui est la base du jazz, aussi brillantes que soient les
interventions personnelles.
David Sanborn a toujours voulu se
couler dans la mode de son temps. Ainsi dans les années 70 et 80, il
privilégiait le son de son saxo alto et donnait à sa musique une
direction très proche d'une sorte de smooth jazz, peu dérangeant, qui
flirtait avec la fusion, mais sans jamais dépasser les limites d'une
musique médiane loin des outrances du free et même du bebop et hard bop,
trop loin de la musique susceptible de toucher le grand public. Il
effectue aujourd'hui un virage complet, introduisant une partie plus
funk à son orchestre, et parfois même quelques ouvertures vers le free
dont on ne voit pas trop l'utilité. Heureusement l'organiste Ricky
Peterson replace cette musique dans une voie plus proche du jazz et la
batterie de Billy Kilson demeure dans cette même veine et pallie
largement l'absence du percussionniste annoncé. André Berry à la basse
donne la direction funk à la musique tandis que le guitariste Nicky
Moroch reste assez discret. Mais en cherchant trop à rester au goût du
jour, il n'est pas certain que David Sanborn y retrouve vraiment une
sonorité personnelle et son public.
La deuxième soirée du
festival est très différente car les deux orchestres présentés sont
certes très différents, mais il s'agit cette fois de véritables groupes.
Le trio du pianiste Rémi Panossian, présenté en partenariat avec le
Conseil Général de Haute Garonne, est une découverte de Jazz sur son 31,
le festival automnal de Toulouse. Les trois musiciens forment un trio
très soudé, et Maxime Delporte à la basse et Frédéric Petiprez à la
batterie, apportent plus qu'un soutien au pianiste, et sont partie
prenante à l'élaboration de la musique. Celle-ci joue plus sur les
couleurs et les textures que sur le swing et le groove, mais chaque
pièce est parfaitement mise en place. De belles improvisations sont
suscitées par les parties d'ensemble et une belle dose d'humour vient
pondérer une musique parfois très sérieuse avec des compositions comme
«Brian le Raton Laveur» ou «Into the Wine». Même si le rock n'est jamais
très loin, la sonorité d'ensemble demeure très européenne avec des
références à l'harmonie de la musique classique.

Deux
ans auparavant, Chucho Valdés était déjà présent sur cette même scène,
mais en petite formation où dominaient les percussions. Cette fois-ci,
avec un mini Irakere, il réalise un parfait équilibre entre section
rythmique et souffleurs. Ces derniers sont présentés en une ligne qui
fait face aux percussionnistes et au pianiste. La musique prend tout de
suite une grande ampleur avec les percussions et le piano qui créent la
mélodie tandis que les trois trompettes et les deux saxos apportent les
riffs de la musique cubaines qui soulignent les percussions. Cela ne les
empêche d'ailleurs pas de prendre tour à tour quelques solos décidés
par le pianiste. Dreiser Durruthy Bombalé percussionniste, chanteur et
danseur, fait office de maître de cérémonie et paraît diriger l'office
païen dédié aux divinités importées d'Afrique et largement transformées
au contact du christianisme. Cependant Chucho Valdés garde constamment
la direction des opérations et relance régulièrement les solos ou les
ensembles. Même lorsqu'il dirige avec beaucoup d'humour un «Take Five» à
la mode cubaine, il demeure d'une grande impassibilité sans jamais se
permettre le moindre sourire. On pense naturellement à Irakere et à la
réussite de cet Orchestre National de Jazz de Cuba où, tout en demeurant
toujours fidèle à la musique cubaine et au jazz, Chucho a réussi et
réussit toujours à créer une musique enthousiasmante de très haut
niveau.

La
troisième soirée présentait un plateau où la Nouvelle-Orléans et la
trompette étaient les vedettes de la soirée. Certes la star annoncée
était Dee Dee Bridgewater. Le dernier disque l'avait présentée beaucoup
plus sobre avec le trompettiste Irvin Mayfield dirigeant le New Orleans
Jazz Orchestra. C'est une formation réduite qui l'accompagne à
Saint-Gaudens où demeurent malgré tout Irvin Mayfield, Victor Atkins (p)
et Adonis Rose (dm). Le saxophoniste Irwin Hall vient de New York et le
bassiste annoncé n'est pas non plus celui du disque. D'emblée, Dee Dee
Bridgewater se place dans le spectacle, présentant longuement chacun de
ses musiciens avant même qu'une note n'ait été jouée. Lorsqu'enfin la
musique commence, elle s'attache à mettre le spectacle en valeur. Le
chant très émouvant du disque est un peu éclipsé par le show. Irvin
Mayfield et l'orchestre, auxquels la chanteuse laisse avec bonheur une
large place, restent d'une belle sobriété qui contraste avec le goût du
spectacle de la chanteuse. Mais ceci n'enlève rien au concert qui reste
toujours intéressant grâce à la maîtrise d’Irvin Mayfield et à la
capacité de Dee Dee Bridgewater de captiver le spectateur et de susciter
l'émotion.

Dee
Dee Bridgewater et Irvin Mayfield avaient été précédés par Christian
Scott qui a abandonné, provisoirement nous l'espérons, son excellent
septet. Seuls restent dans sa formation le batteur Corey Fonville et le
bassiste Kris Funn. Logan Richardson est le saxophoniste et Tony Tixier
le pianiste. Christian Scott nous apprendra d'ailleurs que Tony Tixier a
rejoint l'orchestre une semaine auparavant. Le trompettiste a dessiné
les quatre trompettes qui ont été réalisées pour lui, et il en utilise
deux dans les concerts. Même si la longueur totale du tube demeure la
même, les différences de courbures modifient profondément le son, et
l'on a vu Irvin Mayfield essayer l'une des deux trompettes utilisées. Il
définit sa musique comme de la «stretch music» terme qui peut prendre
plusieurs sens en anglais mais qui signifie à la fois se tendre et se
détendre, s'étendre, s'étirer. Malgré les changements de personnel, ce
concept permet au son de chaque musicien de s'intégrer dans celui
l'orchestre. Ainsi Tony Tixier est dans une veine où dominent le swing
et le groove alors que Logan Richardson est plus porté vers une
esthétique free. Christian Scott propose un discours très lyrique, porté
par ses diverses expériences et les musiques actuelles qu'il intègre à
son discours. Il utilise les compositions personnelles de son dernier
disque West of the West, The Last Chieftain ainsi que Eye of the Hurricane de Herbie Hancock. Avec son jeu sans vibrato, il atteint assez vite
l'émotion qui lui permet ensuite d'aller au delà de ce qui a été fait
tout en restant ancré dans la tradition. Peut-être est-ce cela tout
simplement la stretch music.

La
dernière soirée est beaucoup plus éclectique. Joe Lovano présente
modestement son Classic Quartet avec Laurence Fields au piano, le
bassiste bulgare Peter Slavov et le batteur d'origine kosovar Lami
Estrefi. Le quartet est parfaitement défini par le terme classique qui
est non pas un retour vers le passé mais bien plutôt une adaptation
actuelle des styles du passé. Joe Lovano excelle à se couler dans les
styles qui ont marqué sa famille au travers de son père lui aussi
excellent saxophoniste, de ses années de formation et des grands anciens
de l'instrument. Même si sa sonorité n'est pas reconnaissable dès la
première note, il possède un style bien à lui avec beaucoup d'énergie.
Le quintet fonctionne parfaitement bien avec de belles interactions
entre les quatre musiciens, et les hommages à Wayne Shorter et Michel
Petrucciani sont de parfaites réussites car ils ne se contentent pas de
reproduire les originaux, mais Joe Lovano sait se les approprier pour
rendre l'hommage plus personnel et donc plus émouvant encore.
Changement
complet de décor avec Al Di Meola et son trio qu'il intitule «Elysium
& More». Longtemps adepte de la guitare électrique et des formations
de fusion après des débuts avec Chick Corea dans la deuxième mouture de
Return to Forever. Lassé des décibels, il a désormais décidé de
se consacrer à la musique acoustique à la tête de formations plus ou
moins étoffées. Pour Jazz en Comminges, il a choisi de venir en petite
formation avec Peo Alfonsi (g) et Peter Koszas (dm). Mais la musique
n'est pas très différente de celle des formations plus étoffées par
l'utilisation d'effets électroniques qui permettent de doubler les sons
produits. Le batteur est confiné derrière une sorte de barrière en
plexiglas et apparaît vraiment isolé des deux guitaristes. La musique
est présentée en longues suites plus proches de la world music que du
jazz. Al Di Meola, avec de belles envolées lyriques, abandonne
réellement le rôle de «guitar hero» qu'il tenait dans les formations
électriques: il joue assis avec des partitions vers lesquelles il
penche la tête et recherche avant tout une sonorité personnelle aussi
bien sur ses propres compositions que sur une reprise comme le «Because»
des Beatles. Malgré tout, l'amateur de jazz reste un peu sur sa faim
avec une musique un peu trop au-delà, mais largement appréciée par le
grand public qui ne s'est pas fait prier pour rejoindre le devant de la
scène lorsque Al Di Meola le lui a demandé.
Jazz en Comminges a
connu un beau succès public avec quatre soirées bien remplies, et il a
fallu rajouter des chaises lors de deux soirées. Le programme se veut
éclectique et le programme demeure toujours alléchant. Le seul bémol
viendrait de trop de changement de personnels de dernière minute qui,
s'ils ne changent pas la qualité de la prestation, compliquent un peu le
travail du chroniqueur. Un affichage des line-ups serait sans nul doute
un moyen d'y remédier. La 14e édition de Jazz en
Comminges reste un grand cru avec plusieurs concerts de haute volée dans
une très agréable atmosphère de convivialité.
Guy Reynard
Texte et photos
© Jazz Hot n° 676, été 2016
|

St-Leu-la-Forêt, Val d'Oise
Arts & Swing, 2 avril 2016
Organisé
par l’association Graines de Swing depuis 7 ans, ce petit festival
permet aux musiciens de la région de se produire sur scène ainsi qu'à
d'autres artistes-artisans des environs –luthiers, peintres, sculpteurs,
photographes, etc.– de venir y exposer leurs œuvres. Cette année
Philippe Drillon, luthier, présente les différentes étapes de la
fabrication d’une guitare. Chaque année aussi un musicien de renom est
invité comme tête d’affiche pour le grand concert de soirée; cette
année, c’est Samson Schmitt…
Fond de Caisse, la
formation des organisateurs Christophe Quarez (g, voc), Yves Paris (g),
Michel Taché (g) et Michel Bartissol (b), fait l’ouverture du festival
dans un répertoire constitué de chansons françaises, de jazz de Django
et de bossa nova. Le quartet laisse la place à l’Ecole de musique de
St-Leu, sous la direction de Sylvain Guichard, qui aborde les standards
de jazz. La jeune Julie Fraisse (g) se distingue par son jeu fluide;
puis le duo Sophia (g, voc) et Déon (voc) enchaîne sur des arrangements
pop et hip hop, un ton surprenant pour ce festival. Retour au jazz avec
le trio Kdoublevé (p-b-dm) de Julien Krywyk (p), qui revisitent les
standards et avec le trio ZAF de Serge Zafalon, professeur de guitare à
Montmorency, qui nous ramène à la musique de Django et clôture cette
première partie.
L’ambiance cabaret voulue par les organisateurs
rassemble petit à petit les visiteurs le long du bar pendant que le
plateau se vide de ses instruments pour accueillir Amalgam, groupe de
jazz vocal de 30 artistes créé en 1983 sous la direction de Paul Anquez.
Passant de la comédie musicale au jazz et aux rythmes brésiliens, cette
chorale a capella présente des tableaux syncopés de toute beauté.
Intermède classique avec Olivier de Valette, 1er prix
du Conservatoire de Paris, qui interprète brillamment des musiques
Andalouses et des compositions de Georges Gershwin. Retour au jazz avec
le SG Trio de Sylvain Guichard (g), Gabriel (g) et Eric Métais (b) qui
s’inspire aussi des standards du jazz et Monalisa Jazz Quintet, composé
de Marc Merli (p), Hugo Lagos (g), Sacha Leroy (b), Thierry Cassard
(dm), qui nous propose un jazz électrique en prélude à l’invité du grand
concert, Samson Schmitt.

Clôture
du festival avec Samson Schmitt (g), l’enfant de Forbach. Il a donné
son premier concert à 12 ans, et il est considéré avec son quartet, avec
qui il a déjà enregistré deux albums (Djieske en 2002 et Alicia en 2007), comme l’un des meilleurs groupes français de jazz de la
tradition de Django Reinhardt. Il joue ce soir en trio avec Pascal
Bordeau (g) et Claudius Dupont (b), et ils reprennent essentiellement
des morceaux de l’album Vocal et Swing, produit à partir des
compositions de Pascal Bordeau sur des arrangements de Samson Schmitt:
«La Tête qu’on fait», «La Crise», «Carole», etc. Ces morceaux permettent
à Samson Schmitt d’étaler la beauté de son jeu, sa personnalité et sa
virtuosité, et la mise en avant de ses musiciens, l’humour et le partage
sur scène témoignent du bon esprit du groupe. Le public apprécie, en
redemande, debout au dernier rappel.
Ce petit festival d'un jour,
autour de la musique de Django et des arts qui s'y rattachent, mérite
un détour. Rendez-vous pour la prochaine édition!
Patrick Martineau
texte et photos
© Jazz Hot n° 675, printemps 2016
|

Bergame, Italie
Bergamo Jazz, 17-20 mars 2016
Après la gestion de quatre ans d’Enrico Rava, Dave Douglas a repris la direction artistique de la 38e édition de Bergamo Jazz, lui imprimant un tour peut-être moins
innovant, mais en maintenant la haute qualité et la variété des
propositions.
La richesse de l’affiche a été comme toujours
complétée par des événements collatéraux, comprenant des concerts de
musiciens locaux, des présentations de livres et des rencontres, comme
celles peaufinées par le Centro Didattico Produzione Musica avec des élèves de écoles primaires et secondaires, ou bien le débat entre Dave Douglas et Franco d’Andrea.
Comme
de coutume les concerts se sont déroulés entre le Teatro Donizetti, le
Teatro Sociale, l’Auditorium della Libertà et la galleria d’arte Gamec.
Le public, nombreux et attentif, s’est pratiquement trouvé face à une
ample gamme de thèmes, avec avant tout, l’approche de la tradition,
conjuguée en modes divers.

Le
trio D’Andrea, intégrant Han Bennink, constitue pour le pianiste une
clé efficace pour greffer les polyphonies du jazz new orleans (pratiqué
pendant sa jeunesse) sur une organisation polyrythmique dans laquelle
coexistent des références à Waller, Ellington, Tristano et Monk, et des
empiètements dans le domaine atonal. Puis affleure une matrice
africaine, comme le démontrent les figures sombres dans le registre
grave qui déconstruisent «Caravan», et émerge la dialectique constante
avec Han Bennink, héritière entre autres de Baby Dodds, le tout inclus
dans le solo à la caisse claire et sur toutes les surfaces
environnantes. Daniele D’Agaro (cl) et Mauro Ottolini (tb) représentent
le versant polyphonique d’une ample gamme de timbres et d’expressions,
interprètes modernes d’un parcours qui d’une part unit Johnny Dodds,
Barney Bigard et Pee Wee Russell à Jimmy Giuffre et Anthony Braxton, et
d’autre part à Kid Ory, Tricky Sam Nanton et Jack Teagarden à Roswell
Rudd et Ray Anderson.

Dans
une période dans laquelle certains musiciens afro-américains (Nicholas
Payton en tête) réfutent le terme jazz en faveur de l’acronyme BAM
(Black American Music), Geri Allen, dans un solo de piano dédié à
Detroit et Motown, a démontré comment on peut exécuter de la grande
musique en se contrefichant des étiquettes. Sans écarts stylistiques,
Miss Allen a fait preuve de profondeur harmonique, d’un choix de phrasé,
d’un méticuleux travail rythmique (avec un usage efficace du registre
grave) et d’une pensée mélodique limpide et pure, même dans la relecture
des classiques Motown comme «That Girl» de Stevie Wonder, «The Tears of
a Clown», écrit par le même Wonder pour Smokey Robinson, «Save the
Children» de Marvin Gaye et «Wanna Be Startin’ Something» de Michael
Jackson.

Avec
son nouveau quartet –Lawrence Fields (p), Peter Slavov (b), Lamy
Estrefi (dm)– Joe Lovano présente une poétique désormais consolidée:
implantation modale de matrice coltranienne, thèmes élégants et bien
agencés, successions de solos torrentiels dans lesquels se détache le
langage sec de Fields, digne de Red Garland et soutenu par une pompe
rythmique, mémoire de McCoy Tyner. Mainstream moderne? Classicisme? Le
débat est ouvert.
Kenny
Barron a offert une authentique leçon de style et de mesure. En trio
avec Kiyoshi Kitagawa (b) et Johnathan Blake (dm), le pianiste de
Philadelphie a concentré en une synthèse efficace l’héritage du bebop (à
travers le morceau éponyme de Dizzy Gillespie), les tensions
rythmiques-harmoniques du hard bop, la leçon de Garland et Monk, son
association passée avec Charlie Haden («Nightfall»). Blake se révèle un
partenaire idéal, en vertu d’un drumming éclectique et riche d’analyses.

Dans
le quartet Wicked Knee, le batteur Billy Martin a rassemblé trois
cuivres, le tuba de Michel Godard, fondement de l’incessante pulsation
rythmique et protagoniste de quelques solos estimables; le trombone de
Brian Drye, riche d’inflexions qui parcourent l’histoire de
l’instrument; la trompette (également slide) de Steven Bernstein, en
parfaite opposition aux stimuli rythmiques dictés par le leader qui part
de la tradition des Marching Bands pour poursuivre à travers des
figures rythmiques enrichissant le tissu avec les couleurs de multiples
percussions. Avec cette position, semblable au Pocket Brass Band de Ray
Anderson et au Brass Ecstasy de Dave Douglas, le quartet embrasse la
polyphonie de New Orleans, le premier Ellington («It Don’t Mean a
Thing») jusqu’au «Peace» d’Ornette Coleman.
Balkan
Bop est la dénomination forgée par le pianiste albanais Markelian
Kapedani pour son trio multi-ethnique, complété par l’Israélien Asaf
Sirkis (dm), et le Russe Yuri Goloubev (b), doté d’un son somptueux et
d’une belle inventivité mélodique. Par moments, d’évidents rappels à la
tradition balkanique émergent par l’adoption de mesures impaires comme
le 7/4 et le 9/8, et par les échos populaires de certaines mélodies.
Tout est filtré à travers une esthétique mainstream et le fréquent
recours aux rythmes latins. Dans le jeu de piano de Kapedani, on
retrouve des traces de Red Garland, Bobby Timmons, Cedar Walton et
Herbie Hancock.

La
poétique de la clarinettiste israélienne Anat Cohen est bien plus
impressionnante tant elle possède une gamme de timbres et un spectre
dynamique vraiment impressionnants, ainsi qu’un accent qui unit une
infrastructure classique, des nuances jazzistiques, des inflexions et
des modulations hébraïques évoquant les grands solistes traditionnels
comme Naftule Brandwein et Dave Tarras, ou d’extraction classique comme
Giora Feidman et David Krakauer. Son apport majeur consiste dans la
combinaison d’un arrière plan hébraïque avec des mélodies et des formes
brésiliennes, avec comme exemples frappants «Lilia» de Milton Nascimento
de veine mélancolique, ou les chôros «Espinha de bacalhau» de Severino
Araújo et «Um a zero» de Pixinguinha. Objectif atteint aussi grâce à
l’apport infatigable de Daniel Freedman (dm), aux lignes pulsantes de
Tal Mashiach (b) et aux incursions téméraires de Gadi Lehavy (p).
De
nombreux éléments du patrimoine latino-américain, largement présents
dans le Melting Pot de New York, sont traduits dans un contexte actuel
par le groupe Catharsis du tromboniste Ryan Keberle, avec des références
évidentes à Cuba, au Brésil et à la Colombie. Instrumentiste formidable
et fin compositeur, Keberle intrique des lignes contrapuntiques et
produit de denses amalgames avec Mike Rodriguez (tp). Jorge Roeder (b)
et Eric Doob (dm), qui réunissent le dynamisme, la cohésion et
d’intéressantes trouvailles mélodiques. La voix de Camila Meza, parfois
insérée dans les lignes des soufflants, possède un timbre éthéré et une
tessiture limitée, mais en fait elle fonctionne bien dans le contexte.
Aujourd’hui
il est rare qu’un concert de jazz attire de nombreux jeunes. La thèse a
été démentie par le Jazz Quartet de Mark Giuliana, en vertu de sa
participation au Blackstar de David Bowie. L’écriture du batteur prévoit
des thèmes mélodieux construits sur des structures harmoniques
ingénieuses, avec des développements mélodiques de bon goût et
d’extraction populaire, secondées par une poétique chère à Bad Plus et
Bill Frisell. Tandis que l’apport du groupe –Jason Rigby (ts), Fabian
Almazan (p), Chris Morrissey (b)– est purement fonctionnel dans le
collectif. Giuliana met en évidence une certaine originalité de langage
par l’utilisation coloriste de la batterie, avec des contretemps sur la
caisse claire, la grosse caisse et la charleston, et la scansion
simultanée des quatre temps sur la ride et la crash.
Bergamo
Jazz a accordé un peu de place à la recherche. Les deux Tino
Tracanna-Massimiliano Milesi (ts) ont conduit une analyse sur le rapport
entre le son, l’espace et le temps au moyen d’une ample gamme de
thèmes: échos de la Renaissance, anaphores minimalistes, contrepoints à
la Bach, constructions rythmiques, éclats d’improvisation totale et une
version de «The Train and the River» de Jimmy Giuffre.

Le
quintet scandinave Atomic recueille idéalement l’hérédité du Free
historique et de l’improvisation radicale européenne des années 70, et
il la projette dans une synthèse fraîche et incisive. Dans le cadre
d’une même exécution s’alternent de puissants collectifs, des thèmes
dépouillés, des progressions sur up tempo swinguants, de
fréquents changements métriques, des phases atonales, des structures
asymétriques qui rappellent la conception harmolodique d’Ornette
Coleman. Sous la mise en scène de Håvard Wiik (p), tête du groupe, se
mêlent les entrées en scène foudroyantes de Magnus Broo (tp) et Fredrik
Ljungkvist (ts, cl), alimentées par la masse sonore produite par
Ingebrigt Håker Flaten (b) et enrichie par les inventions coloristes de
Hans Hulbækmo (dm).

On
rencontre de très solides racines historiques et identitaires dans le 5
Blokes de Louis Moholo-Moholo, avec lesquelles le batteur sud-africain
ravive l’esprit, et en partie, le répertoire des blue notes. Composé de
musiciens anglais, le quintet traduit dans une forme vive et crédible le
legs des regrettés Mongesi Feza, Dudu Pukwana, Johnny Dyani et Chris
McGregor. Ainsi se rétablit, idéalement mais pas filologiquement, la
connexion entre la scène free anglaise et les expatriés sud-africains.
Shabaka
Hutchings (ts, bcl) et Jason Yarde (as, ss, bs) entreprennent de
torrides digressions, souvent entrecroisées. Alexander Hawkins (p) fait
souvent fonction de raccord entre les différentes phases des longues
exécutions avec sa frappe lancinante. John Edwards (b) possède un phrasé
violent qui produit une onde de choc sur laquelle se greffe le drumming
hétérodoxe du leader: une série exténuante de roulements, de
contretemps, quasiment un solo sans fin. L’homogénéité du collectif se
détache et prévaut dans une sorte d’imaginaire de rencontre entre des
hymnes sud-africains et Albert Ayler.
Comme dit précédemment, le
festival a mis en évidence la tendance des artistes américains à avoir
des réflexions sur leurs propres traditions, mettant en évidence
l’effort des musiciens d’une autre provenance pour greffer sur le
langage jazzistique des éléments de leur culture propre. Connaissant
l’ouverture d’esprit et la variété des intérêts de Dave Douglas, il est
licite de s’attendre à des nouveautés substantielles et des choix plus
courageux pour les prochaines éditions.
Enzo Boddi
Traduction: Serge Baudot
Photos Gianfranco Rota by courtesy of Bergamo Jazz
© Jazz Hot n° 675, Printemps 2016
|
|

